15 mars 2023
Base Documentaire : Doctrine
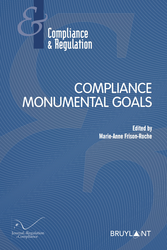
► Référence complète : A. Le Goff, "Monumental Goals Perceived by the Firm: Serene Business or Business under Pressure?", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, coll. "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p. 83-90.
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Monumental Goals, dans lequel cet article est publié.
____
► Résumé de l'article :
________
Mise à jour : 15 mars 2023 (Rédaction initiale : 14 octobre 2021 )
Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Definition of Proportionality and Definition of Compliance Law", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, série "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p.
___
► Résumé de l'article : The use of Proportionality always limiting powers is only justified when it is about sanctions, but sanctions are only one tool among others in Compliance Law, intended moreover to have little place in this Ex-Ante branch of Law. And returning to the very nature of Compliance Law, which relies on operators, private or public, because they are powerful, then using proportionality to limite powers is detrimental to Compliance Law.
However, nothing requires that. Compliance Law is not an exception that should be limited. On the contrary, it is a branch of Law which carries the greatest principles, aimed at protecting human beings and whose Normativity lies in its "Monumental Goals": detecting and preventing future major systemic crisis (financial, health and climate ones).
However, literally the principle of Proportionality is: "no more powers than necessary, as many powers as necessary".
The second part of the sentence is independent of the first: this must be used.
Politics having fixed these Monumental Goals, the entity, in particular the company, must have, even tacitly, "all the necessary powers" to achieve them. For example, the power of vigilance, the power of audit, the power over third parties. Because they are necessary to fulfill the obligations that these "crucial operators" must perform as they are "in a position" to do so.
So instead of limiting the powers, the Principe of Proportionality comes to support the powers, to legitimize them and to increase them, so that we have a chance that our future is not catastrophic, perhaps better.
In this respect, Compliance Law, in its rich Definition, will itself have enriched the Principle of Proportionality.
____
____
📘Lire une présentation générale du livre, Compliance Monumental Goals, dans lequel l'article est publié.
____
► lire la présentation des autres contributions de Marie-Anne Frison-Roche dans ce livre :
📝Compliance Monumental Goals, beating heart of Compliance Law,
📝 Role and Place of Companies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis,
________
15 mars 2023
Base Documentaire : Doctrine
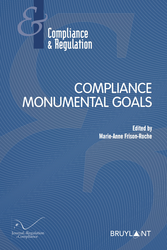
► Référence complète : J.-Ch. Roda, "Compliance, Internal Investigations and International Competitiveness: What are Risks for the French Companies (in the Light of Antitrust Law)?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Monumental Goals, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2023, pp. 355-368
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Monumental Goals, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article: The author draws on American and European Competition Law to measure whether internal investigations, as far as they provide factual elements, can provide foreign authorities and competitors, here American, with "sensitive information" (notably via leniency programs), and as such constitute a competitive handicap. But this turns out to be quite difficult, whereas compliance audits, for example under the legal duty of vigilance, can provide American litigants with useful information, drawn from internal documents, in particular the reports of compliance officers, which can be captured by procedures of discovery.
French Law remains weak in the face of these dangers, due to its refusal to recognise the legal privilege mechanism concerning these internal documents, contrary to American Law and the consequent effectiveness of discovery in international procedures, concerning internal documents, in particular resulting from internal investigations. Solutions have been proposed, the activation of a new conception of blocking statutes being complex, the prospect of adopting a legal privilege being more effective, but there would remain the hypothesis of an international conflict of privilege, American Law having a strict design of legal advice justifying it and judges checking that powerful companies do not use it artificially.
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
15 mars 2023
Conférences

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Pourquoi le Droit de la Compliance", in Roman Aydogdu et Hans De Wulf (dir.), Inauguration de la Chair Business Compliance, Faculté de Droit de Gent, Faculté de Droit de Liège, Fédération des Entreprises de Belgique (FEB); Bruxelles, 15 mars 2023.
___
►Présentation de la conférence : dans le cadre du lancement de la Chair Business Compliance dirigée par Roman Aydogdu et Hans de Wulf, avant que ceux-ci n'en présentent les objectifs, j'ai pris comme thème général "Pourquoi la compliance", qui est tout autant une question (car cela semble si nouveau), une protestation (pourquoi les entreprises devraient faire le travail de l'État, cela ne devrait pas avoir lieu) et un accablement (comment faire pour donner à avoir que l'on respecte à tout instant, en tout lieu et en toute personne toutes les normes applicables, cela parait impossible).
C'est donc à ceux qui promeuvent et activent le Droit de la Compliance de l'expliquer, de le fonder et de dire Pourquoi il existe.
___
📈Consulter les slides ayant servi de support à l'intervention
________
15 mars 2023
Conférences
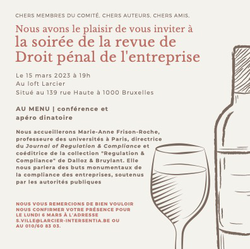
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les Buts Monumentaux de la Compliance soutenus par les autorités publiques", in Revue Droit pénal de l'entreprise, La soirée de la Revue de Droit pénal de l'entreprise, Bruxelles, 15 mars 2023.
________
15 mars 2023
Publications

♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
♾️s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, coll. "Compliance & Régulations ", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, 518 p.
____
► Le livre en quelques mots : Seize Compliance by its normativity: its Monumental Goals. The notion of "monumental goals" of Compliance was proposed in 2016 by Marie-Anne Frison-Roche !footnote-2828. It has become explicit in the texts and the resolution of cases, for example to fight against climate change, make human beings effectively equal, force to be extraterritorially vigilant about suppliers.
Compliance Monumental Goals are targeted ex ante by regulations, contracts, CSR, and international treaties. Creating an alliance between business and political authorities, aiming for a new form of sovereignty. The presence in litigation of these Monumental Goals of global dimension renews the responsibilities and the Judge office. Describing and conceiving these Monumental Goals makes it possible to anticipate Compliance Law, which is more powerful every day.
____
📕Parallèlement, un ouvrage en français, Les Buts Monumentaux de la Compliance, est publié dans la collection coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz.
🧮 Les deux ouvrages font suite à un cycle de colloques 2021 organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.
____
Ce volume s'insère dans la ligne de cette collection créée par Marie-Anne Frison-Roche pour développer le Droit de la Compliance :
📚 Lire les autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :
📘 Frison-Roche, M.-A. (dir.), Compliance Juridictionnalisation, 2022
📘 Frison-Roche, M.-A. (dir.), Compliance Tools, 2020
___
►Construction générale de l'ouvrage
The book opens with an Introduction, which proposes the Monumental Goals as definition of Compliance Law putting them at its "beating heart", giving this new branch of law its originality and specificity, explaining what, in the History of the United States and Europe, gave birth to this singular corpus and justifies a substantial definition of Compliance Law. The concept of Monumental Goals is explained, justifying both systemic and political nature of Compliance Law, the practical consequences of which legal specific rules are thus better identified and limited, since Compliance Law does not lead to all-obedience. We can then determine what we can expect from this Law of the Future that is Compliance Law.
From there, the book unfolds in 5 chapters.
A first chapter is devoted to the "radioscopy" of this notion, and branch of Law by branch of Law.
A second chapter aims to measure how the Monumental Goals are questioned by a crisis, for example in a health situation, but not in that example, if they aggravate it and must be discarded, or if, on the contrary, they are exactly conceived for this hypothesis. of crisis, risks, catastrophes and that it is advisable to exploit them, in particular in order, in this "test", to benefit from the alliance between the political authorities, public powers and crucial operators.
Once made explicit and tested, the Monumental Goals must find a sure way to be considered. This is why a third chapter aims to measure in principle and in practice how the Proportionality method can help the integration of Compliance, thus giving a new dimension to the Law without dragging it into insecurity and illegitimate grabbing of powers.
But because Compliance Monumental Goals express a very great ambition, the question of a bearable, even beneficial relationship with the international competitiveness of companies, standards and systems must be opened. This is the object of the fourth chapter.
Finally, because the Monumental Goals express by nature a new ambition of the Law in a world which must not give up in what could be the prospect of its abyss, the fifth chapter has for object the relationship between the Monumental Goals of Compliance and Sovereignty.
____
►INTRODUCTION
🕴️Frison-Roche, M.-A., 📝
🕴️Frison-Roche, M.-A., 📝Compliance Monumental Goals, beating heart of Compliance Law
CHAPTER I. THE VERY IDEA OF MONUMENTAL GOALS, THE BEATING HEART OF COMPLIANCE LAW
🕴️R.-O. Maistre, 📝What monumental goals for the Regulator in a rapidly changing audiovisual and digital landscape?
🕴️A.-V. Me Fur, 📝Interest and “raison d’être” of the company: how do they fit with the Compliance Monumental Goals?
🕴️M. Malaurie, M., 📝Monumental goals of Market Law. Reflection on the method
🕴️PC. Peicuti, C. et 🕴️J. Beyssade,📝The Feminization of Responsability positions in Companies as a Compliance Goal. Example of the banking sector
🕴️B. Petit, 📝The Arrangement of the Monumental Goals of Labor Law: a Moving and Often Paradoxical Whole
🕴️Vaquieri, J.-F., 📝The "Monumental Goals" perceived by the company. The example of Enedis
🕴️Ch. Huglo,📝Under what conditions could Climate Law constitute a priority Monumental Goal?
CHAPTER II. IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE MONUMENTAL GOALS IN ARTICULATION OF THE MAJOR PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY
🕴️Rapp, L., 📝Proportionality and Normativity
🕴️Bär-Bouyssière, B., 📝Practical obstacles to the effective place of Proportionality in Compliance
🕴️Meziani, L., 📝Proportionality in Compliance, the guarantee of public order in companies
🕴️Segonds, M., 📝Compliance, Proportionality and Sanction. The example of the sanctions taken by the French Anticorruption Agency
🕴️Frison-Roche, M.-A., 📝Definition of Proportionality and Definition of Compliance
CHAPTER III. COMPLIANCE MONUMENTAL GOALS TESTED BY CRISIS SITUATIONS
🕴️Oumedjkane, A., Tehrani, A. et Idoux, P., 📝Public Norms and Compliance in times of Crisis: Monumental Goals tested: Elements for a Problematic
🕴️Bonnet, J., 📝The Crisis, an opportunity to seize Compliance as a Mode of Communication by Public Authorities
🕴️Frison-Roche, M.-A., 📝Role and Place of Companies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis
CHAPTER IV. EFFECTIVENESS OF COMPLIANCE MONUMENTAL GOALS AND INTERNATIONAL COMPETITIVENESS
🕴️Deffains, B., 📝The economic challenge of international competitiveness of Compliance🕴️Frison-Roche, M.-A., 📝Assessment of Whistleblowing, and the obligation of Vigilance
CHAPTER V. COMPLIANCE SUPPORTED BY MONUMENTAL GOALS AND NEW WAY FO SOVEREIGNY
🕴️Bismuth, R., Compliance and Sovereignty: ambiguous relationships
🕴️Pottier, S., In favour of European Compliance, a vehicle of economic and political assertion In favour of European compliance, a vehicle of economic and political assertion
🕴️André, Ch., State sovereignty, popular sovereignty: what social contract for compliance?
🕴️Frison-Roche, M.-A., The Principle of Active Systemic Proximity, a corollary of the renewal of the Principle of Sovereignty by Compliance Law
_______
15 mars 2023
Publications

♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
♾️ s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence générale : M.-A. Frison-Roche, "Compliance Monumental Goals, beating heart of Compliance Law", in M.A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, coll. "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p.
___
► Résumé de l'article : Compliance Law can be defined as the set of processes requiring companies to show that they comply with all the regulations that apply to them. It is also possible to define this branch of Law by a normative heart: the "Monumental Goals". These explain the technical new legal solutions, thus made them clearer, accessible, and anticipable. This definition is also based on a bet, that of caring for others that human beings can have in common, a form of universality.
Through the Monumental Goals, appears a definition of Compliance Law that is new, original, and specific. This new term "Compliance", even in non-English vocabulary, in fact designates a new ambition: that a systemic catastrophe shall not be repeated in the future. This Monumental Goal was designed by History, which gives it a different dimension in the United States and in Europe. But the heart is common in the West, because it is always about detecting and preventing what could produce a future systemic catastrophe, which falls under "negative monumental goals", even to act so that the future is positively different ("positive monumental goals"), the whole being articulated in the notion of "concern for others", the Monumental Goals thus unifying Compliance Law.
In this, they reveal and reinforce the always systemic nature of Compliance Law, as management of systemic risks and extension of Regulation Law, outside of any sector, which makes solutions available for non-sector spaces, in particular digital space. Because wanting to prevent the future (preventing evil from happening; making good happen) is by nature political, Compliance Law by nature concretizes ambitions of a political nature, in particular in its positive monumental goals, notably effective equality between human beings, including geographically distant or future human beings.
The practical consequences of this definition of Compliance Law by Monumental Goals are immense. A contrario, this makes it possible to avoid the excesses of a "conformity law" aimed at the effectiveness of all applicable regulations, an extremely dangerous perspective. This makes it possible to select effective Compliance Tools regarding these goals, to grasp the spirit of the material without being locked into its flow of letters. This leads to not dissociating the power required of companies and the permanent supervision that the public authorities must exercise over them.
We can therefore expect a lot from such a definition of Compliance Law by its Monumental Goals. It engenders an alliance between the Political Power, legitimate to enact the Monumental Goals, and the crucial operators, in a position to concretize them and appointed because they are able to do so. It makes it possible to find global legal solutions for global systemic difficulties that are a priori insurmountable, particularly in climate matters and for the effective protection of people in the now digital world in which we live. It expresses values that can unite human beings.
In this, Compliance Law built on Monumental Goals is also a bet. Even if the requirement of "conformity" is articulated with this present conception of what Compliance Law is, this conception based on Monumental Law is based on the human ability to be free, while conformity law supposes more the human ability to obey.
Therefore, Compliance Law, defined by the Monumental Goals, is essential for our future, while conformity law is not.
____
____
📘 Lire une présentation générale du livre, Compliance Monumental Goal, dans lequel l'article est publié.
____
Lire les présentations des autres contributions de Marie-Anne Frison-Roche dans cet ouvrage :
📝Definition of Principe of Proportionality and Definition of Compliance Law,
📝 Role and Place of Companies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis,
📝 Assessment of Whistleblowing and the duty of Vigilance
________
15 mars 2023
Publications

♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
♾️ s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche., "Monumental Goals, beating heart of Compliance Law," in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2023, p..
___
____
► Summary of this Article: Compliance Law can be defined as the set of processes requiring companies to show that they comply with all the regulations that apply to them. It is also possible to define this branch of Law by a normative heart: the "Monumental Goals". These explain the technical new legal solutions, thus made them clearer, accessible and anticipable. This definition is also based on a bet, that of caring for others that human beings can have in common, a universality.
Through the Monumental Goals, appears a definition of Compliance Law that is new, original, and specific. This new term "Compliance", even in non-English vocabulary, in fact designates a new ambition: that a systemic catastrophe shall not be repeated in the future. This Monumental Goal was designed by History, which gives it a different dimension in the United States and in Europe. But the heart is common in the West, because it is always about detecting and preventing what could produce a future systemic catastrophe, which falls under "negative monumental goals", even to act so that the future is positively different ("positive monumental goals"), the whole being articulated in the notion of "concern for others", the Monumental Goals thus unifying Compliance Law.
In this, they reveal and reinforce the always systemic nature of Compliance Law, as management of systemic risks and extension of Regulation Law, outside of any sector, which makes solutions available for non-sector spaces, in particular digital space. Because wanting to prevent the future (preventing evil from happening; making good happen) is by nature political, Compliance Law by nature concretizes ambitions of a political nature, in particular in its positive monumental goals, notably effective equality between human beings, including geographically distant or future human beings.
The practical consequences of this definition of Compliance Law by Monumental Goals are immense. A contrario, this makes it possible to avoid the excesses of a "conformity law" aimed at the effectiveness of all applicable regulations, a very dangerous perspective. This makes it possible to select effective Compliance Tools with regard to these goals, to grasp the spirit of the material without being locked into its flow of letters. This leads to not dissociating the power required of companies and the permanent supervision that the public authorities must exercise over them.
We can therefore expect a lot from such a definition of Compliance Law by its Monumental Goals. It engenders an alliance between the Political Power, legitimate to enact the Monumental Goals, and the crucial operators, in a position to concretize them and appointed because they are able to do so. It makes it possible to find global legal solutions for global systemic difficulties that are a priori insurmountable, particularly in climate matters and for the effective protection of people in the now digital world in which we live. It expresses values that can unite human beings.
In this, Compliance Law built on Monumental Goals is also a bet. Even if the requirement of "conformity" is articulated with this present conception of what Compliance Law is, this conception based on Monumental Law is based on the human ability to be free, while conformity law supposes more the human ability to obey.
Therefore, Compliance Law, defined by the Monumental Goals, is essential for our future, while conformity law is not.
____
____
► read the presentation of the other Marie-Anne Frison-Roche's contributions in this book:
📝 Role and Place of Compagnies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis
📝Definition of Principe of Proportionality and Definition of Compliance Law
📝 Assessment of Whistleblowing and the duty of Vigilance
________
1 mars 2023
Interviews

♾️suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
♾️s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, F. Ancel, N. Roret, "Les juges vont être de plus en plus présents dans le droit de la compliance", entretien avec Olivia Dufour, Actu-Juridique, 1er mars 2023.
____
____
► Présentation de l'entretien par le journal : "À l’instigation du professeur Marie-Anne Frison-Roche, l’École nationale de la magistrature (ENM) a proposé pour la première fois début février une formation en compliance à destination des magistrats et des avocats. François Ancel, conseiller la Cour de cassation, Nathalie Roret, avocate et directrice de l’ENM et Marie-Anne Frison-Roche plaident d’une seule voix pour le renforcement du rôle des acteurs judiciaires dans la compliance."
____
► Questions posées :
- D’où est venue l’idée d’aborder ce droit en cours d’émergence qui semble encore très confidentiel ?
- En effet, on croit souvent savoir ce qu’est la compliance, en la confondant avec la conformité, pouvez-vous expliquer ce qui les distingue ?
- On constate, en lisant le programme de la formation, que toutes les branches du droit sont concernées par la compliance depuis le droit des sociétés jusqu’au pénal en passant par les contrats et la responsabilité. Pouvez-vous nous donner des exemples ?
- Comment se redistribuent les rôles entre les avocats, les juges et les entreprises dans cette nouvelle configuration qu’est la compliance ?
- En quoi est-ce important pour les magistrats d’appréhender ce nouvel univers ?
- Ces transformations sont-elles cantonnées à la compliance ou peuvent-elles sortir de son champ ?
- Par exemple qu’en est-il de la question très controversée du rôle de l’avocat à l’égard du juge ?
- Avez-vous constaté lors de cette formation une amélioration du dialogue entre les différents acteurs ?
- Cette formation va-t-elle être instituée de manière permanente dans la formation des magistrats et des avocats ? Une autre manifestation est-elle prévue ?
________
9 février 2023
Interviews

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les notaires "agents d'effectivité de la compliance"", entretien avec Sarah Bertone, Solution Notaire Hebdo, 9 février 2023.
____
____
► Présentation de l'entretien par le journal : "Souvent envisagée comme un ensemble des processus visant à s’assurer du respect de certaines réglementations et/ou valeurs éthiques par les professionnels, la compliance est aujourd’hui encore mal appréhendée. Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit, spécialisée en droit de la régulation et de la compliance, nous explique en quoi le notariat trouve pourtant toute sa place dans cette démarche."
____
► Questions posées :
-
Quelle conception de la compliance doit-on adopter pour être efficace ?
-
En quoi ces organisations sont-elles clés ?
-
Concrètement, puisque ces organisations anciennes se révèlent si adéquates, ont-elles besoin de s’adapter ?
-
Ne faudrait-il pas que ces professions se modifient ?
________
8 février 2023
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Instaurer l'insécurité juridique comme principe, outil de prévention des crises systémiques catastrophiques totales", in G. Cerqueira, H. Fulchiron & N. Nord (dir.), "Insécurité juridique" : l'émergence d'une notion ?, Société de législation comparée, coll. "Colloques", vol. 53, 2023, pp. 153-167.
____
____
🚧lire le document de travail sur la base duquel la conférence a été faite, l'article ayant été par la suite complété
____
🎤regarder la conférence du 22 mars 2021 qui s'est tenue à la Cour de cassation et pour laquelle cette réflexion a été globalement menée
____
► Résumé de l'article : "whatever it takes". Mario Draghi, par cette formule visait en 2015 l'objectif de défense de la monnaie européenne, lorsque l'Euro risquait de s'effondrer sous la danse des spéculateurs enrichis de son effondrement. On a rarement fait formule plus violemment politique et plus fortement normative. Elle a participé à le faire surnommer comme dans le jeu vidéo "Super Mario". La formule a été reprise en 2020 par le Président de la République Française face aux désordres financiers engendrés par la crise sanitaire ayant engendré de semblables calculs. Elle excède le seul "coût financier". Par cette formule, le président de la Banque Centrale Européenne, a posé que la situation de crise économique était telle en Europe que tout pour y mettre fin y serait déployé par l'Institution, sans aucune limite ; que tous ceux qui par leurs comportements, même appuyés sur leurs prérogatives juridiques, en l'espèce les spéculateurs, parce qu'ils détruisaient le système économique et financier, allaient buter sur cela et seraient eux-mêmes balayés par la Banque Centrale car la mission de celle-ci, en ce qu'elle est d'une façon absolue la sauvegarde de l'Euro lui-même, allait prévaloir "quoi qu'il en coûte". A un moment, le maître se lève. Si la position royale est la position assise lorsque, pondéré, il écoute et juge, c'est en se levant qu'il montre son acceptation d'être aussi le maître parce qu'il est en charge de plus et qu'il fera usage de tout pour gagner.
Plus largement, l'on peut songer à dessiner le concept positif de l'insécurité juridique (ce qui ne peut que plaire aux hégéliens), accroît la sécurité juridique : ainsi cela permet d'associer aux hypothèses d'insécurité juridique un régime juridique plus clair. En effet, plutôt que de mettre sous le tapis le Droit, ce qui explique bien des tensions entre le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat d'une part et le Législateur et le Gouvernement d'autre part concernant "l'Etat d'urgence", l'on pourrait disposer des conditions dans lesquelles l'insécurité juridique permet d'écarter ou de limiter des règles.
L'idée proposée est donc que dans des "situations extraordinaires", l'insécurité juridique serait une dimension, voire un principe admissible. Et développant ce premier point il est proposé que l'hypothèse d'une "crise économique" justifie une dimension, voire un principe d'"insécurité juridique". Mais cette première affirmation est à éprouver. En effet, une crise économique, notion qu'il convient de définir, si elle doit avoir un effet si majeur de retournement, est-elle une "situation" si extraordinaire que cela ? En outre, pour traiter cette situation extraordinaire que constitue une "crise économique", quelle dose d'insécurité juridique serait juridiquement admissible, voire pourrait être juridiquement revendiquée ? Voire pourrait-on concevoir un renversement de principe qui conduirait le Droit applicable à une crise économique sous l'égide de l'insécurité juridique ? Dans un tel cas, la question qui se pose alors est de déterminer les conditions et les critères de la sortie de la crise économique, voire de déterminer les éléments de perspective d'une crise économique, qui pourrait justifier par avance l'admission d'injection d'insécurité juridique. Le Droit a avant tout maîtriser sur le temps futur.
Il convient donc de déterminer juridiquement la crise économique comme constituant une situation exceptionnelle, avant de souligner que le Droit de la régulation et de la compliance, parce que d'une part nous passons de crise en crise et que d'autre part tout le système vise à éviter et à gérer par avance la crise future ou à exclure celle-ci, notamment en matière sanitaire ou climatique (la façon dont la crise sanitaire a été gérée a été de "décréter" l'ouverture par l'Etat d'une crise économique) posant l'insécurité juridique non plus comme une lointaine exception, une défaillance à combattre mais un levier permettant prise sur l'avenir.
________
3 février 2023
Enseignements

♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
♾️s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : F. Ancel et M.-A. Frison-Roche, Droit de la compliance, Ecole nationale de la magistrature (ENM), 2 et 3 février 2023, maison des Avocats, Paris.
_____
► Présentation de l'enseignement : la session de deux jours est conçue pour les magistrats et les avocats en exercice et non nécessairement spécialisés, afin de leur permettre, à partir de cas concrets, d'appréhender les enjeux, objectifs et méthodes de la compliance en entreprise, dont la judiciarisation croissante et la dimension supranationale renforcent et modifient l’office du juge et le rôle des avocats.
L'analyse en est faite sous l’angle du droit civil (contrat, responsabilité), du droit des sociétés, du droit du travail et du droit répressif, mais aussi de la gouvernance, de la régulation, des enjeux climatiques, numériques et des marchés financiers.
____
► Organisation de l'enseignement : l'enseignement est ouvert à l'ensemble des magistrats judiciaires et des avocats. Les inscriptions se font auprès de l'Ecole nationale de la magistrature.
____
lire ci-dessous le programme construit et organisé par François Ancel et Marie-Anne Frison-Roche⤵️

2 février 2023
Organisation de manifestations scientifiques
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, co-organisation de la formation ENM Droit de la Compliance, co-organisé entre l'École nationale de la magistrature et le Journal of Regulation & Compliance (JoRC), les 2 et 3 février 2023.
____
► Présentation générale de la formation : la session de deux jours est conçue pour les magistrats et les avocats en exercice et non nécessairement spécialisés, afin de leur permettre, à partir de cas concrets, d'appréhender les enjeux, objectifs et méthodes de la compliance en entreprise, dont la judiciarisation croissante et la dimension supranationale renforcent et modifient l’office du juge et le rôle des avocats.
L'analyse en est faite sous l’angle du droit civil (contrat, responsabilité), du droit des sociétés, du droit du travail et du droit répressif, mais aussi de la gouvernance, de la régulation, des enjeux climatiques, numériques et des marchés financiers.
____
► Bibliographie sommaire :
- M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023.
- M.-A. Frison-Roche (dir.), Les buts monumentaux de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2022.
- M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021.
- N. Borga, J.-Cl. Marin, J.-Ch. Roda (dir), Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2018.
- M.-A. Frison-Roche (dir.), Pour une Europe de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2019.
- M.-A. Frison-Roche (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, coll. "Régulations", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2017.
____
► Interviennent :
🎤François Ancel, Conseiller à la Première chambre civile de la Cour de cassation
🎤Guillaume Beaussonie, Professeur à l'Université Toulouse 1 Capitole
🎤Jean-François Bohnert, Procureur national financier
🎤Gilles Briatta, Secrétaire général du Groupe Société Générale
🎤Marie-Anne Frison-Roche, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)
🎤Cécile Granier, Maître de conférences à l'Université Jean-Moulin Lyon 3
🎤Jean-Michel Hayat, Premier Président honoraire de la Cour d'appel de Paris
🎤Christophe Ingrain, Avocat à la Cour
🎤Anne-Valérie Le Fur, Professeure à l'Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
🎤Stanislas Pottier, Conseiller spécial de la Direction générale d'Amundi
🎤Jean-Baptiste Racine, Professeur à l'Université Panthéon-Assas (Paris II)
🎤Juliette Thery, Membre du Collège de l'Arcom
____
Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous⤵️
2 février 2023
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : E. Wennerström, "Quelques réflexions sur la Compliance et la Cour européenne des droits de l'homme", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 479-489.
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Le développement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, contribuant à l'intégration européenne, a intégré l'idée substantielle de "compliance" qui dépasse l'idée de légalité par rapport à laquelle les entreprises demeurent passives et promeut les systèmes juridiques comme des ensembles en interaction les uns avec les autres.
L'auteur développe l'esprit et la portée du Protocole 15 par lequel sont organisées à la fois le principe de subsidiarité et les marges de manœuvre des Etats signataires de la Convention, mécanismes éclairés par le principe de proportionnalité. La subsidiarité pose les Etats sont les mieux placés pour concevoir l'application la plus adéquate de la Convention, les liens étroits entre les Etats permettant une application efficace de celle-ci. En outre, la procédure d'avis qui permet à une juridiction nationale d'avoir sur un cas pendant l'opinion non obligatoire de la CEDH assure une meilleure efficace de la Compliance au regard des objectifs de la Convention.
La jurisprudence de la Cour reprend cette exigence substantielle à travers sa doctrine notamment dégagée dans le cas Bosphorus , en soulignant que l'adhésion d'un Etat à l'Union européenne présume son respect des obligations découlant de la CEDH, en exécutant le droit de l'Union européenne, même cette présomption peut être réfutée si la protection est manifestement défaillante, ce qui fut admis dans plusieurs affaires, notamment à propos du droit à un tribunal impartial en matière de régulation économique. S'articulent ainsi les différents ordres juridiques.
L'auteur conclut que la Cour européenne des droits de l'homme, comme la Cour de justice de l'Union, contribue à la construction du Droit de la Compliance en Europe, dans une perspective Ex Ante favorisant les avis plutôt que les sanctions Ex Post et créant, notamment par la doctrine Bosphorus des éléments de sécurité et de confiance pour l'intégration européenne autour des valeurs communes aux différents systèmes juridiques articulés et laissant aux Etats les marges adéquates pour favoriser cette intégration.
________
Mise à jour : 2 février 2023 (Rédaction initiale : 23 juin 2021 )
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Ch. Lapp, "La compliance dans l'entreprise : les statuts du process", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p.141-150.
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite au colloque L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de Droit Lyon 3. Ce colloque a été conçu sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Christophe Roda et s'est déroulé à Lyon le 23 juin 2021. Au cours de ce colloque, l'intervention fût commune avec Jean-Marc Coulon, également contributeur dans l'ouvrage (v. le résumé de l'article de Jean-Marc Coulon).
Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre I, consacré à L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance.
____
► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : L’entreprise est prise en tenaille par le droit de la Compliance dont les mâchoires sont celles de l’incitation (1) et la sanction qu’elle doit appliquer pour assurer l’effectivité de ses process dont elle est elle-même justiciable (2).
En premier lieu, l’Entreprise a reçu délégation de fabriquer les règles répréhensibles qu’elle doit s’appliquer à elle-même ainsi qu’aux tiers avec lesquels elle est en relation. A cet effet, l’entreprise met en place des "process", c’est-à-dire des procédés de vérifications, de prévention, afin de donner à voir que les infractions qu’elle est susceptible de commettre ne seront pas constituées.
Les process constituent un standard de comportement pour prévenir et éviter que les faits constitutifs des infractions ne soient pas eux-mêmes réalisés. Ils sont ainsi l’un des éléments de la règle de droit de la responsabilité civile dans ses finalités préventive ou réparatrice.
En second lieu, La répression de l’inobservation des process met l’entreprise en face de deux écueils. Le premier place l'entreprise, à l’égard de ses collaborateurs et de ses partenaires, dans l'obligation de éfinir des process qui constituent également le règlement quasi juridictionnel de leur inobservation, l’entreprise devant concilier la sanction qu’elle prononce avec les principes fondamentaux du droit pénal classique, les principes constitutionnels et l’ensemble des droits substantiel. Les process deviennent alors la règle processuelle.
Le second est que l’entreprise est justiciable de l’effectivité de l’évitement par ses process des faits constitutifs d’infractions Par une inversion de la charge de la preuve, l’entreprise est alors astreinte à prouver que ses process ont une efficience au moins équivalente aux mesures définies par les lois et règlements, l’Agence française anticorruption (AFA), les directives européennes et les diverses communications sur les outils de lutte contre les infractions à la probité, les atteintes environnementales et aux préoccupations sociétales actuelles. Les process deviennent alors l’élément constitutif, per se, de l’infraction.
Ainsi, dans sa recherche de l’équilibre entre la prévention et la sanction à laquelle elle est elle-même assujettie, l’entreprise ne sera-t-elle pas alors tentée de privilégier l’orthodoxie de ses process aux attentes de l’AFA, des régulateurs et des juges, au détriment de leur efficacité ?
Ce faisant, ne va-t-on pas vers une Compliance instrumentale et conformiste, paradoxalement déresponsabilisante par rapport aux buts monumentaux de la Compliance ?
________
2 février 2023
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : F. Raynaud, "Le juge administratif et la compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 473-478.
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'auteur étudie les rapports étroits entre la Compliance et le Droit souple, tel que le Juge administratif a fait place à celui-ci dans sa jurisprudence. Ce fut notamment le cas par les arrêts du Conseil d'Etat de 2016, portant sur des sujets de Droit de la régulation, ce que prolonge le Droit de la compliance.
Ce souci d'internaliser dans les entreprises ce que veulent les autorités publiques avait d'ailleurs été pris en considération par le Conseil d'Etat par des petites touches à partir de 2010 et s'est continuellement étoffé. C'est notamment le cas lorsque le document émis est "de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent", ce qui rejoint directement les enjeux de compliance. La nouvelle conception adoptée par le Conseil d'Etat a conduit celui-ci à contrôler de nombreuses "positions", "recommandations", "lignes directrices", etc., adoptées par de multiples Autorités notamment pour protéger les personnes sur lesquelles ces actes ont un "effet notable", n'hésitant pas parfois à censurer l'organisme émetteur. Le droit souple en matière de compliance bancaire, plus spécifiquement émis par l'EBA, a donné au juge administratif l'occasion d'ajuster son contrôle avec celui-ci exercé par la Cour de Justice saisie par une question préjudicielle.
Ainsi, "Par sa jurisprudence sur la justiciabilité des actes de droit de souple, le Conseil d’Etat s’affirme donc comme un acteur de la compliance en permettant aux entités visées par ces actes et soumises à leur égard à une obligation de compliance de saisir le juge administratif d’un recours en annulation contre ces actes, afin qu’ils puissent être soumis à un contrôle de légalité et, le cas échéant, annulés".
Mais faut-il que le juge administratif soit saisi. Il peut l'être dans de nouveaux domaines, par exemple en matière climatique, comme cela fut le cas dans l'affaire Grande Synthe. Par sa décision, "Le Conseil d’Etat va ainsi au bout de la logique du dispositif mis en place par le législateur et par le pouvoir réglementaire pour mettre en œuvre les accords de Paris, lesquels reposent sur une forme de compliance à l’échelle mondiale, chaque Etat signataire s’engageant, en quelque sorte, à faire le nécessaire pour atteindre un objectif commun à une date donnée, à charge pour chacun de s’organiser pour l’atteindre. En l’absence d’un juge international capable de vérifier le respect de ces engagements, le juge national apparait le plus naturel pour accepter de vérifier, lorsqu’il est saisi d’un litige en ce sens, que ces engagements ne restent pas lettre morte. ".
Par ce mouvement général, "La compliance est devenue un nouveau mode de régulation d’un nombre croissant d’activités. ".
________
2 février 2023
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le jugeant-jugé. Articuler les mots et les choses face à l'éprouvant conflit d'intérêts", in Frison-Roche, M.-A. (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 59-80.
____
____
🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à une intervention dans le colloque L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de Droit Lyon 3. Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Christophe Roda, codirecteurs scientifiques, et s'est déroulé à Lyon le 23 juin 2021.
Dans l'ouvrage, l'article est publié dans la partie I, consacré à L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance.
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Avant même d'aborder la situation de l'entreprise, ainsi placée comme "jugeant-jugée" par le Droit de la Compliance, parce que l'enjeu est avant tout celui de la qualification adéquate, l'article pose en préalable qu'il faut garder à l'esprit trois principes : ce qu'est le Droit dans sa corrélation avec la réalité, lui confiant le soin de garder même par rapport à son propre pouvoir le soin de conserver un lien minimal avec la réalité ou de restaurer le lien entre les mots et les choses, grâce à la qualification ; ce qu'est l'activité de "juger" et son corolaire, la procédure, obligeant le Droit à travers ce qu'en disent les tribunaux, à qualifier "juge" celui qui juge pour mieux le contraindre par le Droit processuel; ce qu'est la personnalité morale, notion qui permet à l'entreprise de se dédoubler et paraît ainsi très commode pour sanctionner un collaborateur, voire un mandataire social mais ce qui va l'encontre de l'hostilité systémique du Droit de la Compliance à l'égard de cette notion.
Ayant cela en perspective, l'article montre en premier lieu comment est-ce que le Droit "démasque" les entreprises qui jugent et sanctionnent en prétendant ne pas le faire, qualification imposée pour contraindre les entreprises à respecter les principes processuels au bénéfice de ceux qui sont poursuivis ou jugés par elle. Cela devient acrobatique lorsque la personne morale se poursuit elle-même, non seulement en application de la loi mais par exemple au nom du contrat ou au nom de l'éthique ou de la raison d'être. Les juges le font néanmoins, le Droit de la Compliance reprenant toutes les solutions que la jurisprudence dégagea dans le Droit de la Régulation concernant les Autorités administratives de régulation, selon un raisonnement fonctionnel, à reprendre ici, le Droit de la Compliance prolongeant encore une fois ici le Droit de la Régulation. Cette transposition permet de justifier le cumul des pouvoirs par les entreprises qui, devant admettre l'ampleur de ces pouvoirs exercés, doivent donc s'organiser pour que les conflits d'intérêts structurels qu'ils engendrent soient pourtant résolus. Pour cela, la notion à la fois centrale et suffisante est l'Impartialité
La seconde partie de l'article expose la façon dont les entreprises peuvent se poursuivre elles-mêmes et se juger elles-mêmes d'une façon pourtant impartiale. Si l'on considère que l'héroïsme éthique, consistant à se punir soi-même avec impartialité pour que prévalent des intérêts autres que le sien, ne peut suffire à bâtir un système et à le soutenir dans la durée,, tout est donc dans l'art de la distance, qu'il faut reconstituer au sein même de l'entreprise "jugeante-jugée".
Pour ne pas sacrifier la cohérence du Droit de la Compliance qui ne peut plus donner de force à la personnalité, il faut que l'entreprise organise des distances entre qui juge et qui est jugée sans pour autant recourir à la personnalité morale. Si l'on ne pense pas que les "machines impartiales", telles que les adeptes de l'intelligence artificielle les promettent, puissent être une perspective consistante, il faut davantage approfondirez des perspectives comme celles des structures internes de médiation, voire des structures externes dont l'Oversight Board de Meta est la première expérience. La perspective la plus riche demeure celle du recours à des tiers humains, en distinguant les intérêts distincts, voire divergents en cause dans la mise en oeuvre des Outils de la Compliance, par exemple les enquêtes internes, chacun de ses intérêts étant défendu par un conseil qui lui est propre, notamment un avocat.
________
2 février 2023
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : O. Douvreleur, "Compliance et juge du droit", in M.-A Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 465-471.
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : La compliance entretient avec le juge, et plus encore avec le juge du droit, celui qui, par principe, ne connaît pas des faits qu’il laisse à l’appréciation souveraine des juges du fond – la Cour de cassation dans l’ordre judiciaire -, des rapports complexes. A première vue, la compliance est une technique internalisée dans les entreprises et la place qu'occupent les techniques de justice négociée appellent peu l'intervention du juge du droit.
Son rôle a pourtant vocation à se développer, notamment à propos du devoir de vigilance ou dans l'articulation entre les branches du droit lorsque la compliance rencontre le droit du travail, ou encore dans l'ajustement entre le droit américain et notre système juridique. La façon dont le principe de proportionnalité va prendre place dans le droit de la compliance est également un enjeu majeur pour le juge du droit.
________
2 février 2023
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : S. Schiller, "Un juge unique en cas de manquement international à des obligations de compliance ?, in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 453-464.
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par l'auteure) : Vu le caractère très international des sujets appréhendés, des acteurs en cause et donc des contentieux en matière de la compliance, il est essentiel de savoir si une personne peut être mise en cause devant plusieurs juges, rattachés à des états différents ou même si elle peut être condamnée par plusieurs juridictions. La réponse est donnée par le principe non bis in idem qui fait l’objet d’une riche jurisprudence sur le fondement de l’article 4 du protocole n°7 de la CEDH, clairement inapplicable pour des juridictions émanant d’États différents.
Pour apprécier si des manquements à des obligations de compliance pourront faire l’objet de sanctions multiples dans des états différents, il conviendra de rechercher d’abord si des fondements textuels sont invocables.
A l’échelle européenne, l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux permet aujourd’hui d’invoquer le principe ne bis in idem. Applicable à tous les domaines de la compliance, il assure une protection très forte qui couvre non seulement les condamnations, mais également les poursuites. Tout comme ses effets, le champ d’application de l’article 50 est très large. Les procédures concernées sont celles qui ont une nature répressive, au-delà de celles prononcées par des juridictions pénales au sens strict, ce qui permet de couvrir les condamnations prononcées par une des nombreuses autorités de régulation compétentes en matière de compliance.
A l’échelle internationale, la situation est moins claire. Pourra être invoqué l’article 14-7 du Pacte international sur les droits civils et politiques à condition de surmonter plusieurs obstacles dont la décision du 2 novembre 1987 du Comité des droits de l’homme qui l’a restreint au cadre interne, c’est-à-dire à l’hypothèse d’une double condamnation par un même État.
Même si des fondements sont applicables, deux spécificités des situations de compliance risquent d’entraver leur application, les premières liées aux règles processuelles applicables en particulier les règles de compétence, et les secondes liées aux spécificités des situation.
L’application de la règle non bis in idem n’est formellement admise qu’en ce qui concerne la compétence universelle et les compétences personnelles, c’est-à-dire les compétences extraterritoriales, ce qui ne constitue qu’une partie des compétences. La Cour de cassation l’a confirmé dans le célèbre arrêt dit « Pétrole contre nourriture » du 14 mars 2018. Le refus de reconnaitre à ce principe un caractère universel, quelle que soit la règle de compétence en cause, prive les entreprises françaises d’un moyen de défense. En outre, la répression des atteintes aux règles de compliance se règle de plus en plus souvent par des mécanismes transactionnels. Ces derniers n’entreront pas toujours dans le champ d’application des règles européennes et internationales posant le principe non bis in idem, faute d’être parfois qualifiés de « jugement définitif » selon les termes de l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux et de l’article 14-7 du Pacte international sur les droits civils et politiques.
Les manquements commis en matière de compliance reposent souvent sur des actes multiples. En découle des prescriptions dont le point de départ est retardé au dernier évènement et une compétence juridictionnelle facilitée pour les juridictions françaises dès lors qu’un seul des faits constitutifs est constaté en France. En matière de compliance, le principe non bis in idem ne permet généralement donc pas de protéger les entreprises et n’empêche pas qu’elles soient attraites devant des juridictions de deux pays différents pour la même affaire. Il leur accorde néanmoins une autre protection en obligeant à tenir compte des décisions étrangères pour déterminer le montant de la peine. La sanction retenue contre Airbus SE dans la Convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) du 29 janvier 2020 en est une parfaite illustration.
________
Mise à jour : 2 février 2023 (Rédaction initiale : 23 juin 2021 )
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L.-M. Augagneur, "La juridictionnalisation de la réputation par les plateformes", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 97-113.
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à une intervention dans le colloque L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de Droit Lyon 3. Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Christophe Roda, codirecteurs scientifiques, et s'est déroulé à Lyon le 23 juin 2021.
Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre I, consacré à L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance.
____
► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : Les grandes plateformes se trouvent placées en arbitre de l’économie de la réputation (référencement, notoriété) dans laquelle elles agissent elles-mêmes. Malgré, le plus souvent, de faibles enjeux unitaires, la juridictionnalité de la réputation représente des enjeux agrégés importants. Les plateformes sont ainsi conduites à détecter et apprécier les manipulations de réputation (par les utilisateurs : SEO, faux avis, faux followers ; ou par les plateformes elles-mêmes comme l’a mis en lumière la décision Google Shopping rendue par la Commission Européenne en 2017) qui sont mises en œuvre à grande échelle avec des outils algorithmiques.
L’identification et le traitement des manipulations n’est elle-même possible qu’au moyen d’outils d’intelligence artificielle. Google procède ainsi à un mécanisme de déclassement automatisé des sites ne suivant pas ses lignes directrices, avec une possibilité de faire une demande de réexamen par une procédure très sommaire entièrement menée par un algorithme. De son côté, Tripadvisor utilise un algorithme de détection des faux avis à partir d’une « modélisation de la fraude pour relever des constantes électroniques indétectables par l’œil humain ». Elle ne procède à une enquête humaine que dans des cas limités.
Cette juridictionnalité de la réputation présente peu de caractères communs avec celle définie par la jurisprudence de la Cour de Justice (origine légale, procédure contradictoire, indépendance, application des règles de droit). Elle se caractérise, d’une part, par l’absence de transparence des règles et même d’existence des règles énoncées sous forme prédicative et appliquées par raisonnement déductif. S’y substitue un modèle inductif probabiliste par l’identification de comportements anormaux par rapport à des centroïdes. Cette approche pose bien sûr la problématique des biais statistiques. Plus fondamentalement, elle traduit une transition de la Rule of Law, non pas tant vers Code is Law (Laurence Lessig), mais à Data is Law, c’est-à-dire à une gouvernance des nombres (plutôt que “par” les nombres). Elle revient en outre à une forme de juridictionnalité collective puisque la sanction provient d’une appréhension computationnelle des phénomènes de la multitude et non d’une appréciation individuelle. Enfin, elle apparaît particulièrement consubstantielle à la compliance puisqu’elle repose sur une démarche téléologique (la recherche d’une finalité plutôt que l’application de principes).
D’autre part, cette juridictionnalité se caractérise par la coopération homme-machine, que ce soit dans la prise de décision (ce qui pose le problème du biais d’automaticité) et dans la procédure contradictoire (ce qui pose notamment les problèmes de la discussion avec machine et de l’explicabilité de la réponse machine).
Jusqu’ici, l’encadrement de ces processus repose essentiellement sur les mécanismes de transparence, d’une exigence contradictoire limitée et de l’accessibilité de voies de recours. La Loi pour une République Numérique, le Règlement Platform-to-Business et la Directive Omnibus) ont ainsi posé des exigences sur les critères de classement sur les plateformes. La directive Omnibus exige par ailleurs que les professionnels garantissent que les avis émanent de consommateurs par des mesures raisonnables et proportionnées. Quant au projet de Digital Services Act, il prévoit d’instaurer une transparence sur les règles, procédures et algorithmes de modération de contenus. Mais cette transparence est souvent en trompe-l’œil. De la même façon, les exigences d’une intervention humaine suffisante et du contradictoire apparaissent très limités dans le projet de texte.
Les formes les plus efficientes de cette juridictionnalité ressortent en définitive du rôle joué par les tiers dans une forme de résolution de litiges participative. Ainsi, par exemple, FakeSpot détecte les faux avis Tripadvisor, Sistrix établit un indice de ranking qui a permis d’établir les manipulations de l’algorithme de Google dans l’affaire Google Shopping en détectant les artefacts en fonction des modifications de l’algorithme. D’ailleurs, le projet de Digital Services Act envisage de reconnaître un statut spécifique aux signaleurs de confiance (trusted flaggers) qui identifient des contenus illégaux sur les plateformes.
Cette configuration juridictionnelle singulière (plateforme juge et partie, situations massives, systèmes algorithmiques de traitement des manipulations) amène ainsi à reconsidérer la grammaire du processus juridictionnel et de ses caractères. Si le droit est un langage, elle en offre une nouvelle forme grammaticale qui serait celle de la voie moyenne (mésotès) décrite par Benevéniste. Entre la voie active et la voie passive, se trouve une voie dans laquelle le sujet effectue une action où il s’inclut lui-même. Or c’est bien le propre de cette juridictionnalité de la compliance que de poser des lois en s’y incluant soi-même (nomos tithestai). A cet égard, l’irruption de l’intelligence artificielle dans ce traitement juridictionnel témoigne incontestablement du renouvellement du langage du droit.
________
Mise à jour : 2 février 2023 (Rédaction initiale : 23 juin 2021 )
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J. Heymann, "La nature juridique de la "Cour suprême" de Facebook", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 151-167.
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel l'article est publié
____
► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite au colloque L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de Droit Lyon 3. Ce colloque a été conçu sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Christophe Roda et s'est déroulé à Lyon le 23 juin 2021.
Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre I, consacré à L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance.
____
► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : Inséré dans la thématique générale visant à « faire coïncider les mots et les choses », l’article propose une réflexion sur les « conditions du discours » - au sens où l’entendait Foucault dans son Archéologie des sciences humaines – relatif au phénomène de juridictionnalisation de la Compliance.
Plus précisément, la réflexion porte sur la nature de la prétendue « Cour suprême » instituée par le groupe Facebook en vue de connaître des appels des décisions relatives au contenu sur les réseaux sociaux numériques Facebook et Instagram. S’agit-il véritablement d’une Cour suprême, en charge de « juger » le groupe Facebook ?
Un examen attentif de l’Oversight Board, soit le Conseil de Surveillance créé par l’entreprise Facebook, révèle que ce dernier, au-delà de son titre, peut prétendre, en complément de son activité de « conseil » (laquelle consiste à émettre des « avis consultatifs sur les politiques en matière de contenu de Facebook »), exercer une forme d’activité juridictionnelle. Celle-ci se conçoit essentiellement en termes de vérification de conformité, d’une part des contenus publiés sur les réseaux sociaux Facebook ou Instagram aux standards émis par ces deux sociétés, d’autre part des décisions – de modération ou d’appréciation de cette modération – au droit. Le cadre juridique de référence est cependant flou, et semble en outre présenter la particularité d’évoluer en fonction du cadre géographique dans lequel le cas examiné sera localisé. Une mission juridictionnelle semble donc bien pouvoir être caractérisée, même si l’office du Conseil de Surveillance est limité et n’a vocation à s’exercer que dans un cadre restreint.
L’auteur propose donc de retenir, en vue de qualifier l’Oversight Board, la nature d’organe préventif de règlement des différends – l’objectif poursuivi paraissant être celui d’éviter la saisine de tribunaux étatiques en statuant en amont d’une décision judiciaire. Différentes questions doivent subséquemment être soulevées, tant sur le plan de la légitimité que sur celui de l’autorité de pareil Oversight Board. Mais quelles que seront les réponses à ces questions, il reste que cette création d’un Conseil de Surveillance par une entreprise de droit privé révèle d’ores et déjà toute la vivacité du pluralisme juridique contemporain.
________
2 février 2023
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J. Morel-Maroger, "La réception des normes de la compliance par les juges de l’Union européenne", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 443-452.
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par l'auteure) : Destinée à poursuivre la réalisation d’objectifs d’intérêt général – ou de buts monumentaux - les normes de compliance ont en principe pour objet de modifier et orienter les comportements des opérateurs économiques. Pour parvenir à la réalisation de ces objectifs, la compliance utilise toute la variété de la gamme de la normativité. Quel est et doit être le rôle des juges de l’Union européenne face au développement des normes de compliance ? Comme en droit interne, la juridicité même des normes de compliance élaborées par les autorités de régulation est contestée.
Il conviendra d’analyser dans un premier temps quel contrôle opèrent les juges de l’Union européenne à leur égard, la question se posant ici essentiellement pour les règles de droit souple dont la contestation peut être envisagée par deux voies : par le biais d’un recours en annulation, et par voie d’exception par le biais d’un recours préjudiciel.
Mais au-delà du contrôle de la légalité des normes de compliance exercé par les juges européens, ceux-ci contribuent aussi à leur application. L’efficacité de la compliance repose avant tout sur l’adhésion de ses destinataires, les opérateurs économiques étant sans aucun doute les premiers acteurs de son succès. Mais les juges de l’Union européenne, compétents pour trancher les litiges relatifs à l’application du droit de l’Union européenne entre les États membres, les institutions européennes et les requérants individuels, peuvent être amenés dans le cadre des recours dont ils sont saisis à assurer l’effectivité des normes européennes de compliance et à les interpréter.
________
2 février 2023
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : A. Bruneau, "L'entreprise juge d'elle-même : la fonction compliance dans la banque", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 115-131.
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : Tout d’abord il faut rappeler que la fonction compliance est née au sein de la finance, et qu’en se structurant, elle a évolué pour accompagner le passage du droit de la régulation au droit de la compliance. Par le biais de ces mutations, la compliance est passée d’une fonction contrôlante ex-post à une fonction contraignante ex-ante. La crise du LIBOR illustre imparfaitement la primauté de cette transition. L’évolution de ce rôle est illustrée par des exemples concrets.
Dans un premier temps, est étudiée la gestion du risque de réputation élément fondamental de l’entreprise procureur et juge d’elle-même. Le risque de réputation est un élément non négligeable pour un établissement financier, car celui-ci peut engendrer des conséquences négatives sur sa capitalisation, voire culminer en crise systémique. L’évitement de la crise financière de grande ampleur s’inscrit également dans les buts monumentaux de la compliance.
Afin d’éviter des scénarios complexes et inopportuns, le droit de la compliance intervient le plus en amont possible et identifie les sujets susceptibles d’impacter la réputation. La réglementation impose la mise en place de certains dispositifs ex ante. La loi Sapin 2 exige la mise en place d’outils qui concernent l’ensemble des entreprises (et non pas seulement les banques). En effet, au-delà du risque de réputation, il est essentiel de considérer le risque de corruption. La considération du risque de réputation peut justifier le refus d’exécuter certaines opérations. Dans cette optique la compliance doit évaluer les potentielles conséquences de l’entrée en relation avec un nouveau client en amont, pour parfois décliner la prestation de services. Ainsi la fonction compliance juge de façon unilatérale la relation en vue de gérer son risque de réputation.
En second lieu, le mécanisme de sanction interne institué par le droit de la compliance est également abordé, notamment les sanctions internes adoptées par la compliance dans un établissement financier. La compliance peut agir en tant que procureur via des comités conduite mis en place au sein des métiers. En outre, la compliance peut déterminer et appliquer des sanctions à l’encontre des collaborateurs. De la sorte, on constate un double rôle de procureur et juge pour la fonction compliance dans le cadre d’un dispositif extraordinaire du droit commun.
Enfin, l’analyse traite du cas du jugeant-jugé : à la suite d’une décision de la banque, le régulateur peut prendre une position d’autant plus stricte en estimant que la banque applique mal ses lignes directrices. Ainsi, le droit de la compliance qui s’installe au sein de l’entreprise bancaire, se retrouve lui-même sous le jugement de son propre régulateur. L’entreprise se retrouve jugée et est amenée à être procureur et juge d’elle-même, mais aussi de ses clients.
__________
2 février 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Ch. Beaucillon, « Sanctions internationales, coercition économique et souveraineté», Revue Droits, PUF, 2023/1, n°77, pp.183-196.
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
2 février 2023
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : F. Ancel, "Le principe processuel de compliance, un nouveau principe directeur du procès ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 225-230.
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel l'article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Par cet article, l'auteur formule une proposition : celle de hisser le principe de compliance au rang de principe directeur du procès. Pour soutenir cela dans une première partie, l'auteur souligne la convergence des buts de la compliance et de la finalité du procès. En effet, rappelant que le Droit de la compliance n'évince ni l'État ni le juge, dès l'instant que la compliance signifie que la personne doit tenir ses engagements et que le procès repose aussi sur ce principe comme quoi les parties doivent se conformer aux principes et à leur propre "discours", la compliance devient ainsi un principe directeur du procès.
Dans une seconde partie de l'article, l'auteur illustre son propos d'une façon très concrète. En premier lieu, les protocoles de procédure qui sont élaborées par les juridictions et les barreaux sont des engagements qui devraient justifier une forme de contrainte qui, si elle ne doit pas de même forme et de même nature que celle de la loi, doit tout de même avoir des conséquences lorsqu'une partie s'y dérobe, par exemple au regard de l'article 700 du Code de procédure civile. En second lieu, en s'appuyant sur une jurisprudence qui sanctionne une partie qui avait accepté le principe de l'arbitrage puis entrava systématiquement sa mise en oeuvre, l'auteur suggère que sous le principe de compliance puissent être regroupés les notions pour l'instant éparses des principes de loyauté, de cohérence (estoppel) et d'efficacité.
Ainsi, cette "pratique ouverte" faisant écho à la "voie ouverte" d'un principe processuel de compliance fait apparaître celui-ci.
________