4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : A.-C. Rouaud, "L’intensité de l’obligation de vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs financiers", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteure développe le cas des opérateurs financiers et montre que si ceux-ci sont soumis à des très lourdes obligations de vigilance, c'est avant tout en raison des risques systémiques des marchés, obligations consubstantielles à leurs activités, car ces opérateurs étant souvent en charge des infrastructures de marché ou opérant des prestations, qui les font tous appartenir à la catégorie des professions réglementées.
Malgré cette unicité, la manifestation de l'obligation de vigilance est protéiforme, allant de la police, de la surveillance du client, à sa mise en garde, sa protection, laquelle peut être très réduite, la lutte contre le blanchiment visant à protéger le système (kyc).
Cette obligation de vigilance poursuit en outre des finalités variables, ce qui explique des sanctions diverses, car l'intensité de l'obligation varie aussi. La lutte contre le risque systémique est certes une finalité commune, mais s'y ajoutent des soucis de protéger des catégories, par exemple d'investisseurs (perspective plus européenne).
L'intérêt général est pourtant aujourd'hui renouvelé car, constitué par la protection des marchés, il se double du souci de durabilité. Cela se traduit par une variabilité des sanctions, allant des sanctions disciplinaires, maniées par l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'obligation de mettre en place des programmes de compliance par rapport auxquels les manquements sont sanctionnés per se. Le private enforcement se développe en articulation avec le public enforcement, avec une transformation du risque contentieux pour les entreprises, très sensible à l'extraterritorialité et à la portée du Droit souple.
________
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
________
4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Lamoureux, "L’obligation de vigilance des opérateurs énergétiques", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteure montre tout d'abord que, malgré la diversité des activités énergétiques (l'électricité impliquant moins par nature des chaînes de valeur internationales, le pétrole l'impliquant par nature plus), les opérateurs de ce secteur présentent une unicité suffisante pour justifier qu'ils sont globalement appréhendés au regard de la vigilance.
En effet, de fait et pour l'instant ceux-ci sont directement concernés non seulement parce qu'ils ont été de fait assignés devant les juges dans les contentieux du devoir de vigilance, mais encore, voire surtout parce qu'ils sont le signe de l'intensité de la vigilance qui est attendue d'eux. La première partie de l'article développe les caractéristiques des opérateurs énergétiques, qui influent sur l'intensité de l'obligation de vigilance. En effet, leur unicité vient précisément des entreprises elles-mêmes, qui sont des "géants", soumis à l'obligation d'élaborer des plans de vigilance, souvent verticalement intégrés, dans un secteur concentré sur des multinationales aux moyens très importants et présents tout au long de la chaîne de valeur, dont l'activité engage des infrastructures
La deuxième partie de l'article justifie cette intensité de l'obligation de vigilance par les risques spécifiquement liés aux activités de ces opérateurs énergétiques. En effet, même s'il est vrai que leur activité est très hétérogène, les risques des risques très importants, en ce que d'une part elles construisent des infrastructures diverses et gigantesques, ont part dans l'activité extractive, et d'autre part ont un impact à long terme sur l'environnement. Il est demandé aux entreprises d'être elles-mêmes vigilantes sur ces infrastructures et sur ces impacts. La police administrative a mis en place cela depuis longtemps.
Mais la troisième partie de l'article montre précisément cela n'est pas nouveau : la culture de la prévention des risques est déjà très présente dans ces entreprises, notamment en raison de la présente très forte de l'État et de la réglementation. On y retrouve ainsi une culture de "conformité réglementaire". C'est principalement sur ces opérateurs-là que repose la "vigilance climatique".
Les opérateurs énergétiques sont donc au centre, non pas seulement parce qu'ils génèrent des risques, mais encore parce qu'ils détiennent beaucoup de solutions pour atteindre les Buts Monumentaux visés par le système de vigilance : ils contribuent ainsi d'une façon décisive à la lutte contre le changement climatique parce qu'ils en ont les moyens. C'est notamment pourquoi les grands opérateurs ont tous adopté une raison d'être.
________
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Françon, "L’intensité du devoir de vigilance dans le secteur bancaire", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur développe le cas des opérateurs bancaire et d'assurance. Il insiste sur le fait qu'en matière bancaire et d'assurance, la vigilance consiste dans une obligation de traiter des informations, au besoin préalablement collectées, en vue de prévenir la survenance d'un risque systémique.
L'identification et la prévention du risque est une obligation de moyens renforcée qui, dans ce cadre, connaît des variations d'intensité. L'obligation est ancienne, alors que le devoir de vigilance est récent. Ce décalage dans le temps s'explique parce que la vigilance obligée est consubstantielle à l'activité même du banquier et de l'assureur et du fait du caractère systémique du secteur depuis toujours, ce qui produit une imbrication du droits dur et souple.
Les variations de l'intensité de l'obligation de vigilance tiennent quant à elles au fait qu'il y a deux types d'obligations : celles qui sont imposées dans l'intérêt de l'activité et du client et celles qui le sont dans l'intérêt de la stabilité du système. Les secondes sont beaucoup plus fortes que les premières. Elles pèsent aussi bien sur le banquier que sur le client. Ainsi les obligations en matière de blanchiment ont pour seul but l'intérêt général, le client ne pouvant se prévaloir des manquements de la banque (Com. 28 avril 2004). D'ailleurs, en matière de gel des avoirs, l'obligation de vigilance devient de résultat.
Dans l'intérêt général lui-même, l'intensité varie en fonction des buts poursuivis, engendrant des vigilances "standard, simplifiée, renforcée", en fonction du risque sous-jacent. En outre, des droits interférents font varier l'obligation, notamment la protection des droits à la protection des données personnelles, ou le droit à la non-immixtion du banquier. Enfin, interfèrent les obligations de vigilance pesant sur les tiers, y compris situés hors de l'Europe.
________
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
________
28 mai 2025
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
____
► Référence complète : M.A. Frison-Roche, "100 fois remettre la Compliance sur le métier de la Stratégie", in Lettre d'information Compliance. Groupe SNCF, 100ième numéro, 28 mai 2025.
____
____
► Présentation de cet article : Cet article anniversaire plante ce qu'est et doit être la Compliance dans un grand groupe. Il l'exprime en 4 points :
1. Maîtriser activement les réglementations par la compréhension de leur esprit
2. Améliorer la détection des risques sans ôter le goût d’entreprendre
3. Favoriser les convergences et gérer les conflit
4. Renforcer l’identité de l’entreprise par une consolidation autour de ses ambitions stratégiques
________
9 avril 2025
Base Documentaire : Soft Law

► Référence complète : Perspectives de l'OCDE sur la politique de la réglementation 2025, Editions OCDE.
____
_____
____
►Présentation par l'OCDE de son rapport : Le rapport met en exergue que 82% des pays de l’OCDE imposent une participation systématique des parties prenantes pour élaborer les réglementations, que 41% doivent envisager des modes de conception agiles et flexibles pour formuler les réglementations, que 30% doivent tenir systématiquement compte de l’effet de leurs réglementations sur d’autres pays.
(commentaire : ce qui est présenté comme des "chiffres-clés" souligne ce qui est important pour l'OCDE, la façon dont les questions et les réponses ont été formulées par les pays).
Le dialogue pourrait être plus inclusif et les retours d’informations restent difficiles
L’obligation de mener des consultations sur les projets de réglementations est courante dans la zone OCDE. Quand un problème survient, les pays sont plus susceptibles de procéder à des consultations sélectives que de lancer un vaste dialogue. Les citoyens veulent aussi savoir en quoi ils ont aidé à une meilleure élaboration des normes, même si seul un tiers des Membres de l’OCDE leur procure un retour d’informations post-consultation, sachant que cette pratique n’a guère changé au cours des dix dernières années.
Intégrer des approches fondées sur les risques aux politiques de la réglementation peut améliorer les résultats
Les pouvoirs publics sont chargés de mettre en œuvre les réglementations en exerçant des fonctions d’orientation, de suivi, de conformité et de mise en œuvre des textes. Pour déployer ces efforts en fonction des risques éventuels, de leur probabilité et de leur impact, il convient d’accorder une plus grande priorité aux activités à haut risque qu’à celles qui le sont moins, ce qui fait gagner du temps et des ressources aux entreprises et aux pouvoirs publics tout en améliorant les résultats. Les approches fondées sur les risques peuvent fortement favoriser les transitions écologique et numérique.
Les pouvoirs publics peuvent renforcer leur politique de la réglementation afin de soutenir l’innovation au sein de la société
L’ampleur et le rythme de l’innovation sont en train de bouleverser le fonctionnement des sociétés et des économies, mais le processus d’élaboration des règles n’a pas toujours suivi. Si les pouvoirs publics évaluent de plus en plus les effets de l’innovation, il faut que beaucoup aillent encore plus loin pour gagner en flexibilité par l’expérimentation, par l’utilisation de bacs à sable réglementaires et par l’adoption d’autres approches non réglementaires. De même, il est possible d’améliorer la coordination entre les administrations – y compris entre leurs différents niveaux – pour partager informations et compétences sur les défis de l’innovation.
________
11 mars 2025
Conférences

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le juriste, requis et bien placé pour le futur", in Groupe Lamy Liaisons, Les Éclaireurs du Droit, Hôtel de l’Industrie, Place Saint Germain des Près, Paris, 11 mars 2025, 16h.
____
Cette intervention ouvre une manifestation composée de 4 ateliers dont les thèmes respectifs sont :
- Le défi de la confiance
- Le défi du risque
- Le défi de la transmission
- Le défi du leadership
____
🧮consulter le programme complet de cette manifestation
____
____
🎥regarder la courte présentation video faite après le colloque
____
📝lire le compte-rendu qu'il fût fait de l'intervention par Lamy online
____
► Résumé de l'intervention préparée : Les 4 sessions aborderont les thèmes successifs de confiance, de risque, de transmission et de leadership, auxquels les professionnels de droit sont confrontés, notamment du fait des algorithmiques.
Pour d'une part ne pas traiter en soi ces sujets que d'autres vont traiter et parce que d'autre part, il convient d'aborder la question à partir de ce qu'est le futur.
Le futur a une part de stabilité : à cette stabilité, c'est-à-dire le maintien du passé, le juriste peut contribuer (I).
Le futur a une part de prévisibilité : à cette part, le juriste doit l'accroitre (II).
Le futur a une part de nouveauté radicale : à cette part, qui peut correspondre à un précipice, si personne n'avait imaginé, le juriste peut aussi être là. Or, l'on pense aux juristes plutôt dans les 2 premières hypothèses, moins dans celle-ci (III).
A chacune de ces 3 dimensions, les juristes, en tant qu'ils forment une communauté qui doit demeurer soudée autour de l'idée même du droit (les algorithmes ne conçoivent pas d'idée, ce sont les humains qui les transmettent à d'autres humains, le système algorithmique devant demeurer être un média), doivent être présents.
Dans chacune de ces dimensions, le système algorithmique (AI) est présenté comme remplaçant l'humain ou dominant l'humain.
En ce qui concerne la stabilité de l'avenir, le juriste peut et doit y contribuer notamment par la transmission car il n'y a d'autant moins de page blanche que la "création" algorithmique s'appuie sur les données du passé, la formation, où l'humain va être d'autant plus au centre qu'il faut manier des machines.
En ce qui concerne la prévisibilité de l'avenir, il s'agit d'évaluer les risques, particuliers et systémiques, risques juridiques ou non-juridiques, pour ne pas les prendre ou pour les prendre. Plus le juriste sera associé à la prise de risque et plus il sera à sa place, avant et dans l'action.
En ce qui concerne le radicalement nouveau de l'avenir, il n'est pas aisé de qualifier d'AI comme tel ou non, mais la possible disparition de l'Etat de Droit aux Etats-Unis en est un. L'on attend alors du juriste d'avoir deux vertus (que l'algorithme ne soit pas) : la vertu de justice et la vertu de courage. C'est celles-là que nous devons transmettre et partager.
____
L'actualité m'a conduite à consacrer le temps qui m'était imparti à insister sur une seule perspective, la troisième, pour dire ce que l'on attend des juristes si l'on perçoit du radicalement nouveau dans le futur proche.
En effet, aux Etats-Unis sont associés d'une part un chef de l'Etat pour lequel le Droit n'existe pas et qui utilise le pouvoir de la réglementation pour exprimer son indifférence absolue à l'encontre des Etats, des entreprises, des êtres humains, et d'autre part un entrepreneur qui affirme qu'il va devenir le maître de la technologique algorithmique, système sur lequel il exerce déjà une grande puissance.
Face à cette nouveauté radicale, l'on attend de la communauté des juristes, de tous les juristes, quelle que soit leur place, leur maîtrise technique, leur niveau, leur nationalité, qu'ils s'expriment pour dire Non. Comme l'ont fait Kelsen, Cassin ou Ginsberg. Dire Non et aider les autres à dire Non. Pour cela, ils faut que ces êtres humains que sont les juristes, en tant qu'ils se soucient des autres êtres humains, aient conscience de la double vertu qui est attendue d'eux : la vertu d'attachement à la justice et la vertu de courage.
________
7 novembre 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Th. Favario, "Le contenu du "rapport de durabilité"", JCP E, 7 nov. 2024, n° 45, doss. 1319, pp. 28-33
____
► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Mesure emblématique de la directive du 14 décembre 2022 (directive CSRD) désormais transposée en droit interne, le « rapport de durabilité » complète l'information due par les sociétés les plus importantes. Tenues d'y rendre compte de la manière dont elles intègrent « les enjeux de durabilité », ce rapport impose en creux à ces sociétés de s'inscrire dans une dynamique de « durabilité » de nature à influer sur leur organisation et leur activité.".
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
27 mai 2024
Conférences

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Contentieux Systémique Émergent du fait du système numérique", in Les contrôles techniques des risques présents sur les plateformes et les contentieux engendrés, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 27 mai 2024, 9h-10h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin
____
🧮consulter le programme complet de cette manifestation
____
🧮consulter le programme de l'ensemble du cycle Contentieux Systémique Émergent
____
🔲consulter les slides ayant servi de support à l'intervention
____
🌐consulter sur LinkedIn les slides ayant servi de support à l'intervention
____
🎤consulter une présentation de la seconde intervention de Marie-Anne Frison-Roche prononcée lors de cette conférence-débat : "Un contentieux systémique in vivo : le cas dit des sites pornographiques"
____
____
____
► Résumé de cette conférence : cette intervention est préalable aux trois interventions plus substantielles et vise à montrer en quoi le système numérique par nature produit et va produire un "Contentieux Systémique".
En effet, le "Contentieux Systémique" se définit par des "causes" (notion procédurale) qui sont portées devant des juges, qui peuvent être de première instance, éventuellement des juges de l'urgence, dans lesquelles sont impliquées les intérêts, voire l'avenir, d'un système au-delà du litige entre les parties.
Ce cas systémique peut être présenté devant un juge spécialisé, y compris devant l'organe juridictionnel d'une Autorité de Régulation ou de Supervision, mais aussi devant un juge de droit commun, sur la base d'un texte spécial mais éventuellement sur un texte de droit commun. Il peut alors se produire un éclatement du contentieux, alors même que l'unité du système demeure, voire est en jeu, dans le présent et dans l'avenir.
Le "système numérique" est exemplaire de la production "naturelle" de Contentieux Systémique qui naissent du seul fait du système numérique, notamment en raison de risques systémiques inhérents à ce système, au fait que leur prévention et leur gestion sont internalisés dans les opérateurs qui ont construit et gèrent le système (Droit de la Compliance). L'enjeu est alors celui de l'interrégulation.
Les plateformes font plus particulièrement émerger un Contentieux Systémique en raison de la spécificité de certains risques, par exemple, désinformation, terrorisme, destruction des droits (les droits d'auteur n'étant qu'un exemple), risque d'accès des mineurs à des contenus destructeurs pour eux, etc.
Le Contentieux Systémique Numérique ne fait que commencer.
Il est essentiel que les juges y sont préparés et qu'ils y fassent face ensemble.
________
24 mai 2024
Conférences

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Surplomb
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Synthèse", in Concurrence : les enjeux de la Compliance. Programme de conformité : le Document-cadre de l’Autorité de la concurrence. Retour d’expériences pratiques deux ans après, 24 mai 2024, Paris, Collège européen de Paris, Université Panthéon-Paris-Assas, 28 rue Saint-Guillaume 75007 Paris.
____
🧮consulter le programme complet de cette manifestation
____
► Présentation de la synthèse, faite sur le banc : le colloque s'est appuyé sur le "document-cadre" que l'Autorité de la concurrence a publié le 24 mai 2022 relatif aux programmes de conformité et a développé principalement l'un des outils de ceux-ci, à savoir la cartographie des risques. Le soin d'associer des universitaires dont le métier est de rendre compte de la réalité en la classant et en la nommant, ce qui la rend celle-ci plus facilement maniable, et des personnes qui dans les entreprises chaque jour trouvent des solutions pour anticiper des difficultés afin qu'elles soient résolues, voire qu'elles n'adviennent pas, a produit ses fruits.
____
De l'ensemble des discussions, il ressort 4 perspectives, qui montrent chacune ce qui est acquis, ce qui peut encore en ressortir en interaction avec tous les autres mécanismes en Droit de la Compliance qui intègrent la cartographie des risques (Sapin 2, loi dit "Vigilance", directive CS3D, etc.) et les autres mécanismes qui sont corrélés avec la cartographie des risques (audit, enquêtes internes, éléments probatoires susceptibles d'être évoqués devant un juge par l'entreprise et/ou par une partie concernée) et ce qui reste incertain dans ce document-cadre.
_____
La première perspective est la base même de ces prescriptions, recommandations, encouragements, méthodes, préconisations, etc.
La deuxième perspective sont les moyens développés pour établir et faire vivre ces programmes de compliance.
La troisième perspective est la portée de ce document-cadre, dont dépend aussi en grande partie de la portée des programmes de compliance adoptés par les entreprises eux-mêmes
La quatrième perspective sont les sujets de droit astreints, ou bénéficiaires, bref concernés par l'adoption de tels programmes de compliance en Droit de la concurrence.
____
Pendant cette conclusion en ne m'appuyant que sur les propos de chaque intervenant, j'ai poursuivi les réflexions dans chacune de ces 4 directions
Cela m'a remis en mémoire certains de mes travaux sur ce sujet :
- M.A. Frison-Roche, 📝programme de conformité (compliance), in Dictionnaire du Droit de la concurrence, 2021 (2Ième éd. sous presse).
- M.A. Frison-Roche, 📝L'appui du Droit de la Compliance pour la maîtrise quotidienne du Droit de la concurrence, in Mélanges Laurence Idot, 2022.
- M.-A. Frison-Roche, Dresser des cartographies des risques comme obligation et le paradoxe du "risque de conformité", in Les outils de la compliance, 2021.
- M.A. Frison-Roche, M.A., 📧 Vertus et non-dits du nouveau documents-cadre sur les programmes de compliance en droit de la concurrence, 2021.
- M. A. Frison-Roche, 📝Théorie juridique de la cartographie des risques, centre du Droit de la Compliance, 2019.
- M.A. Frison-Roche, 📝Concurrence et Compliance, 2018.
Pendant cette manifestation, universitaires, avocats et juristes d'entreprises ont rendu compte de la façon dont le document-cadre de l'ADLC du 22 mai 2022 les avait aidés à mieux établir leur cartographie des risques.
Cela était très instructif, puisque tous ont raconté et discuté comment cela se pratique sous les fourches caudines et l'appui de ce droit que l'on dit souple : Fabrice Picod, professeur à Panthéon-Assas université , directeur du Centre de droit européen (CDE), Frederic Puel, avocat associé du cabinet Fidal, Pierre de Gouville, avocat associé, Fidal, Alix Voglimacci, directrice juridique et compliance de PepsiCo France, Gaëlle Hardy, professeure à l’Université des Antilles, et Marie-Pascale Heusse, responsable droit de la concurrence du Groupe BNP Paribas.
De l'ensemble des discussions, il ressort 4 perspectives, qui montrent chacune ce qui est acquis, ce qui peut encore en ressortir en interaction avec tous les autres mécanismes du Droit de la Compliance qui intègrent la cartographie des risques (loi dite "Sapin 2", loi dite "Vigilance", directive CS3D, etc.) et les autres mécanismes qui sont corrélés avec la cartographie des risques (audits, enquêtes internes, éléments probatoires susceptibles d'être évoqués devant un juge par l'entreprise et/ou par une partie concernée) et ce qui reste incertain dans ce document-cadre.
La première perspective est la base juridique de ces prescriptions, recommandations, encouragements, méthodes, préconisations, etc. La concurrence est souvent explicitement ou implicitement la base de nombreux dispositifs de compliance, par exemple dans la directive sur la vigilance.
La deuxième perspective correspond aux moyens développés pour établir et faire vivre ces programmes de compliance. A côté de la cartographie des risques, il y a les audits et les enquêtes internes, les entretiens menés pour établir la cartographie, qui humanisent celle-ci, ayant de nombreux points de contact avec les audits et les enquêtes et ouvrant ainsi des difficultés communes, comme la confidentialité.
La troisième perspective est la portée de ce document-cadre, dont dépend aussi en grande partie la portée de des programmes de compliance adoptés par les entreprises elles-mêmes, de gré lorsqu'il s'agit de concurrence, de force lorsqu'il s'agit d'antiblanchiment, de lutte contre la corruption ou de vigilance, ce qui rend la portée difficile à mesurer lorsque le programme est global, comme le document-cadre le préconise.
La quatrième perspective concerne les sujets de droit astreints, ou bénéficiaires, bref concernés par l'adoption de tels programmes de compliance en Droit de la concurrence. Cela est certes l'entreprise concernée, sollicitée ou contraintes par l'Autorité qui agit pour remplir son propre office de sauvegarde du système à l'avenir, la "durabilité" étant une notion essentielle du Droit de la Compliance, qui fait passer les régimes des règles de l'Ex Post à l'Ex Ante, y compris en Droit de la concurrence, ce qui est proprement une révolution. Les sujets de droit sont aussi les "parties prenantes", catégorie qui demeure assez mystérieuse, le Droit des sociétés étant lui-même transformé par ce que l'on désigne comme la "gouvernance". Mais techniquement cela engendre des droits à l'information, des droits au recours. De ces questions techniques, aux enjeux procéduraux essentiels, les juridictions sont actuellement saisies. Il en ressort que, y compris pour la cartographie des risques, nul ne semble plus être vraiment un "tiers"....
C'est alors la question des secrets et des destinataires de la cartographie des risques qui est posée : conçue comme un outil pour les managers, conçue comme un moyen de préservation des systèmes par l'Autorité, peut-elle être conçue pour des personnes concernées comme un moyen d'action dans une perspective plus générale de reddition des comptes, puisqu'elle signale des risques ? De cette question-là, aussi, les tribunaux commencent à être saisis.
Ainsi, pendant cette conclusion, faite en m'appuyant sur les propos très pertinents de chaque intervenant, j'ai donc pu poursuivre les réflexions dans chacune de ces 4 directions.
Ce sujet est à la croisée de deux chemins : en ce qu'il porte sur la cartographie des risques, outil majeur du Droit de la Compliance d'une part et en ce qu'il rapproche Droit de la Concurrence et Droit de la Compliance, d'autre part.
Ces croisements vont s'accroître mais vont aussi provoquer des heurts car, pour ne prendre qu'un exemple, la Vigilance requiert des structures de collaboration qui doivent s'articuler avec la prohibition des ententes, tandis que la contractualisation de la Compliance, phénomène majeur, peut constituer un abus de position dominante.
_________
18 avril 2024
Base Documentaire : Doctrine
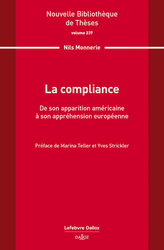
► Référence complète : N. Monnerie, La compliance. De son apparition américaine à son appréhension européenne, Dalloz, coll. "Nouvelle Bibliothèque de Thèses", vol. 237, 2024, 500 p.
____
____
📗lire le sommaire de l'ouvrage
____
📗lire la table des matières de l'ouvrage
____
► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Cette recherche est consacrée à l'émergence de la compliance dans la sphère juridique. À ce titre, elle constitue une des premières études transversales sur cette nouvelle notion.
Appliquée à l'encadrement du comportement des grandes sociétés, la compliance effraie tant qu'elle fascine, alors qu'elle a parfois été considérée comme un phénomène non juridique, une régulation hors du droit. L'intuition émaillant cet ouvrage soutient que la notion de compliance désigne un instrument juridique uniforme et fonctionnel. Enjeu majeur des entreprises et des organisations de tous secteurs, la compliance étend de plus en plus son champ et sa complexité. La mise en place d'un système de compliance efficace est un défi pour de nombreuses entreprises, qui doivent concilier exigences légales et réglementaires avec les contraintes opérationnelles et les objectifs économiques des sociétés. De leur côté, les États sont également confrontés à cet instrument au travers des sanctions prononcées par les autorités étrangères à l'encontre de sociétés domestiques.
L'ambition de cet ouvrage est de systématiser le processus de la compliance, d'analyser son incidence sur l'encadrement des sociétés, tout en appréciant l'opportunité de sa transplantation hors des États-Unis.
Une approche macro-comparative et historique démontre comment la compliance a fini par devenir un instrument permettant à l'État américain de déléguer le contrôle de l'application des normes substantielles. D'un instrument au service de la gestion du risque des sociétés, elle a fini par devenir un standard axé sur la prévention et la coopération. L'étude de l'exportation de la compliance révèle, au moyen de micro-comparaisons, que son arrivée en Europe résulte de l'application extraterritoriale du droit américain. Tout en démontrant qu'après avoir rejeté cette pratique, certains États ont décidé de recourir à une transplantation légale afin d'intégrer cet instrument dans leur ordre juridique.
L'ouvrage conclu en dressant plusieurs pistes de réflexion adressée aux autorités législatives afin de les aider à appréhender les difficultés inhérentes à la transplantation de la compliance.".
________
15 février 2024
Base Documentaire : Doctrine
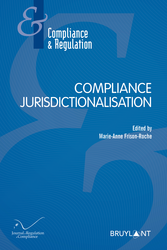
► Reference complète : A. Bruneau, "The company judges itself: the Compliance function in the bank", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2024, pp. 127-145
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié
____
► Summary of the article : First of all, it should be remembered that the compliance function was born within finance, and that by being structured, it has evolved to support the transition from regulatory law to compliance law. Through these changes, compliance has gone from an ex-post controlling function to an ex-ante binding function. The LIBOR crisis imperfectly illustrates the primacy of this transition. The evolution of this role is illustrated by concrete examples
Firstly, the management of reputational risk is a fundamental part of the company as prosecutor and judge of itself. Reputational risk is a significant element for a financial institution, because it can have negative consequences on its capitalization, or even culminate in a systemic crisis. Avoiding a large-scale financial crisis is also part of the monumental goals of compliance.
In order to avoid complex and inopportune scenarios, compliance law intervenes as early as possible and identifies issues that may impact reputation. The regulations require the implementation of certain ex ante mechanisms. The French law known as "Sapin 2" requires the implementation of tools that concern all companies (and not just banks). Indeed, beyond the risk of reputation, it is essential to consider the risk of corruption. Consideration of reputational risk may justify refusing to execute certain transactions. From this perspective, compliance must assess the potential consequences of entering into a relationship with a new client upstream, sometimes to decline the provision of services. The compliance function therefore unilaterally judges the relationship with a view to managing the company reputational risk.
Secondly, the internal sanction mechanism established by compliance law is also discussed in this article, in particular the internal sanctions adopted by compliance in a financial institution. Compliance can act as a prosecutor via management committees set up within the business lines. In addition, compliance can determine and apply sanctions against employees. In this way, there is a dual role of prosecutor and judge for the compliance function within the framework of an extraordinary mechanism of ordinary law.
Finally, the analysis deals with the case of the "judge-judged": following a decision by the bank, the regulator may take an even stricter position by believing that the bank is applying its guidelines incorrectly. Thus, the compliance law, which takes hold within the banking enterprise, finds itself under the judgment of its own regulator. The company finds itself judged and comes to be a prosecutor and judge of itself, but also of its clients.
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
15 février 2024
Base Documentaire : Doctrine
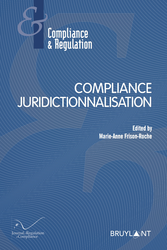
► Référence complète : S. Merabet, "Vigilance, being a judge and not judge", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2024, pp. 218-228
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article :
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
12 janvier 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : M. Mekki, "Pour une compliance notariale", JCP N, n° 01-02, 12 janvier 2024, étude n° 1000, pp. 31-34
____
► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le droit est souvent appréhendé sous l'angle des risques qu'il crée ou qu'il canalise, cadre dans lequel la logique de compliance, outils de prévention et de gestion des risques systémiques, se déploie de manière exponentielle. Dans ce contexte, le notaire s'impose, en sa qualité d'officier public et ministériel, comme un acteur privilégié non seulement pour conseiller les entreprises qui s'engagent dans cette démarche proactive de compliance, mais également et surtout en sa qualité de gardien, Gatekeeper, enrichissant le service public de la sécurité juridique et numérique d'une nouvelle mission : contribuer à prévenir et à gérer les risques systémiques, dans une logique de régulation, principalement dans le domaine de la lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement des activités illicites, risques systémiques plus intenses en raison principalement de la dématérialisation des actifs (crypto-actifs) et de l'internationalisation des échanges."
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
28 septembre 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : V. Magnier, "Devoir de vigilance et risques climatiques", in F. Barrière et M. Zolomian (dir.), Le droit des sociétés saisi par le climat, JCP E, n° 39, 28 septembre 2023, pp.18-21.
____
► Résumé de l'article (fait par l'auteure) : "L’introduction des outils de la compliance en droit des sociétés crée une approche juridique binaire : l’une préventive, l’autre de contrôle et de responsabilité. Alors que la loi sur le devoir de vigilance adopte cette double approche, l’analyse révèle qu’en dépit de l’encadrement d’un dispositif préventif ambitieux, la loi sur le devoir de vigilance peine sur le second volet, les contrôle et responsabilité restant lacunaires.".
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
_________
7 septembre 2023
Publications
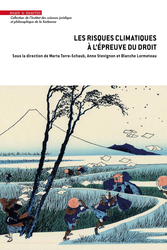
🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Droit de la compliance et climat. Pour prévenir le risque et construire l'équilibre climatiques", in M. Torre Schaub, A. Stevignon et B. Lormeteau (dir.), Les risques climatiques à l'épreuve du droit, Mare & Martin, coll. "Collection de l'Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne", 2023, pp.73-83
____
____
🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertexte
____
► Résumé de l'article : Le Droit de la Compliance commence à se manifester en matière climatique et l'on parle de Droit de la compliance climatique, mais la question climatique n'est elle-même que l'exemple le plus parfait de ce pour quoi le Droit général de la Compliance est fait. Il s'agit en effet d'une branche du Droit nouvelle, d'un Droit global ayant la prétention d'apporter en Ex Ante des solutions ici et maintenant pour des sujets globaux, afin qu'à l'avenir des catastrophes systémiques ne se réalisent pas : ce sont ces "Buts monumentaux" qui donnent sens, cohérence et simplicité au Droit de la Compliance.
Celui-ci, lié à l'État de Droit, permet de dépasser le choix souvent présenté entre l'efficacité de la protection de la planète et le renoncement aux libertés, notamment la liberté d'entreprendre et la liberté des personnes, de la protection de leurs données.
Le Climat est ainsi exemplaire des Buts Monumentaux du Droit de la Compliance (I). Le risque systémique qu'il constitue désormais est analogue aux risques systémiques bancaire ou numérique et appelle donc l'application des instruments juridiques identiques, anciennement mis en place pour la banque, inventés récemment pour le numérique. Le Droit de la Compliance, en ce qu'il prolonge le Droit de la Régulation, en se dégageant de la condition préalable du Secteur et du Territoire, est en effet la branche qui permet de mettre en place des solutions juridiques nouvelles, soit de force (convention judiciaire d'intérêt public, programmes de compliance, etc.), soit de gré (engagements, chartes globales, etc.).
S'opère ainsi une alliance entre Autorités politiques, publiques, et opérateurs économiques cruciaux (II), que la montée en puissance de la "raison d'être" exprime et dont l'enjeu technique est la collecte d'informations qu'il faut corréler. Les scientifiques mettant en commun une information, bien public, apportée par les entités publiques et privées. Les juridictions sont alors au centre d'un Droit dont l'objet est l'Avenir.
________
7 septembre 2023
Base Documentaire : Doctrine
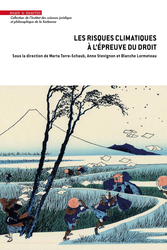
► Référence complète : M. Torre Schaub, A. Stevignon et B. Lormeteau (dir.), Les risques climatiques à l'épreuve du droit, Mare & Martin, coll. "Collection de l'Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne", 2023, 362 p.
____
____
____
► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur) : "Le présent ouvrage explore l’appréhension juridique d’un nouveau concept : le « risque de transition », concept découlant du changement climatique. En effet, le phénomène du changement climatique crée et amplifie des aléas qui sont à l’origine de plusieurs périls encore peu considérés par le droit (risques contentieux, financiers et réglementaires). Pour assurer la pérennité de nos sociétés, toutes les dimensions de ces dangers doivent être identifiées et traitées. Les contributions proposées ont pour objectif de dresser une typologie des risques climatiques et de présenter des pistes juridiques pour y faire face. À l’échelon global, national et territorial, se pose la question de la reformulation de la responsabilité des États, mais également des acteurs privés (entreprises, banques, sociétés d’investissement), face aux aléas non maîtrisés. De nouvelles législations et réglementations internationales, européennes et nationales émergent, tendant à aborder ces risques. Cet ouvrage en fait état, ainsi que des développements contentieux climatiques inédits que s’y rattachent.".
____
📝lire l'article de Marie-Anne Frison-Roche : "Droit de la compliance et climat. Pour prévenir le risque et construire l'équilibre climatiques"
________
30 mars 2023
Base Documentaire : Doctrine
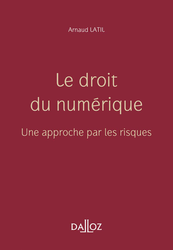
► Référence complète : A. Latil, Le droit du numérique. Une approche par les risques, Hors Collection, Dalloz, 2023, 300 p.
____
____
____
► Résumé de l'ouvrage (fait par l'auteur) : "Le droit du numérique est une matière en pleine construction. Cet ouvrage propose d'éclairer son histoire, ses évolutions et ses nombreuses ramifications. en droit civil, en droit de la consommation et en droit pénal. mais aussi en droit administratif et en matière de libertés fondamentales. Il envisage les activités numériques comme la mise en oeuvre de techniques. au même titre que les techniques industrielles ou scientifiques.
Le droit du numérique est fondé sur une « approche par les risques ». Cette approche est aujourd'hui au centre des politiques publiques européennes et internationales. Elle s'applique au droit des marchés financiers, au droit alimentaire ou encore au droit de la cybersécurité. Ses trois dimensions sont ici explorées : l'approche par les risques est libérale. préventive et résiliente.
Le droit des risques trouve ses racines dans la philosophie et la sociologie des techniques. Il vise la protection de la santé, de la sécurité et des droits fondamentaux en mobilisant des notions complexes. comme la confiance, la neutralité, la souveraineté, l'innovation ou encore la résilience. Le droit des risques reste cependant encore mal connu. Il est pourtant à l'origine de mutations majeures de nos systèmes juridiques.".
________
2 février 2023
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : A. Bruneau, "L'entreprise juge d'elle-même : la fonction compliance dans la banque", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 115-131.
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : Tout d’abord il faut rappeler que la fonction compliance est née au sein de la finance, et qu’en se structurant, elle a évolué pour accompagner le passage du droit de la régulation au droit de la compliance. Par le biais de ces mutations, la compliance est passée d’une fonction contrôlante ex-post à une fonction contraignante ex-ante. La crise du LIBOR illustre imparfaitement la primauté de cette transition. L’évolution de ce rôle est illustrée par des exemples concrets.
Dans un premier temps, est étudiée la gestion du risque de réputation élément fondamental de l’entreprise procureur et juge d’elle-même. Le risque de réputation est un élément non négligeable pour un établissement financier, car celui-ci peut engendrer des conséquences négatives sur sa capitalisation, voire culminer en crise systémique. L’évitement de la crise financière de grande ampleur s’inscrit également dans les buts monumentaux de la compliance.
Afin d’éviter des scénarios complexes et inopportuns, le droit de la compliance intervient le plus en amont possible et identifie les sujets susceptibles d’impacter la réputation. La réglementation impose la mise en place de certains dispositifs ex ante. La loi Sapin 2 exige la mise en place d’outils qui concernent l’ensemble des entreprises (et non pas seulement les banques). En effet, au-delà du risque de réputation, il est essentiel de considérer le risque de corruption. La considération du risque de réputation peut justifier le refus d’exécuter certaines opérations. Dans cette optique la compliance doit évaluer les potentielles conséquences de l’entrée en relation avec un nouveau client en amont, pour parfois décliner la prestation de services. Ainsi la fonction compliance juge de façon unilatérale la relation en vue de gérer son risque de réputation.
En second lieu, le mécanisme de sanction interne institué par le droit de la compliance est également abordé, notamment les sanctions internes adoptées par la compliance dans un établissement financier. La compliance peut agir en tant que procureur via des comités conduite mis en place au sein des métiers. En outre, la compliance peut déterminer et appliquer des sanctions à l’encontre des collaborateurs. De la sorte, on constate un double rôle de procureur et juge pour la fonction compliance dans le cadre d’un dispositif extraordinaire du droit commun.
Enfin, l’analyse traite du cas du jugeant-jugé : à la suite d’une décision de la banque, le régulateur peut prendre une position d’autant plus stricte en estimant que la banque applique mal ses lignes directrices. Ainsi, le droit de la compliance qui s’installe au sein de l’entreprise bancaire, se retrouve lui-même sous le jugement de son propre régulateur. L’entreprise se retrouve jugée et est amenée à être procureur et juge d’elle-même, mais aussi de ses clients.
__________
30 mars 2021
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

► Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Pourquoi régule-t-on? Si c'est pour prévenir les risques systémiques, les "family offices" systémiques doivent y être soumis (cas Archegos), Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation, 30 mars 2021
Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
Résumé de la news:
Archegos était une entreprise de gestion de fortune dont l'activité consistait principalement à gérer des fonds qui n'étaient pas eux mêmes issus des marchés financiers (d'où son titre de "family office"). Manifestement, Archegos se révélait financièrement trop fragile au regard des engagements très spéculatifs qu'il a pris sur les marchés financiers et des banques systémiques ont notamment été profondément affectées par la liquidation d'importants montants par Archegos pour pouvoir répondre aux appels de marge.
Comme le mandat des autorités de régulation financière vise quasi-exclusivement la protection de l'épargne publique, Archegos échappait intégralement à la régulation et à la supervision de la Securities and Exchange Commission (SEC). Or, le Droit de la Régulation vise également à prévenir et gérer les risques systémiques, qui sont souvent pluri-sectoriels et même trans-sectoriels, et ce de manière téléologique. Au regard de cela et de la place de plus en plus importante prise par les comportements spéculatifs sur les marchés financiers, les autorités de régulation financière doivent abandonner la condition d'usage d'épargne publique dans leur considération des opérateurs devant être régulés car même un opérateur ne manipulant pas d'épargne publique peut menacer l'existence des marchés financiers. Dans cette perspective, les "family offices", ne manipulant pas d'épargne publique mais ayant une dimension systémique doivent entrer sous la régulation et la supervision des autorités de régulation financière.
13 mars 2021
Compliance : sur le vif

5 mars 2021
Auditions par une commission ou un organisme public

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Appliquer la notion de "Raison d'être" à la profession du Notariat", audition par le Conseil supérieur du notariat (CSN), 5 mars 2021.
____
🔴trois ans plus tard, cette démonstration fût reprise et approfondie dans une audition devant le Conseil Supérieur du Notariat à propos de la Compliance, sur laquelle un rapport était élaboré, les notions de raison d'être et de compliance étant intimement corrélées comme cela est montré ci-dessous : consulter la présentation de l'audition de 2024..
____
Résumé de l'intervention débutant l'audition : L'on peut prendre "raison d'être" dans son sens courant et dans son sens plus juridique. Dans son sens courant, il est bien difficile de déterminer ce qu'est une "raison d'être". Le plus souvent on ne le traduit pas, en anglais on dira purpose , c'est-à-dire ce qui caractérise l'être humain par rapport à la machine, comme le souligna Alain Supiot, tandis que la langue japonaise le traduit comme Ikigaï, ce qui va animer la personne. L'on sent bien que le souffle de l'esprit passe dans cette notion, qui anime la personne, la porte dans une action qui ne sera pas mécanique, qui va la dépasser elle-même, la fait tout à la fois se distinguer des autres et se rapprocher de ses alter ego....
Mais le Droit a transformé cette notion, si proche de l'éthique, voire de l'art, par laquelle l'individu est "transporté dans le temps par une action partagée avec quelque uns, en un "conception juridique". Cette expression de "raison d'être" est aujourd'hui estampillée par le Droit. A travers une vision renouvelée de l'Entreprise, désormais portée par la législation. En tant qu'une entreprise, selon une définition fortement développée par Alain Supiot est un "projet commun" qui vise une action commune concrétisant un projet conçu ensemble pour être réalisé dans le futur, l'organisation et les moyens n'étant que le reflet de cela. Dans cette définition de l'entreprise, centrée sur la "raison d'être", l'organisation, les moyens, les pouvoirs et les droits de chacun, les rouages internes et les intérêts extérieurs ne sont pas premiers, ils sont totalement imprégnés par cette "raison d'être". Dire la raison d'être, l'affirmer et savoir précisément ce qu'elle est dessine la régime applicable. C'est pourquoi la "raison d'être" a changé en 2019 le Droit des sociétés et le Droit financier.
Elle fût d'abord adoptée par le rapport que Nicole Notat et Dominique Senard remirent le 9 mars 2018 au Ministre de l'Economie et des Finances en réponse à la question posée par celui-ci : l'entreprise peut-elle contribuer à l'intérêt général ? Et la réponse tînt dans cette expression-là : pourquoi pas, si c'est la "raison d'être" de l'entreprise que de s'arracher à la seule préoccupation de se développer afin de devenir toujours plus riche, d'avoir aussi un projet qui inclut le souci d'autrui, d'un autrui qui n'ait pas pour seul souci l'appât du gain, d'avoir le souci d'un intérêt autre (les autres visant pour les auteurs de ce rapport "l'intérêt collectif" et non plus l'intérêt général), par exemple l'intérêt de la Terre, dont la temporalité excède celle de la vie humaine, si fortunée soit cette vie de l'actionnaire et si somptueuse soit la tombe de celui-ci.
La "raison d'être" est donc une notion juridique. A ce titre le Droit des sociétés a changé et l'on en rend les mandataires sociaux responsables : ils doivent montrer qu'ils ont pris en charge d'autres intérêts. L'article 1833 du Code civil a été modifié dans ce sens. Pour pouvoir remplir les nouvelles obligations qu'engendre l'évolution de leur mandat fiduciaire, cela justifie un élargissement de leur "pouvoir" car il est plus difficile encore de faire le bien d'autrui en plus de que rendre riche les associés. Si en plus il faut se soucier de l'environnement et de l'égalité entre les femmes et les hommes ... Les études pleuvent non seulement sur la pertinence managériale et financière de l'approche (plutôt favorable) mais encore juridique (par exemple lorsqu'il y a une offre publique, l'offreur devrait-il démontrer qu'il ferait plus que le bonheur des investisseurs en se saisissant du contrôle de la société-cible ?).
Parle de "raison d'être", c'est donc appliquer un régime juridique à une organisation. Il est fructueux de prendre l'expression au sérieux, c'est-à-dire au pied de sa lettre juridique, car si le Droit est toujours ancré dans le langage courant, les mots gagnent souvent en rigueur et précision par leur entrée dans l'espace juridique. Dans le Droit des sociétés, on a pu critiquer la notion en tant qu'elle diluait la notion d'intérêt social dans de l'insécurité juridique, mais cela permet aussi à l'organisation en cause d'avoir plus de liberté pour poser par sa volonté propre ce pour quoi elle consacre ses prérogatives. Puisque c'est l'entreprise elle-même qui va pose publiquement quelle est sa "raison d'être" (comme elle a posé son objet social)
La "raison d'être" a été conçue pour une "entreprise", pour laquelle la "personnalité morale" a été définie comme n'étant qu'un instrument juridique qui lui permet d'accéder au commerce juridique, selon l'acception retenue par le rapport Notat-Senard. Le Droit va donc vers de plus en plus de "réalisme".
Le notariat se prête particulièrement bien à la notion juridique de "raison d'être". Pour trois raisons. En premier lieu, parce que le Notariat est une profession et que les professions sont des organisations qui sont souvent animées par des projets communs, un esprit commun. C'est même précisément cela que le Droit de la concurrence leur reproche, cette "entente" autour d'une communauté de valeurs, cristallisée par des règles d'organisation (même si l'évolution de ce Droit dans le bon accueil de l'organisation des "groupes de sociétés", notamment face à un appel d'offre montre que cette branche du Droit évolue).
En deuxième lieu, une étude notariale est une entreprise. Pourquoi ne pas l'admettre, et même prendre appui sur cela ? Parce que le Droit des sociétés a si fortement évolué avec la loi Pacte, l'on pourrait considérer que structurellement une étude notariale est une "entreprise à mission". Ce qui doit conduire la profession à étudier de très près ce statut emprunté au Droit britannique, droit incontestablement libéral qui conçoit qu'une entreprise se développe et fasse un chiffre d'affaires, mais pas que.
En troisième lieu, les entreprises à mission se développent dans une architecture institutionnelle par laquelle elles doivent donner à voir l'effectivité de la concrétisation de leur mission. Il a donc deux impératifs : dire exactement quelle est cette mission en amont et donner à voir à tous (et pas seulement à l'Etat) que cette mission, qui justifie de s'écarter du Droit commun de la rencontrer de l'offre et de la demande) est remplie : cela est confiée à la "profession", cadre institutionnel indispensable qui exerce un contrôle permanent (et non pas des contrôles ponctuels comme le font les Autorités de concurrence).
Dès lors, si l'on observe que l'étude notariale a une activité économique de service, ce qui est le cas, elle est légitime comme toute entreprise à avoir une "raison d'être", voire à être une "entreprise à mission". Si en outre, elle appartient à une "profession", elle est alors imprégnée de la "raison d'être" de celle-ci, ce qui n'entame pas sa nature d'entreprise (I). Les professions ne se ressemblant pas et la "raison d'être" donnant à chacun son identité, il convient de prendre au sérieux celle du Notariat pour en tirer à l'avenir les conséquences techniques (II).
Lire le plan de l'intervention ci-dessous.
2 février 2021
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A. Hatchuel, B. Segrestin, "Devoir de vigilance : la norme de gestion comme source de droit ?", Droit & Société, n° 106, 2020, p. 667-682.
____
► Résumé de l'article (fait par les auteurs) : La loi sur le devoir de vigilance introduit un mécanisme de responsabilisation atypique et insuffisamment conceptualisé. En faisant porter l'obligation des sociétés sur l'élaboration d'une gestion prévisionnelle des risques tout au long de la chaîne d'approvisionnement, la loi recourt à une "norme de gestion". L'article analyse les fondements de cette notion et montre qu'elle a été mobilisée à plusieurs reprises dans l'histoire du droit, pour accompagner les dynamiques de l'entreprise et responsabiliser ses relations avec les sociétés et les États. Il montre que le droit puise dans les connaissances et les méthodes en gestion de chaque époque, pour qualifier ce qu'est une action collective raisonnablement responsable, c'est-à-dire une action qui limite les risques encourus par les parties concernées. Prendre en compte les normes de gestion permet de repenser le statut des dirigeants et la responsabilité des entreprises. Cela ouvre aussi des perspectives théoriques nouvelles pour les sciences sociales.
________
8 décembre 2020
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : A. Trescases, "Le risque", in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 655-670
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article :
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
8 décembre 2020
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Teller, "L'intelligence artificielle", in J.-B. Racine (dir.), Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, LGDJ, coll. "Droit & Économie", 2020, pp. 461-478
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Le droit économique au XXIe siècle. Notions et enjeux, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article :
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
25 novembre 2020
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Archives de Philosophie du Droit (APD), Le principe de précaution, t. 62, Dalloz, 2020, 580 p.
____
📗lire la 4ième de couverture
____
📗lire la table des matières
____
Voir la présentation d'autres tomes des Archives de Philosophie du Droit
________