Publications : Doctrine
► Référence complète : Amrani-Mekki, S., Les plateformes de résolution en ligne des différends, in L'émergence d'un droit des plateformes, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2021, pp.189-203.
_____
► Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel s'insère cet article.
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : E. Netter, "Les technologies de conformité pour satisfaire les exigences du droit de la compliance. Exemple du numérique", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de cette contribution (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L’auteur distingue la Compliance qui renvoie aux buts monumentaux et la conformité, qui sont les moyens concrets que l’entreprise utilise pour tendre vers eux, par des procédés, des checks-liksts dans le suivi desquels l’opérateur rend des comptes (art. 5.2. RGPD). La technologie permet à l’opérateur de satisfaire à cette exigence, le caractère changeant des technologies s’ajustant bien au caractère très général des buts visés, qui laissent un large place aux entreprises et aux autorités publiques qui produisent du droit souple.
L’étude s’attache tout d’abord aux technologies existantes. A ce titre, le Droit peut par la Compliance interdire une technologie ou en restreindre l’usage, parce qu’elle contrarie les buts visés, par exemple la technologie de la décision entièrement automatisée produisant des effets juridiques sur des personnes. Parce que l’exercice est périlleux de dicter par la loi ce qui est bon et ce qui est mauvais en la matière, la méthode est plutôt celle de l’explicabilité, c’est-à-dire de la maîtrise par la connaissance par les autres.
Les Régulateurs développent pourtant de nombreuses exigences issues des Buts Monumentaux de la Compliance. Les opérateurs doivent mettre à jour leur technologie ou abandonnent la technologie obsolescente au regard des nouveaux risques ou pour permettre une concurrence effective ne n’enfermant pas les utilisateurs dans un système clos. Mais la puissance technologique ne doit pas se retourner et devienne trop intrusive, la vie privée et la liberté des personnes concernées devant être respectées, ce qui conduit aux principes de nécessité et de proportionnalité.
L’auteur souligne que les opérateurs doivent se conformer à la réglementation en recourant à certaines technologies, si elles sont disponibles, voire de contrecarrer celles-ci si elles sont contraires aux buts de la réglementation mais uniquement toujours si elles sont disponibles, la notion de « technologie disponible » devenant donc le critère de l’obligation ce qui en fait varier le contenu au fil des circonstances et du temps, notamment en matière de cybersécurité.
Dans une seconde partie, l’auteur examine les technologies qui ne sont que potentielles, celles que le Droit, notamment le Juge, pourrait requérir de l’entreprise qu’elle les invente pour remplir son obligation de compliance. Cela se comprend bien lorsqu’il s’agit de technologies en germe, dont la réalisation va se réaliser, par exemple en matière de transfert de données personnelles pour satisfaire le droit à la portabilité (RGPD) car il faut inciter les entreprises à développer des technologies qui leur sont d’un profit moins immédiate ou en matière de paiement sécurisé pour assurer une authentification forte (DSP 2).
Cela est plus difficile pour des technologies dont la faisabilité n’est pas même certaine, comme la vérification de l’âge en ligne ou l’interopérabilité des messageries sécurisés, deux exigences qui paraissent technologiquement contradictoires dans leurs termes , ce qui relève donc encore de la « technologie imaginaire ». Mais par la Compliance la pression exercée sur les entreprises, notamment les entreprises technologiques du numérique est telle que les investissements sont considérables pour y arriver.
L'auteur conclut que c'est pourtant l'ambition même de la Compliance et que l'avenir verra quel en sera le succès.
____
🦉Cet article est accessible en texte intégrale pour les personnes inscrites aux enseignements de la professeur Marie-Anne Frison-Roche
________
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Jeanneney, J.-N., XIXième siècle : la haine, un ressort puissant, émission "Concordance des temps", France Culture, 29 mai 2021.
L'émission est bâtie sur cet ouvrage :
Présentation du thème par Jean-Noël Jeanneney :
"Les messages de haine qui sont charriés sur les réseaux sociaux doivent-ils être censurés par les responsables de ceux-ci ? Et peuvent-ils l’être ? Une loi récente, portée au Parlement par Laetitia Avia, députée de Paris, le leur imposait, sous peine de lourdes amendes. Et même si ce texte a été censuré, pour une large part, par le Conseil constitutionnel, il témoigne d’une inquiétude qui est aujourd’hui répandue.
Il s’agit de la découverte que l’intensité des haines en circulation sur la Toile, qui figent le dialogue démocratique et qui exaspèrent les passions les plus sinistres et les plus délétères, constituent une grave menace pour la prédominance de la raison sur la passion, pour la sérénité des citoyens et pour la cohésion nationale.
Je ne songe certes pas à minimiser ce souci, qui peut devenir taraudant, mais seulement, pour resituer les choses, à rappeler la violence des imprécations que nos ancêtres ont déjà échangées entre eux, dans tout le champ de la politique, de la société et même de la vie familiale. Leur support a changé, mais leurs ressorts et leurs débordements probablement pas. ".
Publications : Doctrine
► Référence complète : Roda, J.-Ch, Vers un droit de la concurrence des plateformes , in L'émergence d'un droit des plateformes, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2021, pp.77-90.
_____
► Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel s'insère cet article.
Publications : Doctrine
► Référence complète : Houtcieff, D., Les plateformes au défi des plateformes, in L'émergence d'un droit des plateformes, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2021, pp.51-64.
_____
► Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel s'insère cet article.
4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : G. Loiseau, "L’intensité de l’obligation de vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs numériques", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur développe le cas des opérateurs numériques. Il souligne le paradoxe d'un Droit qui est parti d'un texte qui a posé le principe de l'irresponsabilité des hébergeurs, en raison de leur neutralité technique, pour aboutir au DSA et leur imposer des diligences, mais il rappelle que cette obligation n'apparaît qu'à partir d'un signalement qui est porté auprès de l'opérateur numérique et une interdiction expresse d'une obligation générale de surveiller les informations. Il n'existe d'ailleurs pas d'obligation générale de vigilance à la charge des opérateurs numériques, même si la jurisprudence récente semble durcir le rôle imposé aux hébergeurs.
Le But Monumental ici visé est de lutter contre les contenus illicites, mais la liberté d'expression doit être aussi préservée et les réglementations varient selon le type de contenus, tandis que le DSA a une conception plus générale, vise une logique de responsabilisation et de prévention des risques systémiques. Mais vouloir "responsabiliser" les plateformes en Ex Ante, sans toucher au régime de responsabilité en Ex Post, peut poser difficulté.
L'obligation de vigilance va varier suivant que l'opérateur numérique a un rôle passif ou actif. Cela peut conduire les plateformes à adopter des mesures préalables qui peuvent constituer des obligations structurelles, le tiers de confiance pouvant prendre la forme d'un signaleur de confiance. La plateforme est ainsi rendue responsable de sa propre vigilance, mais malgré des hypothèses d'obligation de vigilance renforcée, cela ne doit pas aller jusqu'à des mesures d'investigation. Il faut néanmoins tenir compte d'obligations de vigilance renforcées spécifiques pour les très grandes plateformes, justifiées par les risques engendrés et les types de contenu (terrorisme, pornographie).
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
7 mai 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Rapport France Stratégie, M. de Montaignac (coord.), c. Joly et P. Furic, Lutter contre les stéréotypes filles-garçons. Quel bilan de la décennie, quelles priorités d’ici 2030 ? , préf. Cl. Beaune, mai 2025.
____
____
📝Lire la préface de Clément Beaune.
Dans cette préface, il insiste sur l'importance des réseaux sociaux sur la recrudescence des stéréotypes et sur la nécessité de réguler les plateformes dans cette perspectives.
Dans le rapport, voir les développements sur les stratégies des plateformes p.251 et s., spéc. p.293 et s. : "La construction de l’identité sociale en ligne se fait principalement sous le contrôle des plateformes et des réseaux socionumériques avec des mécanismes d’autorégulation insuffisants et de régulation publique peu efficaces".
_________

29 mars 2025
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
 ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, 🚧Le Contrat, instrument de Compliance : la clause efficacement stipulée engendrant une obligation pour une plateforme de contrôler les contenus : Com., 15 janvier 2025, Société Générale c/ DStorage, document de travail, mars 2025.
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, 🚧Le Contrat, instrument de Compliance : la clause efficacement stipulée engendrant une obligation pour une plateforme de contrôler les contenus : Com., 15 janvier 2025, Société Générale c/ DStorage, document de travail, mars 2025.
____
🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à :
🎬 la vidéo Surplomb👁 du 29 mars 2025 : cliquer ICI
____
🎬🎬🎬Dans la collection des Surplomb👁 Il s'insère dans la catégorie des Actualités.
►Voir la collection complète des Surplombs👁 : cliquer ICI
____
► Résumé du document de travail : L'arrêt du 15 janvier 2025 rendu par la Chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation , apporte une solution au contrôle des contenus dans l'espace numérique. En effet, il résout ce qui apparaît l'aporie si souvent soulignée, voire revendiquée, à savoir l'impossibilité d'élaborer une technologie efficace de contrôle. Pour ce faire, la Cour s'abstrait des lois applicables et se réfère au contrat monétique passé entre la banque et la plateforme, contenant une clause de vigilance sur les contenus illicite, articulée à une clause de résiliation. Elle estime que cette clause a pleine efficacité. Cette solution, si simple et si forte, peut contribuer très fortement à réguler l'espace numérique, si les banques le veulent, car quelles plateformes peut se passer de services monétiques fiables ?
____
🔓lire les développements ci-dessous⤵️
15 janvier 2025
Base Documentaire : 02. Cour de cassation

► Référence complète : Com., 15 janvier 2025, n° 23-14.625, Société Générale c/société Dstorage.
____
____
🚧lire le document de travail qui en fait l'analyse
____
1 novembre 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A. Latil, “Telegram et le délit d'administration d’une plateforme de transactions illicites“, CCE, novembre 2024, n° 11, alerte 318, pp. 3-4
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________

27 mai 2024
Organisation de manifestations scientifiques

► Référence complète : Les contrôles techniques des risques présents sur les plateformes et les contentieux engendrés, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 27 mai 2024, 9h-10h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin
____
🧮consulter le programme complet du cycle Contentieux Systémique Émergent
____
🌐consulter sur LinkedIn le compte-rendu de cette manifestation
____
🧱lire ci-dessous le compte-rendu de cette manifestation⤵️
____
► Présentation de la conférence : L'espace numérique est un espace de risques. Certains y sont naturellement associés, parce qu'il s'agit d'un espace de libertés, d'autres doivent être contrés parce qu'ils sont associés à des comportements interdits d'une façon générale, par exemple le blanchiment d'argent. Mais l'espace numérique a développé des risques qui, par leur ampleur ont été transformés dans leur nature même : il en est ainsi notamment de la déformation imprégnant certains contenus et de l'insécurité qui peut menacer l'ensemble du système lui-même. Le Droit a alors confié aux opérateurs eux-mêmes la vigilance sur ce qui sont devenus des "cyber-risques", comme le risque de désinformation, le risque de destruction des infrastructures de communication, le risque de vol de données, perspective systémique qui peut faire s'effondrer les sociétés elles-mêmes.
De nouveaux textes sont élaborées, notamment le Digital Services Act, pour à la fois accroître les charges et les pouvoirs des entreprises en la matière, les entreprises numériques étant en première ligne, mais aussi les autorités de supervision, comme l'Arcom. Les contentieux qui en naissent, dans lesquels entreprises et régulateurs peuvent être alliés ou en opposition, sont par nature systémiques.
Le traitement par le juge de ces "causes systémiques", par la procédure et les solutions, doit répondre à cette dimension systémique. Le cas dit des "sites pornographiques", qui est en train de se dérouler, permet d'observer in vivo le dialogue des juges lorsqu'une "cause systémique" s'impose à eux.
____
🧮Programme de cette manifestation :
Troisième conférence-débat
LES CONTROLES TECHNIQUES DES RISQUES PRESENTS SUR LES PLATEFORMES ET LES CONTENTIEUX ENGENDRES
Cour d’appel de Paris, salle Cassin
modération par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, Directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)
🕰️9h-9h10. 🎤Le contentieux Systémique Emergent du fait du système numérique, 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
🕰️9h10-9h30. 🎤Les techniques de gestion du risque systémique pesant sur la cybersécurité des plateformes, 🕴️Michel Séjean, Professeur de droit à l'Université Sorbonne Paris Nord
🕰️9h30-9h50. 🎤Un système systémique in vivo : le cas dit des sites pornographiques,🕴️Marie-Anne Frison-Roche
🕰️9h50-10h10. 🎤Les obligations systémiques des opérateurs numériques à travers le Règlement sur les Services Numériques (RSN/DSA) et le rôle des régulateurs, par 🕴️Roch-Olivier Maistre, Président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom)
🕰️10h10-10h30. Débat
____
🔴Les inscriptions et renseignements se font à l’adresse : inscriptionscse@gmail.com
🔴Pour les avocats, les inscriptions se font à l’adresse suivante : https://evenium.events/cycle-de-conferences-contentieux-systemique-emergent/
⚠️Les conférences-débat se tiennent en présentiel à la Cour d’appel de Paris.
________
27 mai 2024
Conférences

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Contentieux Systémique Émergent du fait du système numérique", in Les contrôles techniques des risques présents sur les plateformes et les contentieux engendrés, in cycle de conférences-débats "Contentieux Systémique Émergent", organisé à l'initiative de la Cour d'appel de Paris, avec la Cour de cassation, la Cour d'appel de Versailles, l'École nationale de la magistrature (ENM) et l'École de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris (EFB), sous la responsabilité scientifique de Marie-Anne Frison-Roche, 27 mai 2024, 9h-10h30, Cour d'appel de Paris, salle Cassin
____
🧮consulter le programme complet de cette manifestation
____
🧮consulter le programme de l'ensemble du cycle Contentieux Systémique Émergent
____
🔲consulter les slides ayant servi de support à l'intervention
____
🌐consulter sur LinkedIn les slides ayant servi de support à l'intervention
____
🎤consulter une présentation de la seconde intervention de Marie-Anne Frison-Roche prononcée lors de cette conférence-débat : "Un contentieux systémique in vivo : le cas dit des sites pornographiques"
____
____
____
► Résumé de cette conférence : cette intervention est préalable aux trois interventions plus substantielles et vise à montrer en quoi le système numérique par nature produit et va produire un "Contentieux Systémique".
En effet, le "Contentieux Systémique" se définit par des "causes" (notion procédurale) qui sont portées devant des juges, qui peuvent être de première instance, éventuellement des juges de l'urgence, dans lesquelles sont impliquées les intérêts, voire l'avenir, d'un système au-delà du litige entre les parties.
Ce cas systémique peut être présenté devant un juge spécialisé, y compris devant l'organe juridictionnel d'une Autorité de Régulation ou de Supervision, mais aussi devant un juge de droit commun, sur la base d'un texte spécial mais éventuellement sur un texte de droit commun. Il peut alors se produire un éclatement du contentieux, alors même que l'unité du système demeure, voire est en jeu, dans le présent et dans l'avenir.
Le "système numérique" est exemplaire de la production "naturelle" de Contentieux Systémique qui naissent du seul fait du système numérique, notamment en raison de risques systémiques inhérents à ce système, au fait que leur prévention et leur gestion sont internalisés dans les opérateurs qui ont construit et gèrent le système (Droit de la Compliance). L'enjeu est alors celui de l'interrégulation.
Les plateformes font plus particulièrement émerger un Contentieux Systémique en raison de la spécificité de certains risques, par exemple, désinformation, terrorisme, destruction des droits (les droits d'auteur n'étant qu'un exemple), risque d'accès des mineurs à des contenus destructeurs pour eux, etc.
Le Contentieux Systémique Numérique ne fait que commencer.
Il est essentiel que les juges y sont préparés et qu'ils y fassent face ensemble.
________
16 mars 2024
Interviews

► Référence complète : R.-O. Maistre, "La place du Droit de la compliance dans la régulation de l’espace numérique", entretien mené par M.-A. Frison-Roche à l'occasion d'une série d'entretiens sur le Droit de la Compliance, in Fenêtres ouvertes sur la gestion, émission de J.-Ph. Denis, Xerfi Canal, enregistré le 12 décembre 2023, diffusé le 16 mars 2024
____
🌐consulter sur LinkedIn la présentation en décembre 2023 de l'entretien avec Roch-Olivier Maistre
____
____
🎥visionner l'interview complète sur Xerfi Canal
____
► Point de départ : En 2022, Roch-Olivier Maistre écrit une contribution sur 📝Quels buts fondamentaux pour le régulateur dans un paysage audiovisuel et numérique en pleine mutation ?, dans 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance.
🧱lire la présentation de cette contribution ➡️cliquerICI
____
► Résumé de l'entretien :
Marie-Anne Frison-Roche : Question : L’Arcom a un rôle central en matière de Compliance. Pourriez-vous nous présenter cette Autorité de régulation qu’est l’Arcom ?
Roch-Olivier Maistre : Réponse : le Président Roch-Olivier Maistre décrit le rôle de l'Arcom, autorité qui résulte du CSA et de l'Hadopi, le législateur décidant de créer un nouveau grand Régulateur en charge à la fois de l'audiovisuel et du numérique. Cette Autorité collégiale s'assure du bon fonctionnement de ce secteur et est engagée dans la régulation des nouveaux acteurs du numérique.
____
MaFR : Q. : Comment Régulation et Compliance s’articulent-elles dans la mise en œuvre des missions de l’Arcom ?
R.O.M. : R. : Il répond qu'il s'agit d'une approche complémentaire. Coercition, sanctions s'y articulent. Il s'agit de préserver la liberté d'expression et de communication. Pour cela, objectifs de valeur constitutionnelle, les opérateurs doivent agir pour que ces objectifs soient atteints. Pour cela, ils sont supervisés par l'Autorité qu'est l'Arcom, qui intervient qu'ils ne se conforment à ces obligations de compliance. Lorsqu'il ne s'agit pas de l'audiovisuel, où le contenu est encore possible car il s'agit d'un "monde fini", mais qu'il s'agit du monde numérique, où les contenus se répandent d'une façon virale, c'est aux opérateurs d'agir : la Régulation et la Compliance agissent donc d'une façon complémentaire.
________
15 février 2024
Base Documentaire : Doctrine
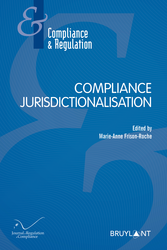
► Réference complète : L.-M. Augagneur, "The jurisdictionalisation of reputation by platforms", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2024, pp.109-125
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : The large platforms are in the position of arbiter of the reputation economy (referencing, notoriety) in which they themselves act. Although the stakes are usually low on a unit basis, the jurisdiction of reputation represents significant aggregate stakes. Platforms are thus led to detect and assess reputation manipulations (by users: SEO, fake reviews, fake followers; or by the platforms themselves as highlighted by the Google Shopping decision issued by the European Commission in 2017) that are implemented on a large scale with algorithmic tools.
The identification and treatment of manipulations is itself only possible by means of artificial intelligence tools. Google thus proceeds with an automated downgrading mechanism for sites that do not follow its guidelines, with the possibility of requesting a review through a very summary procedure entirely conducted by an algorithm. Tripadvisor, on the other hand, uses an algorithm to detect false reviews based on "fraud modeling to identify electronic patterns that cannot be detected by the human eye". It only conducts a human investigation in limited cases.
This jurisdictionality of reputation has little in common with that defined by the jurisprudence of the Court of Justice (legal origin, contradictory procedure, independence, application of the Rules of Law). It is characterized, on the one hand, by the absence of transparency of the rules and even of the existence of rules stated in predicative form and applied by deductive reasoning. It is replaced by an inductive probabilistic model by the identification of abnormal behaviors in relation to centroids. This approach of course raises the issue of statistical bias. More fundamentally, it reflects a transition from Rule of Law, not so much to "Code is Law" (Laurence Lessig), but to "Data is Law", that is, to a governance of numbers (rather than "by" numbers). It also comes back to a form of collective jurisdictionality, since the sanction comes from a computational apprehension of the phenomena of the multitude and not from an individual appreciation. Finally, it appears particularly consubstantial with compliance, since it is based on a teleological approach (the search for a finality rather than the application of principles).
On the other hand, this jurisdictionality is characterized by man-machine cooperation, whether in the decision-making process (which poses the problem of automaticity bias) or in the contradictory procedure (which poses, in particular, the problems of discussion with the machine and the explicability of the machine response).
Until now, the supervision of these processes has been based essentially on the mechanisms of transparency, a limited adversarial requirement and the accessibility of appeal channels. The French Law Loi pour une République Numérique ("Law for a Digital Republic"), the European Legislation Platform-to-Business Regulation and the Omnibus Directive, have thus set requirements on the ranking criteria on platforms. The Omnibus Directive also requires that professionals guarantee that reviews come from consumers through reasonable and proportionate measures. As for the European Digital Services Act, it provides for transparency on content moderation rules, procedures and algorithms. But this transparency is often a sham. In the same way and for the moment the requirements of sufficient human intervention and adversarial processes appear very limited in the draft text.
The most efficient forms of this jurisdictionality ultimately emerge from the role played by third parties in a form of participatory dispute resolution. Thus, for example, FakeSpot detects false Tripadvisor reviews, Sistrix establishes a ranking index that helped establish the manipulation of Google's algorithm in the Google Shopping case by detecting artifacts based on algorithm changes. Moreover, the draft Digital Services Act envisages recognizing a specific status for trusted flaggers who identify illegal content on platforms.
This singular jurisdictional configuration (judge and party platform, massive situations, algorithmic systems for handling manipulations) thus leads us to reconsider the grammar of the jurisdictional process and its characteristics. If Law is a language (Alain Sériaux), it offers a new grammatical form that would be that of the middle way (mesotès) described by Benevéniste. Between the active and the passive way, there is a way in which the subject carries out an action in which he includes himself. Now, it is the very nature of this jurisdictionality of compliance to make laws by including oneself in them (nomos tithestai). In this respect, the irruption of artificial intelligence in this jurisdictional treatment undoubtedly bears witness to the renewal of the language of Law.
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
1 décembre 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-Ch. Roda, "Un an de droit de la concurrence dans l’univers numérique", Communication - Commerce électronique, n° 12, décembre 2023, chron. "Un an de..." n°15
____
► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Initiée en octobre 2021, la présente chronique se propose de faire un tour d'horizon de l'actualité du droit de la concurrence, appliqué au secteur du numérique. Plus exactement, il s'agit de dresser un panorama, nécessairement subjectif et partiel, des décisions de jurisprudence ou des textes qui ont marqué l'actualité, en Europe, en France, mais aussi aux États-Unis. Dans ces trois zones, les grandes plateformes sont désormais dans l'œil du cyclone concurrentiel. L'entrée en vigueur du Digital Markets Act marque certainement une nouvelle ère et l'on constate que, même de l'autre côté de l'Atlantique, les autorités semblent désormais animées de la même ambition. Cela étant, au-delà de ces grands mouvements qui se dessinent, l'actualité montre que les autorités ne sont pas uniquement dans une logique de sévérité et de répression. Poursuivant une sorte de montée en puissance dans le secteur du numérique, l'Autorité française de la concurrence multiplie ainsi les plongées dans des domaines particulièrement techniques, afin de révéler le fonctionnement de ces marchés souvent difficiles à cerner. Le cloud est ainsi mis à l'honneur en 2023, avec un important avis sur la question, mais aussi plusieurs décisions de concentrations qui, s'il fallait encore le noter, montrent qu'il est difficile de réguler les GAFAM sans comprendre les enjeux internationaux qu'une telle entreprise révèle.".
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
____
📝consulter une présentation des autres chroniques "Un an de droit de la concurrence dans l’univers numérique" de Jean-Christophe Roda :
- "Un an de droit de la concurrence dans l’univers numérique" (2022)
- "Un an de droit de la concurrence dans l’univers numérique" (2021)
________
20 mai 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Y. El Hage, "Le contentieux devant les juridictions étatiques", dossier "Les règlements européens DMA-DSA : un nouveau fair-play numérique européen", Dalloz IP/IT, 2023, pp. 283-288
____
► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le Digital Services Act (DSA) et le Digital Markets Act (DMA) devraient susciter un important contentieux à caractère privé et international.
Un contentieux privé, d'une part, parce que l'on imagine très bien des particuliers ou des entreprises souffrir d'un préjudice personnel causé par un opérateur non-respectueux de l'un des deux règlements. Prenons l'exemple de l'article 6, § 3, du DMA qui interdit aux contrôleurs d'accès (gatekeepers) d'imposer leurs logiciels par défaut, notamment leur navigateur internet. Aujourd'hui, Apple - entre autres - fait automatiquement de son propre logiciel, Safari, le navigateur par défaut sur tous ses appareils. Désormais, l'utilisateur final devra être invité par Apple à choisir le navigateur internet par défaut de son choix, notamment au moyen d'un écran multichoix. À défaut, les concurrents d'Apple pourraient parfaitement prétendre subir, personnellement, un dommage de nature concurrentielle. Le DSA et le DMA, toutefois, prévoient des sanctions sous la forme d'amendes, prononcées selon les cas par les autorités nationales ou européennes. Ces sanctions s'expliquent par l'objectif primordial de cette nouvelle législation européenne, qui est d'encadrer le comportement de certains opérateurs sur le marché numérique dans un but d'intérêt général. Une première interrogation peut être alors soulevée : en cas de manquement au DSA ou au DMA, une personne peut-elle exiger la réparation de son préjudice auprès des tribunaux judiciaires et non pas seulement espérer le prononcé d'une amende par les autorités nationales ou européennes ? En d'autres termes, le private enforcement de ces règlements est-il possible ?
Un contentieux international, d'autre part, parce que le marché numérique européen, objet des deux règlements, est par nature transfrontière. Cet aspect soulève alors immédiatement une autre interrogation : en cas de possibilité de private enforcement, devant quels tribunaux judiciaires l'action devrait-elle être menée ?".
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
5 avril 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : N. Moreno Belloso & N. Petit, "The EU Digital Markets Act (DMA). A Competition Hand in a Regulatory Glove", (2023) 48 European Law Review, 391, available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4411743
____
► Résumé de l'article (fait par les auteurs) : "The newly enacted Digital Markets Act (DMA) finds itself at a crossroads. The DMA can develop into a specialist field of competition law for digital platforms or it can evolve into a new field of EU law, detached from competition law. The DMA’s ultimate trajectory will depend on the legal characterization given to the DMA. Is it a special competition law regime or an original instrument distinct from competition law? This paper lays the groundwork for characterizing the DMA by offering a complete descriptive analysis of the instrument. Among the elements discussed are the twin concepts of “gatekeepers” and “core platform services”, which together condition the DMA’s scope of application, as well as the legal obligations imposed on gatekeepers. The paper proposes a novel categorisation of the obligations, showing that each obligation can be associated with at least one of two conventional competition law concerns (exclusion or exploitation). The discussion shows the difficulty of pinpointing the exact nature of the DMA. We argue that this ambiguity creates challenges for the practical implementation of the DMA.".
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
Mise à jour : 2 février 2023 (Rédaction initiale : 23 juin 2021 )
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L.-M. Augagneur, "La juridictionnalisation de la réputation par les plateformes", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 97-113.
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Le résumé ci-dessous décrit un article qui fait suite à une intervention dans le colloque L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance, coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de Droit Lyon 3. Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Christophe Roda, codirecteurs scientifiques, et s'est déroulé à Lyon le 23 juin 2021.
Dans l'ouvrage, l'article sera publié dans le Titre I, consacré à L'entreprise instituée Juge et Procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance.
____
► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : Les grandes plateformes se trouvent placées en arbitre de l’économie de la réputation (référencement, notoriété) dans laquelle elles agissent elles-mêmes. Malgré, le plus souvent, de faibles enjeux unitaires, la juridictionnalité de la réputation représente des enjeux agrégés importants. Les plateformes sont ainsi conduites à détecter et apprécier les manipulations de réputation (par les utilisateurs : SEO, faux avis, faux followers ; ou par les plateformes elles-mêmes comme l’a mis en lumière la décision Google Shopping rendue par la Commission Européenne en 2017) qui sont mises en œuvre à grande échelle avec des outils algorithmiques.
L’identification et le traitement des manipulations n’est elle-même possible qu’au moyen d’outils d’intelligence artificielle. Google procède ainsi à un mécanisme de déclassement automatisé des sites ne suivant pas ses lignes directrices, avec une possibilité de faire une demande de réexamen par une procédure très sommaire entièrement menée par un algorithme. De son côté, Tripadvisor utilise un algorithme de détection des faux avis à partir d’une « modélisation de la fraude pour relever des constantes électroniques indétectables par l’œil humain ». Elle ne procède à une enquête humaine que dans des cas limités.
Cette juridictionnalité de la réputation présente peu de caractères communs avec celle définie par la jurisprudence de la Cour de Justice (origine légale, procédure contradictoire, indépendance, application des règles de droit). Elle se caractérise, d’une part, par l’absence de transparence des règles et même d’existence des règles énoncées sous forme prédicative et appliquées par raisonnement déductif. S’y substitue un modèle inductif probabiliste par l’identification de comportements anormaux par rapport à des centroïdes. Cette approche pose bien sûr la problématique des biais statistiques. Plus fondamentalement, elle traduit une transition de la Rule of Law, non pas tant vers Code is Law (Laurence Lessig), mais à Data is Law, c’est-à-dire à une gouvernance des nombres (plutôt que “par” les nombres). Elle revient en outre à une forme de juridictionnalité collective puisque la sanction provient d’une appréhension computationnelle des phénomènes de la multitude et non d’une appréciation individuelle. Enfin, elle apparaît particulièrement consubstantielle à la compliance puisqu’elle repose sur une démarche téléologique (la recherche d’une finalité plutôt que l’application de principes).
D’autre part, cette juridictionnalité se caractérise par la coopération homme-machine, que ce soit dans la prise de décision (ce qui pose le problème du biais d’automaticité) et dans la procédure contradictoire (ce qui pose notamment les problèmes de la discussion avec machine et de l’explicabilité de la réponse machine).
Jusqu’ici, l’encadrement de ces processus repose essentiellement sur les mécanismes de transparence, d’une exigence contradictoire limitée et de l’accessibilité de voies de recours. La Loi pour une République Numérique, le Règlement Platform-to-Business et la Directive Omnibus) ont ainsi posé des exigences sur les critères de classement sur les plateformes. La directive Omnibus exige par ailleurs que les professionnels garantissent que les avis émanent de consommateurs par des mesures raisonnables et proportionnées. Quant au projet de Digital Services Act, il prévoit d’instaurer une transparence sur les règles, procédures et algorithmes de modération de contenus. Mais cette transparence est souvent en trompe-l’œil. De la même façon, les exigences d’une intervention humaine suffisante et du contradictoire apparaissent très limités dans le projet de texte.
Les formes les plus efficientes de cette juridictionnalité ressortent en définitive du rôle joué par les tiers dans une forme de résolution de litiges participative. Ainsi, par exemple, FakeSpot détecte les faux avis Tripadvisor, Sistrix établit un indice de ranking qui a permis d’établir les manipulations de l’algorithme de Google dans l’affaire Google Shopping en détectant les artefacts en fonction des modifications de l’algorithme. D’ailleurs, le projet de Digital Services Act envisage de reconnaître un statut spécifique aux signaleurs de confiance (trusted flaggers) qui identifient des contenus illégaux sur les plateformes.
Cette configuration juridictionnelle singulière (plateforme juge et partie, situations massives, systèmes algorithmiques de traitement des manipulations) amène ainsi à reconsidérer la grammaire du processus juridictionnel et de ses caractères. Si le droit est un langage, elle en offre une nouvelle forme grammaticale qui serait celle de la voie moyenne (mésotès) décrite par Benevéniste. Entre la voie active et la voie passive, se trouve une voie dans laquelle le sujet effectue une action où il s’inclut lui-même. Or c’est bien le propre de cette juridictionnalité de la compliance que de poser des lois en s’y incluant soi-même (nomos tithestai). A cet égard, l’irruption de l’intelligence artificielle dans ce traitement juridictionnel témoigne incontestablement du renouvellement du langage du droit.
________
1 février 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : G. Loiseau, "Le Digital Services Act", Communication - Commerce électronique, n°2, février 2023, étude 3
____
Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022, qui entrera en application dans les États membres début 2024, s'attaque aux effets toxiques de l’activité des plateformes, qu'il s'agisse de la diffusion de contenus illicites ou de certaines pratiques, comme la publicité ciblée ou les interfaces trompeuses. Sans rien changer au régime de semi-responsabilité des hébergeurs voulu par la directive du 8 juin 2000, il table, pour lutter contre les contenus illicites, sur la pratique de modération qu’il rend obligatoire sur l’intervention d’un tiers, comptant aussi sur les initiatives des opérateurs techniques qui ont eux-mêmes intérêt à traiter les éléments les plus nocifs. Prescriptif, il fait porter l'effort de réglementation sur les sanctions que les plateformes peuvent décider, sur la motivation de leurs décisions ainsi que sur le traitement interne des réclamations. En complément de l’action ex-post ciblant les contenus illicites, le règlement appréhende certains risques, liés à des pratiques potentiellement nuisibles ou présentant un caractère systémique, dont il dicte la gestion ex-ante par les plateformes.".
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
24 octobre 2022
Base Documentaire : Convention, contrat, composition, engagement
► Référence complète : S. Merabet, Le Digital Services Act : guide d’utilisation de lutte contre les contenus illicites", JCP G, n° 42, octobre 2022, doctr. 1210, pp. 1958-1964
____
► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le Digital Services Act ambitionne de responsabiliser davantage les fournisseurs de services d’intermédiaires. Si les règles favorables de responsabilité qui leur profite demeurent très largement inchangées, le texte multiplie les obligations à leur charge. Les autorités européennes entendent en finir avec des règles qui pour l’heure permettent trop souvent aux hébergeurs de se soustraire au contrôle des contenus en ligne. Ce sont essentiellement les plateformes qui sont concernées, avec une attention toute particulière portée aux plus grandes d’entre elles. Le règlement conserve des obligations antérieures, en renforce d’autres et surtout en consacre de nouvelles. Ces obligations n’ont pas toute la même intensité, mais certaines devraient avoir une influence déterminante sur les pratiques des plateformes à l’avenir. L’objectif principal du texte est de lutter contre les contenus illicites et son architecture est pensée à cette fin sans pour autant sacrifier les droits des destinataires des services.".
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
17 octobre 2022
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : S. Merabet, "Le Digital Service Act : permanence des acteurs, renouvellement des qualifications", JCP G, n° 41, octobre 2022, doctr. 1175, pp. 1901-1907
____
► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Le droit du numérique n’en finit pas de se renouveler à l’initiative des autorités européennes. Digital Martek Act, AI Act, proposition de règlement MiCA... Les textes - adoptés ou en cours de négociations - sont nombreux et augurent d’importantes transformations. Le Digital Services Act récemment adopté est sans doute l’un des textes les plus ambitieux aux conséquences les plus immédiates pour les citoyens des États membres de l’Union européenne. Le règlement va profondément affecter les pratiques des services d’intermédiaires et tout particulièrement les plateformes. Deux aspects sont à ce titre déterminant : d’abord, la création de nouveaux acteurs et ensuite la consécration de nouveaux droits et obligations. Ces deux facteurs sont de nature à changer la donne pour les plateformes au cours des prochaines années et chacun d’entre eux sera abordé au travers de deux Études distinctes.".
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
5 octobre 2022
Interviews

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, " Youporn : Le Droit doit se renouveler face à la transformation du monde par l'espace numérique", entretien avec Olivia Dufour, Actu-juridique, 5 octobre 2022.
___
💬Lire l'entretien dans son intégralité
____
Lire l'entretien précédent : 💬L'efficacité de la Compliance illustrée par l'affaire Youporn
____
► Présentation de l'entretien par le journal : "Comment parvenir à bloquer efficacement l’accès des mineurs aux contenus pornographiques sur internet ? C’est à cette difficile question que s’est attaquée l'Arcom (Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique). Avec pour l’instant un succès mitigé. Début septembre, alors que le régulateur demandait au juge de bloquer les cinq sites n’ayant pas obéi à son injonction de modifier leurs conditions d’accès, la justice a décidé de renvoyer le dossier devant un médiateur. Entre temps, un rapport sénatorial publié le 28 septembre souligne l’urgence d’agir. Nous avons demandé au professeur Marie-Anne Frison-Roche, spécialiste de droit de la compliance, comment à son avis il est possible de lutter efficacement contre les dérives de l’industrie pornographique".
____
► Questions posées :
- Dans l'affaire Youporn, la décision du tribunal judiciaire de renvoyer le dossier vers la médiation a suscité un certain émoi. N'est-ce pas le signe d'une forme de renoncement de la justice, avec tout ce que cela implique d'un point de vue symbolique ?
- En quoi le droit de la compliance serait-il plus efficace que les méthodes traditionnelles ?
- Mais n’est-ce pas, d’une certaine façon leur permettre de s’autoréguler, solution que précisément le rapport sénatorial écarte radicalement, estimant qu’elle n’est pas efficace ?
- Le problème, à en croire les sites concernés, c’est qu’il n’y aurait pas de solution qui soit à la fois efficace et respectueuse de la protection de la vie privée…
- Pensez-vous que la compliance ait une chance de réussir là où les outils plus traditionnels connaissent un échec relatif ?
________
1 octobre 2022
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-Ch. Roda, "Un an de droit de la concurrence dans l’univers numérique", Communication - Commerce électronique, n° 10, octobre 2022, chron. "Un an de..." n°12
____
► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Initiée en octobre 2021, la présente chronique se propose de faire un tour d’horizon de l’actualité du droit de la concurrence, appliqué au secteur du numérique. Plus exactement, il s’agit de dresser un panorama, nécessairement subjectif et partiel, des décisions, jurisprudences ou textes qui ont marqué l’actualité, en France et en Europe. Depuis l’an dernier, on peut dire que l’étau ne s’est pas desserré sur les plateformes. La Commission européenne, mais également l’Autorité de la concurrence, ont continué à enquêter et agir contre les grandes plateformes, mais aussi contre différents acteurs du numérique peu scrupuleux. Surtout, l’année écoulée a vu l’adoption définitive du fameux Digital Markets Act, qui promet d’être un des instruments les plus importants pour la régulation du secteur numérique... à condition que les moyens et effectifs alloués soient au rendez-vous. L’adoption de ce règlement est un signal fort en direction des GAFAM... mais aussi des États-Unis qui songent de plus en plus ouvertement à légiférer sur le sujet. Une bataille d’influence se prépare donc du côté de l’antitrust américain. Si les projecteurs sont ainsi braqués sur le « grand droit de la concurrence », le « petit droit » n’a pas été en reste au cours de la période sous chronique. Plus discrètement, mais sûrement, les juges du fond français testent leurs outils plus traditionnels pour tenter de rééquilibrer les rapports de force entre les plateformes et leurs partenaires économiques, avec un certain succès. Autre élément notable durant la période : le droit de la concurrence ne se préoccupe désormais plus uniquement de concurrence stricto sensu, mais semble s’ouvrir vers d’autres champs. Le but de cette chronique n’est toujours pas d’être exhaustif : l’on cherchera plutôt à dessiner les grandes tendances du secteur, en envisageant les textes, puis les décisions et jurisprudences importantes.
1. - Les textes : le Digital Markets Act pour tenter de mettre au pas les GAFAM
2. - La pratique décisionnelle : les autorités ne desserrent pas l’étau sur les plateformes
3. - La jurisprudence européenne : le Tribunal de l’Union confirme les condamnations à l’encontre de Google
4. - La jurisprudence interne : le petit droit de la concurrence sert aussi à contrarier les grandes plateformes".
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
____
📝consulter une présentation des autres chroniques "Un an de droit de la concurrence dans l’univers numérique" de Jean-Christophe Roda :
- "Un an de droit de la concurrence dans l’univers numérique" (2023)
- "Un an de droit de la concurrence dans l’univers numérique" (2021)
________
21 juin 2022
Interviews

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L'efficacité de la compliance illustrée par l'affaire Youporn, entretien avec Olivia Dufour, 21 juin 2022.
____
____
1 décembre 2021
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : P. Akman, "Regulating Competition in Digital Platform Markets : A Critical Assessment of the Framework and Approach of the EU Digital Markets Act", (2022) 47 European Law Review 85, available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3978625 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3978625
____
► Résumé de l'article (fait par les auteurs) : "The European Union’s Digital Markets Act (DMA) initiative, which is set to introduce ex ante regulatory rules for “gatekeepers” in online platform markets, is one of the most important pieces of legislation to emanate from Brussels in recent decades. It not only has the potential to influence jurisdictions around the world in regulating digital markets, it also has the potential to change the business models of the wealthiest corporations on the planet and how they offer their products and services to their customers. Against that backdrop, this article provides an analysis of the aims of and principles underlying the DMA, the essential components of the DMA, and the core substantive framework, including the scope and structure of the main obligations and the implementation mechanisms envisaged by the DMA. Following this analysis, the article offers a critique of the central components of the DMA, such as its objectives, positioning in comparison to competition law rules, and substantive obligations. The article then provides recommendations and proposes ways in which the DMA – and other legislative initiatives around the world, which may take the DMA as an example – can be significantly improved by, inter alia, adopting a platform-driven substantive framework built upon self-executing, prescriptive obligations.".
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________