Publications [810]
2 février 2023
Publications
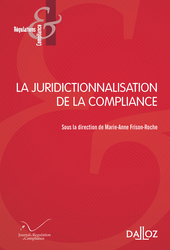
🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2023, 490 p.
____
► Présentation de l'ouvrage : Sanctions, contrôles, recours, deals : les juges et les avocats sont partout dans les mécanismes de Compliance, créant des situations inédites, parfois sans solution encore disponible. Alors même que la Compliance avait été conçue pour éviter le juge et produire de la sécurité en évitant le conflit. Cette juridictionnalisation est donc nouvelle. Obligeant les entreprises à poursuivre et à juger, rôle contraint, peut-être contre-nature. Conduisant à l’adaptation des principes majeurs de procédures, avec difficulté. Confrontant l’arbitrage à des perspectives inédites. Mettant au cœur le juge, dans des mécanismes pensés pour qu’il n’y figure pas. Comment en pratique agencer ces contraires et anticiper les solutions ? C’est le défi relevé par cet ouvrage.
____
📘 Parallèlement, un ouvrage en anglais, Compliance Jurisdictionalisation, est publié dans la collection éditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Bruylant.
____
🧮Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques 2021 organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.
____
📚Ce volume s'insère dans la ligne des ouvrages qui dans la collection "Régulations & Compliance" sont consacrés à la Compliance.
____
🏗️Construction générale de l'ouvrage
L'ouvrage s'ouvre sur une double Introduction. La première, en accès libre, consiste dans un résumé de l'ouvrage, la seconde, substantielle, porte sur la nécessité de conformité le Juge et l'Avocat pour que le Droit de la Compliance soit la caractéristique des États de Droit.
Le premier Titre est consacré à ce qui est spécifique au Droit de la Compliance : la transformation des entreprises en Procureur et Juge d'elles-mêmes, voire des autres.
Le deuxième Titre a pour objet d'étudier les interférences qui se développent entre le Droit processuel et les techniques de compliance.
Le troisième Titre mesure l'emprise des raisonnements et des exigences du Droit de la Compliance dans des modes de résolution des litiges où il n'était pas, sauf exception, présent, mais où il a un grand avenir : l'arbitrage.
Parce que procès et jugement sont indissociables, parce que techniques juridiques et État de Droit ne doivent pas l'être et que les techniques de Compliance pourraient paradoxalement être l'arme de leur dissociation, parce que le pouvoir de juger et les procédures qui l'entourent ne doivent pas être dissociés, parce que donc Compliance et Etat de Droit doivent être pensés et pratiqués ensuite, la montée en puissance de l'un devant être le signe de la montée en puissance de l'autre, et non le prix de l'affaiblissement de l'Etat de Droit, le quatrième Titre a pour objet le rôle du Juge dans la Compliance.
___
►Accès libre à l'article résumant l'ouvrage : cliquer ICI
____
►lire ci-dessous la table des matières avec un accès direct aux résumés de chaque contribution⤵️
________
2 février 2023
Publications

♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
♾️ s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Conforter le rôle du Juge et de l'Avocat pour imposer la Compliance comme caractéristique de l'État de Droit", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 29-55.
____
► Cet article constitue l'introduction de l'ouvrage.
____
____
🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
____
📕consulter la présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
________
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L’on peut comprendre que les mécanismes de compliance sont présentés avec hostilité parce qu’ils paraissent conçus pour éloigner le juge, alors qu’il n’y a pas d’Etat de Droit sans Juge. Des arguments solides présentent les techniques de compliance comme convergeant vers l’inutilité du juge (I). Certes, on croise des magistrats, et de toutes sortes, et de très puissants, mais cela serait signe d’imperfection : lorsque sa logique ex ante se sera déployée dans toute son efficacité, le juge ne serait plus requis… Et l’avocat disparaîtrait donc avec lui…
Cette perspective d’un monde sans juge, sans avocat et finalement sans Droit, où des algorithmes pourraient organiser par de multiples process en Ex Ante la « conformité » de tous nos comportements à toute la masse réglementaire qui nous est applicable, suppose que l’on définisse cette nouvelle branche du Droit comme la concentration des process qui donne pleine efficacité à toutes les règles, sans considération de leur teneur. A supposer que ce rêve d’ingénieur soit même réalisable, l’on ne peut faire ainsi l’économie des juges et des avocats.
C'est pourquoi il est impérieux de reconnaître leurs apports au Droit de la Compliance, apports liés inestimables (II).
Tout d’abord parce qu’un pur Ex Ante n’a jamais existé et que même au temps des Légistes, il fallait encore des personnes pour interpréter les règlements car un ordre juridique doit toujours être interprété en Ex Post par celui qui doit de toutes les façons répondre aux questions que le posent les sujets de droit, dès l’instant que le système politique admet d’attribuer à ceux-ci le droit de former des prétentions devant un juge. Ensuite l’Avocat, dont l’office bien qu’articulé à celui du Juge, est distinct de celui-ci, à la fois plus restreint et plus large, puisqu’il doit apparaître dans tous les cas où la figure juridictionnelle se met en place. Or, le Droit de la Compliance a multiplié celle-ci puisque non seulement, prolongeant en cela le Droit de la Régulation, il confie de nombreux pouvoirs aux Autorités administratives, mais encore il transforme les entreprises en juge, ce à l’égard de quoi l’Avocat doit faire face.
Plus encore le Droit de la Compliance ne prend son sens qu’à partir des Buts Monumentaux qu’il sert. C’est en cela que cette branche du Droit préserve la liberté des êtres humains, notamment dans l’espace numérique où les techniques de compliance les protègent de la puissance des entreprises par l’usage que le Droit contraint ces entreprises de faire de cette puissance même. Or en premier lieu ce sont les Juges qui, dans leur diversité, impose comme référence la protection des êtres humains, soit comme limite à la puissance des outils de compliance soit comme finalité même de ceux-ci. En second lieu, l’Avocat, là encore se distinguant du Juge, au besoin vient rappeler que toutes les parties dont les intérêts sont impliqués doivent être prises en considération. Dans un Droit toujours plus souple et dialogal, chacun se présente comme « l’avocat » de tel ou tel but monumental : l’Avocat est légitime à être le premier à occuper cette place.
________
2 février 2023
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Le système probatoire de la Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2023, p. 409-442.
____
____
🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
____
📕consulter la présentation générale de l'ouvrage, La juridictionnalisation de la Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : l'article vise à dégager le lien qui doit s'opérer entre l'entreprise dans son rapport avec les obligations de compliance qu'elle assume et les juges devant lesquels elle rend compte à ce titre : ce lien est opéré par le jeu des preuves. Or le système probatoire de la preuve est encore à construire, c'est l'objet de cette longue étude que d'en poser les prolégomènes.
A cette fin l'article débute par une description de ce qui est désigné comme le "carré probatoire" dans un "système probatoire" qui se superpose au système des règles de droit substantiel. Cela est d'autant plus important que la Compliance semble être en choc frontal dans ses principes mêmes avec les principes généraux du système probatoire, notamment parce qu'il semble que l'entreprise devrait prouver l'existence du Droit ou qu'elle devrait supporter d'une façon définitive la charge de prouver l'absence de violation, ce qui paraît contraire non seulement à la présomption d'innocence mais au principe de la liberté d'action et d'entreprendre. Pour réarticuler le Droit de la Compliance, les obligations de compliance qui légitimement pèsent sur l'entreprise, il faut revenir sur le système probatoire spécifique à la Compliance, pour que celle-ci demeure dans l'Etat de Droit. Cela suppose que l'on adopte une définition substantielle de la Compliance, qui ne soit pas seulement le respect des règles, ce qui n'est qu'une dimension minimale, mais que l'on définisse le Droit de la Compliance par les Buts Monumentaux sur lesquels d'une façon substantielle les Autorités publiques et les entreprises font alliance.
Le système probatoire de principe fait jouer entre eux ses quatre sommets que sont la charge des preuves, les objets de preuve ce carré probatoire de principe, entre la charge de preuve, les moyens de preuve et leur recevabilité. Le Droit de la Compliance ne sort pas de ce carré probatoire, marquant en cela sa pleine appartenance à l'Etat de Droit
Pour pose les bases du système probatoire spécifique au Droit de la Compliance la première partie de l'article cerne les objets de preuve qui lui sont spécifiques, en distinguant les dispositifs structurels, d'une part et les comportements attendus d'autre part. Les premiers impliquent que soit prouvée la mise en place effective des structures requis au regard des Buts Monumentaux de la Compliance. L'objet de preuve est alors l'effectivité de cette mise en place, ce qui présente l'efficacité du dispositif. En ce qui concerne les obligations comportementales, l'objet de preuve est dans les efforts déployés par l'entreprise pour obtenir ceux-ci, le principe de proportionnalité gouvernant l'établissement de cette preuve, tandis que l'efficience systémique de l'ensemble conforte le dispositif probatoire. Mais la sagesse probatoire consiste pour l'entreprise, alors même que le principe demeure celui de la liberté de la preuve, à préconstituer l'effectivité, l'efficacité et l'efficience de l'ensemble, indépendamment des charges de preuve.
La deuxième partie de l'article vise ceux qui supportent la charge de preuve en Droit de la Compliance. Celui-ci fait porter par principe ce poids sur l'entreprise, au regard de ses obligations légales. Cette charge vient de l'origine légale des obligations, laquelle bloque la "ronde des charges de preuve". Mais dans l'interférence des différents sommets du carré probatoire, la question devient plus délicate lorsqu'il s'agit de déterminer les contours des obligations de compliance que l'entreprise doit exécuter. En outre, la charge de preuve peut elle-même faire l'objet de preuve, comme l'exécution par l'entreprise de ses obligations légales peut elle-aussi faire l'objet de contrats, ce qui fait revenir dans le système probatoire ordinairement applicable aux obligations contractuelles. La situation est d'ailleurs différente lorsqu'il s'agit d'un "contrat de compliance" ou lorsqu'il s'agit d'une ou de plusieurs stipulations de compliance, notions encore peu élaborées en Droit des contrats.
En outre, toutes les branches du Droit appartenant à un système juridique gouvernant par le principe de l'Etat de Droit, d'autres branches du Droit interfèrent et modifient les méthodes et solutions probatoires. Il en est ainsi lorsque le fait, qui est objet de preuve, peut donner lieu à sanction, le Droit de la répression imposant ses solutions propres en matière de charge de preuve.
Dans une troisième partie de l'article, sont examinés les moyens de preuve pertinents en Droit de la Compliance, utilisés en ce que le Droit de la Compliance est avant tout une branche du Droit dont l'objet est d'une part l'information et d'autre part l'Avenir. Des questions ouvertes demeurent, comme celle de savoir si les entreprises pourraient être contraintes par le Juge à construire des technologies pour inventer de nouveaux moyens de preuve pour donner à voir qu'elles concrétisent effectivement les Buts Monumentaux dont elles sont chargées.
Dans une quatrième partie, est montrée le caractère vital de la préconstitution des preuves, qui est le reflet de la nature Ex Ante du Droit de la Compliance : il faut préconstituer des preuves pour écarter la perspective même d'avoir à les utiliser, en trouvant tous les moyens d'établir l'effectivité, l'efficacité, voire l'efficience des différents Outils de la Compliance.
Si les entreprises font tout cela avec méthode, le système probatoire de la Compliance sera établi, en harmonie à la fois avec le système probatoire général, le Droit de la Compliance et l'Etat de Droit.
____
► Lire la présentation de l'ensemble des articles de Marie-Anne Frison-Roche dans cet ouvrage :
📝Résumé de l'ouvrage (en accès libre ICI)
📝Le "jugeant-jugé" : Articuler les mots et les choses face à l'éprouvant conflit d'intérêts
📝Ajuster par la nature des chose le Droit processuel au Droit de la Compliance
________

25 janvier 2023
Publications

♾️suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
♾️s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
 ► Référence générale : Frison-Roche, M.-A. Les grands cas juridictionnellement résolus par le Droit de la compliance, document de travail, janvier 2023.
► Référence générale : Frison-Roche, M.-A. Les grands cas juridictionnellement résolus par le Droit de la compliance, document de travail, janvier 2023.
____
🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à une intervention sur ce thème, prenant place dans la formation de deux jours conçus par François Ancel et Marie-Anne Frison-Roche sur Le Droit de la Compliance pour l'Ecole nationale de la Magistrature, les 2 et 3 février 2023.
____
____
► Résumé du document de travail : Le

Mise à jour : 28 décembre 2022 (Rédaction initiale : 10 juillet 2022 )
Publications

♾️suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
♾️s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
 ► Référence générale : Frison-Roche, M.-A. Régulation et Compliance, expression des missions d'un Ordre, document de travail, juillet 2022.
► Référence générale : Frison-Roche, M.-A. Régulation et Compliance, expression des missions d'un Ordre, document de travail, juillet 2022.
____
🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à une intervention dans le Congrès annuel de l'Ordre des Géomètres-Expert le 15 septembre 2022
____
🎥Regarder la courte présentation de cette intervention
____
🎥Regarder l'intégralité de cette conférence prononcée le 15 septembre 2022 sur la base de ce document de travail
____
► Résumé du document de travail : Les ordres professionnels ne doivent pas se penser comme des exceptions, si légitimes soient-elles, par rapport à un principe, qui serait le jeu concurrentiel, mais comme l'expression d'un principe. Ce principe est exprimé par deux branches du Droit dont l'importance ne cesse de croître dans le Droit européen, branches libérales qui se fondent sur une conception de la vie économique et de l'entreprise tournée avant tout vers le futur : le Droit de la Régulation et le Droit de la Compliance, deux branches du Droit à la fois liées et distinctes.
En effet et c'est l'objet de la première partie, il est vrai que le Droit de la Concurrence conçoit les ordres professionnels comme des exceptions puisque ces "corporations" constituent des ententes structurelles. Le Droit interne français à la fois consolide les ordres en les adossant à l'Etat qui leur subdéléguerait ses pouvoirs mais les embarque dans la remise en cause par l'Union européenne des Etats et leurs outils. Le plus souvent la tentation est alors de rappeler avec une sorte de nostalgie les temps où les ordres étaient le principe mais, sauf à demander comme une restauration, le temps ne serait plus.
Une approche plus dynamique est possible, en accord avec l'évolution plus générale du Droit économique. En effet l'Ordre professionnel est l'expression d'une profession, notion relativement peu exploitée, sur laquelle il exerce la fonction de "Régulateur de second niveau", les Autorités publiques exerçant la fonction de "Régulateur de premier niveau". Le Droit de la Régulation bancaire et financière est construit ainsi et fonctionne de cette façon, au niveau national, européen et mondial. C'est de cela qu'il convient de se réclamer.
Les Ordres professionnels ont alors pour fonction primordiale de diffuser une "culture de Compliance" dans les professionnels qu'ils supervisent et au-delà de ceux-ci (clients et parties prenantes). Cette culture de Compliance s'élabore au regard des mission qui sont concrétisés par les professionnels eux-mêmes.
C'est pourquoi la seconde partie du document de travail porte sur l'évolution juridique de la notion de "mission" qui est devenue centrale en Droit, notamment à travers la technique de l'entreprise à mission. Or les points de contact sont multiples entre la raison d'être, l'entreprise à mission et le Droit de la Compliance, dès l'instant que l'on définit celui-ci par les buts concrets et très ambitieux que celui-ci poursuit : les Buts Monumentaux.
Chaque structure, par exemple l'Ordre des Géomètres-Experts, est légitime à fixer le But Monumental qu'il poursuit et qu'il inculque, notamment le territoire et le cadre de vie, rejoignant ce qui unit tous les Buts Monumentaux de la Compliance : le souci d'autrui. L'Ordre des Géomètres-Experts est adéquat parce qu'il est dans un rapport plus flexible, à la fois plus resserré et plus ample, avec le territoire que l'Etat lui-même.
En inculquant cela aux professionnels, l'Ordre professionnel développe chez le praticien une "responsabilité ex ante", qui est un pilier du Droit de la Compliance, constituant à la fois une charge et un pouvoir que le professionnel exerce et dont l'Ordre professionnel doit être le superviseur.
____
🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
1 décembre 2022
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence générale : M.-A. Frison-Roche, "Contrat de compliance, clauses de compliance", Chronique de Droit de la Compliance, D.2022, p.2115-2117.
____
____
►Lire la présentation des chroniques suivantes :
- "Droit de la compliance et contentieux systémique", 2025
- "Compliance et conformité : les distinguer pour mieux les articuler", 2024
- "La loi, la compliance, le contrat et le juge: places et alliances", 2023
►Lire la présentation des chroniques précédentes :
- "L'aventure de la Compliance", 2020
- "Compliance et personnalité", 2019
____
____
► Présentation de l'article : L’on ne voit souvent dans le droit de la compliance que l’obligation de se conformer à la réglementation. Le droit des obligations en est comme masqué par l’étude des textes et des sanctions. Les cas de responsabilité civile commencent à faire ressortir les engagements des entreprises, actes de volonté. Reste à discerner l’importance des contrats.
En premier lieu, existe un contrat spécifique : le « contrat de compliance ». Il a pour objet la fourniture par un tiers d’une prestation, les moyens pour l’entreprise de « se conformer » à la loi, ou/et de permettre à celle-ci d’atteindre les buts monumentaux qui caractérise le droit de la compliance. L’interprétation et le régime du contrat de compliance doit être marqué par le Droit de la compliance qui l’imprègne. En second lieu, des multitudes de clauses visent la conformité et la compliance.
____
🚧lire le document de travail ayant servi de base à l'article
____
📚Lire les autres articles publiés dans la chronique de Droit de la Compliance publiées au Recueil Dalloz.
________

15 octobre 2022
Publications

♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
♾️ s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le juge, tiers régulateur des obligations contractuelles de compliance, document de travail, octobre 2022.
____
🎤 ce document de travail a été élaboré pour servir de base à une conférence, prononcée le 18 novembre 2022 à l'Université de Nîmes.
____
📝Il sert aussi de base pour un article qui sera publié dans un ouvrage, publié dans sa version française dans l'ouvrage 📕L'obligation de Compliance, dans la collection 📚Régulations & Compliance et dans sa version anglaise dans l'ouvrage 📘Compliance Obligation, dans la collection 📚Compliance & Regulation
____
► Résumé du document de travail :
____
🔓Lire les développements ci-dessous ⤵️
25 septembre 2022
Publications
🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐 s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Fonder la compliance", in Revue de l'ACE, La compliance, n° spéc. n°157, septembre 2022, p.17-31.
____
► Résumé de l'article : L'article traite le sujet en 20 étapes
- Pourquoi fonder les pratiques de compliance ? Pour des impératif pratiques
- Fonder les pratiques de compliance pour rendre supportables, car compréhensibles, les pouvoirs et les charges concentrés dans les outils de Compliance
- Fonder les pratiques de compliance pour maîtriser un savoir technique exponentiel
- Fonder les pratiques pour y trouver la part du Droit
- Fonder la Compliance sur les process d’efficacité
- Rendre supportable la Compliance fondée sur les process d’efficacité par un mix de procédure et d’éthique
- Les professionnels de la Compliance fondée sur des process
- La place particulière de l’avocat et du juge dans la Compliance fondée sur des process
- Fonder la Compliance sur l’obligation de donner à voir par avance que l’on se conforme à la réglementation applicable
- L’aporie de la Compliance fondée sur l’obligation de donner à voir par avance que l’on se conforme à la réglementation applicable
- Les charges engendrées de la Compliance fondée sur l’obligation de donner à voir par avance que l’on se conforme à la réglementation applicable
- L’impraticabilité de la Compliance fondée sur l’obligation de donner à voir par avance que l’on se conforme à la réglementation applicable
- Fonder la Compliance sur des buts substantiels ponctuels
- Les professionnels de la Compliance impliquées par la Compliance fondée sur des buts substantiels ponctuels
- Fonder la Compliance par des buts substantiels globaux et à venir
- Fonder la Compliance par les Buts Monumentaux, négatifs et positifs
- Les professionnels de la Compliance fondée sur les Buts Monumentaux
- La place particulière de la population concernée et de l'Etat dans la Compliance fondée sur les Buts Monumentaux
- La place particulière de l’avocat et du juge dans la Compliance fondée sur les Buts Monumentaux
- L'avenir du Droit de l'Avenir
____
____
____
lire la revue dans son intégralité
_________
21 septembre 2022
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance, the new legal way for human values: towards an Ex Ante Responsibility", in Evolução do Direito no século XXI. Seus princípios e valores: ESG, Liberdade, Regulação, Igualdade e Segurança Jurídica. Homenagem ao Professor Arnoldo Wald, vol. 2, Direito Privado, São Paulo, Editora IASP, 2022, pp. 977-983
_____
► Résumé de l'article : For the first time, the future is the first question for the Humanity. The classical legal conception of Tort Law concerns the Past, the philosophical conception of Hans Jonas, a Responsability for the Future, an Ex-Ante Responsability must become a legal notion.
Traditionally, the Legislator takes decision for the Future and the Judges takes ones for the Past, but now in front of the possible disparition of human beings on this planet, global and catastrophic perspective, all legal perspectives need to be used, breaking the classical repartition, in the priority of the future. To do something, the Responsability must be put on everyone in a legal force, not only on the classical subject of Law and because of past behaviors, but because the operators, States, firms, or individuals, are "in position" to do so.
This new "Ex-Ante Responsibility" is an essential part of the Compliance Law, very new branche of Law, with an extraterritorial effect, to find immediate and active solutions for the future. Because the issue is global, international Arbitration is in position to apply the conception, because international arbitrators are the global judges.
This new conception of legal Ex-Ante Responsibility, declared by courts, expressed human values, such as the concerns for the others, in concordance withe the humanist tradition of European and American Law, Compliance being not at all to obey regulations but to concretise an alliance a Monumental Goal, here for the preservation of human beings in the future, and the powers and the legal duties of corporate and people to do so.
____
📝lire l'article (en anglais)
________

5 septembre 2022
Publications


🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐 s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Contrat de compliance, clauses de compliance, document de travail, septembre 2022.
____
📝Ce document de travail sert de base à un article, publié dans le cadre de la 📚chronique de Droit de la Compliance tenue au Recueil Dalloz.
____
📚Lire les autres articles parus par cette Chronique Droit de la Compliance. ouverte depuis 2018.
____
►Résumé du document de travail : Le Droit de la compliance a multiplié les obligations. Mais si l’on voit apparaître le droit de la responsabilité et si la pratique multiplie les contrats, pour l’instant les rapports entre Droit de la compliance et Droit des contrats sont peu visible (I). Pourtant, il existe des contrats dont le seul objet est de concrétiser la compliance, ce qui en fait un contrat spécifique et doit influencer sa mise en œuvre (II). En outre, l’on a beaucoup à apprendre de la diversité des clauses de compliance disséminées dans de multiples de contrats (III).
________
🔓Lire ci-dessous les développements⤵️
Mise à jour : 1 septembre 2022 (Rédaction initiale : 4 novembre 2021 )
Publications
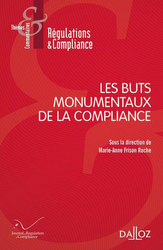
🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐 s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2022, p. 413-436.
____
____
🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les Buts Monumentaux de la Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Si l'on reprend techniquement les outils juridiques de Compliance et qu'on les confronte au souci que le Droit doit avoir de la Compétitivité des entreprises, il faut que ces instruments juridiques n'y nuisent pas parce que le Droit de la Compliance, en raison de ses ambitions immenses, ne peut fonctionner que par une alliance entre des volontés politiques aux grandes prétentions (sauver la planète) et les entités qui sont aptes à concrétiser celles-ci (les opérateurs économiques cruciaux) : la volonté politique puisant dans la puissance des entreprises, il serait contradictoire que les instruments juridiques mis en place par le Droit nuisent à l'aptitude des entreprises à affronter la compétition économique mondiale, ou pire favorisent des compétiteurs internationaux relevant de système juridiques n'intégrant pas ses instruments du Droit de la Compliance.
À partir de ce principe, l'on peut porter une appréciation sur ces deux techniques que sont le lancement d'alerte et l'obligation de vigilance : les deux consistent à capter de l'information, ce qui leur donne une forte unicité et les insère dans la compétition mondiale pour l'information.
Si l'on prend tout d'abord le lancement d'alerte, il apparaît que le premier bénéficiaire de celui-ci est l'entreprise elle-même puisqu'elle découvre une faiblesse et peut donc y remédier. C'est pourquoi qu'au-delà du principe de protection du lanceur d'alerte par l'accès de celui-ci au statut légal conçu par la loi dite "Sapin 2", il est critiquable que toutes les incitations ne sont pas mises en place pour que le titulaire d'une telle information la transmette au manager et que la loi, même après la transposition de la directive européenne de 2019, continuera d'exiger l'absence de contrepartie, la figure "héroïque du lanceur d'alerte et le refus de sa rémunération privant l'entreprise d'un moyen d'information et d'amélioration. Mais la législation française a au contraire développé la bonne incitation quant à la personne à laquelle l'information est transmise car en obligeant à transmettre d'abord au manager, la transmission externe intervenant si celui-ci ne fait rien, l'incitation est ainsi faite au responsable interne d'agir et de mettre fin au dysfonctionnement, ce qui accroît la compétitivité de l'entreprise.
Plus encore et même si cela paraît contre-intuitif, l'obligation de vigilance accroît fortement la compétitivité des entreprises qui y sont soumises. En effet la Loi en les obligeant à prévenir et à lutter contre les atteintes aux droits humains et à l'environnement leur a tacitement donnés tous les pouvoirs nécessaires pour le faire, notamment le pouvoir de capter des informations sur des entreprises tierces, y compris (voire surtout) celles qui ne sont pas soumises à des obligations de transparence. En cela, les entreprises, en tant qu'elles sont à ce titre responsables personnellement, détiennent un pouvoir de supervision sur d'autres, pouvoir qui permet de mondialisation le Droit de la Compliance et qui, au passage, accroît leur propre puissance. C'est pourquoi l'obligation de vigilance est à bien des égard une aubaine pour les entreprises qui y sont soumises. La reprise du mécanisme par la prochaine Directive européenne, elle-même indifférente au territoire, ne fera que renforcer ce pouvoir global des entreprises vigilantes sur des entreprises éventuellement étrangères qui en deviennent les sujets passifs.
________
1 septembre 2022
Publications
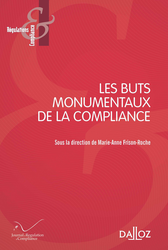
♾️suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
♾️s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2022, 520 p.
____
📘Parallèlement, un ouvrage en anglais, Compliance Monumental Goals, est publié dans la collection éditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Editions Bruylant.
____
📅Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques 2021 organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.
____
📚Ce volume s'insère dans la ligne des ouvrages qui dans cette collection sont consacrés à la Compliance : Consulter les autres titres de la collection.
____
► Présentation générale de l'ouvrage : Saisir la Compliance par son esprit : ses Buts Monumentaux. La notion de "buts monumentaux" de la Compliance a été proposée en 2016 par Marie-Anne Frison-Roche. Elle est devenue explicite dans les textes et la résolution des cas, par exemple pour lutter contre le changement climatique, rendre effectivement égaux les êtres humains, obliger à être extraterritorialement vigilant chez les fournisseurs.
Le Buts Monumentaux de la Compliance sont visés en Ex Ante par des régulations, les contrats, la RSE, et des accords internationaux. Créant une alliance entre les entreprises et les autorités politiques, visant une nouvelle forme de souveraineté. La présence dans les contentieux de ces Buts Monumentaux de dimension mondiale renouvelle les responsabilités et l’office du Juge. Décrire et concevoir ces Buts Monumentaux permet d’anticiper un Droit de la Compliance, chaque jour plus puissant.
____
🏗️Construction générale de l'ouvrage : L'ouvrage s'ouvre sur une double introduction. La première résume l'ouvrage. La seconde, de nature substantielle et de conception générale, propose une définition du Droit de la Compliance mettant en son "cœur battant" les Buts Monumentaux, qui confère à cette branche du droit nouvelle son originalité et sa spécificité, expliquant ce qui, dans l'Histoire des États-Unis et de l'Europe, a fait naître ce corpus si singulier et justifie une définition substantielle du Droit de la Compliance. Le concept de Buts Monumentaux est explicité et explique la nature à la fois systémique et politique de ce Droit, dont les conséquences pratiques sont ainsi mieux cernées et limitées, puisque le Droit de la Compliance n'aboutisse pas à la toute-obéissance. L'on peut alors énoncer ce que l'on peut attendre de ce Droit de l'Avenir qu'est le Droit de la Compliance.
A partir de là, l'ouvrage se déploie en 5 titres.
Un premier Titre est consacré à la "radioscopie" de cette notion, en elle-même et branche du Droit par branche du Droit.
Un deuxième Titre a pour objet de mesurer comme les Buts Monumentaux sont remis en cause par une situation de crise, par exemple sanitaire mais pas seulement, s'ils l'aggravent et doivent être écartés, ou si au contraire ils sont exactement conçus par cette hypothèse de crise, de risques, de catastrophes et qu'il convient de les exploiter, notamment pour, dans cette "épreuve", tirer profit de l'alliance entre les Autorités politiques, pouvoirs publics et Opérateurs cruciaux.
Une fois acquis et éprouvés, les Buts Monumentaux doivent trouver une façon sûre d'être pris en considération. C'est pourquoi un troisième Titre a pour objet de mesurer en principe et en pratique comme la méthode de la proportionnalité peut aider à l'insertion de la Compliance, donnant ainsi une nouvelle dimension au Droit sans l'entraîner dans l'insécurité et l'accaparement illégitime des pouvoirs.
Mais parce que l'ancrage normatif des Buts Monumentaux dans le Droit de la Compliance exprime une très grande ambition, la question d'un rapport supportable, voire bénéfique, avec la compétitivité internationale des entreprises, des normes et des systèmes doit être ouverte. C'est l'objet du quatrième Titre.
Enfin, parce que les Buts Monumentaux expriment par nature une nouvelle ambition du Droit dans un monde qui ne doit pas renoncer à ce qui pourrait être la perspective de sa perte, le cinquième Titre a pour objet le rapport entre les Buts Monumentaux de la Compliance et la Souveraineté.
____
► Appréhender l'ouvrage à travers la table des matières ci-dessous et les résumés de chacun des articles :
DOUBLE INTRODUCTION
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Résumé de l'ouvrage Les buts monumentaux du droit de la compliance (accès libre : cliquer ICI pour lire cet article)
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance
I. LA NOTION DE BUTS MONUMENTAUX DE LA COMPLIANCE
🕴️R.-O. Maistre, 📝Quels buts fondamentaux pour le régulateur dans un paysage audiovisuel et numérique en pleine mutation ?
🕴️A.V. Le Fur, 📝Intérêt et raison d’être de l’entreprise : quelle articulation avec les Buts Monumentaux de la Compliance ?
🕴️A. Le Goff, 📝La part des banques dans la concrétisation des Buts Monumentaux de la Compliance
🕴️J.-F. Vaquieri,📝Les "Buts Monumentaux" perçus par l'entreprise. L'exemple d'Enedis
🕴️M. Malaurie-Vignal, 📝Les Buts Monumentaux du droit du marché. Réflexion sur la méthode
🕴️D. de La Garanderie, 📝Sur les Buts Monumentaux de la Compliance sociale
🕴️C. Peicuti & 🕴️J. Beyssade, 📝La féminisation des postes à responsabilité dans les entreprises comme But de la Compliance. Exemple du secteur bancaire
🕴️I. Gavanon, 📝Le droit des données personnelles dans l’économie numérique à l’épreuve des Buts Monumentaux
🕴️B. Petit, 📝Les Buts Monumentaux du droit (européen) des relations de travail : un système mouvant aux équilibres à consolider
🕴️G. Beaussonie, 📝Droit pénal et Compliance font-ils système ?
🕴️Ch. Huglo, 📝À quelles conditions le Droit climatique pourrait-il constituer un But Monumental prioritaire ?
II. MISE EN OEUVRE DES BUTS MONUMENTAUX DE LA COMPLIANCE EN ARTICULATION DU PRINCIPE MAJEUR DE LA PROPORTIONNALITÉ
🕴️L. Rapp, 📝Conformité, proportionnalité et normativité
🕴️B. Bär-Bouyssière, 📝Les obstacles pratiques à la place effective de la proportionnalité dans la Compliance
🕴️A. Mendoza-Caminade, 📝Compliance, proportionnalité et évaluation
🕴️L. Meziani, 📝Proportionnalité en Compliance, garant de l’ordre public en entreprise
🕴️M. Segonds, 📝Compliance, proportionnalité et sanction
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Définition du principe de proportionnalité et définition du Droit de la Compliance
III. LES BUTS MONUMENTAUX DE LA COMPLIANCE ÉPROUVÉS PAR LES SITUATIONS DE CRISES
🕴️A. Oumedjkane, A. Tehrani et P. Idoux, 📝Normes publiques et Compliance en temps de crise : les Buts Monumentaux à l'épreuve. Éléments pour une problématique
🕴️J. Bonnet, 📝La crise, occasion de saisir la Compliance comme mode de communication des autorités publiques
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Place et rôle des entreprises dans la création et l'effectivité du Droit de la Compliance en cas de crise
IV. EFFECTIVITÉ DES BUTS MONUMENTAUX DE LA COMPLIANCE ET COMPÉTITIVITÉ INTERNATIONALE
🕴️B. Deffains, 📝L’enjeu économique de compétitivité internationale de la Compliance
🕴️F. Marty, 📝L'apport des programmes de conformité à la compétitivité internationale : une perspective concurrentielle
🕴️S. Lochmann, 📝Les agences de notation ESG et l'effectivité de la Compliance face à la compétitivité internationale
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale
V. LA COMPLIANCE PORTÉE PAR LES BUTS MONUMENTAUX, NOUVELLE VOIE DE SOUVERAINETÉ
🕴️R. Bismuth, 📝Compliance et souveraineté : relations ambigües
🕴️L. Benzoni, 📝Commerce international, compétitivité des entreprises et souveraineté : vers une économie politique de la Compliance
🕴️M.-A. Boursier, 📝Les Buts Monumentaux de la Compliance : mode d'expression des États
🕴️S. Pottier, 📝Pour une Compliance européenne, vecteur d'affirmation économique et politique
🕴️Ch. André, 📝Souveraineté étatique, souveraineté populaire : quel contrat social pour la Compliance ?
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Le principe de proximité systémique active, corollaire du renouvellement du principe de souveraineté par le Droit de la Compliance
_________
1 septembre 2022
Publications
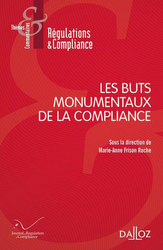
🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Définition du principe de proportionnalité et définition du Droit de la Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2022, p. 245-271.
____
____
🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les Buts Monumentaux de la Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'usage de la Proportionnalité pour toujours limiter les pouvoirs n'est justifié que lorsqu'il s'agit de sanction. Mais dès lors qu'il ne s'agit pas de sanctions, et les sanctions ne sont qu'un outil parmi d'autres, destinées d'ailleurs à avoir peu de place dans ce Droit Ex Ante, et que l'on en revient à la nature même du Droit de la Compliance, qui s'appuie sur des opérateurs, privés ou publics, parce qu'ils sont puissants, alors utiliser la proportionnalité pour limiter les pouvoirs est dommageable au Droit de la Compliance.
Mais rien ne requiert cela. Le Droit de la Compliance n'est pas une exception qu'il faudrait limiter. C'est au contraire une branche du Droit qui porte les plus grands principes, visant à protéger les êtres humains et dont la normativité réside dans les "Buts Monumentaux" : détecter et prévenir les crises systémiques majeurs futures (financières, sanitaires, climatiques).
Or, le principe de Proportionnalité n'est "pas plus de pouvoirs qu'il n'est nécessaire, autant de pouvoirs qu'il est nécessaire". La seconde partie de la phrase est autonome de la première : il faut la saisir. Le Politique ayant fixé ses Buts Monumentaux, l'entité, notamment l'entreprise doit avoir, même tacitement, "tous les pouvoirs nécessaires" pour les atteindre. Par exemple le pouvoir de vigilance, le pouvoir d'audit, le pouvoir sur les tiers. Parce qu'ils sont nécessaires pour remplir les obligations que ces "opérateurs cruciaux" doivent exécuter car ils sont "en position" de le faire.
Ainsi au lieu de limiter les pouvoirs, la proportionnalité vient supporter (au sens anglais) les pouvoirs, les légitimer et les accroître, pour que nous ayons une chance que notre avenir ne soit pas catastrophique, peut-être meilleur. En cela, le Droit de la Compliance, dans sa définition riche, aura lui-même enrichi le principe de proportionnalité.
________
1 septembre 2022
Publications
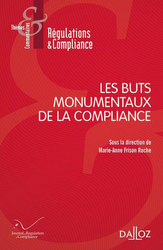
♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
♾️ s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Place et rôle des entreprises dans la création et l'effectivité du Droit de la Compliance en cas de crise", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2022, p. 339-352.
____
____
🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les Buts Monumentaux de la Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Cette réflexion a un objet très précis : la place des entreprises privées, au regard du thème général qui unit les contributions : "l'épreuve que constitue une crise". La crise constitue une "épreuve", c'est-à-dire qu'elle apporte des preuves. Prenons-là comme telle.
En effet, lors de la crise sanitaire, il apparait que les entreprises ont aidé les Autorités publiques à résister au choc, à endurer et à sortir de la crise. Elles l'ont fait de force mais elles ont aussi pris des initiatives dans ce sens. De cela aussi, il faut tirer des leçons pour la prochaine crise qui viendra. Il est possible que celle-ci soit déjà commencé sous la forme d'une autre crise global et systémique : la crise environnementale. Au regard de ce qu'on a pu observer et de l'évolution du Droit, des normes prises par les Autorités mais aussi par les nouvelles jurisprudences, que pourra-t-on attendre des entreprises face à celle-ci, de gré et de force ?
________
1 septembre 2022
Publications
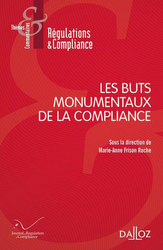
♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
♾️ s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le principe de proximité systémique active, corolaire du renouvellement du principe de souveraineté par le Droit de la Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2022, p. 501-520.
____
____
🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les Buts Monumentaux de la Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : D'une façon étonnante, c'est souvent sur un ton querelleur, courroucé, mécontent, que l'on parle de prime abord de la Compliance, surtout lorsque celle-ci prend une forme juridique, car il s'agit alors de parler de sanctions qui viennent de loin et frapperait à la fois très fort et d'une façon illégitime, le Droit semblant donc ne prendre sa part dans la Compliance que pour accroître sa brutalité : le Droit c'est ce qui prolongerait la guerre entre les Etats pour mieux frapper cette sorte de population civile que serait les entreprises..., dans une nouvelle sorte de "guerre totale planétaire"...
Pourquoi tant de détestation, qui ne peut qu'être engendrée par une telle présentation ?
Parce que, grâce à la puissance du Droit, la Compliance serait donc le moyen pour un Etat, enfin trouvé, de se mêler des affaires des autres afin de servir ses intérêts propres, englobant ceux de ses entreprises, d'aller faire la guerre aux autres Etats et aux entreprises dont ceux-ci se soucient sans avoir même à la leur déclarer dans les formes. Le Droit de la Compliance permettrait enfin à un Etat pas même stratège, juste plus malin, de sortir de son territoire pour aller régenter les autres. Il est vrai que cela parait d'autant plus exaspérant que cela serait en outre sous couvert de vertu et de bons sentiments. Ainsi on ne compte plus dans les écrits qui décrivent et commentent les occurrences de l'expression "cheval de Troie", "guerre économique", etc. L'on compte ainsi plus d'articles sur ce sujet du Droit de la Compliance comme moyen d'aller dicter à des sujets de droit qui relèvent pourtant d'autres systèmes juridiques leurs comportements et de les sanctionner pour y avoir manqué, que sur tous les autres sujets techniques de Compliance.
Dès l'instant que le terme d' "extraterritorialité" est lâché, les couteaux sont tirés. L'abattement de la défaite, car qui peut lutter contre la puissance américaine, le Droit américain séduisant tous ? L'appel à la résistance, ou à tout le moins à la "réaction". En tout cas, il faudrait remettre l'analyse sur son vrai terrain : la politique, la conquête, la guerre donc laisser là la technique juridique, qui serait bonne pour les naïfs et avant tout compter les divisions amassées de chaque côté des frontières, puis constater que seuls les Etats-Unis auraient eu l'ingéniosité d'en compter beaucoup, avec leur armada de juges, de procureurs et d'avocats, avec un Droit de la Compliance amassé comme autant de pièces d'or depuis les années 30, les entreprises américaines relayant l'assaut en internalisant le Droit de la Compliance par des codes, du droit qui n'a de "souple" que le nom et des standards de communauté gouvernant la planète selon des principes américains, la solution consistant alors d'en aligner le plus possible en réaction, puis de tenter de "bloquer" l'assaut. Car s'il n'existe pas de Droit global, le Droit de la Compliance aurait parvenu à globaliser le Droit américain.
La technique des lois de blocage serait donc l'issue heureuse sur laquelle les forces devraient se concentrer pour restaurer la "souveraineté", puisque l'Europe avait été envahie, par surprise par quelques textes célèbres (FCPA) et quelques cas dont l'évocation (BNP) pour l'oreille française sonne comme un Waterloo. Le Droit de la Compliance ne serait donc qu'une morne plaine...
Mais est-ce ainsi que l'on doit appréhender la notion de souveraineté ? La question dite de "l'extraterritorialité du Droit de la Compliance" n'a-t-elle pas été totalement biaisée par la question, certes importante mais aux contours à la fois très précis et très spécifiques, des embargos qui n'a quasiment pas de rapport avec le Droit de la Compliance ?
La première chose à faire est donc d'y voir plus clair dans cette sorte de pugilat de l'extraterritorialité, en isolant la question des embargos des autres objets qui ne doivent pas appréciés de la même façon (I).
Cela fait, il apparaît que là où le Droit de la Compliance est requis, il faut que celui-ci soit effectivement indifférent au territoire : parce qu'il intervient là où le territoire, au sens très concret de la terre dans laquelle on s'ancre n'est pas présente dans la situation à régir, situation à laquelle nos esprits ont tant de mal à s'adapter et qui pourtant désormais est la situation la plus commune : finance, spatial, numérique. Si nous voulons que l'idée de civilisation y demeure, c'est-à-dire que la notion de "limite" y soit centrale. Or, la souveraineté est liée non pas à la toute-puissance, ce sont les petits-enfants qui croient cela, elle est au contraire liée à la notion de limites (II).
Or si la limite avait été naturellement donnée aux êtres humains par le territoire, le sol sur lequel nous marchons et la frontière sur laquelle nous butons et qui nous protège de l'agression, si la limite avait été naturellement donnée aux êtres humains par la mort et l'oubli dans lequel finit par tomber notre corps et notre imagination. En effet, la technologie efface l'une et l'autre de ces limites naturelles. Le Droit était le reflet même de ces limites, puisqu'il était construit sur l'idée de vie et de mort, avec cette idée comme quoi par exemple l'on ne pouvait plus continuer à vivre après notre mort. La technologie numérique pourrait remettre en cause cela. De la même façon, notre Droit avait de la même façon "naturelle" reflété les frontières terrestres, puisque, le Droit international public étant du droit public interne, veillait à ce que chaque sujet souverain reste dans ses frontières terrestres et n'aille au-delà qu'avec l'accord des autres, le Droit international public organisant à la fois l'accueil amical de l'autre, par les traités et la diplomatie, comme l'entrée inamicale, par le Droit de la guerre, tandis que le Droit international privé accueille les Droits étrangers si un élément de rattachement est déjà présent dans la situation.
La complexité des règles et la subtilité des solutions ne modifient la solidité de cette base-là, rattachant toujours le Droit à la réalité matérielle des choses de ce monde qui sont nos corps, qui apparaissent et disparaissent et notre "être" avec eux, et la terre quadrillée par des frontières. Les frontières ont toujours été franchies, le Droit du commerce international n'étant qu'une traduction économique et financière de ce goût naturel des voyages qui ne remet pas en cause le territoire, les êtres humains passant de l'un à l'autre.
Mais le global est arrivé, non pas seulement dans ses opportunités, car l'on peut toujours renoncer au mieux, mais dans des risques globaux dont la naissance, le développement et le résultat ne sont pas maîtrisés et dont il n'est pas pertinent de ne songer qu'à réparer les dégâts car c'est éviter que les risques ne dégénèrent en catastrophe systémique qui est aujourd'hui l'enjeu. Que faire si le territoire se dérobe et si l'hubris saisit les êtres humains qui prétendraient que la technologie pourrait être les nouvelles ailes conduisant quelques fortunés vers le soleil de l'immortalité ? Nous pourrions aller vers un monde à la fois catastrophique et sans limite, deux qualificatifs que les penseurs classiques estimaient identiques.
Le Droit étant ce qui apporte de la mesure, c'est-à-dire des limites dans un monde qui par la technologie promet à quelques-uns la délivrance de toutes ces limites "naturelles", pourrait, par la nouvelle branche du Droit de la Compliance, insérer de nouveau des limites à un monde qui, sans cet apport, deviendrait démesuré, les uns pouvant disposer des autres sans aucune limite : ce faisant le Droits de la Compliance deviendrait alors un instrument de Souveraineté, en ce qu'il pourrait imposer des limites, non pas par impuissance mais au contraire par la force du Droit. C'est pourquoi il est si expressément lié au projet politique de "souveraineté numérique".
Pour renouveler ce rapport entre le Droit et la Souveraineté, où l'Etat prend une nouvelle place, il faut penser de nouveaux principes. Il est ici proposé un nouveau principe : celui de la "proximité", qui doit être insérée dans le Droit Ex Ante et systémique qu'est le Droit de la Compliance. Ainsi inséré, le Principe de Proximité peut être défini d'une façon négative c'est-à-dire sans recourir à la notion de territoire et d'une façon positive c'est-à-dire poser comme étant "proche" ce qui est proche systémiquement, dans le présent et dans le futur, le Droit de la Compliance étant une branche du Droit systémique ayant pour objet l'Avenir.
Ainsi, penser en termes de proximité consiste à concevoir cette notion comme principe systémique, qui renouvelle alors la notion de Souveraineté et fonde l'action des entités en position d'agir, c'est-à-dire les entreprises (III).
Si l'on pense la proximité non pas d'une façon territoriale, le territoire ayant une dimension politique forte mais pas une dimension systémique, mais que l'on pense la proximité systémique d'une façon concrète à travers les effets directs d'un objet dont la situation impacte immédiatement la nôtre (comme dans l'espace climatique, ou dans l'espace numérique), alors la notion de territoire n'est plus première et l'on peut s'en passer.
Si l'idée d'humanisme devait enfin avoir quelque réalité, de la même façon qu'une entreprise "donneuse d'ordre" a un devoir de Compliance à l'égard de qui travaille pour elle, cela rejoint là encore la définition du Droit de la Compliance comme protecteur des êtres humains qui sont proches parce qu'internalisés dans l'objet que nous consommons. C'est bien cette technique juridique-là qui permet la transmission du droit d'action en responsabilité contractuelle avec la chose vendue.
Dès lors, un Principe de Proximité active justifie l'action des entreprises pour intervenir, de la même façon que les Autorités publiques sont alors légitimes à les superviser dans l'indifférence du rattachement juridique formel, ce que l'on voit déjà dans l'espace numérique et dans la vigilance environnementale et humaniste.
________
1 septembre 2022
Publications
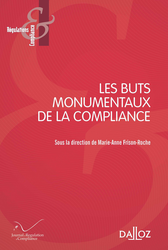
♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
♾️ s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2022, p. 21-44.
____
____
🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les Buts Monumentaux de la Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article : Le droit de la compliance peut être défini comme l'ensemble des procédés obligeant les entreprises à donner à voir qu'elles respectent l'ensemble des réglementations qui s'appliquent à elles. L'on peut aussi définir cette branche par un cœur normatif : les "buts monumentaux". Ceux-ci permettent de rendre compte du droit positif nouveau, rendu ainsi plus clair, accessible et anticipable. Ils reposent sur un pari, celui du souci de l'autre que les êtres humains peuvent avoir en commun, forme d'universalité.
Par les Buts Monumentaux, apparaît une définition du Droit de la Compliance qui est nouvelle, originale et spécifique. Ce terme nouveau de "Compliance" désigne en effet une ambition nouvelle : que ne se renouvelle pas à l'avenir une catastrophe systémique. Cet But Monumental a été dessiné par l'Histoire, ce qui lui donne une dimension différente aux Etats-Unis et en Europe. Mais le cœur est commun en Occident, car il s'agit toujours de détecter et de prévenir ce qui pourrait produire une catastrophe systémique future, ce qui relève de "buts monumentaux négatifs", voire d'agir pour que l'avenir soit différent positivement ("buts monumentaux positifs"), l'ensemble s'articulant dans la notion de "souci d'autrui", les Buts Monumentaux unifiant ainsi le Droit de la Compliance.
En cela, ils révèlent et renforcent la nature toujours systémique du Droit de la compliance, comme gestion des risques systémiques et prolongement du Droit de la Régulation, en dehors de tout secteur, ce qui rend disponibles des solutions pour les espaces non-sectoriels, notamment l'espace numérique. Parce que vouloir empêcher le futur (faire qu'un mal n'advienne pas ; faire qu'un bien advienne) est par nature politique, le Droit de la Compliance concrétise par nature des ambitions de nature politique, notamment dans ses buts monumentaux positifs, notamment l'égalité effectif entre les êtres humains, y compris les êtres humains géographiquement lointains ou futurs.
Les conséquences pratiques de cette définition du Droit de la Compliance par les Buts Monumentaux sont immenses. A contrario, cela permet d'éviter les excès d'un "droit de la conformité" visant à l'effectivité de toutes les réglementations applicables, perspective très dangereuse. Cela permet de sélectionner les outils efficaces au regard de ces buts, de saisir l'esprit de la matière sans être enfermé dans son flot de lettres. Cela conduit à ne pas dissocier la puissance requise des entreprises et la supervision permanente que les autorités publiques doivent exercer sur celles-ci.
L'on peut donc attendre beaucoup d'une telle définition du Droit de la Compliance par ses Buts Monumentaux. Elle engendre une alliance entre le Politique, légitime à édicter les Buts Monumentaux, et les opérateurs cruciaux, en position de les concrétiser et désignés parce qu'aptes à le faire. Elle permet de dégager des solutions juridiques globales pour de difficultés systémiques globales a priori insurmontables, notamment en matière climatique et pour la protection effective des personnes dans le monde désormais numérique où nous vivons. Elle exprime des valeurs pouvant réunir les êtres humains.
En cela, le Droit de la Compliance construit sur les Buts Monumentaux constitue aussi un pari. Même si l'exigence de "conformité" s'articule avec cette conception d'avance de ce qu'est le Droit de la Compliance, celui-ci repose sur l'aptitude humaine à être libre, alors que la conformité suppose davantage l'aptitude humaine à obéir.
C'est pourquoi le Droit de la Compliance, défini par les Buts Monumentaux, est essentiel pour notre avenir, alors que le droit de la conformité ne l'est pas.
________

2 août 2022
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
 ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Prolégomènes pour le système probatoire de la compliance, document de travail, août 2022
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Prolégomènes pour le système probatoire de la compliance, document de travail, août 2022
____
📝ce document de travail a été élaboré pour servir de base à un article : "Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Le système probatoire de la compliance".
📕publié dans sa version française dans l'ouvrage La juridictionnalisation de la Compliance, dans la collection 📚Régulations & Compliance
📘dans sa version anglaise dans l'ouvrage Compliance Jurisdictionalisation, dans la collection 📚Compliance & Regulation
____
► Résumé du document de travail : Pour articuler le système probatoire de la compliance, il convient d'admettre en préalable que le Droit de la preuve est un système à part entière, construit sur un « carré probatoire » fonctionnant quelle que soit la situation, et qu’à première vue le Droit de la Compliance le rejette, étant incompatible avec des principes probatoires majeurs, dès l'instant que l'on définit la Compliance comme l’obligation qu’auraient les entreprises de donner à voir (ce qui relève de la preuve) leur respect de toute la réglementation qui leur est applicable.
Mais heureusement, la Compliance ne doit pas recevoir cette définition. Le Droit de la Compliance consiste dans l’ensemble des principes, institutions, règles et décisions qui, dans une alliance entre Autorités publiques et entreprises cruciales, tend d’une façon substantielle à la concrétisation de Buts Monumentaux. Branche du Droit Ex Ante protectrice des systèmes et des êtres humains qui y sont impliqués, le Droit de la Compliance a pour objet de détecter et de prévenir pour qu’à l’avenir les systèmes soient moins délétères qu’ils ne seraient si l’on ne fait rien, voire soient meilleurs.
De cette action exigée, qui requiert mises en place de structures et séries de comportements, un système probatoire spécifique se dégage. Il est composé en premier lieu d’objets de preuve spécifique, constitués d’une part par les structures et d’autre part par les comportements. En deuxième lieu, la spécificité de la compliance, souvent dénoncée, tient dans la charge de la preuve, dont le fardeau repose sur l’entreprise, mais il faut analyser les interférences avec les autres branches du Droit, que la compliance ne peut avoir détruites. En troisième lieu, l’ampleur des enjeux probatoires est telle que les moyens de preuve se sont multipliés, selon le tryptique de l’effectivité, efficacité et efficience attendues du système de compliance lui-même au regard des buts monumentaux (et non de la réglementation). En quatrième lieu, parce que le Droit de la Compliance est une branche du Droit Ex Ante et que le Juge y est pourtant au centre, il est logique que tous les efforts portent sur la préconstitution des preuves.
____
🔓Lire les développements ci-dessous ⤵️
8 juillet 2022
Publications

► Référence complète : Tardieu, H., Frison-Roche, M.A., Gouriet, M., Gronlier, P., Compliance, and resulting consequences on the labelling framework of Gaia-X, juillet 2022.
____
________
6 juillet 2022
Publications
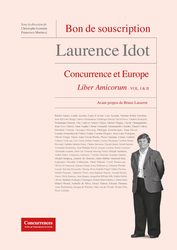
🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'appui du Droit de la Compliance pour la maîtrise quotidienne du Droit de la concurrence", in C. Lemaire & F. Martucci (dir.), Liber Amicorum Laurence Idot. Concurrence et Europe, vol. I, préf. C. Lemaire & F. Martucci, avant-propos B. Lasserre, Concurrences, 2022, pp. 369-374
____
► Résumé de l'article : Le Droit de la concurrence est devenu si énorme et « réglementaire » qu’on finirait par renoncer à vouloir le saisir dans son ensemble, préférant devenir spécialiste de l’une de ses parties. Cela serait perdre de vue la raison simple et forte qui unit l’ensemble et lui donne son souffle :liberté.
Liberté éprouvée par la personne dans son action économique quotidienne, liberté gardée par le Droit de la concurrence, revenant toujours à son principe : la libre concurrence. Raison pour laquelle l’Union européenne fait grande place à la concurrence. Pour la rendre et la garder effective, la « politique de la concurrence » s’articule au Droit de la concurrence mais si autorités et juges ne font pas reproche aux entreprises leur puissance, ils ne s’appuient pas sur celle-ci.
Pour ce faire, il faut alors être épaulé par le Droit de la Compliance, qui incite fortement les entreprises à agir pour l’effectivité et la promotion des principes concurrentiels. Le Droit de la concurrence glisse ainsi de l’Ex Post vers l’Ex Ante, les engagements des entreprises conduisant celles-ci à cesser d’être passives et punies pour devenir des acteurs convaincus et eux-mêmes pédagogues. De quoi plaire à une grande professeure de Droit de la concurrence, à laquelle hommage est ici rendu.
____
📗lire la table des matières des Mélanges
____
🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
____
________

21 juin 2022
Publications

 ♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
♾️s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence générale : Frison-Roche, M.-A. La place de l'Intelligence artificielle dans le respect de la Compliance dans l'entreprise : la juste mesure, document de travail, juin 2022.
____
🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir tout d'abord de base à une intervention dans la conférence de la Cour de cassation du 1ier juillet 2022 : L'intelligence artificielle et la gestion des entreprises.
____
🎥Regarder la conférence prononcée sur la base de ce document de travail
____
📝Il sera également la base à un article.
____
► Résumé du document de travail : Du prochaine Règlement européen sur l'intelligence artificielle, la Commission européenne en a une conception assez neutre pour obtenir un consensus entre les Etats membre, tandis que les Régulateurs et certains Etats en ont une conception plus substantielle voulant que la puissance de celle-ci soit utilisée pour protéger les personnes, et contre ses outils eux-mêmes et contre ce qui est une amplification des maux du monde, comme la haine ou la désinformation. C'est le reflet d'une alternative d'une conception de la Compliance.
En premier lieu, la Compliance peut se définir, soit comme des process neutres qui accroissent l'effectivité de ce qui serait l'obligation ou la volonté pour une bonne gestion des entreprises de se soumettre à la totalité des réglementations qui sont applicables à elle-même et toutes les personnes dont elle doit répondre. C'est ce l'on appelle souvent l'obligation de conformité.
Cette conception implique des conséquences pratiques considérables pour l'entreprise qui pour réussir cet "exploit total" devrait alors recourir à des outils d'intelligence artificielle constituant une "solution totale et infaillible", ce qui engendre mécaniquement pour elle l'obligation de "connaitre" toute la "masse réglementaire", de détecter toutes les "non-conformités", de concevoir son rapport au Droit en termes de "risque de non-conformité", pris totalement en charge par la Compliance by Design qui pourrait, sans intervention humaine, éliminer le risque juridique et garantir la "conformité.
Le "prix juridique" de ce rêve technologique en est très élevé car toutes les prescriptions "réglementaire" vont alors se transformer en obligations de résultat, toute défaillance engendrant responsabilité. Le système probatoire de la Compliance va devenir écrasant pour l'entreprise, tant en termes de charge de preuve, que moyens de preuve, que transferts , sans dispense de preuve. Vont se multiplier des responsabilités objectives pour autrui. Le "droit de la conformité" va multiplier des pénalités systémiques Ex Ante , la frontière avec le Droit pénal étant de moins en moins préservée.
Il est essentiel d'éviter cela, et pour les entreprises, et pour l'Etat de Droit. Pour cela, il faut utiliser l'Intelligence Artificielle à sa juste mesure : elle doit constituer une "aide massive", sans jamais prétendre être une solution totale et infaillible, car c'est l'humain qui doit être au centre et non pas les machines.
Pour cela, il faut adopter une conception substantielle du Droit de la Compliance (et non pas Droit de la conformité). Elle ne vise pas du tout l'ensemble des réglementations applicables et elle n'est pas du tout "neutre", n'ayant en rien une série de process. Cette nouvelle branche du Droit est substantiellement construite sur des buts monumentaux. Ceux-ci sont soit de nature négative (éviter qu'une crise systémique n'arrive, bancaire, financière, sanitaire, climatique, etc.), soit de nature positive (construire un meilleur équilibre, notamment entre les êtres humains, dans l'entreprise et au-delà de celle-ci).
Dans cette conception qui se manifeste de plus en plus fortement, l'intelligence artificielle trouve sa place, plus modeste. En tant que le Droit de la Compliance est basé sur l'information, l'Intelligence Artificielle est indispensable pour la capter et en faire une première mise en connection, la rendant en état d'analyses successives, notamment de la part d'êtres humains, pour qu'il y ait possibilité de ce qui est l'essentiel : l'engagement de l'entreprise, à la fois par les dirigeants et par tous ceux qui sont "embarqués" par une "culture de Compliance" qui est à la fois construite et commune.
Cela redonne l'étanchéité requise entre le Droit pénal et ce que l'on peut demander à l'usage mécanique de l'intelligence artificielle, cela remet l'obligation de moyens comme principe. Cela redonne la place centrale au juriste et au Compliance officer , pour que s'articulent la culture de compliance avec la culture d'un secteur et l'identité de l'entreprise elle-même. En effet, la culture de compliance étant indissociable d'une culture de valeurs, la Compliance by design suppose une double technique, à la fois mathématique et de culture juridique. C'est en cela que le Droit européen de la compliance, en ce qu'il est enraciné dans la tradition humaniste européen, est un modèle.
____
🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
15 juin 2022
Publications

► Full reference : M.-A. Frison-Roche, "Main Aspects of the Book. The Monumental Goals of Compliance Law", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Monumental Goals, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2023, pp. 13-31
___
► Article summary :This article constitutes the afterword of the book Compliance Monumental Goals.
Its purpose is to show the consistency of the book, in that the Monumental Goals themselves, by their normativity, give Uniqueness to Compliance Law, giving it simplicity and strength.
Restituting each of the contributions and articulating them all in an overall demonstration, this article highlights this consistency of the Compliance mechanisms which join the primary function of the Law: the protection of human beings, now and in the future.
___
📘 Read a general presentation of the book Compliance Monumental Goal, in which the article is published
________
► Read Marie-Anne Frison-Roche's presentations of her other contributions in this book :
📝Definition of Principe of Proportionality and Definition of Compliance Law,
📝 Role and Place of Companies in the Creation and Effectiveness of Compliance Law in Crisis,
📝 Assessment of Whistleblowing and the duty of Vigilance
____
This article is freely accessible.
Read this article ⤵️
15 juin 2022
Publications
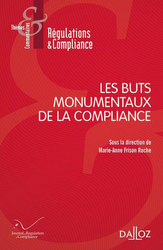
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La dynamique des Buts Monumentaux du Droit de la Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les buts monumentaux de la Compliance, série "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2022, p.1-19.
____
► Résumé de l'article : Cet article constitue la postface du livre Les buts monumentaux de la Compliance.
Il a pour objet de montrer la cohérence du livre, en ce que les Buts Monumentaux eux-mêmes donnent par leur normativité une unicité au Droit de la Compliance, ce qui confère à celui-ci simplicité et force.
Restituant chacune des contributions et les articulant toutes dans une démonstration d'ensemble, il met en valeur cette unicité des mécanismes de Compliance qui rejoignent la fonction première du Droit : la protection des êtres humains, maintenant et à l'Avenir.
___
► lire l'ensemble des présentations des contributions de Marie-Anne Frison-Roche dans cet ouvrage :
📝 Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance
📝 Définition du Principe de Proportionnalité et Définition du Droit de la Compliance
____
Cet article est en libre-accès.
Lire l'article⤵️
9 mai 2022
Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Notes prises pour la synthèse sur le vif de la conférence L'office du juge et les causes systémiques, in Cycle de conférences, Penser l'office du juge, Grand Chambre de la Cour de cassation, 9 mai 2022, 17h-19h.
____
► Résumé des notes prises au fur et à mesure de la conférence : les trois juges, Christophe Soulard, Président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, Fabien Raynaud, Conseiller d'Etat, et François Ancel, Président de la Chambre internationale de la Cour d'appel de Paris, invités à réfléchir et réagir à une hypothèse, à savoir l'existence parmi les cas qui leur sont apportés par les parties, sont intervenus à la fois d'une façon très diverse, très originale et exprimant pourtant l'unicité de l'art de juger.
Les notes prises ci-dessous montrent que les juges ont conscience que les temps ont changé et que, de plus en plus, les "systèmes" sont présents dans les causes qui, construites par les parties, leur sont présentées (1). Leurs analyses, réactions et propositions ont montré à ceux qui les écoutaient que pour appréhender des causes systémiques, les juges doivent être expérimentés (2). Ils ont eu souci de fixer des critères pour identifier la nature systémique des causes parmi la multitude de celles qu'ils traitent, justifiant alors un traitement procédural et décisionnaire particulier (3). L'auditoire a ainsi pu mesurer la part qui revient aux parties (4), puisque le système est dans la construction des faits de la cause et la part qui revient à l'office du juge (5).
Il apparaît alors que par un effet de miroir, l'office du juge se déplace de l'Ex Post vers l'Ex Ante (6), les trois juges décrivant et proposant des mécanismes concrets pour appréhender en Ex Ante cette dimension systémique et y répondre (7). Ils soulignent que cela s'opère en collaboration avec les avocats, dans une instruction élargie et le débat contradictoire (8), dans une collaboration qui s'opère en amont (9). Les trois magistrats ont recherché les techniques procédurales pour accroître la plus grande considération des systèmes (10) et les nouvelles organisations à mettre en place pour répondre à cette dimension systémique de certaines causes (11). Pour ce faire, une dialectique est à opérer vers, à la fois, de l'informel mais aussi plus de formel (12), l'ensemble produisant une meilleure réception méthodologique des systèmes par les juges (13) par une plus grande compréhension entre les juges, quel que soit leur niveau et les droits substantiels en cause, les autorités et les parties systémiques (14).
____
🎥Voir la vidéo de l'ensemble de la conférence
🎥 Voir la vidéo de la synthèse réalisée sur le vif par Marie-Anne Frison-Roche au terme de la conférence
____
📝Lire l'article de Marie-Anne Frison-Roche rendant compte au Dalloz de la conférence.
____
🚧 lire le document de travail L'hypothèse de la "cause systémique, réalisé préalablement à la conférence, pour préparer celle-ci.
_____
✏️ lire les notes exhaustives prises pendant la conférence⤵️
14 avril 2022
Publications
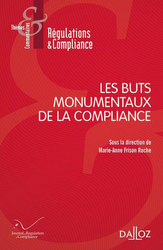
♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
♾️ s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Les buts monumentaux de la Compliance, collection "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, à paraître.
____
► lire le document de travail sur lequel cet article est basé
___
► Résumé de l'article : L'on peut définir cette branche du droit comme l'ensemble des procédés obligeant les entreprises à donner à voir qu'elles respectent l'ensemble des réglementations qui s'appliquent à elles. L'on peut aussi définir cette branche par un cœur normatif : les "buts monumentaux". Ceux-ci permettent de rendre compte du droit positif nouveau, rendu ainsi plus clair, accessible et anticipable. Ils reposent sur un pari, celui du souci de l'autre que les êtres humains peuvent avoir en commun, forme d'universalité.
Par les Buts Monumentaux, apparaît une définition du Droit de la Compliance qui est nouvelle, originale et spécifique. Ce terme nouveau de "Compliance" désigne en effet une ambition nouvelle : que ne se renouvelle pas à l'avenir une catastrophe systémique. Ce But Monumental a été dessiné par l'Histoire, ce qui lui donne une dimension différente aux États-Unis et en Europe. Mais le cœur est commun en Occident, car il s'agit toujours de détecter et de prévenir ce qui pourrait produire une catastrophe systémique future, ce qui relève de "buts monumentaux négatifs", voire d'agir pour que l'avenir soit différent positivement ("buts monumentaux positifs"), l'ensemble s'articulant dans la notion de "souci d'autrui", les Buts Monumentaux unifiant ainsi le Droit de la Compliance.
En cela, ils révèlent et renforcent la nature toujours systémique du Droit de la compliance, comme gestion des risques systémiques et prolongement du Droit de la Régulation, en dehors de tout secteur, ce qui rend disponibles des solutions pour les espaces non-sectoriels, notamment l'espace numérique. Parce que vouloir empêcher le futur (faire qu'un mal n'advienne pas ; faire qu'un bien advienne) est par nature politique. Le Droit de la Compliance concrétise par nature des ambitions de nature politique, notamment dans ses buts monumentaux positifs, notamment l'égalité effectif entre les êtres humains, y compris les êtres humains géographiquement lointains ou futurs.
Les conséquences pratiques de cette définition du Droit de la Compliance par les Buts Monumentaux sont immenses. A contrario, cela permet d'éviter les excès d'un "droit de la conformité" visant à l'effectivité de toutes les réglementations applicables, perspective très dangereuse. Cela permet de sélectionner les outils efficaces au regard de ces buts, de saisir l'esprit de la matière sans être enfermé dans son flot de lettres. Cela conduit à ne pas dissocier la puissance requise des entreprises et la supervision permanente que les autorités publiques doivent exercer sur celles-ci.
L'on peut donc attendre beaucoup d'une telle définition du Droit de la Compliance par ses Buts Monumentaux. Elle engendre une alliance entre le Politique, légitime à édicter les Buts Monumentaux, et les opérateurs cruciaux, en position de les concrétiser et désignés parce qu'aptes à le faire. Elle permet de dégager des solutions juridiques globales pour des difficultés systémiques globales a priori insurmontables, notamment en matière climatique et pour la protection effective des personnes dans le monde désormais numérique où nous vivons. Elle exprime des valeurs pouvant réunir les êtres humains.
En cela, le Droit de la Compliance construit sur les Buts Monumentaux constitue aussi un pari. Même si l'exigence de "conformité" s'articule avec cette conception d'avance de ce qu'est le Droit de la Compliance, celui-ci repose sur l'aptitude humaine à être libre, alors que la conformité suppose davantage l'aptitude humaine à obéir.
C'est pourquoi le Droit de la Compliance, défini par les Buts Monumentaux, est essentiel pour notre avenir, alors que le droit de la conformité ne l'est pas.
____
📝 lire la présentation générale du livre, Les Buts Monumentaux de la Compliance, dans lequel l'article est publié.
_____
► Lire les présentations des autres contributions de Marie-Anne Frison-Roche dans cet ouvrage :
📝 Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance,
________

Mise à jour : 4 avril 2022 (Rédaction initiale : 4 octobre 2021 )
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR. Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, L'hypothèse de la catégorie des causes systémiques portés devant le juge, document de travail, oct. 2021 et avril 2022.
____
► Ce document de travail sert de base à une intervention introductive🎤L'hypothèse de la catégorie des causes systémiques, dans une conférence plus générale, coordonnée et modérée, 🧱L'office du juge et les causes systémiques, qui fait partie d'un cycle général portant sur Penser l'office du juge, et se tiendra le 9 mai 2022 dans la Grand Chambre de la Cour de cassation.
Il a été élaboré en octobre 2021 pour construire la conférence à partir de cette hypothèse selon laquelle parmi la diversité des "causes" apportées aux juges par les justiciables, certaines constituent une catégorie spécifique : les "causes systémiques", justifiant un traitement à la fois spécifique (en ce qu'elles sont systémiques, appelant notamment des solutions procédurales communes à toutes et se distinguant du traitement des causes non-systémiques) et un traitement commun au-delà de la diversité des juges qui en connaissent (juges judiciaire et administratif, juge pénal et non-pénal, juge français et non-français, juge de l'ordre juridique internet et juge de l'Union européenne, etc.). Ce thème spécifique des "causes systémiques", l'hypothèse de l'existence de celles-ci, a été enrichi en avril 2022.
Ce document de travail ne vise pas à traiter l'ensemble du sujet, à savoir à la fois déterminer cette catégorie des "causes systémiques" et les conséquences qu'il faut en tirer sur l'office du juge, puisque c'est l'objet même de la conférence construite sur plusieurs interventions : il vise la première partie du sujet, à savoir l'existence même de cette catégorie processuelle nouvelle qui serait les "causes systémiques", laissant pour d'autres travaux les conséquences pratiques à en tirer dans le traitement processuel qu'elles appellent.
____
📝Ce document de travail sert également de base à un article à paraître
____
►Résumé du document de travail : xx
________
Lire ci-dessous les développements⤵️