25 novembre 2020
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
► Référence complète: Cour de Cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 2020, n°18-86.955, Société Iron mountain France SAS.
____
🏛️Lire le communiqué de presse de la Cour de Cassation
🏛️Lire la note explicative de la Cour de Cassation
____
📝Lire le commentaire de Julie Gallois
____
Résumé de l'arrêt : Dans cet arrêt constituant un revirement de jurisprudence, la Chambre criminelle de la Cour de cassation pose que la société qui absorbe celle à laquelle sont imputables des faits pouvant recevoir une qualification pénale entrainant des peines d'amendes a l'aptitude d'en répondre pénalement.
L'arrêt précise que ce revirement n'est applicable que pour les cas futurs, pour respecter le principe de prévisibilité, sauf si cette fusion n'a été exécutée que pour échapper à la responsabilité pénale des personnes morales.
Ce cas est un exemple de l'utilisation du Droit de la responsabilité pénale comme incitation.
________
24 octobre 2019
Base Documentaire : 05.1. CEDH
Référence complète: CEDH, 24 janvier 2019, Carrefour France c/. France, n°21488/14
Lire le communiqué de presse de la CEDH
Résumé de l'arrêt
Dans cet arrêt, la CEDH condamne la société Carrefour France a une amende civile à raison de pratiques restrictives de concurrence commises par la société Carrefour hypermarchés France, dissoute et absorbée par son unique actionnaire Carrefour France après les faits.
12 juin 2019
Base Documentaire : Doctrine
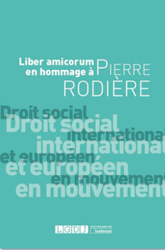
Référence complète: Fabre-Magnan, M., La responsabilité du fait du cocontractant. Une figure juridique pour la RSE, in Liber amicorum en hommage à Pierre Rodière. Droit social international et européen en mouvement, Coll. Mélanges, LGDJ-Lextenso, 2019, pp. 79-90
Les étudiants de Sciences Po ont accès à l'article via le Drive de Sciences Po dans le dossier MAFR - Régulation & Compliance
13 février 2019
Base Documentaire : Doctrine

Référence générale : Patrick Wajsman (dir.), Politique internationale, dossier spécial, Investissement responsable : l'essor, n°162, hiver 2018-2019, 119 p.
Consulter le sommaire de la Revue.
Consulter la présentation des entretiens suivants :
Boujnah, S., Places boursières : promouvoir un modèle européen.
Jensen, S., Norvège : exemple d'un fonds souverain éthique.
Ribera, T., Faciliter la transition écologique : ce que peut l'État.
6 juin 2018
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : R. Pisillo Mazzechi, "Le chemin étrange de la due diligence : d'un concept mystérieux à un concept surévalué", in S. Cassella dir.), Le standard de due diligence et la responsabilité internationale, Pedone, 2018.
____
19 mai 2018
Blog

Il y a quelques jours, dans une réunion j'écoutais Alain Supiot.
Et cela m'a fait penser à un article sous presse que je viens de lire d'une ancienne élève à laquelle j'avais consacré des journées entières pour la guider dans son travail.
Puis ce matin, j'ai lu un extrait d'un livre de Bernard Maris.
Et cela m'a fait penser à des pages de Nietzsche.
Et je me suis dit : la question n'est-elle pas d'échapper non pas du tout à celle de la dette, qui est une question éthique et juridique fondamentale, une notion vaste et belle, mais à une sorte de piège, étroit et mortifère dans lequel il n'y aurait comme "place de référence" comme la place de "débiteur" ou bien la place de "créancier". A la fois en éthique, en économie et en droit.
Et si l'on a tant de mal à trouver notre place, n'est-ce pas parce qu'être "débiteur" peut renvoyer à deux positions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre ? L'une dans laquelle nous portons une dette qui suppose l'existence d'un créancier (ce qui suppose toujours une exécution à venir, une opposition, une violence), et l'autre dans laquelle nous portons une dette qui pourrait exister sans qu'existe un créancier ?
Lire ci-dessous
16 avril 2018
Blog

C'est à propos d'un cas particulier que l'on peut reformuler les questions générales. Si le cas est brûlant, il est d'autant plus important de revenir aux questions générales, qui sont toujours plus froides (plus ennuyeuses, aussi).
Ainsi, Cambridge Analytica, voilà bien un cas dont on parle beaucoup ... Il est à la fois particulier et très brûlant.
On en parle donc beaucoup, et avec véhémence, et d'une façon souvent définitive, aussi bien en attaque qu'en défense.
Pour l'accusation, l'on trouve beaucoup d'avocats, rassemblés par exemple dans les dossiers du Guardian :
Pour la défense, l'on en trouve moins. Mais l'on peut lire par exemple l'article paru début avril 2018 : Why (almost) everything reported about the Cambridge Analytica Facebook ‘hacking’ controversy is wrong
Le nombre et le caractère plus ou moins enflammés, en tout cas toujours définitifs, des propos ne veulent rien dire en soi.
Les régulateurs ont pris la parole un peu plus tard, à la fois d'une façon plus concrète, le "groupe des 29" (réunissant tous les Régulateurs européens des données personnelles) établissant le 11 avril 2018 un groupe de travail à ce sujet et publiant le 10 avril 2018 des nouvelles lignes de conduite sur la place qui doit être faite au "consentement" (voir la présentation qu'en a faite par exemple CNIL, le 12 avril 2018.
Mais ce n'est pas ce que l'on trouve dans les médias. Ce qu'on y lit, ce qu'on y voit bien ressemble plutôt à un procès, car chacun affirme avoir entièrement raison et pose que l'autre a entièrement tort. Procès pour faire éclater la vérité et la vertu, disent les accusateurs. Procès en sorcellerie, dit Facebook mis en cause. Et c'est toujours à nous que cela s'adresse.
Car tout cela tient sans doute au fait que nous ne sommes plus spectateurs : nous sommes placés dans la position du juge. Le marché financier a été le premier juge. Il a déjà condamné. Sans chercher à vraiment savoir. Cela tient au fait que le bien public des marchés financiers est la confiance, il suffit que l'on puisse même soupçonner l'épouse de César, et ce n'est donc pas vraiment de vérité des faits et de bonne application de règle qu'il s'agit.
Pour l'opinion publique que nous sommes, il s'agit d'autre chose, car nous pourrions attendre d'en savoir plus, puisque nous cherchons à rester encore un peu attachés à la "vérité" des faits et au respect du Droit. Or, le cas est complexe et relève avant tout d'une analyse juridictionnelle qui viendra et que nous ne pouvons mener, aussi bien en ce qui concerne les faits - qui sont complexes - que des règles de droit à appliquer qui le sont tout autant.
Ce qui nous transforme en tribunal, phénomène sociologique ordinaire, c'est un mécanisme juridique nouveau : le "lanceur d'alerte. Par nature, il donne la prime à l'attaque.
Cette logique du mécanisme juridique du "lanceur d'alerte", mouvement de fait de lancer des faits comme on lance une bouée à l'extérieur mais on pourrait dire aussi des pierres sur celui-ci que l'insider dénonce, logique aujourd'hui encouragée et protégée par le Droit, permet à une personne qui connait quelque chose, le plus souvent parce qu'il y a participé, de le faire savoir à tous, sans filtre. De le dénoncer. Pour le bien public.
Les textes successifs sur le lanceur d'alerte sont des textes d'un Droit de la Compliance
Le cas est exemplaire de cela, puisque Facebook n'est "dénoncé" qu'en second rang, derrière Cambridge Analytica, mais la notoriété et la puissance du premier fait qu'il est frappé en premier. Le Droit français dans la loi dite "Sapin 2" de 2016 a veillé à protéger l'entreprise dénoncée, mais les droits britanniques et américains sont plus violents, sans doute parce qu'ils manient plus rapidement le private enforcement.
La temporalité est donc favorable à l'attaque. Le temps de la défense est toujours plus lent. Ce sont d'habitude les personnes en situation de faiblesse qui le subissent : lenteur de la justice, justice hors des palais de justice, etc. Avec les mécanismes de Compliance, ce sont sans doute les très puissants qui vont vivre cela. Il ne s'agit en rien de s'en réjouir : le malheur des uns (ici la difficulté qu'a une entreprise hâtivement "jugée") ne console en rien du malheur des autres (la difficulté des êtres ordinaires accusés ou n'ayant que le droit pour se protéger à atteindre concrètement un juge et à obtenir vraiment un jugement exécuté, alors même qu'ils sont dans leur droit).
Mais si l'on passait aux questions générales, puisque sur les faits de ce cas, nous n'avons pas les moyens de les apprécier, pas plus que sur les règles qui leurs sont applicables nous ne pouvons les appliquer d'une façon adéquate tant qu'une juridiction n'aura pas exercé son office ?
Or, les perspectives générales mises en lumière par ce cas singulier sont de deux ordres : d'ordre probatoire (I) et d'ordre de la responsabilité (II).
Lire ci-dessous.
Frison-Roche, M.-A., Le Droit de la Compliance, 2016.
Sur cette notion, Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017.
13 mars 2018
Blog
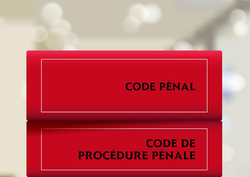
Le journal Libération du 13 mars 2018 reprend l'histoire ; le Huffington Post la raconte pareillement.
Reprenons-là du côté du Droit.
Cette personne qui a assassiné une femme, a été condamné pour cela à 8 ans de prison,en a exécuté 4 ans . Aujourd'hui libre, estime que l'on ne peut pas protester contre le fait qu'il fasse une tournée publique. Il l'exprime en des termes notamment juridiques : il estime qu'il a «payé la dette à laquelle la justice (l’a) condamné», il invoque «le droit à la réinsertion. Le droit d’exercer mon métier».
Voilà son texte, publié sur Facebook :
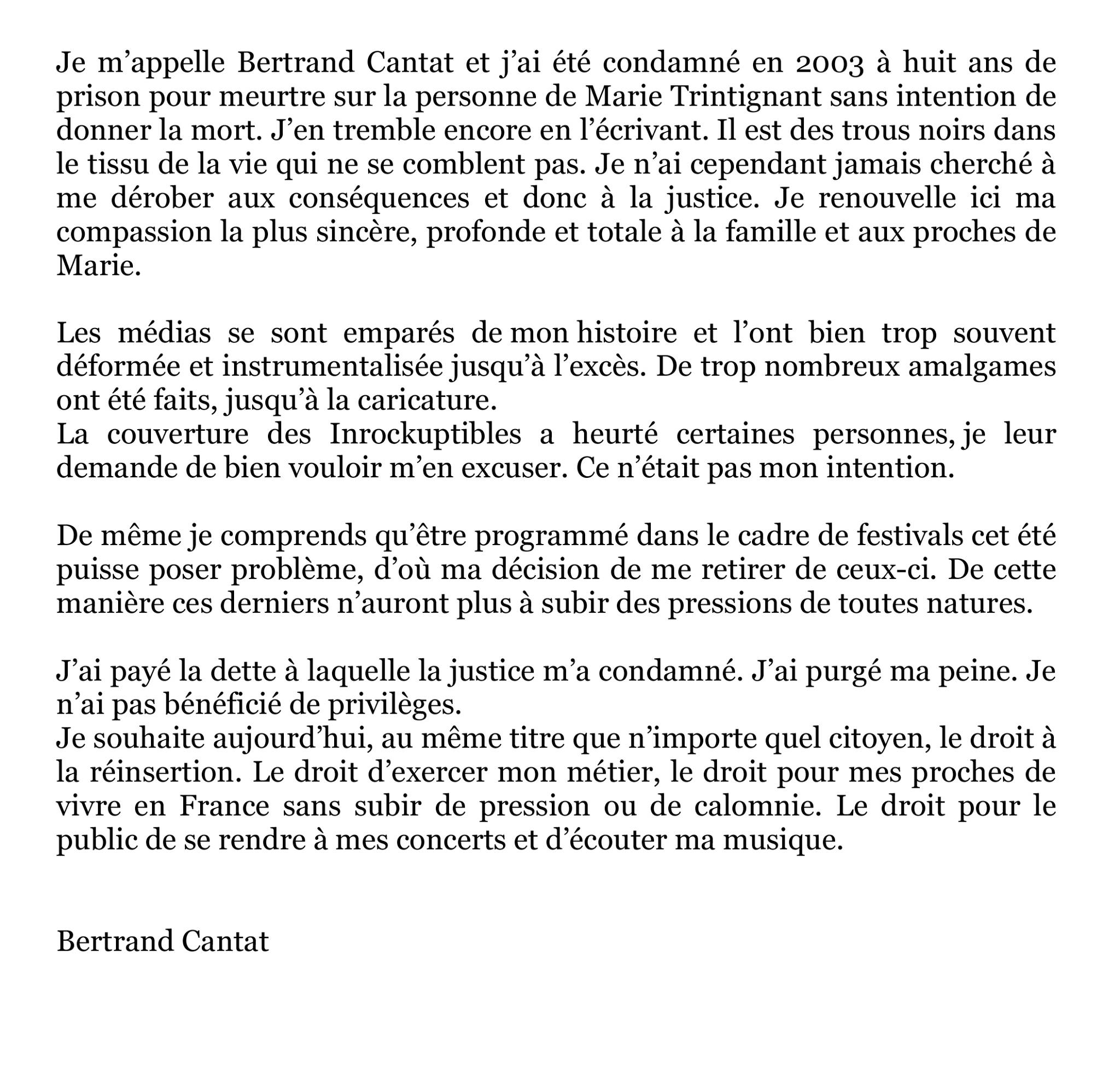
1. La justice ne condamne pas à "payer une dette". C'est une qualification inexacte. La justice pénale n'est pas la justice civile. Si Bertrand Cantat avait été "débiteur d'une dette", alors son créancier l'aurait assigné en justice, devant une juridiction civile et le tribunal l'aurait condamné à exécuter son obligation juridique qui existait préalablement. Condamné civilement, l'exécution qu'il aurait faite de cette obligation civile au bénéfice de son créancier dans un rapport bilatérale aurait éteint le rapport de créance.
Mais il s'agit de la justice pénale et en rien de la justice civile. Il y a un fait, une infraction qui heurte une valeur fondamentale de la vie en société : il ne faut pas tuer les autres personnes. C'est pourquoi le Ministère public, qui représente la société, demande aux tribunaux répressifs de prononcer la culpabilité des auteurs de ces infractions et de prononcer des peines qui sanctionnent ces actes, ces personnes et pas d'autres. Il ne s'agit pas de réparer : la responsabilité pénale est distincte de la responsabilité civile. Elle est gouvernée par les principes constitutionnels majeurs : personnalité des délits et des peines, légalité des délits et des peines, non-rétroactivité, etc. Ainsi, la justice ne condamne en rien à payer une dette, elle condamne une personne qui a commis une infraction ayant atteint une valeur fondamentale de la vie en société. Et de cela une trace est conservée : le casier judiciaire. Ainsi, après l'exécution de la peine, il y a un souvenir de ce qui s'est passé. C'est pourquoi la personne peut continuer à être qualifier de "meurtrier", le "droit à l'oubli" étant un droit subjectif très particulier conféré par des dispositifs législatifs spéciaux en matière numérique
En affirmant que "la justice l'a condamné à payer une dette", c'est une référence implicite à des théories comme quoi il y aurait comme un "contrat" entre l'individu et la justice pénale, l'auteur de l'infraction "achetant" la possibilité de commettre un acte illicite, même un meurtre, au "prix" par exemple d'une privation de liberté (8 ans de prison, ou 4 ans effectivement exécutés), et après c'est fini, se ramènent à une théorie américaine, très libérale, liées à une analyse économique du droit, notamment celle de Gary Becker (qui l'a appliqué à la matière criminelle), où tout s'achète et tout se vend. Par exemple la vie d'un être humain : ici 4 ans de prison. Et une fois que le prix est payé, tout serait dit, plus rien ne pourrait être dit, l'on pourrait acheter un autre acte illicite dès l'instant que l'on "consent" à payer le prix demandé par la société (temps passé en prison, montant d'amende, etc.).
Mais l'on peut ne pas partager cette conception comme quoi tout s'achète, ici dans le cas précis la vie d'une femme contre 4 ans d'enfermement.
Et cette conception n'est pas la base du Droit pénal et de la Procédure pénale français, selon lesquels la justice pénale prononcent des peines et non pas des prix. Ainsi, en rien la justice n'a "condamné Bertrand Cantat à payer une dette". Cela l'aurait bien arrangé (car cela aurait été bien peu cher), mais juridiquement c'est faux. Non, cela n'est pas comme au bistro, l'ardoise ne s'efface pas, ce n'est pas ainsi que fonctionne la Justice.
2. La situation de fait relève ici non pas de "droits" mais des diverses libertés en cause : liberté de se réinsérer, liberté de travailler, liberté de s'exprimer dont sont titulaires également les membres de la société
Il faut distinguer les "droits" et les "libertés".
Bertrand Cantat revendique des "droits" : le "droit à la réinsertion", par exemple, le "droit d'exercer son métier".
Le "droit subjectif" se définit comme une prérogative juridique dont est titulaire une personne, qui est donc "créancière", ce qui suppose qu'existe un sujet passif : un débiteur. Or, il n'existe pas de sujet passif à un tel "droit à", sauf à supposer que l’État soit le sujet passif du "droit à la réinsertion", si l'on transforme toutes les politiques publiques qui visent à réinsérer dans la société les personnes ayant exécuté des peines. Il s'agit plutôt de liberté et de principe de non-discrimination, c'est-à-dire de "droit d'accès", une personne ayant fait de la prison ne pouvant être privée de la liberté d'agir (la liberté ne supposant aucun débiteur) et ne pouvant pas être privée sans justification d'accès à une activité, notamment professionnelle.
C'est donc sur le terrain des libertés qu'il convient de se placer et non pas sur le terrain des droits subjectifs, car sinon il faut désigner les débiteurs dont Bertrand Cantat serait le créancier
Et contre cette liberté d'expression dont tous et chacun nous sommes titulaire, Bertrand Cantat ne peut rien, car les personnes qui s'expriment ainsi ne sont en rien ses débiteurs.
_____
Pour le mesurer, il suffit de prendre un cas récent : dans un jugement du 14 février 2018, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné une personne qui a méconnu le "droit à l'oubli" d'une personne qui avait été condamné pénalement et dont une personne faisait pourtant de nouveau état de ses deux condamnations. Mais en premier lieu, comme le souligne le jugement, l'auteur du site était animé d'une "intention malveillante" dont l'intéressé avait démontré l'existence, celui-ci devenait identifiable alors que dans les décisions publiées sur Légifrance il avait été anonymisé : l'atteinte à la vie privée était donc constituée et l'intention de nuire ici démontrée justifie la condamnation du tiers, malgré le caractère public des décisions de justice d'une part et le principe de liberté des débats d'autre part.
Mais d'une façon générale, c'est en terme de "droit", et même de "droit à", que la situation est analysée. Par exemple dans l'émission du 12 mars 2018. Dès lors que le meurtrier serait titulaire d'un "droit à", il faudrait que les tiers puissent se revendiquer d'un autre "droit à". Ainsi, Bertrand Cantat se prévaut, et d'un "droit à l'oubli" (qui n'existe pas en l'espèce) et d'un "droit à la réinsertion" (qui n'existe pas non plus). Dès lors, la mère de la victime ne sait plus quoi dire.... Alors qu'il s'agit de libertés, et la mère de la victime a la liberté de s'exprimer.
1 mars 2018
Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Dedieu, D., et Gallois-Cochet, D., Obligations et responsabilité des dirigeants dans le cadre des exigences de compliance en droit français, in Bulletin Joly Sociétés, Lextenso, n°3, mars 2018, pp.173-184.
L'étude appréhende les dispositifs de compliance résultant des lois Sapin 2 et Vigilance sous l'angle des dirigeants de sociétés. Elle examine l'identité des dirigeants responsables de ces deux dispositifs et la nature des obligations préventives leur incombant personnellement. Elle analyse enfin les sanctions, tant répressives qu'au titre de leur responsabilité civile personnelle, encourues par ces dirigeants ès qualité pour tout manquement à ces dispositifs préventifs.
Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier "MAFR - Regulation & Compliance".
1 février 2018
Blog

- "Affaire Alexia Daval : une volte-face caméra"
- "Chibanis discriminés : la justice passe, la SNCF devra payer"
- "Lactalis "ne peut exclure" que des bébés aient consommé du lait contaminé entre 2005 et 2017
- "Violences faites aux femmes ou terrorisme : des procès sous pression"
- "La défenses de Jonathann Daval provoque un tollé"
Cela fait longtemps que l'on parle beaucoup de Droit. Les faits divers ont toujours passionnés. La sociologie a toujours regardé cette façon que le "grand public" a regardé cette représentation que la presse lui donne du Droit. L'affaire des sœurs Papin, qui intéressa aussi Lacan, étant sans doute le plus bel exemple.
Cela fait longtemps aussi que l'on observe dans les médias grand public une appréhension du Droit à travers les procès, alors que non seulement les procès ne sont qu'une partie du Droit, mais encore certains affirment qu'ils ne sont que la partie pathologique du Droit.
Ce qui est remarquable ici, c'est le fait que la plus grande partie de l'actualité du jour concerne le Droit (car l'information sur Lactalis est une information précontentieuse).
Quelles conséquences en tirer ?
Il convient d'apprendre le droit technique aux lecteurs des journaux, c'est-à-dire au "grand public", le Droit (par exemple le droit public, le droit de la responsabilité, le droit de la sécurité des produit, le droit du travail, pour prendre ceux correspondant à cette actualité du jour).
Or, si l'économie fait partie des programmes des lycées, le Droit en est absent. Alors même qu'on explique, à juste titre, qu'on doit inculquer davantage de sciences économiques.
Mais le Droit est une matière qui n'est pas enseignée du tout, sauf dans l'enseignement supérieur spécialisé.
Or, cela intéresse toute la population.Comme le montrent les titres d'un quotidien grand public.
Ne convient-il pas de rapprocher les deux faits, et d'en tirer des conséquences ?
La principale est la nécessité de donner à chacun les moyens de comprendre ces informations juridiques, parce que non seulement c'est important mais aussi parce que cela intéresse chacun (c'est donc un "intérêt aux deux sens du terme).
D'en trouver les voies et les moyens.
_____
16 décembre 2017
Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Pons, L., Anonymat des sociétés par actions et transparence : une (r)évolution juridique, in Journal Spécial des Sociétés, Chronique du 16 dec. 2017, n°96, pp. 14-15.
11 octobre 2016
Base Documentaire
Référence complète : Martineau-Bourgnineaud, V., La légalisation de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) au service du dialogue social : idéologie ou utopie ? , Petites Affiches, 11 octobre 2016, p.6-11.
L'auteur relève que l'expression de "responsabilité sociale de l'entreprise" est peu définie. La Commission Européenne y voit la "responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société", les salariés faisant partie de ses "parties prenantes", et la norme ISO 26000 de 2010 sur la gouvernance intégrant les relations de travail.
La RSE a pénétré le Droit par la loi de 2001 sur les "nouvelles régulations économiques", tandis que la loi de 2010 réformant le droit des sociétés cotées et important le principe "appliquer ou expliquer" oblige à inclure dans le rapport annuel de gestion des données sociales et environnementales. En cela ce rapport RSE promeut le dialogue social.
L'auteur pose donc que "cette nouvelle idéologie" est entrée dans le Droit.
Cette "consécration d'une idéologie" consiste à "créer un cadre réglementaire qui place l'homme au cœur des préoccupations de l'entreprise", en changeant pour cela sa gouvernance. En obligeant à la diversité dans les conseils d'administration, notamment leur féminisation et la présence des salariés. Le dialogue social prend la forme aussi de la participation des institutions représentatives du personnel dans le "reporting social et environnemental" et leur participation sur la stratégie de l'entreprise, puisque les discussions à ce propos prennent pour base les reportings précités. On constate cependant que les comités d'entreprise sont peu associés.
C'est sans doute pour cela que l'auteur considère que la RSE comme dialogue social relève plutôt d'une "utopie"...
Le dialogue social participe pourtant de la performance économique de l'entreprise et la loi dite Rebsamen du 17 août 2015 s'en prévaut, la loi du 8 août 2016, dite El Khomri inclut dans la "base de données économiques et sociales" et le taux de féminisation des conseils d'administration et le nombre d'accords collectifs.
Mais l'auteur estime qu'à mettre dans le dialogue social des éléments qui n'en relèvent pas - comme l'environnement ou le sociétal - on affaiblit le dialogue social.
L'auteur conclut son article d'une façon très critique en ces termes :
"La RSE à l'épreuve du droit nus enseigne que l'élément matériel de la RSE, les obligations légales (reporting, diversité des conseils d'administration, régle complain or explain...), et l'élément psychologique, son caractère volontaire impulsé par les dirigeants de l'entreprise sont indissociables. Alors que la RSE entend mettre l'humain au coeur des préoccupations de l'entreprise, on constate qu'il y a complète dissociation entre le discours affiché et la réalité économique et sociale. ..... cette RSE légalisée devient un instrument sophistique au service de ce but exclusif en permettant aux entreprises de se draper de vertus dans le but d'acheter la paix sociale, les conflits sociaux étant l'ennemi juré de la productivité.".
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article en accédant via le drive au dossier "MAFR - Régulation"
22 juillet 2016
Base Documentaire : Doctrine
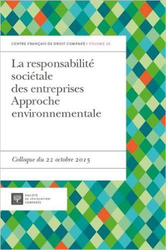
Référence complète : Parance, B., La responsabilité sociétale des entreprises. Approche environnementale, coll. "Centre français de droit comparé", vol.20, Société de législation comparée, 2016, 204 p.
Voir la quatrième de couverture.
+
Voir la présentation des articles publiés dans cet ouvrage :
9 mars 2016
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Schmid, J., Après la dénazification, la "renazification ? La réintégration des magistrats en Allemagne d'après la guerre (1945-1968), Droit et société, vol. 92, n°1, 2016, p.159-1979.
____
► Résumé de l'article (par l'auteur) : L’article propose une synthèse critique de travaux publiés sur l’épuration et la réintégration des magistrats allemands ayant exercé leurs fonctions sous le régime nazi. Il traite de la période entre le début de la dénazification en 1945 jusqu’en 1968, date à laquelle la plupart des magistrats actifs sous le nazisme prennent leur retraite. À travers les différentes étapes d’une dénazification administrative et juridique, l’article cherche à saisir la nature d’une « renazification » dénoncée par les institutions judiciaires ouest-allemandes. Contrairement à l’Allemagne de l’Est où la magistrature est purgée minutieusement sans réintégration de ceux qui en ont été écartés, l’Allemagne occidentale connaît un retour massif des magistrats compromis. Si ces derniers ne s’opposent pas au développement d’un système judiciaire démocratique, on constate un manque de prise de conscience de leur responsabilité sous le régime nazi.
17 décembre 2014
Conférences

Toulouse School of Economics, Conference in Law and Economics
Organizers : Simone M. Sepe and Jean Tirole
Read The Working Paper (in French and in English)
14 octobre 2014
Enseignements : Grandes Questions du Droit, Semestre d'Automne 2014
14 octobre 2014
Enseignements : Grandes Questions du Droit, Semestre d'Automne 2014
 La responsabilité est un thème philosophique majeur, qui fonde les sociétés et les personnes. Les personnes irresponsables sont-elles encore des personnes ? Si les animaux accédaient à la personnalité, il faudrait les déclarer aptes à la responsabilité. Classiquement, une personne est responsable parce qu'elle est coupable, conception avant tout religieuse de la responsabilité, qui met au centre la notion de faute. Plus pragmatiquement, c'est aujourd'hui l'engagement qui noue l'obligation de répondre, par exemple l'engagement contractuel d'un assureur. La responsabilité n'est plus alors individuelle mais collective et renvoie à un marché de la responsabilité ou à une prise en charge collective par les pouvoirs publics. Dans une description plus technique, une personne est responsable par sa faute, du fait d'une chose ou du fait d'une personne. Mais si les textes ont jusqu'ici peu bougé dans le Code civil, la jurisprudence a objectivisé le système, développant les deux dernières hypothèses, pour privilégier la fonction réparatrice des responsabilités, y compris pénales et administratives, même si la réparation est symbolique. Les conséquences de la responsabilité sont en effet très diverses. Il peut s'agir aussi bien du remord, qu'il est difficile de demander aux personnes morales mais qu'on exige de ses dirigeants, la punition pour laquelle le droit actuel développe une grande passion, tandis que la réparation devient un souci majeur et se transforme en prévention, dans une société du risque 0.
La responsabilité est un thème philosophique majeur, qui fonde les sociétés et les personnes. Les personnes irresponsables sont-elles encore des personnes ? Si les animaux accédaient à la personnalité, il faudrait les déclarer aptes à la responsabilité. Classiquement, une personne est responsable parce qu'elle est coupable, conception avant tout religieuse de la responsabilité, qui met au centre la notion de faute. Plus pragmatiquement, c'est aujourd'hui l'engagement qui noue l'obligation de répondre, par exemple l'engagement contractuel d'un assureur. La responsabilité n'est plus alors individuelle mais collective et renvoie à un marché de la responsabilité ou à une prise en charge collective par les pouvoirs publics. Dans une description plus technique, une personne est responsable par sa faute, du fait d'une chose ou du fait d'une personne. Mais si les textes ont jusqu'ici peu bougé dans le Code civil, la jurisprudence a objectivisé le système, développant les deux dernières hypothèses, pour privilégier la fonction réparatrice des responsabilités, y compris pénales et administratives, même si la réparation est symbolique. Les conséquences de la responsabilité sont en effet très diverses. Il peut s'agir aussi bien du remord, qu'il est difficile de demander aux personnes morales mais qu'on exige de ses dirigeants, la punition pour laquelle le droit actuel développe une grande passion, tandis que la réparation devient un souci majeur et se transforme en prévention, dans une société du risque 0.
14 octobre 2014
Enseignements : Grandes Questions du Droit, Semestre d'Automne 2014
La responsabilité est un thème philosophique majeur, qui fonde les sociétés et les personnes. Les personnes irresponsables sont-elles encore des personnes ? Si les animaux accédaient à la personnalité, il faudrait les déclarer aptes à la responsabilité. Classiquement, une personne est responsable parce qu'elle est coupable, conception avant tout religieuse de la responsabilité, qui met au centre la notion de faute. Plus pragmatiquement, c'est aujourd'hui l'engagement qui noue l'obligation de répondre, par exemple l'engagement contractuel d'un assureur. La responsabilité n'est plus alors individuelle mais collective et renvoie à un marché de la responsabilité ou à une prise en charge collective par les pouvoirs publics. Dans une description plus technique, une personne est responsable par sa faute, du fait d'une chose ou du fait d'une personne. Mais si les textes ont jusqu'ici peu bougé dans le Code civil, la jurisprudence a objectivisé le système, développant les deux dernières hypothèses, pour privilégier la fonction réparatrice des responsabilités, y compris pénales et administratives, même si la réparation est symbolique. Les conséquences de la responsabilité sont en effet très diverses. Il peut s'agir aussi bien du remord, qu'il est difficile de demander aux personnes morales mais qu'on exige de ses dirigeants, la punition pour laquelle le droit actuel développe une grande passion, tandis que la réparation devient un souci majeur et se transforme en prévention, dans une société du risque 0.
17 mars 2014
Base Documentaire : 02. Lois
Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 6 décembre 2011 )
Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 8 novembre 2011 )
Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

18 juin 2012
Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le droit à un tribunal impartial, in , CABRILLAC, Rémy, FRISON-ROCHE, Marie-Anne et REVET, Thierry (dir.), Libertés et droits fondamentaux, 18ième éd., Dalloz, Paris, 2012 p. 557-570.
L’État de Droit n'a de sens que si les tribunaux sont impartiaux, afin que les citoyens y aient la garantie de leurs droits, comme le reflète l’article 6 de la Convention Européenne des droits de l’Homme. Dès lors, le juge doit donner à voir sa neutralité, n’être pas en conflit d’intérêts, encore moins corrompu. Mais cela contredit la tendance vers une justice toujours plus humaine et personnalisée. Pour avoir les moyens de ce luxe nécessaire de l’impartialité, le système juridique doit organiser l’indépendance du juge à l’égard de l’État,dans l’acte de juger et dans sa carrière.
Lire le résumé de l'article ci-dessous
10 mai 2007
Conférences
7 avril 2007
Publications

Références complètes : FRISON-ROCHE, Marie-Anne (dir.), Responsabilité et régulation économique, coll. "Droit et Economie de la Régulation", vol.5, Dalloz / Presses de Sciences Po, 2007, 187 pages.
L'ouvrage analyse dans sa première partie le rôle des responsabilités dans les régulations économiques d'une façon générale. Pour l'analyse économique, cela s'insère dans la perspective des incitations, tandis que les juristes, plus attachés aux principes fondamentaux du droit pénal, sont réticents face à cette instrumentalisation. Le droit public conçoit davantage la responsabilité comme un mode de reddition des comptes pour des structures puissantes et indépendantes. La seconde partie de l'ouvrage porte sur des secteurs particuliers, à savoir le secteur bancaire et financier, le secteur de la publicité et l'arbitrage CERDI.
Accéder à l'article de Marie-Anne Frison-Roche : Responsabilité, indépendante et reddition des comptes dans les systèmes de régulation économique
Lire le résumé de l'ouvrage ci-dessous.
7 avril 2007
Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Responsabilité, indépendance et reddition des comptes dans les systèmes de régulation économique, in Responsabilité et régulation des systèmes économiques, coll. "Droit et Economie de la Régulation", Presses de Sciences Po / Dalloz, 2007, p.55-70.
Les opérateurs économiques des secteurs régulés comme les régulateurs doivent voir leur aptitude à être responsable mesurée au regard de l’efficacité de la régulation, conséquence de la nature téléologique de celle-ci. Il en résulte une prévalence de l’efficacité des sanctions, y compris par le biais paradoxal de la clémence ou de la transaction, sur l’examen de la faute. En outre, si les agents économiques prétendent à l’autorégulation, celle-ci sera fondée sur l’alliance entre le contrat et la responsabilité, formant les engagements. Le régulateur quant à lui rend des comptes sans que son indépendance fléchisse. L’évaluation de l’efficacité de son action par le bon usage des pouvoirs et des moyens qui lui sont donnés pour concrétiser les fins poursuivies par le législateur est elle aussi la traduction directe de la nature téléologique de la régulation.
Lire une présentation de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
Lire le résumé de l'article ci-dessous.