24 septembre 2024
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
9 septembre 2024
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. Draghi, The future of European competitiveness, rapport, septembre 2024, 397 p., dit "rapport Draghi"
____
📓lire la première partie du rapport Draghi, A competitiveness strategy for Europe
► Référence complète : M. Draghi, The future of European competitiveness. Part A - A competitiveness strategy for Europe, rapport, septembre 2024, 69 p.
____
📓lire la seconde partie du rapport Draghi, In-depth analysis and recommendations
► Référence complète : M. Draghi, The future of European competitiveness. Part B - In-depth analysis and recommendations, rapport, septembre 2024, 328 p.
________

2 août 2024
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
____
 ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Droit des marchés concurrentiels, champ naturel de Contentieux Systémique, document de travail, juillet 2024
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Droit des marchés concurrentiels, champ naturel de Contentieux Systémique, document de travail, juillet 2024
____
📝Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à l'article à paraître dans sa version anglaise "Antitrust, natural field of Systemic Litigation" dans la Revue Concurrences en septembre 2024.
____
► Résumé du document de travail : Le Contentieux Systémique est un catégorie spécifique de contentieux dans lequel au-delà de la dispute entre les parties l'intérêt d'un système est impliqué, notamment son avenir. Le Droit de la concurrence constitue une source naturelle de ce type de contentieux qui apparaît aujourd'hui fortement pour les systèmes informationnel, climatique, énergétique, etc. Rappelons qu'un marché n'est pas autorégulé et ne continue à fonctionner dans la durée qu'en bénéficiant d'un juge, personnage spécifique en ce qu'il est à la fois extérieur au système concurrentiel et appréhendant pourtant son intérêt spécifique. Pour satisfaire cette double exigence, les systèmes juridiques libéraux confient souvent à l'Autorité administrative de concurrence la connaissance de ce Contentieux Systémique. Mais de toutes les façons, le juge de droit commun en connaîtra aussi, soit sur recours soit dans d'autres instances. La dimension systémique du contentieux judiciaire est alors procéduralement exprimée par la présence de l'Autorité dans l'instance. Cela expliquer des règles procédurales difficiles à justifier en Droit classique. Il faut en effet que l'Autorité, par exemple la Commission européenne, puisse juger et être pourtant encore dans l'instance de recours pour exprimer l'intérêt spécifique du système concurrentiel. Dans le même esprit dans un litige de droit commun où l'intérêt du système concurrentiel apparaît, le juge sera éclairé s'il demande l'avis de l'Autorité. Cette fonction toujours particulière de l'Autorité de concurrence dans ce contentieux, parce que celui-ci est systémique, a été mise en place depuis des décennies et doit servir de modèle pour le Contentieux Systémique qui se développe aujourd'hui d'une façon plus générale à propos des autres systèmes pour la durabilité desquels le Juge est aujourd'hui saisi.
____
🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
6 juin 2024
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (34)

► Référence complète : S. Piédelièvre, Droit commercial (Actes de commerce - Commerçants - Fonds de commerce - Concurrence - Consommation), Dalloz, coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", 1ière éd., 1997, 14ième éd., 2024, 480 p.
____
► Présentation générale de l'ouvrage : Cet ouvrage, qui s’adresse principalement aux étudiants de L2 et L3, propose une approche claire et détaillée de la notion de commercialité. Il intéressera également les praticiens souhaitant actualiser leurs connaissances en droit commercial.
Complexe dans le système français, cette notion suscite de nombreuses questions appelant des solutions concrètes d’une grande importance comme les régimes de compétence et de preuve. Cet ouvrage aborde la question du droit commercial à travers les actes de commerce, les commerçants, les fonds de commerce, ainsi que la concurrence et la consommation.
L’auteur s’est appliqué à présenter les règles qui constituent les principes de l’activité marchande.
____
📕lire la quatrième de couverture
____
____
📚consulter l'ensemble de la collection dans lequel l'ouvrage a été publié
________
27 mai 2024
Base Documentaire : Soft Law

► Référence complète : Autorité de la concurrence (ADLC), Communiqué relatif aux orientations informelles de l’Autorité en matière de développement durable, 27 mai 2024, 6 p.
____
____
📰lire le communiqué de presse accompagnant la publication de ce document
________
25 mai 2024
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Cartographie des risques et Concurrence : place et avenir du Droit de la Compliance", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 25 mai 2024
____
📧Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
____
🧱Compliance et Concurrence : l'enjeu de la cartographie des risques
Merci aux organisateurs du colloque sur "Concurrence : les enjeux de la Compliance. Programme de conformité : le Document-cadre de l’Autorité de la concurrence. Retour d’expériences pratiques deux ans après", qui s'est tenue le 24 mai 2024, au Collège européen de Paris de Panthéon-Assas université avec le soutien des Editions Larcier-Intersentia, de m'avoir demandé d'en faire la conférence de synthèse.
Grâce à la très grande qualité des intervenants, Fabrice Picod, Frederic Puel, Pierre de Gouville, Gaëlle Hardy, Alix Voglimacci et Marie-Pascale Heusse, j'ai pu retirer quelques conclusions, notamment des expériences concrètes des cartographies des risques aujourd'hui développées.
____
📧lire l'article publié le 25 mai 2024 dans la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation ⤵️
24 mai 2024
Conférences

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Surplomb
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Synthèse", in Concurrence : les enjeux de la Compliance. Programme de conformité : le Document-cadre de l’Autorité de la concurrence. Retour d’expériences pratiques deux ans après, 24 mai 2024, Paris, Collège européen de Paris, Université Panthéon-Paris-Assas, 28 rue Saint-Guillaume 75007 Paris.
____
🧮consulter le programme complet de cette manifestation
____
► Présentation de la synthèse, faite sur le banc : le colloque s'est appuyé sur le "document-cadre" que l'Autorité de la concurrence a publié le 24 mai 2022 relatif aux programmes de conformité et a développé principalement l'un des outils de ceux-ci, à savoir la cartographie des risques. Le soin d'associer des universitaires dont le métier est de rendre compte de la réalité en la classant et en la nommant, ce qui la rend celle-ci plus facilement maniable, et des personnes qui dans les entreprises chaque jour trouvent des solutions pour anticiper des difficultés afin qu'elles soient résolues, voire qu'elles n'adviennent pas, a produit ses fruits.
____
De l'ensemble des discussions, il ressort 4 perspectives, qui montrent chacune ce qui est acquis, ce qui peut encore en ressortir en interaction avec tous les autres mécanismes en Droit de la Compliance qui intègrent la cartographie des risques (Sapin 2, loi dit "Vigilance", directive CS3D, etc.) et les autres mécanismes qui sont corrélés avec la cartographie des risques (audit, enquêtes internes, éléments probatoires susceptibles d'être évoqués devant un juge par l'entreprise et/ou par une partie concernée) et ce qui reste incertain dans ce document-cadre.
_____
La première perspective est la base même de ces prescriptions, recommandations, encouragements, méthodes, préconisations, etc.
La deuxième perspective sont les moyens développés pour établir et faire vivre ces programmes de compliance.
La troisième perspective est la portée de ce document-cadre, dont dépend aussi en grande partie de la portée des programmes de compliance adoptés par les entreprises eux-mêmes
La quatrième perspective sont les sujets de droit astreints, ou bénéficiaires, bref concernés par l'adoption de tels programmes de compliance en Droit de la concurrence.
____
Pendant cette conclusion en ne m'appuyant que sur les propos de chaque intervenant, j'ai poursuivi les réflexions dans chacune de ces 4 directions
Cela m'a remis en mémoire certains de mes travaux sur ce sujet :
- M.A. Frison-Roche, 📝programme de conformité (compliance), in Dictionnaire du Droit de la concurrence, 2021 (2Ième éd. sous presse).
- M.A. Frison-Roche, 📝L'appui du Droit de la Compliance pour la maîtrise quotidienne du Droit de la concurrence, in Mélanges Laurence Idot, 2022.
- M.-A. Frison-Roche, Dresser des cartographies des risques comme obligation et le paradoxe du "risque de conformité", in Les outils de la compliance, 2021.
- M.A. Frison-Roche, M.A., 📧 Vertus et non-dits du nouveau documents-cadre sur les programmes de compliance en droit de la concurrence, 2021.
- M. A. Frison-Roche, 📝Théorie juridique de la cartographie des risques, centre du Droit de la Compliance, 2019.
- M.A. Frison-Roche, 📝Concurrence et Compliance, 2018.
Pendant cette manifestation, universitaires, avocats et juristes d'entreprises ont rendu compte de la façon dont le document-cadre de l'ADLC du 22 mai 2022 les avait aidés à mieux établir leur cartographie des risques.
Cela était très instructif, puisque tous ont raconté et discuté comment cela se pratique sous les fourches caudines et l'appui de ce droit que l'on dit souple : Fabrice Picod, professeur à Panthéon-Assas université , directeur du Centre de droit européen (CDE), Frederic Puel, avocat associé du cabinet Fidal, Pierre de Gouville, avocat associé, Fidal, Alix Voglimacci, directrice juridique et compliance de PepsiCo France, Gaëlle Hardy, professeure à l’Université des Antilles, et Marie-Pascale Heusse, responsable droit de la concurrence du Groupe BNP Paribas.
De l'ensemble des discussions, il ressort 4 perspectives, qui montrent chacune ce qui est acquis, ce qui peut encore en ressortir en interaction avec tous les autres mécanismes du Droit de la Compliance qui intègrent la cartographie des risques (loi dite "Sapin 2", loi dite "Vigilance", directive CS3D, etc.) et les autres mécanismes qui sont corrélés avec la cartographie des risques (audits, enquêtes internes, éléments probatoires susceptibles d'être évoqués devant un juge par l'entreprise et/ou par une partie concernée) et ce qui reste incertain dans ce document-cadre.
La première perspective est la base juridique de ces prescriptions, recommandations, encouragements, méthodes, préconisations, etc. La concurrence est souvent explicitement ou implicitement la base de nombreux dispositifs de compliance, par exemple dans la directive sur la vigilance.
La deuxième perspective correspond aux moyens développés pour établir et faire vivre ces programmes de compliance. A côté de la cartographie des risques, il y a les audits et les enquêtes internes, les entretiens menés pour établir la cartographie, qui humanisent celle-ci, ayant de nombreux points de contact avec les audits et les enquêtes et ouvrant ainsi des difficultés communes, comme la confidentialité.
La troisième perspective est la portée de ce document-cadre, dont dépend aussi en grande partie la portée de des programmes de compliance adoptés par les entreprises elles-mêmes, de gré lorsqu'il s'agit de concurrence, de force lorsqu'il s'agit d'antiblanchiment, de lutte contre la corruption ou de vigilance, ce qui rend la portée difficile à mesurer lorsque le programme est global, comme le document-cadre le préconise.
La quatrième perspective concerne les sujets de droit astreints, ou bénéficiaires, bref concernés par l'adoption de tels programmes de compliance en Droit de la concurrence. Cela est certes l'entreprise concernée, sollicitée ou contraintes par l'Autorité qui agit pour remplir son propre office de sauvegarde du système à l'avenir, la "durabilité" étant une notion essentielle du Droit de la Compliance, qui fait passer les régimes des règles de l'Ex Post à l'Ex Ante, y compris en Droit de la concurrence, ce qui est proprement une révolution. Les sujets de droit sont aussi les "parties prenantes", catégorie qui demeure assez mystérieuse, le Droit des sociétés étant lui-même transformé par ce que l'on désigne comme la "gouvernance". Mais techniquement cela engendre des droits à l'information, des droits au recours. De ces questions techniques, aux enjeux procéduraux essentiels, les juridictions sont actuellement saisies. Il en ressort que, y compris pour la cartographie des risques, nul ne semble plus être vraiment un "tiers"....
C'est alors la question des secrets et des destinataires de la cartographie des risques qui est posée : conçue comme un outil pour les managers, conçue comme un moyen de préservation des systèmes par l'Autorité, peut-elle être conçue pour des personnes concernées comme un moyen d'action dans une perspective plus générale de reddition des comptes, puisqu'elle signale des risques ? De cette question-là, aussi, les tribunaux commencent à être saisis.
Ainsi, pendant cette conclusion, faite en m'appuyant sur les propos très pertinents de chaque intervenant, j'ai donc pu poursuivre les réflexions dans chacune de ces 4 directions.
Ce sujet est à la croisée de deux chemins : en ce qu'il porte sur la cartographie des risques, outil majeur du Droit de la Compliance d'une part et en ce qu'il rapproche Droit de la Concurrence et Droit de la Compliance, d'autre part.
Ces croisements vont s'accroître mais vont aussi provoquer des heurts car, pour ne prendre qu'un exemple, la Vigilance requiert des structures de collaboration qui doivent s'articuler avec la prohibition des ententes, tandis que la contractualisation de la Compliance, phénomène majeur, peut constituer un abus de position dominante.
_________
18 avril 2024
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L’usage des puissances privées par le droit de la compliance pour servir les droits de l’homme", in J. Andriantsimbazovina (dir.), Puissances privées et droits de l'Homme. Essai d'analyse juridique, Mare Martin, coll. "Horizons européens", 2024, pp. 279-295
____
🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
____
► Résumé de l'article : Si l’on suit la tradition du Droit l’on associera la puissance à une source légitime qu’est l’État, la puissance publique étant son apanage, les entreprises n’exerçant leur puissance que dans l’ombre portée de cette puissance Ex Ante. À l’inverse la trivialité du Droit économique, dont le Droit de la concurrence serait le cœur, consistant à partir de l’activité des entreprises qui utilisent leurs puissances sur des marchés, relèguent l’action de l’État au rang d’exception, admissible si celui-ci, qui prétend exercer cette puissance contraire, le justifie. La distribution des rôles est donc symétrique, en ce que les places sont échangées, mais le modèle de l’opposition est partagé. Ce modèle de l’opposition épuise les forces des organisations qui sont reléguées à n’être que soit le principe soit l’exception. Or, si l’on veut porter de grandes ambitions, par exemple concrétiser des droits humains au-delà du système juridique à l’intérieur duquel les Autorités publiques exercent leurs pouvoirs normatifs, il faut s’appuyer sur une nouvelle branche du Droit, remarquable par son pragmatisme et par l’ampleur des ambitions, y compris humanistes, qu’elle porte : le Droit de la Compliance.
Il apparaît que le Droit de la Compliance est ainsi la branche du Droit qui fait porter le souci d’autrui, concrétisé par des droits humains, par les entités en position de le satisfaire, entités que sont les entités systémiques, les grandes entreprises en étant l’exemple privilégié, sujets de droit directs de la Compliance (I). Il en résulte une nouvelle répartition entre les autorités publiques, légitimes à formuler le But Monumental de protéger les êtres humains, et les organisations privées, qui s’ajustent à cela selon le type de droits humains et au regard des moyens mis en place pour les préserver. Les entreprises sont recherchées parce qu’elles sont puissantes, en ce qu’elles sont en position de concrétiser les droits humains, dans leur indifférence au territoire, dans la centralisation des informations, des technologies et des moyens économiques, humains et financiers. Cette alliance est essentielle pour que le système ne conduise pas à un transfert de choix politique et que cela aboutisse à une efficience systémique. Il en résulte une nouvelle définition de la souveraineté telle qu’on la voit se dessiner dans l’espace numérique, lequel n’est pas un secteur particulier puisque c’est le monde qui s’est digitalisé, la question climatique justifiant la même nouvelle répartition des rôles (II).
____
________
4 avril 2024
Publications
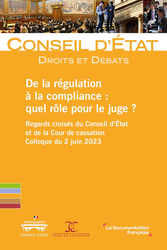
🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le rôle du juge dans le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance", in Conseil d'État et Cour de cassation, De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ? Regards croisés du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation - Colloque du 2 juin 2023, La Documentation française, coll. "Droits et Débats", 2024, pp. 173-182
____
🎥cet article fait suite à l'intervention de clôture prononcée lors du colloque biannuel organisé par la Cour de cassation et le Conseil d'État, qui portait en 2023 sur le thème De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?, le 2 juin 2023
____
🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
____
► Présentation de l'article de synthèse : Il est remarquable de constater l'unité de conception et de pratiques entre les professionnels qui évoluent plutôt dans l'ordre des juridictions administratives et les professionnels qui évoluent plutôt dans l'ordre des juridictions judiciaires : ils constatent tous et dans des termes semblables un mouvement essentiel : ce qu'est le Droit de la Régulation, comment celui-ci a opéré sa transformation en Droit de la Compliance, et comment dans l'un et plus encore dans l'autre le Juge y est au centre.
Les juges, mais aussi les Régulateurs et les responsables européens l'expliquent et disent à partir d'exemples différents la transformation profonde que cela apporte pour le Droit, pour les entreprises en charge d'accroître l'effectivité systémique des règles par la pratique et la diffusion d'une culture de compliance.
Le Juge participant à cette transformation Ex Ante voit son office renouvelé, qu'il soit juge de droit public ou juge de droit privé, dans une unité accrue du système juridique.
____
► Résumé de l'article : La querelle de mots qui nous épuise, entre "Compliance" et "conformité", masque l'essentiel, c'est-à-dire la grande nouveauté d'une branche du Droit qui assume une vision humaniste exprimant l'ambition de modeler l'avenir, afin que celui-ci ne soit pas catastrophique (prévention de l'effondrement des systèmes), voire qu'il soit meilleur (protection des êtres humains dans ces systèmes).
L'article décrit tout d'abord l'émergence du Droit de la Compliance, en prolongement du Droit de la Régulation et en dépassement de celui-ci. Cette nouvelle branche du Droit rend compte d'un monde nouveau, en porte les bénéfices et veut parer à ces dangers systémiques pour que les êtres humains en bénéficient et n'en soient pas broyés. Cette branche du Droit Ex Ante est en cela politique, souvent portée par des Autorités publiques, comme les Autorités de Régulation, mais dépasse aujourd'hui les secteurs, comme le montre sa pointe avancée qu'en est le devoir de Vigilance.
Les "Buts Monumentaux" dans lesquels s'ancre normativement le Droit de la Compliance implique une interprétation téléologique, mène à une "responsabilisation" des opérateurs cruciaux, non seulement les Etats mais encore les entreprises, en charge de l'effectivité des multiples nouveaux outils de compliance.
L'article montre ensuite que le juge est toujours plus au centre du Droit de la Compliance. En effet, les procès visent à responsabiliser les entreprises. Dans cette transformation, le juge a aussi pour fonctionner de demeurer le gardien de l'Etat de Droit, aussi bien dans la protection des droits de la défense que dans celle des secrets, l'efficacité n'étant pas ce qui définit la Compliance, qui ne serait être réduite à une pure et simple méthode d'efficacité, ce qui mènerait à être un instrument de dictature. C'est pourquoi le principe de proportionnalité est essentiel dans le contrôle que le juge opère des exigences issues de cette branche du Droit si puissante.
Le juge est ainsi saisi d'un contentieux d'un type nouveau, de nature systémique, dans l'espace qui lui est propre et qu'il ne faut pas dénaturer : l'espace de justice.
____
________

Mise à jour : 15 mars 2024 (Rédaction initiale : 30 novembre 2023 )
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Naissances d'une branche du Droit : le Droit de la Compliance, document de travail, novembre 2023.
____
📕Ce document de travail a été élaboré pour constituer une contribution aux Mélanges offerts à Louis Vogel, remis et publiés en octobre 2024.
____
► Résumé du document de travail : L’étude porte sur les différents mouvements qui ont fait naître le Droit de la Compliance, l’accent étant plus particulièrement mis sur le Droit de la Concurrence.
Après une réflexion préalable sur la construction du système juridique en branches du Droit, leur classement les unes par rapport aux autres, la difficulté rencontrée à ce propos par le Droit économique, et les différents mouvements qui en font naître une, diversité dont la branche garde par la suite la trace, l’étude est construite en 4 parties.
Pour rechercher ce qui a fait naître le Droit de la Compliance, la première partie convie à récuser la perspective étroite d’une définition qui se contente de définir celui-ci par le fait de « se conformer » aux réglementations applicables. Cela a pour effet d’accroître l’efficacité de celles-ci mais cela ne produit pas une branche du Droit, étant un outil d’efficacité comme un autre.
La deuxième partie de l’étude vise à éclaircir ce qui apparaît comme une « énigme », car l’on affirme souvent que cela viendrait d’une méthode souple, ou d’un texte américain, ou d’autant de réglementations qu’il y a d’occasions d’en prendre. Il apparaît plutôt qu’il s’est agi aux États-Unis au sortir de la crise de 1929, d’établir une autorité et des règles pour prévenir un nouvel effondrement atroce de système, tandis qu’il s’est agi en Europe, en 1978, en souvenir de l’usage des fichiers, d’établir une autorité et des règles pour prévenir une atteinte atroce aux droits humains. Un élément commun qui vise l’avenir (« plus jamais ça »), mais pas le même objet de rejet préventif. Cette différence des deux naissances explique l’unicité et la diversité des deux Droits de la compliance, les tensions qui peuvent exister entre les 2, l'impossibilité d'obtenir un Droit global.
La troisième partie analyse la façon dont le Droit de la concurrence a fait naître en son soin la conformité : une branche secondaire qui est gage de conformité à la réglementation concurrentielle. Notamment développée ainsi à travers le droit souple émis par les autorités de concurrence, il en résulte une sorte d’obéissance souple, une collaboration bien comprise de type procédurale par laquelle l’entreprise éduque, surveille, voire sanctionne, sans sortir du Droit de la Concurrence dont la conformité constitue l’annexe. L’on peut mesurer ici le chemin qui sépare une culture de conformité d’un Droit de la Compliance.
La quatrième partie vise à montrer que le Droit de la Concurrence et le Droit de la Compliance sont deux branches du Droit autonomes et articulées. Le Droit de la Compliance étant une branche du Droit construite sur des Buts Monumentaux, notamment la durabilité des systèmes et la préservation des êtres humains qui y sont impliqués pour qu’ils n’y soient pas broyés mais en bénéficient, l’enjeu actuel de la construction européenne est de construire à côté du plier concurrentiel le pilier du Droit de la Compliance. Les juridictions sont en train de le faire et de les articuler.
____
🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
15 février 2024
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : C. Prieto, "Les autorités administratives indépendantes et les sources du droit des affaires : l’exemple de l’Autorité de la concurrence", JCP E, n° 7-8, 15 février 2024, étude 1050, pp. 24-34
____
► Résumé de l'article (fait par l'auteure) : "Les autorités administratives indépendantes ont-elles leur place dans les sources du droit des affaires ? À partir de l’exemple de l’Autorité de la concurrence, une réponse est apportée à la lumière des avancées du Conseil d’État et de la Cour de cassation.".
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
9 février 2024
Conférences

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Préalable : ce qu'est un engagement", in L. Aynès, M.-A. Frison-Roche, J.-B. Racine et E. Silva-Romero (dir.), L'arbitrage international en renfort de l'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Institut de Droit des affaires internationales de la Chambre de commerce internationale (Institut), Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), Paris, 9 février 2024
____
🧮consulter le programme complet de cette manifestation
____
____
____
🔲consulter les slides servant de support à l'intervention
____
🎤consulter une présentation de la conférence "Préalable : ce qu'est l'Obligation de Compliance", prononcée dans le même colloque
___
🎤consulter une présentation de la conférence "Le renforcement des engagements de compliance par le renvoi Ex Ante à l'arbitrage international", qui n'a finalement pas été prononcée mais donnera lieu à la rédaction d'un 📝article dans l'ouvrage à paraître sur 📕L'obligation de Compliance
____
► Présentation de la conférence : Après avoir défini l'Obligation de Compliance dans l'intervention "Préalable : ce qu'est l'Obligation de Compliance", j'ai entrepris de définir ce qu'est un engagement.
Que les engagements, en tant que paroles, constituent des faits pouvant engager la responsabilité des entreprises s'il y a incohérences, ou mensonges, nul n'en doute. La question est aujourd'hui celle de savoir si un engagement peut constituer un acte juridique, liant ex ante.
Les entreprises s'engagent, soit pour concrétiser leurs obligations légales de Compliance, ce qui n'est alors qu'une obéissance à la loi, soit pour exprimer une volonté propre, soit pour elles-mêmes, soit pour autrui. Les cas sont souvent confondus, alors que les portées ne sont pas les mêmes.
Si l'engagement prend la forme d'un contrat, la Compliance est concernée si le contrat est manié comme Outil de Compliance Ex Ante📎
L'engagement, notion venue plutôt de l'Économie de la Regulation, a été pensé entre une Autorité de Régulation et une Entreprise : c'est la décision unilatérale de l'Autorité qui donne une force juridique à l'engagement. La jurisprudence le confirme (Conseil d'État📎
Si l'engagement est central en Compliance, notamment en Vigilance, c'est parce que le Droit de la Compliance est le prolongement du Droit de la Régulation📎
Dans l'élaboration d'un plan, l'entreprise exécute son obligation légale. Mais si l'on devait considérer qu'il s'agit d'un engagement, alors il faudrait aussi considérer que le plan résulte de sa volonté, qu'elle doit dans son élaboration consulter les parties prenantes mais que la source du plan est sa volonté : les dispositions ne sont pas des stipulations, ne sont pas des applications de la loi, mais des dispositions volontaires unilatérales.
A ce titre, et parce que sa source est la volonté de l'entreprise (ce qui n'empêche pas sa co-construction), un plan pourrait contenir une "offre graduée" d'arbitrage.
Cette offre peut être insérée dans des engagements moins encadrés par la loi, comme tous ceux pris au titre de la RSE.
________
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021.
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Du Droit de la régulation au Droit de la compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance ; 📝Le Droit de la Compliance au-delà du Droit de la Régulation, 2018 ; 📝Le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance dans un projet européen, 2023.
17 janvier 2024
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : E. Moyne, "Les impacts sur les droits de la défense des disparités de la justice pénale négociée dans l’Union européenne", in M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance et droits de la défense. Enquête interne – CJIP – CRPC, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur examine tout d'abord dans l'espace européen l'usage que le Droit français fait de ces techniques de justice négociée. Il constate leur extension continuelle, notamment de la CJIPP qui, de réforme en réforme, s'étend désormais à la fraude fiscale et aux délits environnementaux, estimant qu'il faudrait que cela puisse fonctionne à tout et à tous, c'est-à-dire d'une part à toutes les infractions, notamment en droit de la concurrence et à toutes les infractions financières, et d'autre part non seulement aux personnes morales mais encore aux personnes physiques.
L'espace européen est pour l'instant plutôt occupé par le Parquet européen, dont l'action pourrait être efficace pour mener à une transaction pénale ou à une CJ, notamment en matière environnementale. Pour l'instant l'hétérogénéité des procédures simplifiées à la disposition des différents procureurs européens délégués en matière de poursuite engendre un risque de forum shopping. En outre, l'absence d'harmonisation européenne des mécanismes de transaction pénale ou de CJIP rend difficile la mise en oeuvre de ceux-ci car non seulement de nombreux Etats-membres ne les ont pas même institués mais lorsque cela est le cas, les procédures sont très diverses, notamment concernant les droits de la défense...
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
12 janvier 2024
Conférences

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Conclusion. Compliance et contrats publics : une alliance naturelle", in M.-A. Frison-Roche, C. Gilles et A. Oumedjkane (dir.), Compliance et contrats publics, Journal of Regulation & Compliance (JoRC), Centre de recherches et d’études administratives de Montpellier (CREAM) et Centre d’Études et de Recherches Comparatives Constitutionnelles et Politiques (CERCOP) de l'Université de Montpellier, Faculté de droit et de science politique de Montpellier, 39 rue de l’Université, Amphithéâtre C Paul Valéry, 12 janvier 2024
____
🧮consulter le programme complet de cette manifestation
____
✏️consulter les notes prises sur le vif pour élaborer la conclusion du colloque
____
____
____
► Résumé de la conférence : il apparaît en premier lieu que, comme pour tous les contrats étudiés en matière de Compliance, les contrats publics sont pour l'administration ou les entreprises publiques un instrument par lequel elles mettent en oeuvre l'Obligation de Compliance que les lois et règlements font peser sur elles. L'on observe que les personnes publiques impliquées dans les contrats publics sont particulièrement concernées en raison des points de contact, voire intimité, entre le Droit de la Compliance et l'intérêt général. Mais le contrat, qu'il soit public ou privé, demeure dans sa conception classique ce qui résulte de l'expression de deux volontés qui échangent leurs consentements📎
En cela, en deuxième lieu et sur le terrain des libres volontés, les contrats publics peuvent être la voie par laquelle les personnes publiques et leur cocontractant expriment leur conception de ce qu'il faut faire pour préserver l'avenir, par exemple en matière environnementale et sociale. La question, qui paraît technique, des exclusions de la commande publique, dans leur qualification d'exclusion automatique ou exclusion facultative, exprime au contraire cette part de volonté dans la construction du soin que les acteurs économiquement puissants (l'administration, les municipalités, les entreprises publiques) prennent de l'autre. En cela, le Droit de la Compliance contre le Droit de la concurrence📎
Mais en troisième lieu le contrat public, en ce qu'il exprime par nature l'intérêt général, sa nature ex ante conforte l'action régulatrice et la nature de la Compliance comme prolongement de la Régulation📎
Plus encore, en quatrième lieu, le contrat public apparaît comme le modèle du contrat de compliance. Le contrat public est un modèle tout d'abord en raison de la place centrale de l'intérêt général. Or, les "Buts Monumentaux" dans lesquels s'ancre la définition substantielle du Droit de la Compliance📎
Le contrat public est également un modèle parce que le contrat est manié par une partie puissante, ici la personne publique. Or, le sujet du Droit de la Compliance est l'entreprise puissante, et seulement celle-là, choisie parce qu'elle est puissante et pour qu'elle utilise cette puissance afin que les Buts Monumentaux soient atteints. À ce titre, les "pouvoirs exorbitants", qui caractérisent le contractant public, sont reconstitués soit par les lois de Compliance soit par des stipulations, qui confèrent pour toutes les entreprises astreintes ou volontaires - en raison de la RSE, dont les points de contact sont multiples avec le Droit de la Compliance dès l'instant qu'on ne le confond pas avec le fait d'obéir aux réglementations applicable (ce qu'est la "conformité")📎
Le juge est celui qui, à travers le contentieux contractuel, aussi bien public que privé, va faire vivre ces Buts Monumentaux voulus par l'État, portés par des entités puissantes (administration, entreprises), gage de l'État de Droit📎
Il s'agit notamment des mécanismes contractuels d'information, d'audit, de révélation, de contrôle, de collaboration, de supervision, etc., par lesquels l'entreprise, qu'elle soit privée ou publique, prend en charge la structure qu'elle a créé, par exemple la chaîne de valeur qu'elle maîtrise📎
L'on peut donc conclure que cette logique d'un contrat public comme instrument de l'action administrative pour atteindre des buts d'intérêt général, aujourd'hui pleinement repris dans le Droit de la Compliance, doit être acculturée dans le droit commun des contrats et doit être conservée dans le Droit des contrats publics, ce qui suppose un nouvel équilibre avec le Droit de la Concurrence qui porta longtemps au sein du Droit public un modèle de contrat sans souci de durabilité ni d'intérêt collectif. Pour cela, le dialogue des juges est essentiel. Le Conseil d'État et la Cour de cassation en donnent l'exemple📎
____
📝Cette intervention sera suivie d'un article, "Le contrat public, modèle du contrat de compliance", qui sera publié dans l'ouvrage 📕Compliance et contrat.
________
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017.
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Les Buts Monumentaux, cœur battant du Droit de la Compliance, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022.
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Conforter le rôle du Juge et de l'Avocat pour imposer la Compliance comme caractéristique de l'État de Droit, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023.
🕴️M.-A. Frison-Roche, 🚧Usage des puissances privées par le droit de la compliance pour servir les droits de l’homme, 2023.
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Conforter le rôle du Juge et de l'Avocat pour imposer la Compliance comme caractéristique de l'État de Droit, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la Compliance, 2023.
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Appréciation du lancement d'alerte et de l'obligation de vigilance au regard de la compétitivité internationale, in 🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022.
Conseil d'État et Cour de cassation, 📗Du droit de la régulation au droit de la compliance : quel rôle pour le juge ?, La Documentation Française, 2024 (sous presse).
1 décembre 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-Ch. Roda, "Un an de droit de la concurrence dans l’univers numérique", Communication - Commerce électronique, n° 12, décembre 2023, chron. "Un an de..." n°15
____
► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Initiée en octobre 2021, la présente chronique se propose de faire un tour d'horizon de l'actualité du droit de la concurrence, appliqué au secteur du numérique. Plus exactement, il s'agit de dresser un panorama, nécessairement subjectif et partiel, des décisions de jurisprudence ou des textes qui ont marqué l'actualité, en Europe, en France, mais aussi aux États-Unis. Dans ces trois zones, les grandes plateformes sont désormais dans l'œil du cyclone concurrentiel. L'entrée en vigueur du Digital Markets Act marque certainement une nouvelle ère et l'on constate que, même de l'autre côté de l'Atlantique, les autorités semblent désormais animées de la même ambition. Cela étant, au-delà de ces grands mouvements qui se dessinent, l'actualité montre que les autorités ne sont pas uniquement dans une logique de sévérité et de répression. Poursuivant une sorte de montée en puissance dans le secteur du numérique, l'Autorité française de la concurrence multiplie ainsi les plongées dans des domaines particulièrement techniques, afin de révéler le fonctionnement de ces marchés souvent difficiles à cerner. Le cloud est ainsi mis à l'honneur en 2023, avec un important avis sur la question, mais aussi plusieurs décisions de concentrations qui, s'il fallait encore le noter, montrent qu'il est difficile de réguler les GAFAM sans comprendre les enjeux internationaux qu'une telle entreprise révèle.".
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
____
📝consulter une présentation des autres chroniques "Un an de droit de la concurrence dans l’univers numérique" de Jean-Christophe Roda :
- "Un an de droit de la concurrence dans l’univers numérique" (2022)
- "Un an de droit de la concurrence dans l’univers numérique" (2021)
________
1 octobre 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : J.-C. Roda, "Les obligations environnementales et numériques pesant sur les entreprises : quelle gestion des risques concurrentiels ?", Revue Lamy de la concurrence, n°131, 1er octobre 2023, actualité 4501.
____
► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : "Les entreprises cruciales sont aujourd'hui soumises à des obligations de plus en plus lourdes et qui concernent l'environnement et le numérique. Le franchissement de seuils de « taille » oblige désormais ces acteurs à se plier à la logique de la vigilance et de la compliance. De telles obligations ont un impact concurrentiel, surtout si l'on envisage les choses sous l'angle de la concurrence mondialisée. Comment, dès lors, les entreprises concernées peuvent-elles réagir, pour transformer la contrainte en un nouveau départ ? Celui-ci est-il envisageable ? Faut-il faire acte de résilience ou de résistance ?"
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
27 septembre 2023
Base Documentaire : 02. Cour de cassation

15 juillet 2023
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le déploiement du Droit de la Régulation par le Droit de la Compliance dans un projet européen, document de travail, juillet 2023.
____
📝Ce document de travail sert de base à un article, "Le déploiement du droit de la régulation par le droit de la compliance dans un projet européen", qui s'insère dans un dossier spécial consacré à La régulation par la compliance, perspective européenne, publié par la Revue des affaires européennes, en novembre 2023.
____
► Résumé du document de travail : Le Droit de la Compliance n’est ni une méthode d’obéissance aux réglementations, ni une simple méthode neutre d’efficacité des normes, ni pas une voie d’exécution déplacée de l’Ex Post vers l’Ex Ante. Il est le prolongement du Droit de la Régulation et va au-delà de celui-ci. Comme lui, il porte l’ambition de construire des espaces selon un projet politique propre à une zone, par exemple l’Europe. Droit tourné vers l’avenir, il construit et maintient d’une façon systémiques des équilibres durables bien qu’instables pour atteindre des des « buts monumentaux » où réside sa normativité : sécurité, durabilité, probité, vérité, dignité. En internalisant ces Buts Monumentaux dans les entreprises en position de les atteindre, les « entreprises cruciales, le Droit de la Compliance conserve la logique de régulation, lui offrant un essor prodigieux puisqu’il la libère de la condition d’un secteur et des frontières territoriales, qui paraissaient tautologique, en associant puissances privées et volonté publique, laquelle demeurant première. La Compliance peut ainsi réguler le numérique et le climatique, dans des choix politiques portés par une Europe souveraine.
________
🔓Lire ci-dessous les développements⤵️
28 juin 2023
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

♾️suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
♾️s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "S'engager n'est pas contracter (décision du Conseil d'État du 21 avril 2023, Orange c/ Arcep)", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 28 juin 2023.
____
📧Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
____
🔴Engagements, acceptation, convention : multiplication de ces actes de volonté acceptés qui ne sont pourtant pas des contrats et échappent à leurs principes
Dans sa décision du 21 avril 2023, société Orangec/ Arcep, le Conseil d'État dit ce que ne constitue pas les engagements souscrits par l'opérateurs pour le déploiement de la fibre, acceptés par le ministre : ce n'est pas un contrat. La "qualification négative" est donc donnée. Mais alors qu'est-ce que c'est ?
____
📧lire l'article ⤵️
Mise à jour : 16 juin 2023 (Rédaction initiale : 24 novembre 2022 )
Conférences

♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
♾️ s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
 ► Référence complète : Frison-Roche, M.A., Les programmes de compliance, in Université de Lille, Les risques concurrentiels des entreprises à l’aune de la transition écologique et numérique : regards croisés sur les outils de prévention, Lille, 16 juin 2023. ____
► Référence complète : Frison-Roche, M.A., Les programmes de compliance, in Université de Lille, Les risques concurrentiels des entreprises à l’aune de la transition écologique et numérique : regards croisés sur les outils de prévention, Lille, 16 juin 2023. ____
► Présentation générale de la conférence : sss
____
► pour aller plus loin ⤵️
17 mai 2023
Base Documentaire : Doctrine
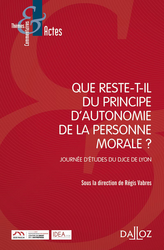
► Référence complète : J.-Ch. Roda, "La personne morale en droit de la concurrence : entre effacement et persistance", in R. Vabres (dir.), Que reste-t-il du principe d'autonomie de la personne morale ? - Journée d'études du DJCE de Lyon, coll. "Thèmes & Commentaires", Dalloz, 2023, pp.91-101.
____
► Résumé de l'article :
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________

25 avril 2023
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
 ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le rôle du Juge dans le déploiement du Droit de la Régulation par le Droit de la Compliance, document de travail, avril 2023.
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le rôle du Juge dans le déploiement du Droit de la Régulation par le Droit de la Compliance, document de travail, avril 2023.
____
🎤 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à la séance de synthèse constituant la conclusion du colloque organisé par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?, qui s'est tenu le 2 juin 2023 au Conseil d'Etat.
_____
📝 Ce document de travail a servi également de base à l'article qui constitue la conclusion de l'ouvrage De la régulation à la compliance : quel rôle pour le juge ?, La Documentation Française, 2024.
____
► Résumé du document de travail : Il est remarquable de constater l'unité de conception et de pratiques entre les professionnels qui évoluent plutôt dans l'ordre des juridictions administratives et les professionnels qui évoluent plutôt dans l'ordre des juridictions judiciaires : ils constatent tous et dans des termes semblables un mouvement essentiel : ce qu'est le Droit de la Régulation, comment celui-ci a opéré sa transformation en Droit de la Compliance, et comment dans l'un et plus encore dans l'autre le Juge y est au centre. Les juges, mais aussi les Régulateurs et les responsables européens l'expliquent et disent à partir d'exemples différents la transformation profonde que cela apporte pour le Droit, pour les entreprises en charge d'accroître l'effectivité systémique des règles par la pratique et la diffusion d'une culture de compliance. Le Juge participant à cette transformation Ex Ante voit son office renouvelé, qu'il soit juge de droit public ou juge de droit privé, dans une unité accrue du système juridique.
____
🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️

12 avril 2023
Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Le Contrat, récepteur et créateur de l'Obligation de Compliance, gardée et encouragée par le Juge, document de travail construit à partir des notes prises en synthèse du colloque Le juge face aux clauses et aux contrats de compliance, 13 avril 2023.
____
Ce travail de synthèse a été opéré sur la base d'un colloque que j'ai moi-même coorganisé scientifiquement, consacré au Juge face aux clauses et aux contrats de compliance, colloque lui-même
Il s'appuie :
1. sur les travaux précédemment menés, à savoir d'une part les ouvrages et articles produit à propos de La Juridictionnalisation de la Compliance et d'autre part l'article sur Contrat de Compliance, Clause de Compliance
2. sur les notes prises sur le vif tout au long de la journée du colloque.
Lire le document de travail
5 avril 2023
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : N. Moreno Belloso & N. Petit, "The EU Digital Markets Act (DMA). A Competition Hand in a Regulatory Glove", (2023) 48 European Law Review, 391, available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4411743
____
► Résumé de l'article (fait par les auteurs) : "The newly enacted Digital Markets Act (DMA) finds itself at a crossroads. The DMA can develop into a specialist field of competition law for digital platforms or it can evolve into a new field of EU law, detached from competition law. The DMA’s ultimate trajectory will depend on the legal characterization given to the DMA. Is it a special competition law regime or an original instrument distinct from competition law? This paper lays the groundwork for characterizing the DMA by offering a complete descriptive analysis of the instrument. Among the elements discussed are the twin concepts of “gatekeepers” and “core platform services”, which together condition the DMA’s scope of application, as well as the legal obligations imposed on gatekeepers. The paper proposes a novel categorisation of the obligations, showing that each obligation can be associated with at least one of two conventional competition law concerns (exclusion or exploitation). The discussion shows the difficulty of pinpointing the exact nature of the DMA. We argue that this ambiguity creates challenges for the practical implementation of the DMA.".
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
15 mars 2023
Base Documentaire : Doctrine
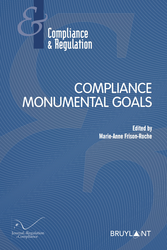
► Référence complète : J.-Ch. Roda, "Compliance, Internal Investigations and International Competitiveness: What are Risks for the French Companies (in the Light of Antitrust Law)?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Monumental Goals, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2023, pp. 355-368
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Monumental Goals, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article: The author draws on American and European Competition Law to measure whether internal investigations, as far as they provide factual elements, can provide foreign authorities and competitors, here American, with "sensitive information" (notably via leniency programs), and as such constitute a competitive handicap. But this turns out to be quite difficult, whereas compliance audits, for example under the legal duty of vigilance, can provide American litigants with useful information, drawn from internal documents, in particular the reports of compliance officers, which can be captured by procedures of discovery.
French Law remains weak in the face of these dangers, due to its refusal to recognise the legal privilege mechanism concerning these internal documents, contrary to American Law and the consequent effectiveness of discovery in international procedures, concerning internal documents, in particular resulting from internal investigations. Solutions have been proposed, the activation of a new conception of blocking statutes being complex, the prospect of adopting a legal privilege being more effective, but there would remain the hypothesis of an international conflict of privilege, American Law having a strict design of legal advice justifying it and judges checking that powerful companies do not use it artificially.
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________