Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : R. Sève, "L'Obligation de Compliance et les mutations de la souveraineté et de la citoyenneté", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître.
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : La contribution décrit "les changements de philosophie du droit que la notion de compliance peut impliquer par rapport à la représentation moderne de l’Etat assurant l’effectivité des lois issues de la volonté générale, dans le respect des libertés fondamentales qui constituent l’essence du sujet de droit.".
Le contributeur estime que la définition de la compliance tient à des auteurs qui « jouer un rôle d’éclairage et de structuration d’un vaste ensemble d’idées et de phénomènes précédemment envisagés de manière disjointe. Pour ce qui nous occupe, c’est sûrement le cas de la théorie de la compliance, développée en France par Marie-Anne Frison-Roche dans la lignée de grands économistes (Jean-Jacques Laffont, Jean Tirole) et dont la première forme résidait dans les travaux bien connus de la Professeure sur le droit de la régulation. ».
S'appuyant sur les Principles of the Law de l’American Law Institute, qui considère que la compliance est un « set of rules, principles, controls, authorities, offices and practices designed to ensure that an organisation conforms to external and internal norms», il souligne que la compliance apparaît alors un mécanisme neutre visant à l'efficacité par un passage vers l'Ex Ante. Mais il souligne que la nouveauté tient dans le fait de viser "seulement" des événements futurs, en "refondamentalisant" et en "monumentalisant" la matière par la notion de "buts monumentaux" conçue par Marie-Anne Frison-Roche, faisant apparaître un nouveau jus comune. Ainsi, "la compliance c’est l’idée permanente du droit appliquée à de nouveaux contextes et défis.".
Il ne s'agit donc pas de faire des économies budgétaires mais bien plutôt de continuer à faire vivre la philosophie du Contrat social à des enjeux complexes, notamment les enjeux environnementaux.
Cela renouvelle la place qu'y occupe le citoyen car il y apparaît non seulement comme individu, ce qui est dans la conception classique grecque et chez Rousseau, mais encore à travers des entités, notamment les ONG, tandis que les grandes entreprises, parce qu'elles ont seules les moyens de poursuivre les buts monumentaux de la compliance, seraient comme des "super-citoyens", ce dont l'espace numérique commence à développer l'expérience, au risque de disparition de l'individu lui-même par l'effet du "capitalisme de surveillance". Mais de la même façon que la pensée du Contrat social s'articule avec celle du capitalisme, la compliance se situe sans rupture fondamentale dans un prolongement historique logique : "C’est le développement et la complexité du capitalisme qui forcent à introduire dans les entités privées des mécanismes procéduraux d’essence bureaucratique, pour discipliner les salariés, contenir les critiques internes et externes, soutenir les managers en place" en les forçant à justifier les rémunérations, les avantages, etc.
En outre, selon les termes de l'auteur, "Avec les buts monumentaux, - la prise en compte des effets lointains, diffus, agrégés par delà les frontières, de l’intérêt des générations futures, de tous les êtres vivants - , on passe, pour ainsi dire, à une dimension industrielle de l’éthique, que seuls de vastes systèmes de traitement de l’information permettent d’envisager effectivement.".
C'est ainsi que l'on peut trouver une répartition entre l'intelligence artificielle et les êtres humains dans les organisations, notamment les entreprises, ou dans les processus de décisions.
De la même façon, la liberté de l'individu ne disparaît pas par la Compliance car c'est précisément et au contraire l'un de ses buts monumentaux que de rendre les individus aptes à choisir dans un environnement complexe, notamment dans l'espace numérique où le système démocratique est désormais en jeu, tandis que des mécanismes techniques, comme le lancement d'alerte, vont renaître le droit à la désobéissance civile, invalidant le grief de "capitalisme de surveillance".
L'auteur conclut que les enjeux sont si grands que la Compliance qui a déjà dépassé les distinctions entre le droit privé et le droit public, entre le droit national et le droit international, doit aussi dépasser celle entre l'information et et le secret, notamment en raison des cyber-risques, ce qui requiert de l'Etat l'élaboration et la pratique de stratégies non-publiques de Compliance pour préserver l'avenir.
________
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : R. Sève, "Compliance Obligation and changes in Sovereignty and Citizenship", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : The contribution describes "les changements de philosophie du droit que la notion de compliance peut impliquer par rapport à la représentation moderne de l’Etat assurant l’effectivité des lois issues de la volonté générale, dans le respect des libertés fondamentales qui constituent l’essence du sujet de droit." ("the changes in legal philosophy that the notion of Compliance may imply in relation to the modern representation of the State ensuring the effectiveness of laws resulting from the general will, while respecting the fundamental freedoms that constitute the essence of the subject of law").
The contributor believes that the definition of Compliance is due to authors who « jouer un rôle d’éclairage et de structuration d’un vaste ensemble d’idées et de phénomènes précédemment envisagés de manière disjointe. Pour ce qui nous occupe, c’est sûrement le cas de la théorie de la compliance, développée en France par Marie-Anne Frison-Roche dans la lignée de grands économistes (Jean-Jacques Laffont, Jean Tirole) et dont la première forme résidait dans les travaux bien connus de la Professeure sur le droit de la régulation. » ( "play a role in illuminating and structuring a vast set of ideas and phenomena previously considered in a disjointed manner. For our purposes, this is certainly the case with the theory of Compliance, developed in France by Marie-Anne Frison-Roche in the tradition of great economists (Jean-Jacques Laffont, Jean Tirole) and whose first form was in her well-known work on Regulatory Law").
Drawing on the Principles of the Law of the American Law Institute, which considers compliance to be a "set of rules, principles, controls, authorities, offices and practices designed to ensure that an organisation conforms to external and internal norms", he stresses that Compliance thus appears to be a neutral mechanism aimed at efficiency through a move towards Ex Ante. But he stresses that the novelty lies in the fact that it is aimed 'only' at future events, by 'refounding' and 'monumentalising' the matter through the notion of 'monumental goals' conceived by Marie-Anne Frison-Roche, giving rise to a new jus comune. Thus, "la compliance c’est l’idée permanente du droit appliquée à de nouveaux contextes et défis." ("Compliance is the permanent idea of Law applied to new contexts and challenges").
So it's not a question of making budget savings, but rather of continuing to apply the philosophy of the Social Contract to complex issues, particularly environmental issues.
This renews the place occupied by the Citizen, who appears not only as an individual, as in the classical Greek concept and that of Rousseau, but also through entities such as NGOs, while large companies, because they alone have the means to pursue the Compliance Monumental Goals, would be like "super-citizens", something that the digital space is beginning to experience, at the risk of the individuals themselves disappearing as a result of "surveillance capitalism". But in the same way that thinking about the Social Contract is linked to thinking about capitalism, Compliance is part of a logical historical extension, without any fundamental break: "C’est le développement et la complexité du capitalisme qui forcent à introduire dans les entités privées des mécanismes procéduraux d’essence bureaucratique, pour discipliner les salariés, contenir les critiques internes et externes, soutenir les managers en place" ("It is the development and complexity of capitalism that forces us to introduce procedural mechanisms of a bureaucratic nature into private entities, in order to discipline employees, contain internal and external criticism, and support the managers in place") by forcing them to justify remuneration, benefits, and so on.
Furthermore, in the words of the author, "Avec les buts monumentaux, - la prise en compte des effets lointains, diffus, agrégés par delà les frontières, de l’intérêt des générations futures, de tous les êtres vivants - , on passe, pour ainsi dire, à une dimension industrielle de l’éthique, que seuls de vastes systèmes de traitement de l’information permettent d’envisager effectivement." ("With the Monumental Goals - taking into account the distant, diffuse effects, aggregated across borders, the interests of future generations, of all living beings - we move, so to speak, to an industrial dimension of ethics, which only vast information processing systems can effectively envisage").
This is how we can find a division between artificial intelligence and human beings in organisations, particularly companies, or in decision-making processes.
In the same way, individual freedom does not disappear with Compliance, because it is precisely one of its monumental goals to enable individuals to make choices in a complex environment, particularly in the digital space where the democratic system is now at stake, while technical mechanisms such as early warning will revive the right to civil disobedience, invalidating the complaint of "surveillance capitalism".
The author concludes that the stakes are so high that Compliance, which has already overcome the distinctions between Private and Public Law and between national and international law, must also overcome the distinction between Information and secrecy, particularly in view of cyber-risks, which requires the State to develop and implement non-public Compliance strategies to safeguard the future.
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
18 avril 2024
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L’usage des puissances privées par le droit de la compliance pour servir les droits de l’homme", in J. Andriantsimbazovina (dir.), Puissances privées et droits de l'Homme. Essai d'analyse juridique, Mare Martin, coll. "Horizons européens", 2024, pp. 279-295
____
🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
____
► Résumé de l'article : Si l’on suit la tradition du Droit l’on associera la puissance à une source légitime qu’est l’État, la puissance publique étant son apanage, les entreprises n’exerçant leur puissance que dans l’ombre portée de cette puissance Ex Ante. À l’inverse la trivialité du Droit économique, dont le Droit de la concurrence serait le cœur, consistant à partir de l’activité des entreprises qui utilisent leurs puissances sur des marchés, relèguent l’action de l’État au rang d’exception, admissible si celui-ci, qui prétend exercer cette puissance contraire, le justifie. La distribution des rôles est donc symétrique, en ce que les places sont échangées, mais le modèle de l’opposition est partagé. Ce modèle de l’opposition épuise les forces des organisations qui sont reléguées à n’être que soit le principe soit l’exception. Or, si l’on veut porter de grandes ambitions, par exemple concrétiser des droits humains au-delà du système juridique à l’intérieur duquel les Autorités publiques exercent leurs pouvoirs normatifs, il faut s’appuyer sur une nouvelle branche du Droit, remarquable par son pragmatisme et par l’ampleur des ambitions, y compris humanistes, qu’elle porte : le Droit de la Compliance.
Il apparaît que le Droit de la Compliance est ainsi la branche du Droit qui fait porter le souci d’autrui, concrétisé par des droits humains, par les entités en position de le satisfaire, entités que sont les entités systémiques, les grandes entreprises en étant l’exemple privilégié, sujets de droit directs de la Compliance (I). Il en résulte une nouvelle répartition entre les autorités publiques, légitimes à formuler le But Monumental de protéger les êtres humains, et les organisations privées, qui s’ajustent à cela selon le type de droits humains et au regard des moyens mis en place pour les préserver. Les entreprises sont recherchées parce qu’elles sont puissantes, en ce qu’elles sont en position de concrétiser les droits humains, dans leur indifférence au territoire, dans la centralisation des informations, des technologies et des moyens économiques, humains et financiers. Cette alliance est essentielle pour que le système ne conduise pas à un transfert de choix politique et que cela aboutisse à une efficience systémique. Il en résulte une nouvelle définition de la souveraineté telle qu’on la voit se dessiner dans l’espace numérique, lequel n’est pas un secteur particulier puisque c’est le monde qui s’est digitalisé, la question climatique justifiant la même nouvelle répartition des rôles (II).
____
________

12 janvier 2024
Organisation de manifestations scientifiques

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, C. Gilles et A. Oumedjkane (dir.), Compliance et contrats publics, Journal of Regulation & Compliance (JoRC), Centre de recherches et d’études administratives de Montpellier (CREAM) et Centre d’Études et de Recherches Comparatives Constitutionnelles et Politiques (CERCOP) de l'Université de Montpellier, Faculté de droit et de science politique de Montpellier, 12 janvier 2024
____
____
🏗️Ce colloque s'inscrit dans le cycle de colloques organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires, portant en 2023-2024 sur le thème général de L'Obligation de Compliance
____
📚Les travaux s'inséreront ensuite dans les ouvrages :
📕Compliance et contrat, à paraître dans la collection 📚Régulations & Compliance, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, publié en langue française.
📘Compliance & Contract, à paraître dans la collection 📚Compliance & Regulation, coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, publié en langue anglaise.
____
► Présentation générale du colloque : La Compliance se développe dans l'ensemble du système juridique, aussi bien via les techniques de Droit public que de Droit privé. Le Droit des contrats publics en porte la trace par deux façons : par son champ d’application, en ce que la Compliance vise les relations économiques nouées par des personnes publiques, et par son objet, internalisant une conciliation entre leurs intérêts économiques et un ensemble d’autres finalités d’intérêt général ou « Buts Monumentaux », conciliation dont les personnes publiques ont traditionnellement la charge. A côté de l’acte unilatéral et pour opérer concrètement cette conciliation, le contrat a toute sa place. Sa flexibilité permet la négociation et l'ajustement dans les charges qu’il convient de faire peser sur les cocontractants.
L’objet de ce colloque est de parvenir à rattacher différentes manifestations de l’obligation de Compliance en contrats publics et ainsi donner une cohérence à des politiques qui sont encore trop souvent envisagées de manière étanche parce qu’elles renvoient à des buts et des domaines très différents.
Au stade de la passation, d’abord, la promotion des achats responsables ou innovants, notamment d’un point de vue environnemental, est l’un des signes de la présence de la Compliance. Dans un registre tout autre, il en est de même de la remise en cause par la CJUE de l’application automatique des interdictions de soumissionner, qui empêchent le pouvoir adjudicateur de statuer sur la fiabilité d’un candidat en prenant en compte les programmes de compliance mis en œuvre par les entreprises depuis leur condamnation.
Au stade contentieux, ensuite, la récente et large reconnaissance par le Conseil d’État de l’illégalité d’un contrat administratif pour violation des obligations déontologiques est venue nuancer la dynamique de sécurisation des contrats, tirant en ce sens les conséquences du grand mouvement de transparence de la vie publique engagé depuis 2013.
La matinée aura pour but d'appréhender les diverses formes de l'obligation de Compliance dans les contrats publics. Ce panorama permettra, dans l'après-midi, de viser à unifier l'obligation de Compliance dans les contrats publics.
____


____
► Interviennent :
🎤Ugo Assouad, Doctorant à l’Université de Montpellier, CREAM
🎤Philippe Augé, Président de l'Université de Montpellier
🎤Clémence Ballay-Petizon, Doctorante contractuelle chargée d'enseignement (DCCE) à l’Université de Montpellier, CREAM
🎤Yannisse Benrahou, Doctorant à l’Université Paris Nanterre, CRDP
🎤Léon Boijout, Doctorant contractuel chargé d'enseignement (DCCE) à l’Université de Montpellier, CREAM
🎤Julien Bonnet, Professeur à l’Université de Montpellier, CERCOP
🎤Guylain Clamour, Doyen de la Faculté de droit et de science politique de Montpellier
🎤Marie-Anne Frison-Roche, Professeure de Droit de la Régulation et de la Compliance, directrice du Journal of Regulation & Compliance (JoRC)
🎤Pierre-Yves Gadhoun, Professeur à l'Université de Montpellier, CERCOP
🎤Pascale Idoux, Professeure à l’Université de Montpellier, CREAM
🎤Nedjma Kontoukas, Doctorante contractuelle chargée d'enseignement (DCCE) à l’Université de Montpellier, CREAM
🎤Valentin Lamy, Maître de conférences à l’Université de Lorraine, IRENEE
🎤Antoine Oumedjkane, Maître de conférences à l’Université de Lille, ERDP
🎤Lucien Rapp, Professeur émérite à l’Université Toulouse Capitole
🎤Marion Ubaud-Bergeron, Professeure à l’Université de Montpellier, CREAM
____
🧮Lire une présentation détaillée de la manifestation ci-dessous⤵️
27 avril 2018
Blog

Le Conseil d'Etat a rendu public son Avis :
Parmi les très nombreuses dispositions de ce projet de loi de programmation et de réforme de la Justice", aussi abondantes que variées et que disparates, figurent un pan consacré aux peines.
Puisqu'il s'agit du Droit pénal, l'exigence de précision dans les termes est plus grande encore, impliquée par les principes constitutionnels de nécessité et d'interprétation restrictive.
Le titre qui donne de la cohérence aux dispositions en la matière est de "renforcer l'efficacité et le sens de la peine".
Le "travail d'intérêt général" peut être notamment effectué au sein d'une personne morale de droit privé chargée d'une "mission de service public" habilitée, que son but soit lucratif ou non .
Au regard des garanties constitutionnelles et internationales concernant le travail forcé, le Conseil d'Etat estime que la notion de "personne morale de droit privé chargé d'une mission de service public" est suffisamment explicite pour que les garanties soient satisfaites, dès l'instant que les décrets en Conseil d'Etat détermineront et les conditions de l'habilitation de ces personnes morales habilitées et les conditions de l'activité à laquelle la personne est condamnée.
Mais le projet de loi avait également visé "l'entreprise engagée dans une politique de responsabilité sociale de l'entreprise".
Et cela n'a pas été agréé par le Conseil d'Etat, non pas tant qu'il récuse l'idée d'une extension entre "l'intérêt général" et "l'intérêt collectif", mais qu'à juste titre soucieux de la pulvérisation des définitions des sortes d'intérêts que toutes sortes d'entités poursuivent, il demande à ce que celle-ci s'ancre dans ce qui serait la définition de référence : la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Voilà les termes exacts de l'Avis (p.30) :
- En ce qui concerne l’identification des personnes morales pouvant proposer un travail d’intérêt général
107. Le Conseil d’Etat estime que la notion utilisée par le législateur de « personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public » est suffisamment explicite et qu’il n’est pas nécessaire d’y ajouter la mention particulière d’une catégorie de personnes comprise dans cette notion. S’il le juge utile, le Gouvernement dispose d’autres moyens pour informer les personnes en cause de la portée du dispositif prévu à l’article 131-8.
- En ce qui concerne le champ de l’expérimentation
108. Le Conseil d’Etat propose de substituer à la notion, imprécise, d’« entreprise engagée dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise » celle, différente, de « personne morale de droit privé remplissant les conditions définies par l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi ». En effet, la catégorie de personnes morales de droit privé visée par cette nouvelle rédaction est à la fois mieux définie et plus adaptée à l’utilité sociale des travaux pouvant être proposés, conformément à l’objectif recherché par le Gouvernement. ......
Lire le commentaire ci-dessous.
V. par exemple le résumé fait au Dalloz du 19 avril 2018.
7 décembre 2017
Interviews

Référence complète : FRISON-ROCHE, M.-A., Il faut construire un dispositif européen de compliance, voilà l'avenir !, in Actualité/Entretien, Petites Affiches, propos recueillis par Olivia DUFOUR, n° 244, 7 déc. 2017, pp. 4-6.
Entretien donné à propos de la sortie de l'ouvrage Régulation, Supervision, Compliance.
Réponse aux questions suivantes :
- Quels sont les buts que vous assignez à la Compliance ?
- Que signifient ces deux concepts que vous introduisez : service public mondial et buts monumentaux ?
- Que devient l’État face à une entreprise globale ?
- Que pensez-vous du lanceur d'alerte ?
- Comment est affectée la relation entre l'Europe et les États-Unis ?
- Par la Compliance, les entreprises ne vont-elles pas gouverner le monde ?
______
2 février 2017
Conférences

Référence : Frison-Roche, M.-A., Le droit de la
Le Droit de la
En effet, les autorités publiques expriment des buts monumentaux dépassant le fonctionnement marchand et qu’elles n’ont pas les moyens de mettre en œuvre mais dont elles chargent certaines entreprises de la concrétisation. Ainsi, la
Face à ce phénomène américain, les entreprises européennes sont restées passives, se contentant d’être condamnées. Il convient bien plutôt de s’approprier ce Droit de la
Enedis est à ce titre un sujet dynamique de
Consulter les slides ayant servis de support à la conférence.

26 septembre 2016
Publications

Ce working paper a servi de base à un article publié en novembre 2016 dans la Revue
L'Autorité de la
A lire le Communiqué de l'Autorité de la
Ainsi, le principe de la Loi dite "Macron" est la
D'ailleurs, ne nous trompons pas de bataille à propos de cette loi nouvelle. Il ne s'agit pas de laisser sur le champs soit le
La profession notariale doit plutôt se concentrer sur la représentation que le Législateur a eu d'elle : des "tiers de
11 mai 2015
Base Documentaire : Doctrine
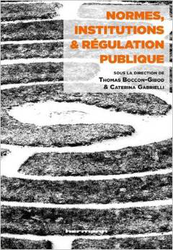
Référence complète : Chevallier, J., Régulation et service public, in Boccon-Gibod, Th. et Gabrielli, C. (dir.), Normes, institutions & régulations publiques, éd. Hermann, 2015, p.157-166.
Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
L'article peut être lu par les étudiants de Sciences po ayant accès via le drive au dossier MAFR - Régulation.
____
L'auteur pose que la promotion de la régulation a un effet sur la conception du service public.
En effet, l'Etat lui-même est pensé comme une "instance de régulation". L'Etat vise au maintien des grands équilibres économiques et sociaux, et cela d'une façon plus modeste que jadis. Dans l'Etat-providence, l'Etat plus intrusif prenait la forme de services publics structurant l'économie. La logique d'action était celle d'une "providence" ayant souci de chacun, tandis que l'entreprise n'a souci que d'elle-même. Cette finalité particulière justifiait des modes particuliers de gestion, soustraits au principe de concurrence.
L'auteur rattache à la crise de l'Etat-providence la promotion de la notion de régulation qui redéfinit le périmètre des services publics. L'Etat n'est plus acteur économique, il devient arbitre des équilibres. Il n'intervient plus que d'une façon subsidiaire, s'il y a défaillance du marché. La régulation renvoie à une conception libérale. L'auteur montre que le service public se réduit alors aux biens et activités "essentiels" : reste à savoir ce qui est essentiel ou non. Tandis que le pluralisme des modes de gestion se développe.
L'auteur poursuit en montrant que l'activité de service public est transformée par la régulation, le service public étant dans un contexte concurrentiel. L'Europe impose de partir du principe d'égalité de concurrence entre opérateurs publics et opérateurs privés, la mission de service public pouvant seule justifiant une exception au principe de concurrence au bénéfice des opérateurs en charge d'un service public d'intérêt économique général.
Les équilibres sont surveillés par des autorités de régulation, transformant l'Etat qui devient "pluriel".
Jacques Chevallier conclut son article en observant que la Régulation a procéder à une "démythification du service public".
_____
21 novembre 2014
Conférences

Sans doute faut-il partir du fait que le secteur du médicament est régulé, dans le but de préserver le consommateur final, le malade qui accède à un bien commun : la santé.
Le fait que le médicament doivent circuler d'opérateur en opérateur, de segment de marché en segment de marché, ne change pas cette réalité sociale et politique, constituée par le souci particulier, traduit par le "caractère fixe du prix" du médicament pour celui qui le consomme, ce qui est un oxymore, et par le fait que celui-ci n'est le plus souvent pas le payeur, ce qui est un contresens dans un système de prix.
C'est donc à partir de ces "contrariétés techniques", qui ne s'expliquent que par la profondeur politique du système de santé, qu'il convient d'analyser l'un des segments les plus chahutés par l'énergie compétitive, à savoir la distribution en gros, segment de circulation du médicament entre celui qui le fabrique et celui qui le vend au détail au consommateur final.
Certes, la concurrence, servie par son outil juridique naturel qu'est le contrat, doit se déployer dans les interstices de la régulation qui est le principe d'organisation. Mais c'est la régulation qui continue de fixer les soucis qui guident l'application des règles, par exemple le souci de disponibilité des médicaments, toujours et en masse critique. Le mécanisme concurrentiel, de l'instant et de la tension, fonctionne sur d'autres impératifs. Ainsi, lorsque les Autorités de concurrence lisent les textes, elles donnent à la compétition un espace de jeu qui lui donne place de principe, sans avoir souci de la pérennité du système ou de la gestion d'une crise sanitaire. Elles ne se soucient pas de régulation. On peut le comprendre, puisqu'il s'agit d'autorité de concurrence.
Mais le droit d'un segment du système de santé est coloré par les principes fondamentaux du système dans son entier. Or, pour la France et l'Europe, la santé et le médicament sont gouvernés par le souci de la protection de l'usager, la concurrence qui sert le client solvable a une autre finalité. Elle doit se plier et ne jouer qu'entre des distributeurs qui respectent également et avant tout les obligations que le système de régulation a mis à la charge des distributeurs en gros.
Les travaux seront publiés dans la Revue Lamy Concurrence - Régulation au premier semestre 2015.
Accéder au programme du colloque.
Accéder au plan de la conférence.
Accéder au working paper servant de support à l'intervention orale.

13 novembre 2014
Publications

Ce working paper a servi de base à un colloque sur Contrat et concurrence dans le secteur pharmaceutique. Perspectives nationales et internationales, qui se tiendra à l'Université de Lille, le 21 novembre 2014.
Il a servi de base à un article , publié dans la Revue Lamy Concurrence - Régulation.
Ce travail consiste à rappeler dans une première partie les fondamentaux du système de la distribution en gros du médicament, laquelle est régulée parce qu'elle est elle-même une part du système global de santé publique, régulée afin de servir l'intérêt du malade. C'est pourquoi il est nécessaire d'adopter, comme en matière bancaire ou énergétique, une perspective systémique de la distribution en gros, dans sa corrélation avec l'accès que le malade doit avoir au médicament.
Dans ce principe de régulation, la concurrence est bienvenue puisqu'elle fait baisser les rentes et accroît les efficacités, mais à deux conditions. En premier lieu, il faut qu'elle n'anéantisse pas à moyen terme le service de la fin généralement recherchée par le système de santé et en second lieu la compétition doit voir s'affronter des compétiteurs en égale position. Or, ces deux conditions ne sont plus remplies en droit positif depuis 2012.
En effet, la seconde partie du travail confronte ces principes à l'état du droit positif, qui est construit désormais sur des normes contradictoires, la loi adoptée en 1996 organisant des rentes pour que des obligations de service public soient prises en charge tandis qu'un arrêté pris en 2012 permet des transferts de marge qui détruisent la perspective de concrétiser ces obligations. En premier lieu, la hiérarchie des normes n'est pas respectée, puisqu'un arrêté ne peut venir contredire une loi. En second lieu, c'est changer de système que de remplacer un système de santé basé sur l'accès aux soins par un système de santé basé sur la concurrence. Ce choix, ni les autorités administratives, ni le juge ne peuvent l'opérer, seul le Politique peut le faire.
(Consulter le plan du Working paper)
15 octobre 2014
Publications
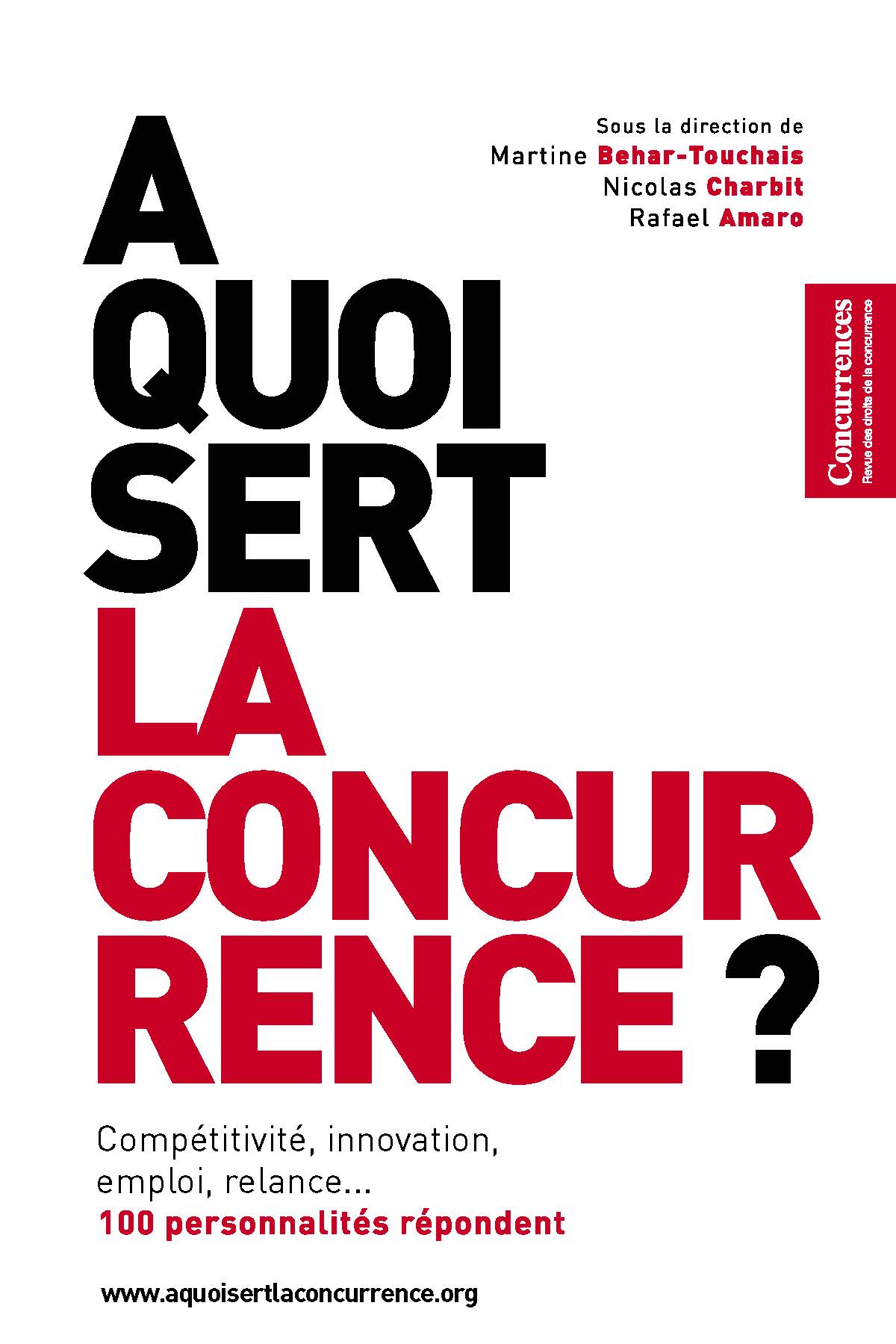 Référence complète FRISON-ROCHE, M.-A., La concurrence, objectif adjacent dans la régulation de l'énergie, in BEHAR-TOUCHARS, Martine, CHARBIT, Nicolas et AMARO, Rafael (dir.), À quoi sert la concurrence ?, Paris, oct. 2014, p.423-428.
Référence complète FRISON-ROCHE, M.-A., La concurrence, objectif adjacent dans la régulation de l'énergie, in BEHAR-TOUCHARS, Martine, CHARBIT, Nicolas et AMARO, Rafael (dir.), À quoi sert la concurrence ?, Paris, oct. 2014, p.423-428.
Le droit économique se concevant d'une façon instrumentale, il se dessine et s'apprécie à partir des buts qu'il sert et poursuit.
L'instrument juridique est utilisé pour sa puissance normative dans le secteur de l'énergie. Il l'est parfois dans l'objectif de la concurrence, mais celui-ci est difficile à atteindre, comme le montre la force d'inertie des systèmes nationaux.
Cela peut paraître contrariant mais fondamentalement la concurrence n'est pas l'objectif principal du secteur de l'énergie. La concurrence n'en est pas exclue : elle est son objectif adjacent.
Ainsi, lorsque la concurrence permet au consommateur de plus aisément bénéficier du bien commun, elle est bienvenue. Lorsque la concurrence fait s'articuler à la fois la protection de l'environnement, le souci de l'eau, la construction du lien social, l'autonomie à long terme, la sécurité, elle est de droit. Mais lorsqu'elle ne concrétise pas spontanément ces objectifs, elle n'est pas première.
La concurrence ne peut alors que venir en soutènement du droit de la régulation, y compris dans la dimension politique de celui-ci. C'est alors aux États ou aux politiques de l'Union européenne de prendre le pas sur une application mécanique et neutre de l'ajustement des offres et des demandes.
Lire le working paper sur lequel l'article s'appuie et dans lequel les références techniques sont disponibles.
8 avril 2014
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 20 septembre 2011 )
Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

18 avril 2013
Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Fournier, J., L'économie des besoins. Une nouvelle approche du service public, éd. Odile Jacobs, 2013
Consulter la table des matières.
Lire ci-dessous.
4 juin 2002
Base Documentaire : 05. CJCE - CJUE
Référence complète: CJCE, 4 juin 2002, arrêt C-483/99, Commission c/ France (Total)
27 juin 2000
Publications
► Référence complète : J.-F. Burgelin, J.-M. Coulon et M.-A. Frison-Roche, "L’office de la procédure", in Mélanges offerts à Pierre Drai, Le juge entre deux millénaires, Dalloz, 2000, p.253-267.
____
____
► Résumé de l'article : l'article a pour objet de revenir à ce à quoi sert la procédure, quel est donc son "office", l'office du juge ne pouvant pas être que de juger mais portant aussi vers ce qui le mène à cet acte-là, c'est-à-dire la procédure, laquelle ne devant pas être davantage séparée de ce qui l'a fait mettre, à savoir le litige. Si la procédure en est totalement séparée, alors elle devient proprement folle, comme elle le devient si l'on oublie que la procédure est un instrument qui se conçoit que par rapport à son utilité. L'autonomie du Droit processuel ne contrarie en rien cet ancrage.
A ce titre et dans une première partie, l'article examine la façon dont la procédure concrétise les prérogatives des parties que la procédure protège. La procédure permet aux parties de reconstituer les faits qu'elles construisent et pour l'allégation desquels elles apportent des preuves dans les formes procéduralement admises, le juge pouvant intervenir par un tour procédural inquisitorial pour que la preuve du fait allégué soit apportée.
Par ailleurs, procès correspond à une triade constituée par les deux parties et le juge, la procédure suppose que les deux parties acceptent le principe même du droit de l'autre à lui parler et à utiliser les mêmes formes, la procédure étant de ce fait une civilisation du conflit qui est tout à fois mis à distance par le cérémonial et calmé par le codage : la procédure a pour office d'imposer un lien civilisé entre les parties, elle incarne en cela la justice elle-même. A ce titre, l'opposition souvent faite entre l'accusatoire et l'inquisitoire doit être relativisé car la procédure inquisitoire peut être plus protectrice de ce lien, notamment par les droits de la défense.
La seconde partie de l'article expose l'office de la procédure dans la perspective de l'efficacité du service public de la justice. La procédure efficace fait disparaître le litige, ce que fait le jugement, puisque celui-ci tranche le litige. En cela, le jugement n'est pas un acte de procédure commensurable aux autres et il faut qu'il arrive dans un délai raisonnable. C'est pourquoi le juge doit avoir des pouvoirs importants, comme l'injonction, y compris dans une procédure accusatoire, et favoriser les modes alternatifs, comme la médiation.
De la même façon, le procès doit s'ouvrir aux tiers, notamment parce que la distinction des intérêts s'estompe et que l'intérêt collectif ou général doit être entendu.
________
22 juin 1999
Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Les rythmes d’évolution des services publics, in Chevalier, J.-M., Ekeland, I. et Frison-Roche, M.-A. (dir.), L’idée de service public est-elle encore soutenable ? , coll. "Droit, Ethique et Société", PUF, 1999, pp.31-39.
Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
22 juin 1999
Publications

Référence complète : Chevalier, J.-M., Ekeland, I. et Frison-Roche, M.-A. (dir.), L'idée de service public est-elle soutenable ?, coll. "Droit, Éthique et Société", PUF, 1999, 261 p.
Accéder à l'article de Marie-Anne Frison-Roche : Les rythmes dans l'évolution conjointe et commune des services publics.
8 septembre 1998
Publications
10 juillet 1998
Publications
Référence complète : L. Cohen-Tanugi. et M.-A. Frison-Roche, La régulation : monisme ou pluralisme ? Équilibres dans le secteur des services publics concurrentiels, numéro spéciale des Petites Affiches, 10 juillet 1998.
____
Lire les deux articles de Marie-Anne Frison-Roche :
- "Les différentes définitions de la Régulation", p.5 et s.
- Les difficultés françaises face à la notion de Régulation", p.24 et s.
7 juin 1998
Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le service public de la justice. Conclusions ouvertes, in Le service public de la justice, éd. Odile Jacob, 1998, p. 183 s.
Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
7 juin 1998
Publications
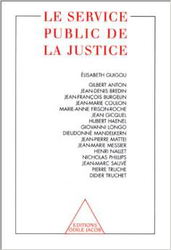
Référence complète : Coulon, J.-M., Frison-Roche, M.-A. et Haenel, H. (dir.), Le service public de la justice, éd. Odile Jacob, 1998.
Accéder à l'article de conclusion de Marie-Anne Frison-Roche et Hubert Haenel.
5 décembre 1997
Conférences

10 octobre 1997
Organisation de manifestations scientifiques