27 novembre 2018
Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Droit de la concurrence et droit de la compliance, novembre 2018, in Revue Concurrences n° 4-2018, Art. n° 88053, pp. 1-4.
__________
► Résumé : Le droit de la compliance est une branche du droit nouvelle, encore en construction. L’on peut en avoir une “définition restreinte”, consistant à la concevoir comme l’obligation qu’ont les entreprises de donner à voir qu’elles se conforment en permanence et d’une façon active au Droit. L’on peut en avoir une définition plus riche, de nature substantielle, la définissant comme l’obligation ou la volonté propre qu’ont certaines entreprises de concrétiser des “buts monumentaux” dépassant la seule performance économique et financière. Le droit de la concurrence intègre en partie ses deux conceptions de la compliance. Précurseur, le droit de la concurrence concrétise avec dynamisme la première conception du droit de la compliance. C’est avec davantage de difficultés mais aussi beaucoup plus d’avenir que le droit de la concurrence peut exprimer en dialectique la seconde conception du droit de la compliance comme internationalisation de “buts monumentaux”, notamment dans l’espace numérique.
____
________
16 octobre 2018
Enseignements : Droit commun de la Régulation

Consulter les slides servant de support à la Leçon relative à la définition du Droit de la Régulation comme Équilibre entre la Concurrence et d'autres soucis.
Accéder au Plan général du Cours de Droit commun de la Régulation.
Se reporter à la présentation générale du Cours de Droit commun de la Régulation.
Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.
Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit de la Régulation
Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative au Régulateur
Résumé de la leçon.
Le Droit de la Régulation peut se construire dans la perspective de la concurrence, soit pour la construire, soit pour se placer comme simple béquille ou exception par rapport à son principe. Mais l'on peut, dans une conception plus politique concevoir le Droit de la Régulation comme un équilibre permanent, instable et à long terme entre le principe de concurrence et d'autres soucis, a-concurrentiels, voire anti-concurrentiels.
De la définition (souvent politique) de la Régulation, découle tout son régime juridique. En modifiant le régime du Droit de la Régulation, on obtient des changements politiques qui peuvent être majeurs.C'est pourquoi on se dispute tant pour savoir ce "qu'est" la Régulation, car concrètement le pouvoir est là.
Trois définitions sont admissibles et elles se superposent aujourd'hui, y compris en France.L'on peut concevoir la Régulation par rapport à la concurrence, qu'il s'agit d'un appareillage juridique de régulation pour obtenir concrètement à un système concurrentiel ou qu'il s'agisse d'injecter des doses bienvenu de concurrence dans un système organisé selon d'autres principes.La troisième définition est la plus complexe et sans doute la plus prometteuse. Il s'agit de la régulation comme mécanisme juridique d'équilibre entre le principe de concurrence et d'autres principes. Dans une telle définition, qui trouve illustration dans tous les secteurs régulés plus que jamais, se mélangent à la fois des considérations très techniques et des éléments purement politiques. Il en résulte des mécanismes juridiques paradoxaux. Cela constitue néanmoins un "droit commun". On est alors loin de l'idéal de concurrence.
11 octobre 2018
Blog

Ouest-France relaye une information juridique intéressante.
Les relations entre les joueurs de football et les clubs sont organisés par des contrats.
Selon la définition de ce qu'est un contrat, celles-ci fixent les obligations respectives des parties. Ainsi et par exemple le footballeur s'oblige à des comportements tandis que les clubs s'engagent notamment à payer celui-ci. Comment les contrats sont synallagmatiques, les obligations des uns font en quelque sorte face aux obligations des autres.
Or, sont insérées dans les contres des clauses expressément qualifiées de "clauses éthiques".
Par exemple dire bonjour au public est un comportement du footballeur y est visé. On pourrait dire qu'il s'agit d'une "clause de politesse", et il est usuel d'opposer la règle de Droit et la règle de politesse ....
Et y fait face une rémunération particulière. D'un montant qui peut être particulièrement élevé. Ainsi, dans ces contrats, il y aurait les obligations juridiques, rémunérées comme telles (jouer au foot) et les obligations a-juridiques, dont la rémunération est également stipulée d'une façon spécifique (éthique).
_____
L'on comprend bien la spécificité de ces clauses.
En effet, en premier lieu il n'est pas dans le métier de footballeur de dire bonjour ou d'applaudir le public lui-même. Dans ce dernier cas, il y a inversion des rôles car c'est au public d'applaudir et non pas au joueur. Dans le premier cas, c'est même le fait de se comporter comme une personne ordinaire, celle qui dit bonjour, qui répond à tous ceux qui l'acclament,. Une personne bien-élevée.
Mais pourquoi le prévoir contractuellement ?
Parce que le football est autant un spectacle qu'un sport.
Il est donc essentiel que les "vedettes" se comportent comme telles : soient en contact direct avec leur "public" qui les aiment et veulent avoir un "retour". Ainsi il convient qu'au-delà du sport ces personnes particulières, à savoir les "vedettes" de l'équipe, celles qui sont connues et aimées, aient le comportement attendu par le public, lequel viendra assister au match aussi, voire surtout, pour entrer en contact avec les stars du foot.
Pour que cela advienne, que ces stars saluent, leur parlent, les applaudissent, il convient que les clubs rémunèrent les stars qui marchent sur leur tapis vert. Et c'est l'objet de ces clauses.
L'on comprend plus difficilement la qualification "éthique" de ces clauses.
Ce qui est étonnant, c'est la qualification donnée à une telle disposition contractuelle.
En premier lieu, comme cela ne fait pas partie du "métier" de footballeur , sans doute le club ne peut pas "contraindre" le footballeur à dire bonjour ou à applaudir le public ... C'est sans doute aussi pour cela qu'en application directe de la théorie des "incitations" c'est une incitation financière directe qui est affectée à tel ou tel geste qui n'est pas un geste techniquement sportif.
Comme l'on ne sait pas qualifier un tel geste ainsi financièrement récompensé et techniquement décrit, alors on utilise le terme "éthique".... Il est "éthique" d'être aimable et empathique avec son public. Et cela mérite récompense. Comme cela fait penser aux contrats de GPA "éthique" qui prévoient pareillement des mouvements spontanés mais minutieusement décrits dans des contrats qui stipulent des contreparties financières.
Ne vaudrait-il pas mieux dire que dans le métier de footballeur, pour certains être un vedette fait aussi partie du métier et mérite rétribution ? Que cela n'est pas affaire d'éthique, mais d'adéquation à un désir du public qui paie pour cela, ce qui justifie le paiement de celui qui offre le spectacle ?
Car l'éthique, cela ne doit pas être ce qui permet de masquer la réalité.
2 octobre 2018
Enseignements : Droit commun de la Régulation

Accéder au plan de la Leçon n°2 sur le Droit de la Régulation dans la perspective de la Concurrence
Consulter les slides servant de support à la Leçon
Accéder au Plan général du Cours de Droit commun de la Régulation.
Se reporter à la présentation générale du Cours de Droit commun de la Régulation.
Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.
Consulter la Bibliographie générale du Cours de Droit commun de la Régulation
Consulter la bibliographie ci-dessous, spécifique à cette Leçon relative au Droit de la Régulation dans la perspective de la Concurrence
Résumé de la leçon.
Le Régulateur est ce par quoi l'on repère le Droit de la Régulation. Mais le Droit de la Régulation a du mal à trouver sa place dans le système juridique en ce qu'il oscille entre le Droit de la concurrence et le Droit public ... Les difficultés à situer le Droit de la régulation dans le système juridique rejoint les difficultés de définition qu'il rencontre.
Trois sens sont actuellement actifs dans le Droit de la Régulation. Le premier vise la Régulation comme "Voie vers la concurrence". Certains limitent le Droit de la Régulation à cela, la concurrence étant alors comme son "idéal" sans cesse retardé, son Graal. Cela conduit à une application technique des règles qui posent la concurrence en principe et ce qui n'y correspond pas en exception.
Le deuxième vise la Régulation comme mécanisme adjacent à un système concurrentiel, ce qui conduit à sur-estimer parfois ce qui ne sont que des insertions adjacents de mécanismes de droit de la concurrence dans des secteurs économiques par principes régulés.
En troisième lieu la Régulation peut se définir non plus en perspective mais en part égale voire en préférence à la concurrence, lorsque des raisons de durée, confiance, dangers, risques, comme un équilibre instable et durable entre le principe de concurrence entre d'autres principes, entre le principe de concurrence et d'autres soucis. Il peut s'agir de principes que la technicité même de l'objet requiert mais cela peut être aussi que le regarde qui est porté sur cet objet lui fait porter : par exemple le souci de soin que l'on fait porter au médicament, le souci d'inclusion que l'on fait porter à la banque, le souci de chaleur partagée que l'on fait porter à l'électricité, le souci de civilisation que l'on fait porter à l'oeuvre.
Mais qui est légitime à porter ce regard juridiquement créateur : le juge ? l'entreprise (socialement responsable) ? le législateur national ? l'organisme international ?

Mise à jour : 8 septembre 2018 (Rédaction initiale : 30 avril 2018 )
Publications

► Ce document de travail avait vocation à servir de support à une conférence dans le colloque Droit & Ethique du 31 mai 2018 dans un colloque organisé par la Cour de cassation et l'Association française de philosophie du Droit sur le thème général Droit & Ethique.
Voir une présentation de la conférence.
Il a plutôt servi de support à l'article paru dans les Archives de Philosophie du Droit (APD).
► Résumé : C'est par le Droit que l'être humain a acquis en Occident une unité (I). Ce que la Religion avait pu faire, le Droit l'a également fait en posant sur chaque être humain la notion indétachable de lui de "personne"(I.A). Mais c'est cela qui est remis en cause aujourd'hui, non pas la personnalité et le pouvoir que l'être humain a d'exprimer sa liberté mais l'unité que cela implique dans la disposition que l'on a de soi en repoussant le désir qu'autrui a toujours eu de disposer de nous. Le Droit actuel tend en effet à "pulvériser" les êtres humains en données et à transformer en prestations juridiques neutres ce qui était considéré comme de la dévoration d'autrui. La notion juridique de "consentement", cessant d'être une preuve d'une volonté libre mais devenue une notion autonome, y suffirait (I.B.).
Pour empêcher que ne règne plus que la "loi des désirs", laquelle ne fait que traduire l'ajustement des forces, il faut requérir ici et maintenant la souveraineté éthique du Droit, parce que le Droit ne peut pas être qu'une technique d'ajustement des intérêts (II). L'on peut former cette requête si l'on ne veut pas vivre dans un univers a-moral (II.A), si l'on constate que l'unité de la personne est l'invention juridique qui protège l'être humain faible (II.B.). Si on en admet l'impératif, il faut alors se demander enfin qui en Droit va l'exprimer et l'imposer, notamment de la Loi, ou du Juge, car nous semblons avoir perdu la capacité de rappeler ce principe de la Personne sur laquelle l'Occident fut si centré. Or, les principes qui ne sont plus dits disparaissent. Il ne resterait plus alors que l'ajustement au cas par cas des intérêts entre êtres humains dans le champ mondial des forces particulières. A cette aune, le Droit ne serait plus qu'une technique de sécurisation des ajustements particuliers. Réduit à cela, Le Droit aurait perdu son lien avec l'Ethique. (II.C).
Lire ci-dessous les développements.
25 mai 2018
Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Noblot, C., Pour une interprétation téléologique de la notion de "service", in Petites affiches, Lextenso, n°105, mai 2018, pp. 8-10.
Résumé : Dans quelle catégorie classer la notion de " service " ? Un courant jurisprudentiel récent laisse entendre qu'il s'agit d'une notion conceptuelle définie une fois pour toutes à partir de critères précis. Il nous semble, au contraire, que la notion de service est fonctionnelle. Elle se définit en fonction de ce à quoi elle sert dans un contexte normatif donné et se prête à une interprétation téléologique.
Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier "MAFR -Regulation&Compliance"
22 mai 2018
Base Documentaire : Doctrine
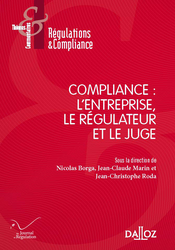
Référence complète : Besson, V., L'entreprise et l'élaboration d'un programme de compliance, in Borga, N., Marin, J.-Cl. et Roda, J.-Cl., Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, Série Régulations & Compliance, Dalloz, 2018, pp. 201-214.
Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel est publié l'article.
Consulter les autres titres de la Série dans laquelle est publié l'ouvrage.
27 avril 2018
Blog

Le Conseil d'Etat a rendu public son Avis :
Parmi les très nombreuses dispositions de ce projet de loi de programmation et de réforme de la Justice", aussi abondantes que variées et que disparates, figurent un pan consacré aux peines.
Puisqu'il s'agit du Droit pénal, l'exigence de précision dans les termes est plus grande encore, impliquée par les principes constitutionnels de nécessité et d'interprétation restrictive.
Le titre qui donne de la cohérence aux dispositions en la matière est de "renforcer l'efficacité et le sens de la peine".
Le "travail d'intérêt général" peut être notamment effectué au sein d'une personne morale de droit privé chargée d'une "mission de service public" habilitée, que son but soit lucratif ou non .
Au regard des garanties constitutionnelles et internationales concernant le travail forcé, le Conseil d'Etat estime que la notion de "personne morale de droit privé chargé d'une mission de service public" est suffisamment explicite pour que les garanties soient satisfaites, dès l'instant que les décrets en Conseil d'Etat détermineront et les conditions de l'habilitation de ces personnes morales habilitées et les conditions de l'activité à laquelle la personne est condamnée.
Mais le projet de loi avait également visé "l'entreprise engagée dans une politique de responsabilité sociale de l'entreprise".
Et cela n'a pas été agréé par le Conseil d'Etat, non pas tant qu'il récuse l'idée d'une extension entre "l'intérêt général" et "l'intérêt collectif", mais qu'à juste titre soucieux de la pulvérisation des définitions des sortes d'intérêts que toutes sortes d'entités poursuivent, il demande à ce que celle-ci s'ancre dans ce qui serait la définition de référence : la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.
Voilà les termes exacts de l'Avis (p.30) :
- En ce qui concerne l’identification des personnes morales pouvant proposer un travail d’intérêt général
107. Le Conseil d’Etat estime que la notion utilisée par le législateur de « personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public » est suffisamment explicite et qu’il n’est pas nécessaire d’y ajouter la mention particulière d’une catégorie de personnes comprise dans cette notion. S’il le juge utile, le Gouvernement dispose d’autres moyens pour informer les personnes en cause de la portée du dispositif prévu à l’article 131-8.
- En ce qui concerne le champ de l’expérimentation
108. Le Conseil d’Etat propose de substituer à la notion, imprécise, d’« entreprise engagée dans une politique de responsabilité sociale de l’entreprise » celle, différente, de « personne morale de droit privé remplissant les conditions définies par l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et poursuivant un but d’utilité sociale au sens de l’article 2 de la même loi ». En effet, la catégorie de personnes morales de droit privé visée par cette nouvelle rédaction est à la fois mieux définie et plus adaptée à l’utilité sociale des travaux pouvant être proposés, conformément à l’objectif recherché par le Gouvernement. ......
Lire le commentaire ci-dessous.
V. par exemple le résumé fait au Dalloz du 19 avril 2018.
11 mars 2018
Blog

En lisant une lettre que Voltaire écrit pour convaincre de la nécessité d'agir en faveur de Sirven, accusé d'avoir assassiné sa fille et condamné à mort par contumace, Voltaire évoque l'affaire Calas.
C'est une technique rhétorique dangereuse, à double-tranchant, car il écrit par ailleurs aux avocats que le fait d'avoir fait pression à propos de Calas peut conduire à indisposer les tribunaux dans le cas Sirven, qui se déroule dans la même région et dont la situation est analogue.
Mais il le fait pourtant et en ces termes-là :
Vous voulez savoir comment cette réclamation de toute l’Europe
contre le meurtre juridique du malheureux Calas, roué à Toulouse, a pu venir d’un petit coin de terre ignoré, entre les Alpes et le Mont-Jura,
à cent lieues du théâtre où se passa cette scène épouvantable.
N'est-ce pas remarquable que plutôt de parler d'erreur judiciaire, ou d'utiliser des termes plus neutres, Voltaire choisit :
- d'utiliser les termes de : "meurtre juridique"
- de désigner celui qui en est victime de : "malheureux Calas", et non pas d'innocent.
Il souligne ainsi que c'est bien par le Droit que Callas a été tué, et il retient la qualification juste que le Droit pénal retient : celle de "meurtre". Mais comme Voltaire estime que c'est le Droit lui-même qui a conduit à la mort de Callas, par l'application qui lui a été faite de la Loi, puis l'application du procès, puis l'application de la peine (exécution par l'écartèlement), alors il qualifie cela comme un "meurtre juridique".
En technique rhétorique, c'est un "oxymore".
En théorie juridique, l'on dirait que cela fût un acte d' "anti-droit"
Et cela, les êtres humains le font. Souvent. Sur des cas particuliers, comme ici Callas. Ou bien en masse, comme le fît le nazisme.
Car le système nazi lui aussi commit des "meurtres juridiques".
Il convient de reconnaître la normativité juridique du système nazi, étudiée notamment par Johann Chapoutot dans son ouvrage La loi du sang , mais l'expression choisie par Voltaire pour un cas particulier lui est parfaitement adéquate étendu à un système : le nazisme fût un crime juridique total.
____
Lire un récit complet de l'affaire Sirven.
Lire un ouvrage compilant les nombreuses correspondances écrites par Voltaire pour défendre Sirven
Sur la notion de "anti-Droit", v. Frison-Roche, M.-A., Leçon sur Droit positif, Droit naturel, 2014.
22 février 2018
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Malaurie-Vignal, M., Concurrence - Efficacité économique v/ politique de concurrence ? Réflexions à partir du marché du numérique, Contrats Concurrence Consommation n° 2, février 2018, repère 2.
L'article peut être lu par les étudiants de Sciences po via le Drive dans le dossier "MAFR - Régulation & Compliance"
22 février 2018
Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Aranda Vasquez, A., Affaire Generali : la Cour de cassation précise les caractéristiques de l'obligation, in Petites affiches, février 2018, n° 39, pp.12-15.
"L'affaire Generali connaît un nouvel épisode. La Cour de cassation vient préciser les caractéristiques essentielles de l'obligation. Elle revient sur la position de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 juin 2016 (n°15/00317), en décidant que le remboursement du nominal n'est pas une caractéristique essentielle de l'obligation. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire apporte ainsi un heureux éclairage en la matière."
Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier " MAFR- Regulation & Compliance "
31 janvier 2018
Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

Le droit étant solide par la précision des définitions, il convient tout d'abord de distinguer la
De la même façon, il n'est pas évident de repérer qui est "régulateur". Car cela est incontestable pour "l'Autorité des Marchés Financiers" (AMF), cela l'est moins pour l’
Le régulateur est au centre des systèmes de
De fait, les secteurs bancaires et financiers mélangent les deux systèmes, notamment parce que les "entreprises de marchés", sociétés de droit privé, exercent une fonction de
La tendance est ainsi d'appréhender le régulateur bancaire et financier par ses pouvoirs : adoption de normes générales et abstraites, sanctions, médiation, composition, résolution. Mais ne convient-il pas plutôt de définir le Régulateur par sa mission ? Si l'on va dans cette voie et que l'on se détache du statut d'AAI pour ne prendre en considération que la mission, l'on est conduit à distinguer le Régulateur et le Superviseur. Dans cette perspective, le statut de la
Pour commencer, il convient de commencer par le système français, qui repose sur d'une part un "régulateur financier", l'Autorité des marchés financiers", et un superviseur bancaire, l'Autorité de
Lire le plan de la leçon sur le Régulateur financier et le Superviseur bancaire français.
Voir les slides de la leçon sur le Régulateur et le Superviseur bancaire et financier.
Retourner au plan général du cours.
Retourner à la présentation générale du Cours.
Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la
Consulter la bibliographie générale du Cours.
Consulter une première bibliographie ci-dessous sur le Régulateur bancaire et financier.
Aller dans le groupe numérique ouvert aux étudiants inscrits au cours d'amphi.

Mise à jour : 25 octobre 2017 (Rédaction initiale : 27 mai 2016 )
Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La Mondialisation vue par le Droit, document de travail, mai 2017
____
🎤 ce document de travail a dans un premier temps servi de base à un rapport de synthèse proposé dans le colloque organisé par l'Association Henri Capitant, dans les Journées internationale Allemandes sur La Mondialisation.
📝 Il sert dans un second temps de base à l'article paru dans l'ouvrage La Mondialisation.
📝 Dans sa version anglaise, il sert de base à l'article écrit en anglais (avec un résumé en espagnol) à paraître au Brésil dans la Rarb - Revista de Arbitragem e Mediação (Revue d`Arbitrage et Médiation).
____
Dans ce Working Paper, sont insérées des notes, comprenant des développements, des références et des liens vers des travaux et réflexions menés sur le thème de la mondialisation.
Il utilise par insertion le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.
____
► Résumé du document de travail : La mondialisation est un phénomène déroutant pour le juriste. La première chose à faire est d'en prendre la mesure. Une fois celle-ci prise, il est essentiel que l'on s'autorise à en penser quelque chose, voire que l'on s'impose d'en penser quelque chose. Par exemple sur le caractère nouveau ou non du phénomène, ce qui permet dans un second temps de porter une appréciation sur ce qui est en train de se mettre en place. Si en tant que le Droit peut et doit "prétendre" défendre chaque être humain, prétention universelle ayant vocation à faire face au champ mondial des forces, la question suivante - mais secondaire - se formule alors : quid facere ? Rien ? Moins que rien ? ou bien réguler ? Ou bien prétendre encore que le Droit remplisse son office premier qui est de protéger la personne faible, y compris dans le jeu de forces qu'est la mondialisation ?
____
► Lire le document de travail complet⤵️
6 juillet 2017
Conférences

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., D'où vient la compliance ? ; Où va la compliance : la nécessité de construire un véritable Droit de la compliance, in Cour de cassation et École Nationale de la Magistrature, La compliance, la place du droit, la place du magistrat, Grand'chambre de la Cour de cassation, 6 juillet 2017.
Lire l'intégralité du programme.
Accéder au programme sur le site de la Cour de cassation. , permettant l'inscription au colloque.
Un ouvrage à venir prendra appui sur les travaux de ce colloque.
_____
D'où vient la Compliance ?
Lorsqu'on lit les différents travaux afférents à la Compliance, l'on a parfois une impression étrange : si l'on a du mal à comprendre les mécanismes de Compliance, si l'on en vient à dire que l'on ne peut le comprendre qu'au cas par cas, cela tient au fait que la Compliance change d'aspect suivant qu'on est à une époque ou à une autre, dans un continent ou dans un autre, dans une branche du droit ou dans une autre, dans une entreprise ou dans une autre.
A chaque fois, l'on a l'impression de respirer un air différent, de la violence la plus forte exprimée par les États-Unis, comme le fait le FTCA pour la corruption ; mais l'on parlera encore de compliance lorsqu'une entreprise décide d'édicter une charte éthique au nom de sa capacité autorégulatrice. Et l'on ne comprend pas comment est-ce que cela pourrait constituer un ensemble cohérent, si les différentes personnes ne parlent pas la même langue. Cette impression de cacophonie ne semble que s'accroître, chacun semblant se "spécialiser" dans une des voies, sans qu'aucune harmonie ne se dégage.
Si l'on reprend d'une façon plus historique l'évolution, il apparaît que les mécanismes de Compliance ont 4 origines. Quatre origines qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres. Qui ont produit chacune des effets techniques propres, qui perdurent et se superposent. Comment effectivement ne pas en être abasourdi ? Après cette première impression, il faut "dénouer les fils", reconstituer les 4 corpus à la fois cohérents, fondés qui se rattachent d'une façon autonome à chacune des 4 origines.
En effet, la première origine est celle des crises financières américaines, dont la naissance est logée dans la première partie du 20ième siècle dans le dysfonctionnement interne des opérateurs systémiques bancaires qui tiennent les marchés financiers, ce qui a entraîné le pays dans la crise générale. Cela a produit un premier corpus.
La deuxième origine tient en Europe après la seconde guerre mondiale dans l'idée que le Droit doit régner et que toute entreprise doit, à propos de toute règle de Droit, donner à voir en Ex Ante qu'elle le respecte. Cette passion du Droit fait passer l'Ex post du Droit (sanction des violations) en Ex Ante (manifestation du respect), certaines entreprises pouvant y avoir intérêt pour montrer leur amour du Droit et de la Vertu. Cela a produit un deuxième corpus, notamment en Droit de la concurrence.
La troisième origine intervient dans les années 1990 dans le constat fait par les États de leur propre faiblesse et de la puissance d'entreprises globales, en internalisant en leur sein des "buts monumentaux", ce mouvement étant la réponse des autorités publiques au phénomène de mondialisation. Cela ne concerne que les entreprises globales.
La quatrième origine est dans la volonté exprimée par un entreprise, qui peut être concernée par les trois premiers mouvements mais ne l'être pas, de se soucier d'autre chose que la réalisation de profit, cette prise en charge d'autrui, même lointain, faisant se rejoindre la Compliance et la Responsabilité sociale des entreprises.
Consulter les slides servant de base à l'intervention.
_____
Où va la Compliance ?
s
11 mai 2017
Conférences

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Le contrat est-il l'instrument optimal de la RSE ?, in Trébulle, F.-G. (modérateur), Les instruments de la RSE : le contrat, cycle de conférences organisé par la Cour de cassation et les Universités Paris-Dauphine, Paris VIII, Paris I, Cour de cassation, 11 mai 2017.
Consulter les slides ayant servi de base à la conférence.
Lire le programme de la conférence sur le site de la Cour de cassation.
Lire le programme de l'ensemble du cycle dans lequel la conférence s'insère.
La Responsabilité Sociale des Entreprises appartient au Droit économique. Elle entre donc dans sa logique d'efficacité, conduisant à appréhender tout mécanisme juridique comme un instrument, le contrat comme les autres. Cela ne veut pas dire que tout ne soit qu'instrument, au contraire. Le Droit économique, lorsqu'il prend la forme du Droit de la Régulation, place les principes dans les buts poursuivis. C'est là, dans ces principes qu'il peut rencontrer la RSE si les buts sont les mêmes.
Au regard de ces buts, tout est instrument. A l'échelle des buts qui sont "monumentaux"
Les lois nouvelles, comme la loi Sapin 2 ou la loi établissant un "devoir de vigilance" aux contours si incertains", peuvent n'utiliser le contrat que comme un véhicule pour que les obligations légales soient exécutées par l'entreprise, le Droit de la Régulation internalisant ainsi ses buts dans l'entreprise
Mais le contrat peut aussi être choisi comme instrument par l'entreprise en ce qu'elle poursuit les mêmes buts d'un intérêt général mondial
En cela, le contrat converge vers ce qui est en train de se construire : un Droit de la Compliance.
On this notion of "monumental goal", see , V. Frison-Roche, M-A., Le Droit de la Compliance, 2016 ; From Regulation Law to Compliance Law, 2017.
Pour une démonstration d'ensemble, v. Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017.
Sur la notion d'intérêt général mondial, voire de service public mondial, v. Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017.
18 janvier 2017
Base Documentaire
Référence complète : Gaudemet, Y., La régulation économique ou la dilution des normes, Revue de droit public, p.23 et s.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive de Sciences po dans le dossier "MAFR - Régulation"
Dans cet article critique, Yves Gaudemet affirme que le Droit de la Régulation économique illustre le phénomène plus général de la "dilution des normes, phénomène auquel est consacré le dossier ici consacré par la Revue de Droit public au "Désordre normatif".
Il estime que le Droit de la Régulation économique l'illustre en ce qu'il fait subir aux normes une sorte de "dilution".
Cela tient tout d'abord au vocabulaire, où règne ce qu'il qualifie le "désordre des mots", affectant la sécurité juridique. Le "Droit souple" est le moyen d'une "régulation bavarde", faite de proclamations, de recommandations et de lignes directrices.
Le juge devient alors le "régulateur ultime", puisqu'il applique à ce Droit souple un contrôle de proportionnalité.
Les "actes de régulation" eux-mêmes sont dilués entre eux, puisque les Autorités peuvent les utiliser d'une façon alternée, les pouvoirs s'appuyant les uns sur les autres, notamment le pouvoir de sanction, avec une "utilisation indifférenciée par les autorités de régulation des nombreux outils qu'elles ont à leur disposition", le tout s'appuyant le plus souvent sur un pouvoir d'auto-saisine. Par exemple l'auto-saisine pour émettre un avis. Yves Gaudemet cite l'ARCEP qui pour prendre une décision s'appuie sur de futures lignes directrices ....
L'auteur reprend à son compte les reproches formulés en 2010 par le Rapport Dosière-Vaneste sur la production normative excessive des Autorités de Régulation, et le Rapport du Conseil d'État de 2001 sur les AAI qui leur reproche "l’ambiguïté magique" de leur activité.
Yves Gaudemet propose de ramener de ramener le champs de la Régulation dans la "langue du Droit" et de soumettre son contrôle aux "qualifications du Droit".
Dans la seconde partie de l'article, qui confronte la Régulation économique et l'Ordre du Droit, Yves Gaudemet attend de la jurisprudence, ici principalement celle du Conseil d'État qu'elle discipline cette régulation, telle qu'exprimée par les arrêts du 21 mars 2016, Fairwesta et Numericable.
De cette façon là, les Autorités de Régulation deviennent responsable de l'exercice de leur pouvoir normatif d'émettre du Droit souple.
5 janvier 2017
Blog

Le juge a le pouvoir de "qualifier", c'est-à-dire de donner à une situation de fait ou de droit sa nature, quelle que soit les termes qu'ont utilisé les personnes. Cet office du juge est exprimé par l'article 12 du Code de procédure.
Ainsi, les réseaux sociaux utilisent le terme "amis".
Ce terme a des conséquences juridiques très importantes. En effet, en droit les relations amicales supposent par exemple un désintéressement, l'ami travaillant gratuitement au bénéfice de l'autre. Mais déjà la Cour d'appel de Paris à laquelle FaceBook avait raconté cette fable, se présentant comme le constructeur désintéressé uniquement soucieux de permettre aux internautes de nouer des liens d'amitié, avait répondu en février 2016 que le souci premier de cette entreprise florissante était bien plutôt le profit. Comme on le sait, le profit et la gratuité font très bon ménage.
De la même façon, une relation amicale suppose un souci que l'on a de l'autre, une absence de distance, une certaine chaleur. En cela, une relation amicale est toujours partiale.
C'est pourquoi logiquement lorsqu'un avocat fût l'objet d'une procédure disciplinaire devant le conseil de l'ordre, il demanda la récusation de certains de ces confrères siégeant dans la formation de jugement en évoquant le fait qu'ils étaient "amis" sur FaceBook, ce qui entacherait leur impartialité, les instances disciplinaires étant gouvernées par le principe subjectif et objectif d'impartialité.
Par un arrêt du 5 janvier 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, comme la Cour d'appel, refuse de suivre un tel raisonnement.
En effet, celui-ci n'aurait de sens que si en soi les personnes en contact sur un réseau social étaient effectivement des "amis". Mais ils ne le sont pas. Comme le reprend la Cour de cassation dans la motivation de la Cour d'appel, "le terme d’ « ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession".
Ce sont des personnes qui ont des choses en commun, ici une profession, mais cela peut être autre chose, éventuellement un sujet de dispute, même si les études récentes montrent que les personnes se rejoignent plutôt sur des opinions communes.
Mais il ne s'agit tout d'abord que d'un renvoie à une "appréciation souveraine" des faits. Ainsi, si la personne avait apporté la preuve d'une opinion partagée sur le réseau montrant un préjugé - même abstraitement formulé - lui étant défavorable, le résultat aurait été différent. De la même façon, comme cela est souvent le cas, des liens personnels se nouent, par des photos plus personnelles, des échanges plus privés, etc., alors le résultat aurait été différents.
Ainsi, les contacts sur un réseau sociaux ne sont pas en soi des "amis", mais ils peuvent l'être ou le devenir. L'enjeu est donc probatoire. Montrer un lien virtuel n'est pas suffisant, mais c'est une première étape, qui peut mener à la démonstration, qui continue de reposer sur le demandeur à l'instance, d'un lien personnel et désintéressé, ce qui renvoie à la définition juridique de l'amitié, excluant notamment l'impartialité.
Mise à jour : 30 novembre 2016 (Rédaction initiale : 29 septembre 2016 )
Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Droit de la compliance", D.2016, Chron., pp.1871-1874.
____
► Résumé de l'article : les contraintes pesant sur les entreprises au titre de la compliance se multiplient et s'alourdissent. Mais la notion est contradictoire, incertaine, "étrange", l'expression de "conformité" n'étant qu'une translation.
La compliance apparaît aujourd'hui comme l'internalisation mondiale d'une régulation publique, souvent conçue aux États-Unis, dans les entreprises, transformées en agents d'effectivité de buts mondiaux monumentaux : équité concurrentielle, lutte contre le terrorisme ou des États jugés indignes (embargos).
Plutôt que d'emprunter des solutions éparses, il est essentiel de construire un "Droit de la compliance", proprement européen, à l'aune duquel chacun devra rendre compte. Cette nouvelle branche du Droit est construite téléologiquement sur ses Buts Monumentaux. Elle est portée par les entreprises cruciales. Le Juge y est au centre.
____
____
🚧lire le document de travail sur la base duquel l'article a été rédigé.
____
Lire la présentation du cycle de conférences organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) en 2016 autour de la Compliance.
L'ouvrage en résultant, Régulation, Supervision, Compliance a été publié dans la série Régulations & Compliance co-éditée par le JoRC et les Editions Dalloz.
________
19 novembre 2016
Interviews

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Pour réguler l'espace numérique : la solution de "l'interrégulation" !, entretien, Revue Communication Commerce Électronique, nov. 2016, p.8.
Cet interview a été donné à l'occasion de l'ouvrage Internet, espace d'interrégulation
Il aborde trois questions :
- la définition de l'interrégulation,
- les justifications de l'interrégulation en matière numérique
- les conditions de l'effectivité de l'interrégulation en matière numérique
18 novembre 2016
Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse et propos conclusifs, in Université de Bordeaux, colloque organisé par l’Institut Léon Duguit et le Forum Montesquieu, Régulation et jeux d’argent et de hasard. Vers d’autres formes de régulation en matière de jeux d’argent et de hasard ?, Bordeaux, 17 et 18 novembre 2016.
Cette intervention se situe au terme des deux journées et plus particulièrement de la seconde, qui a posé que nous étions dans une situation "postmoderne" et que nous allions vers de "nouvelles formes" de régulation des jeux.
Ces travaux déboucheront sur un ouvrage, publié dans la collection "Droit et Économie", chez Lextenso - LGDJ. , au cours du premier semestre 2017.
Consulter les slides, élaborées au fur et à mesure de l'audition des interventions.
Les différentes contributions ont mis en valeur les remises fondamentales et salutaires de l'évolution à la fois technique et sociale du phénomène des jeux : tout s'ouvre, tout se remet en cause, tout est possible. Tout doit donc être réfléchi.
Il en ressort notamment trois grandes questions.
Le Droit de la Régulation exprime un rapport nouveau entre les règles et les faits, rapport tendu entre l’Économie, le Droit et le Politique, aucun ne pouvant d'une façon définitive ni exclure ni même dominer les deux autres. Si l'ouverture de l'espace virtuel bouleverse les jeux plus encore que d'autres activités humaines - car l'on s'amuse tant dans le numérique ! -, ce rapport et cette tension demeure. Mais les prétentions varient parce que si l’État prétendait naguère être le maître, c'est davantage les opérateurs économiques, arguant à la fois de l'ordinaire concurrentiel et du fait technologique, montré comme prouesse, qui prétendent aujourd'hui être les maîtres, le droit allant de l'un à l'autre, l'éthique ayant bien du mal à trouver son chemin. Il faut dire que morale, jeu et plaisir ont toujours eu du mal à converser.
C'est donc la question de la spécificité des jeux, entraînés vers un destin banal qui est aujourd'hui posée (I). Sur une sorte de surréaction, les jeux apparaissent dans leurs traits contraires renforcés, à la fois la dimension financière plus que jamais présente, peut-être devenue première, alors que la dimension politique demeure revendiquée (II). La question première est alors celle de l'avenir : allons-nous vers un mécanisme ordinaire de plaisir et de désir de s'amuser, s'amuser à tout prix, ou bien la régulation a-t-elle pour objet de brider cette tendance naturelle d'offrir à chacun l'objet de son désir de jeu, ou bien la régulation ne peut-elle au contraire avoir pour ambition d'offrir à travers le jeu plus que le jeu, par exemple l'éducation ? (IIII).
Consulter le working paper en cours de rédaction, sur lequel sera élaboré l'article dans l'ouvrage à paraître.
11 octobre 2016
Base Documentaire
Référence complète : Martineau-Bourgnineaud, V., La légalisation de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) au service du dialogue social : idéologie ou utopie ? , Petites Affiches, 11 octobre 2016, p.6-11.
L'auteur relève que l'expression de "responsabilité sociale de l'entreprise" est peu définie. La Commission Européenne y voit la "responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société", les salariés faisant partie de ses "parties prenantes", et la norme ISO 26000 de 2010 sur la gouvernance intégrant les relations de travail.
La RSE a pénétré le Droit par la loi de 2001 sur les "nouvelles régulations économiques", tandis que la loi de 2010 réformant le droit des sociétés cotées et important le principe "appliquer ou expliquer" oblige à inclure dans le rapport annuel de gestion des données sociales et environnementales. En cela ce rapport RSE promeut le dialogue social.
L'auteur pose donc que "cette nouvelle idéologie" est entrée dans le Droit.
Cette "consécration d'une idéologie" consiste à "créer un cadre réglementaire qui place l'homme au cœur des préoccupations de l'entreprise", en changeant pour cela sa gouvernance. En obligeant à la diversité dans les conseils d'administration, notamment leur féminisation et la présence des salariés. Le dialogue social prend la forme aussi de la participation des institutions représentatives du personnel dans le "reporting social et environnemental" et leur participation sur la stratégie de l'entreprise, puisque les discussions à ce propos prennent pour base les reportings précités. On constate cependant que les comités d'entreprise sont peu associés.
C'est sans doute pour cela que l'auteur considère que la RSE comme dialogue social relève plutôt d'une "utopie"...
Le dialogue social participe pourtant de la performance économique de l'entreprise et la loi dite Rebsamen du 17 août 2015 s'en prévaut, la loi du 8 août 2016, dite El Khomri inclut dans la "base de données économiques et sociales" et le taux de féminisation des conseils d'administration et le nombre d'accords collectifs.
Mais l'auteur estime qu'à mettre dans le dialogue social des éléments qui n'en relèvent pas - comme l'environnement ou le sociétal - on affaiblit le dialogue social.
L'auteur conclut son article d'une façon très critique en ces termes :
"La RSE à l'épreuve du droit nus enseigne que l'élément matériel de la RSE, les obligations légales (reporting, diversité des conseils d'administration, régle complain or explain...), et l'élément psychologique, son caractère volontaire impulsé par les dirigeants de l'entreprise sont indissociables. Alors que la RSE entend mettre l'humain au coeur des préoccupations de l'entreprise, on constate qu'il y a complète dissociation entre le discours affiché et la réalité économique et sociale. ..... cette RSE légalisée devient un instrument sophistique au service de ce but exclusif en permettant aux entreprises de se draper de vertus dans le but d'acheter la paix sociale, les conflits sociaux étant l'ennemi juré de la productivité.".
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article en accédant via le drive au dossier "MAFR - Régulation"
22 avril 2016
Publications
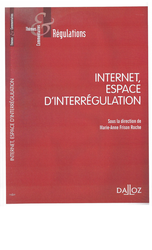
► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Penser le monde à partir de la notion de "donnée", in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Internet, espace d'interrégulation, série "Régulation", 2016, p.7-16.
____
► Résumé de l'article : Le Droit est une reconstitution du monde à travers des définitions et des catégories, exprimées par des mots, auxquels on impute des corps de règles. Il y a toujours un part d’invention dans le Droit articulée à un part de fidélité au monde concret qu’il retranscrit, combinaison permettant au Droit de régir celui-ci. Le Droit est mis en difficulté par ce que le terme de « donnée », assez nouveau, n’est pas aisé à définir. Le fait qu’on le formule étrangement en latin pour montrer qu’il y a pluralité, les data, avant de lui associer un adjectif anglais lorsqu’il y a beaucoup, les big data, ne nous avance pas plus sur ce qu’est une "donnée". Or, le Droit est un art pratique qui ne fonctionne bien que s'il manie des catégories dont on maîtrise la définition. C'est pourquoi dans un premier temps il convient de reconnaître les incertitudes de la notions mêmes de "données" (I), pour s'orienter dans un second temps vers ce qu'est une donnée, à savoir une valeur "pure" dans une société de consommation d'information (II).
____
____
📝Cet article est corrélé à un autre article publié dans le même ouvrage : Les conséquences régulatoires d'un monde repensé à partir de la notion de "donnée".
_________
Cet article s'appuie sur un working paper comprenant des liens hypertextes et des notes s'ouvrant par pop-up.

Mise à jour : 12 mars 2016 (Rédaction initiale : 7 novembre 2015 )
Publications
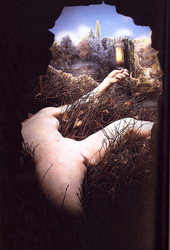
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Repenser le monde à partir de la notion de "donnée", Document de travail, novembre 2015.
____
🎤Ce working paper a servi de base à une intervention à un colloque organisé par le Journal of Regulation, ayant pour thème : Internet, espace d'interrégulation.
____
🚧 Ce document de travail est articulé avec un second Document de travail qui, tirant les conséquences de celui-ci, élabore les conséquences régulatoires d'un monde repensé à partir de la notion de donnée.
____
📝 Il a servi de base à l'article publié dans l'ouvrage 📕Internet, espace d'interrégulation, édité dans la Série Régulations, aux Éditions Dalloz.
____
► Résumé du document de travail : il a pour objet de réfléchir sur le monde actuel, qui est en train de se reconstruire à partir de la notion de donnée". Le Droit est une reconstitution du monde à travers des définitions et des catégories, exprimées par des mots, auxquels on impute des corps de règles. Il y a toujours un part d’invention dans le Droit articulée à un part de fidélité au monde concret qu’il retranscrit, combinaison permettant au Droit de régir celui-ci.
Le Droit est mis en difficulté par ce que le terme de « donnée », assez nouveau, n’est pas aisé à définir. Le fait qu’on le formule étrangement en latin pour montrer qu’il y a pluralité, les data, avant de lui associer un adjectif anglais lorsqu’il y a beaucoup, les big data, ne nous avance pas plus sur ce qu’est une "donnée". Or, le Droit est un art pratique qui ne fonctionne bien que s'il manie des catégories dont on maîtrise la définition. C'est pourquoi dans un premier temps il convient de reconnaître les incertitudes de la notion mêmes de "données" (I), pour s'orienter dans un second temps vers ce qu'est une donnée, à savoir une valeur "pure" dans une société de consommation d'information (II).
____
🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
2 février 2016
Enseignements : Droit commun de la Régulation

23 décembre 2015
Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les différentes natures de l'ordre public économique, in Archives de philosophie du droit, L'ordre public, t.58, Dalloz, 2015, p.105-128.
Cet article vient à la suite d'une conférence et s'appuie sur un working paper dans lequel ont été insérées les références et les liens hypertextes.
Renvoyant au rapport de force entre le Droit et l'Économie, l'ordre public économique a plusieurs natures. En premier lieu, l'on doit distinguer l'ordre public "gardiens des marchés", de l'ordre public "promoteur des marchés", de l'ordre public "architecte des marchés". En second lieu, l'on doit distinguer l'ordre public de "constitution des marchés" de l'ordre public posant des "octrois aux marchés". Celui-ci est premier, puisqu'il empêche que des objets de désir, objets naturels d'échange, deviennent objets de marché. Cet ordre public économique qui brise les élans de désir est hautement politique. Si l'on ne l'admet pas, alors le Droit n'est plus que l'agent d'effectivité du système économique, lequel engendre une société d'ajustement des désirs individuels.