12 décembre 2019
Conférences

Référence : Frison-Roche, M.-A., La sanction comme incitation dans les techniques de compliance, in Faculté de droit de l'Université Toulouse-Capitole, Journal of Regulation & Compliance (JoRc),Les incitations, outils de la Compliance, 12 décembre 2019.
- Lire la présentation générale du cycle de conférences, consacré au thème Les outils de la Compliance
- Lire la présentation de l'ouvrage qui sera publié ultérieurement
- Lire la présentation de la collection Régulations & Compliance dans laquelle l'ouvrage sera publié
Résumé de la conférence
La Compliance ne se réduit pas à une méthode d'efficacité du Droit. Sinon il convient de l'appliquer à toutes les branches du Droit, ce que l'on ne fait pas. Mais même substantiellement défini, en ce qu'il est un prolongement du Droit de la Régulation, internalisé dans des "opérateurs cruciaux", délié ainsi de la détermination préalable d'un secteur, il conserve la nature téléologique de celui-ci. Le Droit qui est aussi un outil ne devient plus alors que cela, puisque la norme est placée dans le but.
Le renversement du traitement juridique de la matière pénale par la théorie appliquée des incitations
On observe très souvent que le Droit de la Compliance a pour cœur des sanctions, auxquelles Droit, dans son exercice inhérent de qualifié, donne le nom qui correspond à la chose : la "matière pénale". Logiquement, comme pour le droit pénal, qui n'est que la forme juridique de la matière pénale, le régime juridique devrait être le même que le Droit pénal. Mais il n'en est rien en raison de l'application de la théorie des incitations. De cela, les juristes et les juges n'en reviennent pas et c'est pourquoi il y mettent des limites que les tenants de la théorie des incitations n'admettent pas. Cela ne tient pas de la simple technique, de tel ou tel cas, mais de l'opposition de fond. En effet, pour le Droit pénal, celui-ci a vocation à être "autonome" dans le système juridique, c'est-à-dire développe des notions et des régimes qui lui sont propres parce qu'il est une exception légitime au principe de liberté auquel il rend par essence hommage et ne saurait se définir autrement, tandis qu'insérée dans la notion "d'incitation" la technique de la sanction n'intègre en rien cela et se contente d'emprunter à l'efficacité de la dureté pénale pour rendre efficace la règle sous-jacente ainsi dotée, la sanction étant ainsi et par un semblable effet de nature dans une parfaite dépendance. Il y a donc à première vue opposition de fond entre "sanction" et "incitation" alors qu'intuitivement frapper fort est si "commode et dissuasif" lorsqu'on veut obtenir d'une entreprise tel ou tel comportement..
En effet, certes la perspective d'une sanction en Ex Post en cas de manquement est la meilleure incitation à l'obéissance en Ex Ante à la norme d'interdiction et de prescription. C'est pourquoi le droit financier le plus libéral est également le plus répressif, l'analyse économique du droit conduisant à calculer des normes qui amènent l'agent à ne pas avoir intérêt à commettre un manquement. A l'obéissance se substitue l'intérêt. Le Droit de la concurrence et le Droit des marchés financiers en sont à ce point familiers que certains ont douté de la juridicité.
Mais cela produit aussi des chocs en retour très importants, dans une méconnaissance assurée des principes, pourtant de valeur constitutionnelle, constituant la base de la matière pénale. On peut en dresser la liste :
- des sanctions qui ne sont plus l'exception mais l'ordinaire, le cœur dans les régulations des marchés et le droit des entreprises supervisées, contraire aux principes économiques libéraux
- des sanctions d'autant plus élevées qu'elles sont négociables en échange de ce que veut la puissance publique : ainsi la pénalisation n'exclut en rien la contractualisation, au contraire elle en est un sous-outil entre les mains de l'autorité administrative ou politique de poursuite
- des sanctions qui sont conçues indépendamment des principes procéduraux, le couple "droit pénal/procédure pénale" perdant son intimité
- des sanctions qui sont échangées contre des preuves (programmes de clémence, qui sont des outils de Compliance)
- des sanctions qui ne sont pas arrêtées par le temps : application immédiate et rétroactivité dans le temps
- des sanctions qui ne sont pas arrêtées par l'espace : extraterritorialité de l'application des sanctions
- des sanctions contre lesquelles, la matière pénale étant indissociable de la façon de les appliquer ("Procédure pénale") les entités aptes à en répondre devant justifier leur comportement et non être présumées conformes dans celui-ci
- des sanctions qui se cumulent pour un même fait si cela est efficace ;
- l'abandon des notions classiques d'intentionnalité et de causalité, puisque le raisonnement est fonctionnel et non causal.
Cela est-il admissible ?
Non car en premier lieu dans une conception classique du Droit pénal c'est une succession de principes constitutionnels qui sont méconnus et les juges vont bloquer un Droit de la Compliance dont le seul principe serait l'efficacité : le Droit ne peut être un seul "outil d'efficacité", sauf à n'être plus le Droit. Le Droit pénal est un outil d'inefficacité parce qu'il se définit comme une exception légitime à la liberté des êtres humains et donc le gardien de ce principe de liberté, ce qui est étranger à la théorie des incitations, mais lui est supérieur et bloque les effets déroulés par celle-ci.
Non car en second lieu dans une conception trop étendue de la Compliance, consistant à l'appliquer à toutes les règles dont on voudrait qu'elles soient effectives parce que celui-ci qui les a émises le veut, ce qui voudrait pour toutes les règles, même celles qui ne sont pas d'ordre public. Dans une telle "passion pour la Réglementation" mettant fin au libéralisme et au Droit, les sanctions permettent à une Autorité publique d'imposer en Ex Ante avec l'accord des intéressés ce qu'il veut, comme on peut le voir en Asie, la répression passant en Ex Ante se transformant en rating et obtention volontaire d’obéissance pour toute prescription.
Oui si l'on définit correctement le Droit de la Compliance dans un seul lien avec des "buts monumentaux" qui seuls peuvent justifier la violence des mécanismes de sanction, en tant qu'il est le prolongement du Droit de la Régulation. La Régulation de l'économie est plus que jamais nécessaire, alors que les Etats n'ont plus de prise. Par l'internalisation dans les entreprises, si des "buts monumentaux" sont visés et contrôlés, alors le caractère restrictif de la matière pénale passe de l'outil au but : seuls les buts monumentaux peuvent justifier tous les effets précédemment décrits, mais ils le justifient.
L'enjeu est donc de redessiner le principe restrictif des sanctions non plus en celles-ci mais dans le but de Compliance servi par celles-ci. Par ce passage de la conservation de la nature restrictive de la sanction, non plus dans l'outil-même de la sanction mais dans le but servi par celle-ci. Non pas n'importe quelle règle, comme dans certains pays, non pas toutes les règles de ce que l'on appelle d'une façon trop extensive la Compliance, qui est juste le "fait d'obéir aux normes applicables".
Ainsi et par exemple, l'application extraterritoriale de normes nationales répressives adoptées dans un seul but national (embargo) est inadmissible et doit être rejetée par les Tribunaux, alors que cette même application extraterritoriale de normes pour lutter contre le blanchiment d'argent est admissible et pratiquée par tous. Suivant la nature du risque combattu, le terrorisme par exemple, le régime de la sanction est ou n'est pas légitime.
D'une façon plus générale, les "buts monumentaux" qui donnent au Droit de la Compliance sa définition substantielle, alors que beaucoup réduisent encore la Compliance à une simple méthode d'efficacité, voire n'y voient rien de juridique, permettent de distinguer là où la sanction doit être un outil plus ou moins violent pour atteindre le but en raison de la légitimité de celui-ci, du phénomène caché qu'il s'agit de combattre (par exemple terrorisme ou blanchiment) ou du caractère global (par exemple risque environnemental).
____________
28 novembre 2019
Conférences

Référence : Frison-Roche, M.-A., Présentation générale du cycle de conférences sur Les outils de la Compliance et "Théorie générale de la cartographie des risques", in Département d'Economie de Sciences Po & Journal of Regulation & Compliance (JoRC), La cartographie des risques, outil de la Compliance, 28 novembre 2019, Sciences Po, Paris.
- Lire la présentation générale du cycle de conférences, consacré au thème Les outils de la Compliance
- Lire la présentation de l'ouvrage qui sera publié ultérieurement
- Lire la présentation de la collection Régulations & Compliance dans laquelle l'ouvrage sera publié
Résumé de la conférence
La cartographie des risques est à la fois centrale dans les obligations ou pratiques des entreprises et très peu appréhendée par le Droit. Elle est peu expressément visée par celui-ci, en dehors des lois spéciales dites "Sapin 2" et "Vigilance". Mais si nous sommes hors de ce champ, parce qu'il n'y a qu'une description et non pas une définition, encore moins une notion, l'on ne sait quel régime juridique appliquer à l'action de cartographier les risques. Il est donc utile, voire impérieux, de cerner la notion juridique de l'action de cartographier les risques. En partant sur ce qui est encore le terrain le plus sûr, à savoir ces deux lois spéciales, pour aller vers des terrains juridiques moins assurés, comme la doctrine des Autorités ou les engagements des entreprises, voire les certifications ISO obtenues en la matière. A travers quelques décisions de justice et par le raisonnement juridique se dessine alors une notion juridique de l'action de cartographier les risques.
Il convient de procéder en 5 temps (le document de travail suit quant à lui une autre démarche). La première, prenant directement appui sur les deux lois disponibles, appréhende l'action de cartographier lorsqu'elle vient en exécution d'une obligation légale spéciale. La décision rendue en 2019 par la Commission des sanctions de l'Agence Française Anticorruption dessine les jeux probatoires quant à la démonstration de l'exécution de l'obligation et le système probatoire peut être étendu. De la même façon la décision du Conseil constitutionnel en 2017 à propos de la Loi "Vigilance" montre qu'un mécanisme visé comme une "modalité" est légitime au regard du but, qui est concernant cet outil-là l'établissement d'une responsabilité pour autrui. C'est donc le souci du sort d'autrui qui peut être visé.
Le deuxième thème vise l'action de cartographier les risques comme un fait de bonne gestion d'une entreprise, alors qu'elle n'y est pas contrainte. Ce fait constitue un paradoxe parce que l'Autorité de régulation et le Juge peuvent, lorsque le comportement qu'il s'agissait de prévenir advient, par exemple un abus de marché ou un comportement anticoncurrentiel, soit le qualifier comme une circonstance aggravante, soit comme une circonstance atténuante. La considération de la théorie des incitations devrait conduire à adopter la solution américaine, c'est-à-dire la qualification d'une cartographie effective comme un fait atténuant. La jurisprudence européenne n'est pas encore fixée en matière de Compliance concurrentielle.
Le troisième thème vise l'action de cartographie menée par une entité qui de fait exerce un pouvoir sur un tiers. Car la cartographie est aussi bien une obligation qu'un pouvoir, éventuellement sur un tiers. Le Conseil d'État en 2017 a qualifié la cartographie des risques comme un acte faisant grief, mais le faisant légitimement, puisqu'il s'agissait de prévenir les incendies de forêts. Cette solution basée sur la téléologie attachée au Droit de la Compliance peut être transposée dans d'autres domaines.
Allant plus loin, l'on peut songer à transformer cette action du statut de fait au statut d'engagement juridique de la part de l'entreprise, si elle repère ainsi des risques pour les tiers. Elle rendrait ainsi les tiers créanciers du droit d'être en situation de mesurer les risques qui pèsent sur eux. La cartographie des risques ferait ainsi partie d'un engagement unilatéral plus général de la part d'entreprises puissantes sachant l'existence de risques pour les tiers de mettre ceux-ci en mesure d'en connaître la nature et l'ampleur. Si cette responsabilité Ex Ante (caractéristique du Droit de la Compliance) est remplie, alors la responsabilité Ex Post de l'entreprise ne pourrait plus être retenue. C'est l'enjeu en cours du procès Johnson & Johnson (jugement de 2019), en matière de compliance médicale. Car si l'on peut soutenir qu'il existe, à travers cette sorte de cartographie, des risques qu'est la posologie un "droit subjectif à être inquiété sur les risques liés à la prise du médicament", le patient demeure libre dans l'usage de celui-ci. La question de savoir si l'éducation des tiers est incluse dans la cartographie, puisque l'alerte est déjà incluse dans celle-ci, est une question ouverte. Pour l'instant, la réponse est négative.
En effet et dans un cinquième temps, apparaît la définition libérale du Droit de la Compliance à travers l'appréhension que le Droit doit faire de la cartographie des risques. Au-delà de l'acte rationnel qu'a toute personne de contrôler ses risques pour son propre intérêt, en prévenant les effets dommageables pour ça de la cristallisation du risque en fait avéré, il s'agit de préserver un intérêt extérieur pour la préservation duquel le Droit doit intervenir car le sujet de droit, notamment l'entreprise aura moins tendance à en avoir souci.
Par l'empreinte du Droit, la cartographie des risques exprime alors le souci d'un intérêt externe, soit d'un système, soit d'un tiers. Mais cette prise en charge en Ex Ante implique de force (Sapin 2, Vigilance, obligation d'information du marché financier) ou de gré (responsabilité sociétale, engagement éthique, adoption de normes a-financières) ne porte que sur l'information, sa constitution, son intelligibilité et sa hiérarchisation. Ensuite c'est aux acteurs exposés aux risques, mis en mesure de comprendre en Ex Ante l'ampleur en ce qui les concerne, soit l'entité elle-même, soit les tiers, de choisir de les courir au non.
- Consulter les deux jeux de slides servant de support à la conférence :
- Slides servant de support à la présentation générale du cycle de conférences, dont cette manifestation constitue la conférence inaugurale
- Slides servant de support à la présentation de la contribution "Théorie juridique de la cartographie des risques".
______
27 septembre 2019
Conférences

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Les solutions offertes par le Droit de la Compliance pour lutter effectivement contre les contrefaçons de masse, in Colloque de l'Association des Praticiens du Droit Droit des Marques et des Modèles (APRAM), La contrefaçon de masse : va-t-on un jour réussi à y mettre un frein ? Quelques nouvelles pistes de réflexion, 27 septembre 2019.
Lire le programme général du colloque.
L'intervention dans ce colloque est construite notamment à partir du rapport remis au Gouvernement et publié en juillet 2019 : L'apport du Droit de la Compliance dans la Gouvernance d'Internet.
Elle est également contruite sur la participation à la prochaine édition, à paraître en octobre 2019 des Grands Arrêts de la propriété intellectuelle par une nouvelle rubrique : "Le maniement de la propriété intellectuelle comme outil de régulation et de compliance". Cette publication est basée sur un Working Paper : The use of Intellectuel Property as a tool for Regulatory and Compliance Perspectives.
Pour des travaux plus anciens, liant Propriété Intellectuelle, Régulation et Compliance, v. par exemple : Droit et Economie de la propriété intellectuelle.
Résumé. Dans un colloque consacré aux moyens nouveaux pour réagir à la "contrefaçon de masse", l'idée ici est de partir du constat d'un accroissement de l'ineffectivité et de l'inefficacité des droits de propriété intellectuelle - et donc du Droit de la propriété intellectuelle. Le Droit étant un art pratique, ce n'est pas un simple inconvénient, c'est une question centrale. L'on peut y pallier en améliorant les procédés juridiques Ex Post, mais l'on peut songer à trouver des mécanismes Ex Ante. Le Droit de la Régulation est Ex Ante, mais le numérique n'est pas un secteur. Une direction prometteur est donc le Droit de la Compliance, en ce qu'il est à la fois Ex Ante et non-sectoriel. L'intervention montre le fonctionnement déjà en linéament du Droit de la Compliance et la façon dont celui-ci pourrait s'appliquer pour que ces droits subjectifs-là soient efficacement protégés dans un monde numérique, qui est désormais le nôtre, et qui de fait a les moyens de les ignorer.
Consulter les slides ayant servi de base à la conférence.
14 mai 2019
Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., participation à la table-ronde L'officier public ministériel est-il soluble dans la blockchain?, conférence-débat organisée par Le Club du Droit & le Conseil supérieur du Notariat, 14 mai 2019, Paris.
Consulter la présentation générale du colloque.
Consulter le document de travail sur la base duquel l'intervention a été faite.
Lire le compte-rendu qui en a été fait dans la presse.
Dans cette table-ronde, un professeur d'économie expose la dimension technologique et économique de la blockchain.
Puis est abordée la dimension juridique, dont l'exposé m'était plus particulièrement confié.
_____
A ce titre, après avoir replacé la question technique dans ce que doit garder le Droit, à savoir la distinction entre la Personne et les choses, ce que la technologie présentée aujourd'hui comme un ensemble de choses "intelligentes" et "décidantes" remettant en cause...., l'intervention porte sur 4 points (qui sont développés dans le document de travail).
En premier lieu, avant de porter une appréciation sur ce qui est adéquat et sur l'avenir il faut distinguer les fonctions techniques de conservation des actes, de duplication des actes et d'élaboration des actes, la distinction entre negotium et instrumentum n'étant en rien effacée par la technologie des blockchains.
En deuxième lieu, dès l'instant qu'il y a une altération substantielle de l'acte instrumentaire parce qu'un nouveau negotium a eu lieu, parce que les mentions doivent mesurer la reproduction de la réalité de ce qui fut décidé par les parties, l'on n'est plus dans l'acte de conserver et de dupliquer à l'identique, mais dans l'acte d'élaboration. Or, dans l'acte de conservation et de duplication, la blockchain peut être un atout technologique très précieux, en ce qu'à supposer sa fiabilité acquise, l'erreur étant exclue, c'est comme si l'on pouvait produire des originaux indéfiniment. La fiabilité est telle que la distinction entre original et copie n'aurait plus lieu d'être. Mais pour l'élaboration de l'instrumentum au regard du negotium , comment une machine pourrait-elle "dresser" un acte, c'est-à-dire en vérifier son rapport d'exactitude par rapport à la réalité ? Elle ne le peut pas. Seul un être humain le met, l'Etat ayant "déconcentré" son pouvoir de dresser uniléralement des actes (en cela, les notaires sont issus de la même idée de déconcentration....) en exigeant qu'ils vérifient la conformité à la réalité pour que l'incontestabilité soit ensuite attachée aux mentions.
En troisième lieu, il apparaît alors que la blockain est un outil de conservation et de duplication, mais que l'intermédiation d'un tiers de confiance humain vérifiant l'exactitude des mentions est nécessaire si l'on veut par sécurité que ce qui est dit dans l'acte écrit, puis conservé, puis dupliqué, soit la reproduction de la réalité. S'opère alors un choix de politique économique, souvent lié à la culture des pays. L'on peut considérer que le coût de l'intermédiation est élevé et qu'il faut mieux assumer le risque de l'inexactitude des mentions (quant aux parties, à la réalité de leur consentement, à la consistance de l'objet, à l'ampleur des obligations, etc.) et s'assurer ainsi un marché liquide. Le réajustement des actes par rapport à la réalité des choses se fait alors par la crise, qui réinjecte l'information, l'exemple en étant la crise des prêts immobiliers financiarisés des subprimes. C'est le choix anglais et américains. L'on peut préférer la sécurité par l'intermédiation en ralentissant le marché. C'est le choix du droit romano-germanique. Ces options demeurent ouvertes. La technologie du blockchain n'interfère pas, parce qu'elle ne doit pas viser l'établissement des actes. Si elle devait la viser, alors on aurait choisi la liquidité à la sécurité. Ou en termes plus généraux, l'on aurait choisi la Concurrence contre la Régulation. Mais plus que jamais le souci Ex Ante des risques systémiques (et le fossé entre la réalité et les actes qui doivent la transcrire est un risque systémique majeur) est premier.
En quatrième lieu, en ayant ainsi un tableau des fonctionnalités, l'on voit que les notaires peuvent avoir grand usage des blockchains. Sans laisser des machines établir des actes, ils peuvent les utiliser comme le furent des coffreforts et des photocopieuses, avec une fiabilité et une mise en commun que seul le numérique et la capacité de calcul peuvent offrir à travers cette nouvelle technologie. Plus encore, l'articulation de l'amont (élaboration) et de l'aval (conservation et duplication) étant de nouveau reconnue comme la plus efficace, les officiels ministériels sont les mieux placés, en tant qu'ils dressent des actes instrumentaires dont ils ont vérifié les mentions et après avoir conseillé les parties, à conserver et à dupliquer ceux-ci.
_____
8 avril 2019
Conférences

Cette participation à la table-ronde présidée par Andrea Enria, chairman du Supervisory Board du Single Supervisory Mecanism de la Banque Centrale Européenne qui a pour thème Competition and Regulation in the financial sector.
Elle-même fait partie d'une journée ayant pour thème Competition in a globalised world: the role of public policies, organisée dans le cadre du G7 France 2019 par la Banque de France et le Ministère de l'économie et des finances.
La conférence et les supports sont en anglais.
Dans la table-ronde, il m'est plus particulièrement demandé d'abord la question de la méthodologie à adopte dans le secteur financier, en raison des nouveaux acteurs digitaux, et des principes à adopter à propos des datas.
9 octobre 2018
Conférences

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Participation à la plénière d'ouverture : Regtech, une définition en constante évolution, in Cercle Montesquieu & Open Law en partenariat avec La LJA, La technologie pour une application efficace de la règlementation, Paris Regtech Forum, Paris, 9 octobre 2018.
Regarder la vidéo d'une partie de l'intervention de Marie-Anne Frison-Roche

Lors du débat plénier qui ouvre la manifestation ont été abordées les questions suivantes : Qu’est-ce qu’une RegTech ? Quelles sont leurs applications ? Sont-elles les nouveaux business partners des directions juridiques… Pourquoi ne peut-on/doit-on pas les ignorer ?
Pour ma part, j'ai développé que
- les RegTech doivent distinguer des Fintech, non pas en tant qu'ils sont plus étroits que ceux-ci, mais au contraire plus larges. Ils ne doivent pas se limiter à la "réglementation" d'une part et ne doivent en rien se limiter aux secteurs bancaire et financier, mais se saisir de tous les autres secteurs, notamment énergétique, télécom ou pharmaceutique, voire aller dans le transversal comme l'environnement.
- Plus encore les RegTech sont en lien avec la "Compliance", laquelle n'est pas davantage une sous-partie des "RegTech" et c'est pour cela qu'il est approprié de développer d'une façon articulée mais autonome des "ComplianceTech" ou "ComplyTech", en tant que celles-ci doivent pouvoir par la technologie mais sans se dissoudre dans celles-ci centrer l'acculturation dans l'entreprise et par l'entreprise de ce qu'il continue de continuer à appeler le Droit (et non pas la "réglementation") à savoir la préservation des êtres humains et de ce dont ils ont souci : la préservation de la nature et des autres êtres humains.
14 décembre 2017
Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L'indépendance des auditeurs, exigence du Droit de la Régulation, intervention d'ouverture in Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris (CRCC Paris), L'indépendance du Commissaire aux comptes : les défis d'une profession sous contrôle, Tribunal de Commerce, Paris, 14 décembre 2017.
Le principe d'indépendance des Commissaires aux Comptes peut se "soutenir" de deux façons. En tant que telle et ce n'est pas de cela que je vais parler. Mais aussi d'un point de vue extérieur, qui est celui du Droit de la Régulation. Celui-ci est un droit de nature téléologique, en ce qu'il place sa normativité dans ses buts, les crises de 2008 ayant pris comme but la prévention des crises systémiques en mettant au centre l'information.
C'est en cela que l'auditeur est devenu un acteur central, c'est en cela que son indépendance est devenue absolument requise car l'information est un bien public. Ainsi, si l'indépendance est consubstantielle à l'auditeur pour des raisons objectives, tenant au fonctionnement d'un système où il a sa part, avec d'autres, système qui n'entend pas se passer de lui.
Au contraire, plus cette conception systémique prend de l'importance, notamment à travers la prévalence de l'information pertinence et du souci des risques, et plus l'auditeur est central. En outre, l'évolution montre une dialectique entre le Droit de la Régulation et le Droit de la Supervision, le premier tenant aux structures de marché, le second tenant aux opérateurs eux-mêmes. Ce maillage entre les deux, reflété dans un maillage institutionnel, est ce sur quoi l'Europe est en train de se construire.
Les Auditeurs doivent y jouer un rôle actif, être une force de proposition, et parce qu'ils sont indépendants en raison de la fonction qu'ils jouent, ils doivent donner à voir en permanence d'une indépendance (théorie européenne, d'origine anglaise, de l'indépendance). En cela, ils ont le même régime juridique que celui imposé aux autorités de régulation et aux autorités de supervision, qui doivent donner à voir en permanence leur indépendance et leur impartialité. Cela est dans l'ordre des choses, puisque, comme les entreprises de marché les Auditeurs et leurs organisations professionnelles sont eux-mêmes des Régulateurs et des Superviseurs de second niveau.
_____
Consulter les slides ayant servi de base à la conférence.
Lire l'article rendant compte de la conférence (Journal Spécial des sociétés)
17 novembre 2017
Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse, in Institut Léon Duguit, Université de Bordeaux, L'économie des contrats de partenariat. Les inflexions du droit sous l'influence de l'économie des marchés de partenariat, Bordeaux, 16 et 17 novembre 2017.
Consulter le programme complet de la manifestation.
Les rapprochements entre l'approche économique et l'approche juridique d'un même fait sont toujours instructifs. Oui, mais toujours difficiles. Et toujours hasardeux, dans leur menée et dans leur résultat. Sans doute parce qu'on aimerait que l'analyse économique du droit prenne la forme d'un dialogue. Mais c'est si difficile.
Lorsqu'on écoute et lit, on observe plutôt deux systèmes statiques, voire campés. D'un côté, un système juridique qui n'aurait besoin que de faire fonctionner sa propre logique, dans les mains du juge, assurant la légalité de l'action administrative, sur des critères propres et suffisants, prêtant attention aux discours autour de l'efficacité si finement construits comme on écoute sagement à la messe celui qui, lancé dans une grande homélie, parle sur la chaire avec un vocabulaire qui n'entrera dans son esprit que le temps d'une brève rencontre dominicale. De l'autre côté, un système économique qui n'aurait pareillement besoin que de connaître ses propres théories, peaufinées prix Nobel après prix Nobel, et affirmant les bonnes solutions pour le droit, sans qu'il soit besoin pour le détenteur du savoir de rien connaître des lois et règlements, puisque par principe s'il y a distance ce serait à la loi d'être modifiée et non à la théorie de changer. Puisque la théorie dirait le vrai, alors que le droit était de l'ordre de la contingente politique, n'excédant au vrai, au rationnel, et à l'incontestable qu'en recopiant les conclusions de l'analyse économique. Celui qui était un prédicateur devenant celui qui tient le Vrai, il n'aurait nul besoin de connaître la technique juridique.
Si c'est cela, pour le sujet des contrats de partenariats public-privé (PPP comme pour tous les autres, alors il ne peut y avoir d'inflexion, terme qui évoque le résultat d'un dialogue, de points de contacts dessinés, d'éléments pris d'autres, d'adaptations, bref d'une "prise en considération" du Droit par l’Économie d'une part et d'une "prise en considération" de l’Économie par le Droit. En outre, pour qu'un tel dialogue puisse s'établir et produire des effets, qui ne sont donc pas une fermeture du Droit à toute observation venant de la théorie économique ou une soumission totale du Droit laissant la place à une conception économique qui règle les questions selon sa propre et exclusive logique, encore faut-il comprendre les mots utilisés par les uns et les autres.
Or, à propos des contrats de partenariat, sur lesquels tant de réglementation, de jurisprudence et de théorie économique ont été déversés, à tel point qu'on pourrait y voir dans cette masse une cause du fait qu'en pratique le contrat de partenariat n'est guère utilisé, les mêmes mots sont utilisés de part et d'autre, par les uns et les autres, dans des sens différents (I). Il est alors bien difficile de se comprendre, rappelant ainsi les relations entre les britanniques et les américains, séparés par une même langue. Si l'on éclaircit ces malentendus, il apparaît alors les points de ce qui pourraient être des "inflexions", c'est-à-dire une "influence", une "prise en considération", et non une porte fermée par le Droit à l’Économie, et pas davantage une porte du Droit fracassée par l’Économie s'installant en nouveau maître du système juridique (II).
20 octobre 2017
Conférences

Référence générale : Frison-Roche, M.- A., La "compliance", c'est quoi ?, in La Cotardière, A. de, Frison-Roche, M.-A., Amico, Th., "Compliance et Sapin II", Convention Nationale des Avocats, Bordeaux, 20 octobre 2017.
Voir le programme général de la Convention Nationale des Avocats.
Consulter les slides servant de base à l'intervention relative à la définition de la "compliance".
Consulter les slides servant de base à l'intervention relative à la "Loi vigilance".
14 septembre 2017
Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Forces et enjeux des principes coopératifs -perspectives internationales, in "Planète coopérative" , 14 septembre 2017, Maison de la Chimie.
Lire une présentation générale de la manifestation.
Consulter les slides servant de support à la conférence.
Nous vivons avec des "modèles" en tête. L'éparpillement du Droit en réglementations innombrables et en prérogatives multiples masque cet élément essentiel, que le détachement que procure la perspective internationale permet de mieux percevoir. Ainsi, ce que nous avons comme modèle en tête, tous, non seulement comme entreprise, mais encore comme gouvernant ou comme personne privée, c'est le "marché". Au point qu'Alain Supiot a pu à juste titre montrer que nous vivions désormais sous l'idée agissante du "Marché total", la majuscule étant le signe d'une défaite pour les autres idées devenant vassales, ne pouvant exister que si elles trouvent une justification pour exister encore par rapport à l'idée-mère qu'est le Marché.
C'est ainsi : les Idées mènent le monde.
C'est pourquoi les règles qui expriment autre chose que le marché, nous ne les voyons pas, nous ne les "supportons" qu'à peine, aussi bien au sens français qu'au sens anglais de ce terme.
Or, le Marché, c'est l'idée d'une lutte à mort (la faillite) dont il sortira un bienfait (le marché "nettoyé", l'entreprise la plus adéquate survivant pour toujours plus de richesse et d'innovation), le vice individuel produisant la vertu générale, car Adam Smith était avant tout un moraliste. Puis, Schumpeter expliqua que de cette destruction naissait du nouveau. Ainsi, tout marche bien, pas besoin d'intervention de l'être humain : le Marché est l'espace auto-régulé par excellence. Ainsi, dès que des êtres humains apparaissent, que leurs volontés propres se manifestent, autrement que par leur appétit de gain, le Droit de la concurrence y pose une présomption simple de comportement malicieusement destructeur des bienfaits destructeurs de l'immense machine à calculer et à produire de la richesse d'être le Marché.
Gardons en tête que nous partons de l'idée que le "principe" est l'économie de la guerre de tout instant entre agents, ce qui produit sur le moyen et long terme le bonheur de tous, l'organisation plus conviviale et dans la durée de "l'économie sociale et solidaire" étant donc une "exception". En Politique comme en Droit, être dans le "principe" ou être dans "l'exception", cela n'est pas du tout pareil, parce que lorsqu'on est dans le principe, l'on n'a pas à se justifier, tandis que lorsqu'on est dans l'exception, il faut se justifier, tout mouvement est interprété strictement.
Mais cette "idée" du Marché (comme guerre de tous les instants) comme principe et de l'action ensemble sur le long terme comme exception, est-ce que cela correspond à l'évolution technique des textes généraux ?
Non.
Cela correspond à l'idée que l'on s'en fait, à ce que l'on apprend aux enfants à l'école. Cela ne correspond pas à la réalité.
En effet, les principes ont migré d'un principe de concurrence à un principe de "régulation", qui exprime dans tous les secteurs déterminants pour l'économie une solidarité dans le long terme. Non pas tant par humanisme, pas parce que cela est vital pour l'économie. En cela, les entreprises qui sont elles-mêmes structurées en "coopératives" ne sont pas des "exceptions légitimes" mais sont comme des "reflets" de ce qui est aujourd'hui, dans une économie dont la marque est avant le risque et le souci du temps, la nécessité de supporter les chocs et d'anticiper les crises. Or, si on lit les 7 principes coopératifs, ils visent surtout la structure interne et de gouvernance au sein de celle-ci. Mais si on la perçoit comme étant plus poreuse au marché général, on mesure que celui-ci dans son droit général ouvert à ce type de structure et cela pour une raison simple : il est aujourd'hui en train d'être repensé à travers la notion de "crise" et de "risque".
Pour cela, l'idée de marché est en train d'évolution. Elle se reconstitue non plus autour de la notion de "prix" que sert la notion d'information liée au prix mais autour de la notion d'information élargie à un ensemble d'éléments corrélés qui dépassent la notion de prix et embrassent le long terme, tandis que la notion de responsabilité devient centrale. En cela, les notions de confiance, d'information et de responsabilité, au cœur des marchés financier, qui étaient des marchés exceptionnels et régulés, deviennent les notions centrales des marchés ordinaires mondialisés. Or, ce sont ces notions-là qui structurent les entreprises coopératives. En cela, elles sont le bastion avancée du Droit des marchés ordinaires.
6 juillet 2017
Conférences

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., D'où vient la compliance ? ; Où va la compliance : la nécessité de construire un véritable Droit de la compliance, in Cour de cassation et École Nationale de la Magistrature, La compliance, la place du droit, la place du magistrat, Grand'chambre de la Cour de cassation, 6 juillet 2017.
Lire l'intégralité du programme.
Accéder au programme sur le site de la Cour de cassation. , permettant l'inscription au colloque.
Un ouvrage à venir prendra appui sur les travaux de ce colloque.
_____
D'où vient la Compliance ?
Lorsqu'on lit les différents travaux afférents à la Compliance, l'on a parfois une impression étrange : si l'on a du mal à comprendre les mécanismes de Compliance, si l'on en vient à dire que l'on ne peut le comprendre qu'au cas par cas, cela tient au fait que la Compliance change d'aspect suivant qu'on est à une époque ou à une autre, dans un continent ou dans un autre, dans une branche du droit ou dans une autre, dans une entreprise ou dans une autre.
A chaque fois, l'on a l'impression de respirer un air différent, de la violence la plus forte exprimée par les États-Unis, comme le fait le FTCA pour la corruption ; mais l'on parlera encore de compliance lorsqu'une entreprise décide d'édicter une charte éthique au nom de sa capacité autorégulatrice. Et l'on ne comprend pas comment est-ce que cela pourrait constituer un ensemble cohérent, si les différentes personnes ne parlent pas la même langue. Cette impression de cacophonie ne semble que s'accroître, chacun semblant se "spécialiser" dans une des voies, sans qu'aucune harmonie ne se dégage.
Si l'on reprend d'une façon plus historique l'évolution, il apparaît que les mécanismes de Compliance ont 4 origines. Quatre origines qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres. Qui ont produit chacune des effets techniques propres, qui perdurent et se superposent. Comment effectivement ne pas en être abasourdi ? Après cette première impression, il faut "dénouer les fils", reconstituer les 4 corpus à la fois cohérents, fondés qui se rattachent d'une façon autonome à chacune des 4 origines.
En effet, la première origine est celle des crises financières américaines, dont la naissance est logée dans la première partie du 20ième siècle dans le dysfonctionnement interne des opérateurs systémiques bancaires qui tiennent les marchés financiers, ce qui a entraîné le pays dans la crise générale. Cela a produit un premier corpus.
La deuxième origine tient en Europe après la seconde guerre mondiale dans l'idée que le Droit doit régner et que toute entreprise doit, à propos de toute règle de Droit, donner à voir en Ex Ante qu'elle le respecte. Cette passion du Droit fait passer l'Ex post du Droit (sanction des violations) en Ex Ante (manifestation du respect), certaines entreprises pouvant y avoir intérêt pour montrer leur amour du Droit et de la Vertu. Cela a produit un deuxième corpus, notamment en Droit de la concurrence.
La troisième origine intervient dans les années 1990 dans le constat fait par les États de leur propre faiblesse et de la puissance d'entreprises globales, en internalisant en leur sein des "buts monumentaux", ce mouvement étant la réponse des autorités publiques au phénomène de mondialisation. Cela ne concerne que les entreprises globales.
La quatrième origine est dans la volonté exprimée par un entreprise, qui peut être concernée par les trois premiers mouvements mais ne l'être pas, de se soucier d'autre chose que la réalisation de profit, cette prise en charge d'autrui, même lointain, faisant se rejoindre la Compliance et la Responsabilité sociale des entreprises.
Consulter les slides servant de base à l'intervention.
_____
Où va la Compliance ?
s
2 juin 2017
Conférences
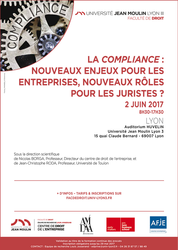
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les fonctions de la Compliance, in Borga, N. et Roda, J.-Ch. (dir.), La compliance : nouveaux enjeux pour les entreprises, nouveaux rôles pour les juristes ?, Centre du Droit de l'entreprise Louis Josserand, Université Lyon IIII Jean Moulin, Lyon, 2 juin 2017.
Consulter les slides servant de base à la conférence.
Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.
Cette conférence s'appuie notamment sur un working paper en préparation : Le bon usage de la compliance.
La Compliance est en train de se constituer en "Droit de la Compliance", branche du Droit économique, qui prolonge le Droit de la Régulation. Ses fonctions sont déterminées par les buts. Or, les buts sont "monumentaux", puisqu'il ne s'agit rien de moins que la fin de la corruption, du trafic d'influence, le trafic d'armes, le terrorisme international, la traite des êtres humains, la vente d'organes, la protection de l'environnement, la sauvegarde de la planète, l'accès de tous à la culture, la préservation de la civilisation, l'effectivité des droits humains ....
Les buts d'une entreprise ne sont à priori pas de cet ordre, même si elle comprend qu'il est malin de paraître aimable.
Par la confrontation des deux, l'on mesure une différence de nature.
Par le Droit de la Compliance, les entreprises sont donc invitées à « sortir d’elles-mêmes.
De ce fait, les fonctions dessinant les contours du Droit de la Compliance, transforment ceux qui en sont les "sujets de droit", les entreprises : celles-ci en sont les sujets, en tant qu'elles en sont les agents de légalités. Mais cela ne saurait être le cas pour toutes les entreprises.
Si l'on devait généraliser l'effet de la Compliance à l'ensemble des entreprises, cela serait catastrophique et n'aurait pas de sens.
Or, qui a fermement et précisément dessiné le cercle des "sujets de droit éligibles à être agent de la légalité " de la compliance ? Avec les coûts et les responsabilités considérable qui vont avec ?
Si cela n'a pas été le Législateur, il faudra impérativement que ce soit le Juge. Car le juge est gardien de l'esprit des Lois et gardien des ordres juridiques. Surtout s'il s'agit d'un ordre juridique global.
___
Par ailleurs, les entreprises ne sont pas seulement des sujets passifs du Droit de la Compliance - ce qui serait le cas d'un Droit de la Compliance mal compris - mais doivent aussi des sujets actifs du Droit de la Compliance. En effet,, ces "buts monumentaux" qui dessinent les fonctions de la Compliance sont exactement les mêmes que ceux de la Responsabilité sociales des Entreprises.
Ainsi, si l'on ne conçoit la Compliance que comme une soumission à la fois immense et vide de toutes les entreprises à la réglementation totale, il en résultera une opposition entre Régulation et volonté des entreprise, concrètement une opposition entre Autorités publiques et entreprises. Si au contraire l'on conçoit le Droit de la compliance comme ce par quoi les "entreprises cruciales" comme les Régulateurs cheminent vers la concrétisation de "buts monumentaux, alors le Droit de la Compliance cristallise un "Pacte de confiance" entre les deux, lequel excède les frontières et devient un mode de régulation de la globalisation. Mais la confiance ne serait être imposée.
____
Il existe donc trois cercles, qui peuvent se superposer, mais qui ne sauraient se confondre sauf à engendre des catastrophes. Un premier cercle renvoyant à l'obligation générale de se conformer au Droit, cercle qui vise tout en chacun mais dans lequel la compliance ne se distingue pas du Droit lui-même. Un deuxième cercle qui ne peut viser que les "opérateurs cruciaux" dans lesquels des autorités publiques internalisent par souci d'efficacité des buts monumentaux, financiers et non financiers, ces opérateurs y étant contraints de par leur position. Un troisième cercle qui concernent des agents économiques qui décident, de par leur volonté, de sortir de leur pure logique économique pour viser des buts non-économiques et de contribuer au bien commun, parce qu'ils le veulent. Concrètement, il s'agit le plus souvent d'opérateurs cruciaux, mais ces deux cercles peuvent ne pas se recouvrir car le troisième cercle est dessiné par des actes de volonté des opérateurs - qui doit être validé et vérifié - alors que ceux-ci sont contraints de par leur position d'opérateurs cruciaux dans le deuxième cercle.
Cette articulation entre ces trois cercles de la Compliance est l'avenir du Droit européen.
11 mai 2017
Conférences

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Le contrat est-il l'instrument optimal de la RSE ?, in Trébulle, F.-G. (modérateur), Les instruments de la RSE : le contrat, cycle de conférences organisé par la Cour de cassation et les Universités Paris-Dauphine, Paris VIII, Paris I, Cour de cassation, 11 mai 2017.
Consulter les slides ayant servi de base à la conférence.
Lire le programme de la conférence sur le site de la Cour de cassation.
Lire le programme de l'ensemble du cycle dans lequel la conférence s'insère.
La Responsabilité Sociale des Entreprises appartient au Droit économique. Elle entre donc dans sa logique d'efficacité, conduisant à appréhender tout mécanisme juridique comme un instrument, le contrat comme les autres. Cela ne veut pas dire que tout ne soit qu'instrument, au contraire. Le Droit économique, lorsqu'il prend la forme du Droit de la Régulation, place les principes dans les buts poursuivis. C'est là, dans ces principes qu'il peut rencontrer la RSE si les buts sont les mêmes.
Au regard de ces buts, tout est instrument. A l'échelle des buts qui sont "monumentaux"
Les lois nouvelles, comme la loi Sapin 2 ou la loi établissant un "devoir de vigilance" aux contours si incertains", peuvent n'utiliser le contrat que comme un véhicule pour que les obligations légales soient exécutées par l'entreprise, le Droit de la Régulation internalisant ainsi ses buts dans l'entreprise
Mais le contrat peut aussi être choisi comme instrument par l'entreprise en ce qu'elle poursuit les mêmes buts d'un intérêt général mondial
En cela, le contrat converge vers ce qui est en train de se construire : un Droit de la Compliance.
On this notion of "monumental goal", see , V. Frison-Roche, M-A., Le Droit de la Compliance, 2016 ; From Regulation Law to Compliance Law, 2017.
Pour une démonstration d'ensemble, v. Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017.
Sur la notion d'intérêt général mondial, voire de service public mondial, v. Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017.
24 mars 2017
Conférences
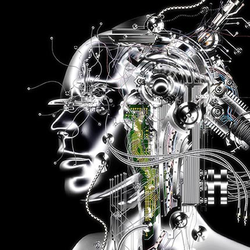
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le droit des data, in Association Française de Philosophie du Droit et Cité des Sciences et de la Techniques, Vers de nouvelles humanités ? L’humanisme face aux nouvelles technologies, 24 mars 2017, auditorium de la Cité des sciences et de l’industrie.
Regarder la vidéo de la conférence.
Consulter le document du programme complet du colloque (23 et 24 mars 2017).
Consulter en lien le programme.
Retrouver les activités passées et présentes de l'Association française de philosophie du Droit.
Les travaux du colloque seront publiés dans le tome 59 des Archives de Philosophie du Droit (APD). Voir la présentation de quelques volumes des Archives de Philosophie du Droit.
Le "Droit des data" semble se constituer en branche du droit nouvelle, sans doute parce que des textes les visent, en leur ensemble et parce qu'ils ont pour sous-jacent spécifique l'informatique et l'espace qu'elle a fait naître, le numérique. Mais doit-on même admettre ce redécoupage du système juridique et de l'enseignement dynamique qu'on en fait ?
Pourquoi y associer si souvent l'adjectif big , à la fois si attractif et effrayant, nouveau Big Fish qui nous ramène à l'enfance ?
Ne sommes-nous pas pulvérisés dans un premier temps et reconstruits par d'autres, qui disposent ainsi de nous comme on le fait de marionnettes à tel point qu'on en vient à parler de "quasi-propriété" parce que la propriété des êtres humains à laquelle les entreprises songent pourtant serait un mot trop violent mais trop exact ?
A quoi ressemble le "Droit des data" car, puisqu'il est nouveau, soit il faut trouver ses racines, soit il faut trouver des comparaisons pour références, afin qu'il ressemble à autre chose qu'un bric-à-brac de textes qui définissent par exemple la "banque de données" comme un "ensemble de données" ou de casuistiques qui colmatent les cas, l'éthique étant confiée par désespoir à la notion si étrangement venue de "design" ?
La ressemblance la plus nette et qui permettrait de mieux le comprendre est sans doute de l'anticiper, c'est le Droit financier.
Or, les données sont le plus souvent la projection de l'être humain lui-même.
Et à propos de celui, Législateur et Juge n'auraient rien à dire ?
Que vaut la parole humaine face à ce flot de chiffres qui mime si parfaitement la langue humaine et si servilement que les ingénieurs donnent aux robots l'allure de jeunes filles souriantes et toujours consentantes ?
Contre la servilité consentante, modèle du marché global, c'est la Parole de la Personne humaine que le Droit des data doit préserver.
La Parole humaine, elle se formule en Questions. Et non pas de demandes. Elle se forge en Savoir. Et non pas en information.
Cette Parole humaine, que les data, série de chiffres ne peuvent imiter, ce sont les artistes qui la portent.
C'est donc à eux qu'il faut donner la parole.
Et la servir. D'en faire que la glose. Dans deux exercices de style. En s'inclinant tout d'abord devant un artiste pythique qui a décrit en 1972 notre engloutissement sous l'information et les images immobiles. Puis en s'inclinant devant l'artiste qui est le dernier homme que le premier appelle, l'homme qui par son art exprime la bravoure humaniste.
Le courage, c'est tout ce dont nous avons besoin.
Mais en avons-nous ?
Voir les slides préparés pour servir de support à la conférence.
Regarder la vidéo de l'intervention, laquelle, pour des raisons techniques, ne correspondit pas aux slides.
.
2 février 2017
Conférences

Référence : Frison-Roche, M.-A., Le droit de la
Le Droit de la
En effet, les autorités publiques expriment des buts monumentaux dépassant le fonctionnement marchand et qu’elles n’ont pas les moyens de mettre en œuvre mais dont elles chargent certaines entreprises de la concrétisation. Ainsi, la
Face à ce phénomène américain, les entreprises européennes sont restées passives, se contentant d’être condamnées. Il convient bien plutôt de s’approprier ce Droit de la
Enedis est à ce titre un sujet dynamique de
Consulter les slides ayant servis de support à la conférence.
14 décembre 2016
Conférences

Dans la 18ième édition du livre d'économie, il s'agit d'appuyer sur l'ouvrage de Jean Tirole, présent pendant la conférence, L'économie du bien commun, pour prendre un thème d'économie avec un public de lycéens.
Lire le programme du colloque.
La question est celle de la croissance et du marché telle que l'État peut l'envisager, soit comme acteur, soit comme régulateur.
Dans la 1ière table-ronde animée par Pierre-Henri de Menthon, intervient Varie Rabault, rapporteure générale de la Commission des finances à l'Assemblée Nationales qui expose le rôle du budget de l'État dans le pilotage à long terme de l'économie.
Puis Philippe Sauquet, membre du Comex de Total explique que l'entreprise privée prend la mondialisation comme un fait acquis mais parvient néanmoins à développer des stratégies à très long terme, internationales avec des investissements très lourds, en s'appuyant sur la puissance des États, dont elles souhaitent l'autorité et aimeraient un comportement plus prévisible et moins court-termiste.
Jean Tirole reprend l'idée que la mondialisation est un fait. L'enjeu est que les pays ne se replient pas. Pour cela, il faut que les plus possibles y gagnent et que ceux qui y perdent
Puis Jean-Marc Daniel revient sur l'idée de l'ouverture définitive de l'économie, notamment du fait du numérique, ce qui va bouleverser les comportements et créer de nouveaux marchés. La concurrence est déjà là et l'État doit lui-même se comporter comme un producteur de normes facilitant cette compétitivité.
Marie-Anne Frison-Roche a souligné que la part du droit dans cette économie dont le principe est le marché apparaît de plus en plus nettement, un droit qui n'est pas réduit à de la réglementation mais prend la forme de contrats, d'un droit de la concurrence et de jurisprudence dont l'adoption est déterminante et varie suivant les cultures des pays. Ainsi l'Angleterre ou les États-Unis ont une culture juridique populaire plus développée qu'en France, ce qui rend le choc de l'ouverture des marchés moins violent. L'éducation juridique précoce devrait être développée en France. Et ce d'autant plus que le métier de juriste est un métier de grand avenir.
Mise à jour : 5 décembre 2016 (Rédaction initiale : 8 septembre 2016 )
Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Droit et confiance. Un rapport difficile, in Universités d'été de la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes et de l'ordre des experts-comptables de la région Paris-Ile de France, Osons la confiance, 8 septembre 2016, Paris.
Consulter les slides ayant servi de base à la conférence.
Regarder la vidéo de la conférence.
Lire la contribution à l'ouvrage La confiance ayant servi de support aux Universités d'été.
2 décembre 2016
Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse et libres propos conclusifs, in Lasserre, V. (dir.), "articulation des normes privées, publiques et internationales", Université du Maine, 2 décembre 2016.
Consulter les slides servant de support à la conférence.
Un article sera publié dans un ouvrage à paraître en 2017.
Le "Droit souple" est l'expression sur laquelle l'on converge désormais, puisque le Conseil d’État l'a voulu... La première question que l'on se pose est de savoir s'il constitue une nouveauté, comme on le dit souvent ou bien s'il ne révèle pas ce qu'a toujours été le Droit, pour ceux qui se souviennent avoir lu avant la publication du Rapport du Conseil d’État un ouvrage dont le titre est Flexible Droit ....
La deuxième question tient dans une présentation du Droit souple soit comme une pure méthode, embrassant dès lors tout le droit et au-delà du droit, ou bien comme un nouveau droit substantiel. Cela mène à une troisième question, car l'on hésite à voir dans le Droit souple un phénomène général et abstrait, ou bien au contraire caractéristique de certains secteurs du droit, principalement le droit du commercial international et le droit financier, là où l’État de fait n'aurait plus guère prise.
Vient alors à l'esprit une troisième question, qui est presque un soupçon : au jeu du Droit souple, qui est gagnant ?
18 novembre 2016
Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse et propos conclusifs, in Université de Bordeaux, colloque organisé par l’Institut Léon Duguit et le Forum Montesquieu, Régulation et jeux d’argent et de hasard. Vers d’autres formes de régulation en matière de jeux d’argent et de hasard ?, Bordeaux, 17 et 18 novembre 2016.
Cette intervention se situe au terme des deux journées et plus particulièrement de la seconde, qui a posé que nous étions dans une situation "postmoderne" et que nous allions vers de "nouvelles formes" de régulation des jeux.
Ces travaux déboucheront sur un ouvrage, publié dans la collection "Droit et Économie", chez Lextenso - LGDJ. , au cours du premier semestre 2017.
Consulter les slides, élaborées au fur et à mesure de l'audition des interventions.
Les différentes contributions ont mis en valeur les remises fondamentales et salutaires de l'évolution à la fois technique et sociale du phénomène des jeux : tout s'ouvre, tout se remet en cause, tout est possible. Tout doit donc être réfléchi.
Il en ressort notamment trois grandes questions.
Le Droit de la Régulation exprime un rapport nouveau entre les règles et les faits, rapport tendu entre l’Économie, le Droit et le Politique, aucun ne pouvant d'une façon définitive ni exclure ni même dominer les deux autres. Si l'ouverture de l'espace virtuel bouleverse les jeux plus encore que d'autres activités humaines - car l'on s'amuse tant dans le numérique ! -, ce rapport et cette tension demeure. Mais les prétentions varient parce que si l’État prétendait naguère être le maître, c'est davantage les opérateurs économiques, arguant à la fois de l'ordinaire concurrentiel et du fait technologique, montré comme prouesse, qui prétendent aujourd'hui être les maîtres, le droit allant de l'un à l'autre, l'éthique ayant bien du mal à trouver son chemin. Il faut dire que morale, jeu et plaisir ont toujours eu du mal à converser.
C'est donc la question de la spécificité des jeux, entraînés vers un destin banal qui est aujourd'hui posée (I). Sur une sorte de surréaction, les jeux apparaissent dans leurs traits contraires renforcés, à la fois la dimension financière plus que jamais présente, peut-être devenue première, alors que la dimension politique demeure revendiquée (II). La question première est alors celle de l'avenir : allons-nous vers un mécanisme ordinaire de plaisir et de désir de s'amuser, s'amuser à tout prix, ou bien la régulation a-t-elle pour objet de brider cette tendance naturelle d'offrir à chacun l'objet de son désir de jeu, ou bien la régulation ne peut-elle au contraire avoir pour ambition d'offrir à travers le jeu plus que le jeu, par exemple l'éducation ? (IIII).
Consulter le working paper en cours de rédaction, sur lequel sera élaboré l'article dans l'ouvrage à paraître.
23 septembre 2016
Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., L'ouverture du patrimoine immatériel public dans la perspective du bien commun, in La valorisation du patrimoine immatériel des personnes publiques. 10 ans après le Rapport Lévy-Jouyet., Bordeaux, 23 septembre 2016.
Dans sa recommandation n°11, le rapport Lévy-Jouyet recommande la mise en ligne des données publiques pour améliorer le service public (open data), son financement se faisant au besoin par la publicité. C’est à un autre titre que par sa recommandation n°12, le rapport préconise d’aider la diffuser de la création française à l’étranger.
Dans une économie de l’immatériel devenue une « économie de l’accès », ces deux recommandations pourraient se rapprochent, se fondre peut-être. En effet, si l’on relit par exemple les « lieux de mémoires » de Pierre Nora, on observe que les personnes publiques portent le patrimoine immatériel de la France. Il est d’une grande valeur. Il a été créé notamment par l’histoire. L’État en organise l’accès, par l’open data. En cela, il organise l’accès à une création collective. En cela, il remplit sa fonction de satisfaire le bien commun d’ouverture.
Mais l'on bute rapidement sur une difficulté, voire une aporie : comme l'exprime le rapport Lévy-Jouyet pour les données publiques l’accès à celles-ci doit être financé. De la même façon, l’accès aux "lieux de mémoires doit être financé". Et l'on voit à travers cette question financière la contradiction de l'open data : L’enrichissement par les opérateurs de l’accès sans aucune contrepartie est incompréhensible. Seule une licence de droit commun peut rétablir le caractère commutatif entre le dépositaire de la création immatérielle collectif qui est la personne publique qui perdure dans le temps (l’État) et celui qui tire profit de l’accès. Puisque chacun sait que la gratuité n’est pas un système sain, tandis que chacun dit que les licences open data ne sont pas effectives.
C'est pourquoi il convient d'examiner les règles juridiques qui gouvernent aujourd'hui ce que l'on appelle "l'open data" comme l'expression d'un droit d'accès à ce qui est à tout le monde mais qui est pourtant intouchable (I), le régime juridique montrant les contradictions de l'open data, ce à quoi le droit plus classique auquel le rapport renvoie par ailleurs pourrait répondre (II).
Lire le programme de la journée.
Consulter les slides de la conférence.
Regarder la vidéo de la conférence.
Lire le working paper servant de support à la conférence et à l'article à paraître.
27 mai 2016
Conférences

Référence : Frison-Roche, M.-A., La mondialisation vue du point de vue du Droit. Rapport de synthèse, in Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française,Journées internationales allemandes, La mondialisation, Berlin, 27 mai 2016.
Consulter le programme des Journées Allemandes.
Regarder quelques photos de la manifestation d'une semaine, la première partie se déroulant à l'Université de Munster, la seconde se déroulant à l'Université Humboldt à Berlin, et les rapports nationaux sur lesquels la manifestation a été construite.
Consulter le programme des Journées parisiennes qui précèdent.
Lire le working paper qui est conçu pour permettre une meilleure appréhension des différents rapports nationaux élaborés pour les Journées Allemandes de l'Association Henri Capitant. et présentés dans ce cadre, à Munster, puis à Berlin.
Consulter les slides ayant servi de support à la présentation du Rapport de synthèse.
La synthèse des travaux s'appuie sur les présentations synthétiques faites par les rapporteurs des différents pays représentés des travaux menés en 2016 au sein de l'Association Henri Capitant au sein des 23 pays sur 4 thèmes :
- Mondialisation et sources du droit
- Mondialisation et circulation des personnes
- Mondialisation et investissements
- Mondialisation et Internet
____
La Mondialisation peut être vue aussi du point de vue du Droit.
À lire et à écouter les différents rapports nationaux, à apprendre des 4 thèmes retenus, que sont les sources du droit, la circulation des personnes, le traitement des investissements étrangers et Internet, l'on se dit qu'il convient tout d'abord de prendre la mesure de ce phénomène de mondialisation vu du point de vue du Droit.
Cela permet dans un deuxième temps d'en penser quelque chose, car il y a un impératif juridique de penser quelque chose de la mondialisation, de ne pas se retrancher derrière la "neutralité" technicienne ou de laisser à d'autres le soin d'en penser quelque chose. Cela a coûté si cher aux êtres humains lorsque les juristes ont estimé qu'il revenait à d'autres de penser quelque chose.
Dans un troisième temps, l'on se dit "Que faire ?", face à cette sorte de déferlante que semble la mondialisation. Ce n'est pas parce que le Droit n'y pourrait rien, face à la finance et au numérique, les deux voies majeures de la mondialisation en ce qu'elle constitue un phénomène nouveau, qu'il faudrait ne plus rien penser : l'impuissance rend encore plus nécessaire la résistance.
Résistance et Création, le couple vaut aussi pour le Droit. Migration et Liberté, le couple vaut aussi pour le Droit. De grandes figures du Droit nous l'ont montré, nous Amis de la culture juridique française : René Cassin, qui dût migrer pour résister, qui après la guerre et sans cesser de croire à l'amitié construisit la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, lui qui ne cessa jamais de croire et au Droit et à l'être humain, faisant face à la violence des rapports de force.
_____
Ces travaux ont été la base d'un ouvrage publié en 2017.
Lire une présentation général de l'ouvrage La mondialisation.
Lire une présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche, La mondialisation du point de vue du droit, avec accès au working paper bilingue ayant servi de base à sa rédaction (Globalization from the point of view of Law).
10 mars 2016
Conférences

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Diable dans la bouteille des Codes de bonne conduite". Hommage à Gérard Farjat, Centre de Recherche en droit économique de Nice, 10 mars 2016.
____
► Consulter le plan de la conférence.
► Consulter les slides servant de support à la conférence.
____
► Présentation de la conférence : En 1978, notre ami commun Gérard Farjat a écrit un article mémorable sur "les codes de conduite privés" qui depuis ont fait florès. Je me souviens que cela lui causait du souci car tout à la fois il se doutait de la part de rhétorique, voire de contradiction, que ces codes contiennent, et en même temps il ne voyait pas quoi pouvait arrêter désormais cette façon légitimer pour les entreprises internationales d'organiser chez elles un "ordre" puisque le Droit n'était plus apte de leur proposer de l'extérieur un, tandis qu'il n'était pas davantage capable de limiter la tendance moins vertueuse des entreprises à façonner des normes par lesquelles elles exercent un pouvoir non plus seulement pour s'organiser elles mais encore pour régir autrui et le monde extérieur.
Et encore Gérard Farjat lorsqu'il écrivit cet article, en 1978, n'avait pas été conçue l'aimable Corporate Social Responsability...
En sommes-nous au même point ? Peut-on même dire que la situation s'est aggravée, le monde étant "normé" et "gouverné" par des entreprises "globales" qui écrivent et imposent des Codes de "bonnes" conduites qui expriment ce qui est "bon" en soi et finissent par constituer de véritables "Constitutions mondiales" ?
Non. On peut penser même l'inverse. Par la puissance des Régulateurs et des Superviseurs, institutions de puissance publiques, les normes publiques sont internalisées dans les entreprises "globales" qui les répètent dans les codes de bonnes conduites et deviennent les régulateurs et les superviseurs d'elles-mêmes.
________
30 novembre 2015
Conférences
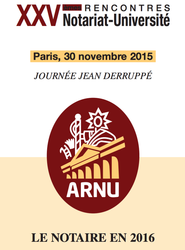
Référence générale : Frison-Roche, M.-A., et Houdard, D., Le coût de l'acte, in Le notaire en 2016, Association Rencontres Notariat-Université (ARNU).
Lire le working paper ayant servi de base à la conférence et contenu les références techniques : La référence au "coût de l'acte" : la nouvelle rationalité de la tarification de l'acte notarié.
Lire l'article publié en février 2016 à la Semaine juridique.
Dans une journée dont le thème est "Le notaire", il peut paraître "déplacé" de traiter la question du "coût de l'acte". En effet, celui- ci dépend avant tout de l'État qui fixe les tarifications de la prestation et non pas tant de la personne qui établit l'acte, qui le conserve et conseille les parties. Mais la Loi pour la croissance, l'activité et l'économique des chances économiques (dite "Loi Macron") du 6 août 2015 a conçu le coût des actes comme on le fait dans la régulation des accès à des biens communs, en additionnant non pas tant les coûts et les marges raisonnables que peuvent attendre les gestionnaires de ces biens du soin qu'ils en prennent, mais les coûts que cela doit en engendrer pour eux. Et plus ce coût est bas, plus le système fonctionne bien, la tarification par les coûts finissant par rejoindre la tarification par le price cap. Il y a donc à la fois de la péréquation et une perspective disciplinaire dans une entéléchie dont le bien-être du consommateur est le but. Le projet de décret traduit cela et c'est donc à travers l'analyse du coût de l'acte, à travers les coûts estimés comme "pertinents" et ceux qui ne le sont pas, que le Ministère de l'Économie et des Finances entends réguler la façon dont le notaire organise son exercice professionnel.
Cette question technique de la tarification du coût par un texte ministériel commun au Ministre de la Justice et au Ministre de l’Économie suscite un grand émoi, une grande incompréhension qui peut parfois dégénérer en agressivité entre la profession et le Ministère ressenti comme désormais dominant. Cela tient au fait que l'on passe d'un système à un autre, dans son esprit même.
Précédemment, le tarif étant le prolongement de l'acte de souveraineté par lequel le garde des Sceaux conférait le pouvoir d'instrumenter à l'officier public, le montant demandé par celui-ci à la personne recevant la prestation allant avoir la délégation de cette souveraineté. La question du montant, de son calcul, de son adéquation, de sa comparaison aux autres prestations, aux autres montants appelés "prix", était secondaire, accessoire, presque saugrenue.
Désormais, l’État prend la perspective à partir de celui qui demande la prestation, perspective de marché peut-être, mais aussi de service public et d'accès à un prestation essentielle. C'est pourquoi la simple loi de l'offre et de la demande sera bloquée par l’État et ce n'est pas un prix qui va ajuster la relation, cela demeure un "tarif". Comme l’État veut s'opposer à la concurrence, il choisit un système de régulation. Si l'Autorité de régulation regarde - ce n'est pas elle qui fixe -, c'est parce qu'il faut calculer hors mécanisme de marché autant que cela est nécessaire et pas plus qu'il n'est nécessaire. Plutôt que de mettre en concurrence les notaires entre eux par la concurrence, la référence aux coûts, méthode très française, permet de nombreuses latitudes.
C'est à la profession notarial d'apporter au Ministre les éléments d'information pour construire la tarification par les coûts. Les informations doivent être elles-mêmes "pertinentes", c'est-à-dire suffisamment "robustes" pour tenir face à une Commission européenne face à laquelle l’État français lui-même doit rendre des comptes en Ex post. La tarification constitue un Ex ante intégrant une logique d'Ex post.
Dans cette construction commune, les coûts ont vocation à intégrer non seulement les coûts d'établissement des actes mais encore les coûts de structure. Plus encore, à intégrer non seulement les coûts des actes d’aujourd’hui', mais encore les coûts des actes de demain, car la régulation est l'injection du temps dans le marché, jouxte avec la politique publique. Les notaires sont requis pour la construction d'un système futur performant, dont le coût est présent, notamment pour un système numérique que l’État veut l'établissement avec l'aide des notaires.
C'est pourquoi ce passage d'un système à un autre qu'exprime cette désignation par la Loi d'une tarification par les coûts est une chance pour le notaire d'être au centre d'un système économique dont la sécurité et le dynamisme tiennent dans une conception régulée.
18 novembre 2015
Conférences

13 novembre 2015
Conférences

Référence : Frison-Roche, M.-A., Concevoir des normes adéquates, in Office parlementaire d’Évaluation des mesures scientifiques et technologiques, L'état de l'art en matière de mesure des émissions de particules et de polluants par les véhicules , Sénat, salle Médicis, 13 novembre 2015, 9h-13h.