Matières à Réflexions
16 octobre 2025
Publications
🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Reference complète : M.-A. Frison-Roche, "De l'obligation de compliance à l'obligation de vigilance: le rôle du juge", in Table-ronde, De la compliance au devoir de vigilance. Une nouvelle responsabilité des entreprises, Lettre des juristes d'affaires, oct. 2025.
____
📝lire l'article reproduisant l'ensemble de la discussion
____
► Résumé de mon intervention: Dans ce débat dont les termes ont été reproduit dans la revue, l'on m'a demandé d'expliquer comment le Droit avait évolué, en posant tout d'abord le Droit de la compliance, construit sur des ambitions systémiques, pour éviter des catastrophes sectorielles (banque, finance, énergie), ambitions constitutives de "buts monumentaux négatifs", pour ensuite évoluer d'une part des "buts monumentaux positifs", à savoir la protection des êtres humains impliqués de gré ou de force dans ces systèmes d'autre part en dehors même de secteurs aux contours cernables, comme les ambitions environnementales ou numériques. Le devoir de vigilance prolonge ce Droit de la Régulation et concrétise cette "obligation de compliance" à laquelle les entreprises sont assujetties. Il faut garder de la mesure dans la conception de la responsabilité qui y est attachée pour ne pas tout perdre. Les entreprises sont tenues par les buts mais doivent rester libres des moyens, et être notamment incitées à manier les techniques du contrat. Cette mesure est confiée au Juge car, en raison de la juridictionnalisation de la Compliance, est au coeur de cette nouvelle branche du Droit, qui se développe indépendament des fluctuations des textes.
Dans la suite de la discussion, l'on m'a demandé mon opinion sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 17 juin 2025, dit La Poste. J'ai souligné que les commentaires n'avaient souvent retenu que les développements sur la cartographie des risques, alors que cet arrêt pose tout d'abord en principe que le plan est l'oeuvre des organes décisionnaires de l'entreprise et qu'il n'est pas coconstruit, la concertation étant une consultation et une prise en considération, ce qui n'est pas la même chose, le juge rappelant lui-même qu'il ne doit lui-même pas immiscer dans la gestions.
Dans la discussion, j'ai souligné que si l'on doit souligner l'essentie de ce qui serait une "nouvelle responsabilité", elle porterait avant tout sur une nouvelle dimension probatoire que l'entreprise doit mettre en place en Ex Ante. La mise en oeuvre de la CSRD, même si elle a été excessivement normée, est dans ce sens et cette culture probatoire doit se développer.
____
⛏️Aller plus loin sur la question :
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕L'obligation de compliance, 2025
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝La Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance, 2025
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, 2025
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de la compliance, 2023
________
15 octobre 2025
Base Documentaire : Soft Law
► Référence complète : Speech of HE Judge Iwasawa Yuji, President of the International Court of Justice, before the Sixth Committee of the United Nations General Assembly, 15 octobre 2025
____
📝Lire la prise de parole (en anglais)
____
► Résumé de la prise de parole : L
________
15 octobre 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : C.S. Sunstein, Imperfect Oracle: What AI Can and Cannot Do, Université of Penn Press, 2025, 208 p.
____
► Résumé de l'ouvrage (fait par l'éditeur") : 'Imperfect Oracle is about the promise and limits of artificial intelligence. The promise is that in important ways AI is better than we are at making judgments. Its limits are evidenced by the fact that AI cannot always make accurate predictions—not today, not tomorrow, and not the day after, either.
Natural intelligence is a marvel, but human beings blunder because we are biased. We are biased in the sense that our judgments tend to go systematically wrong in predictable ways, like a scale that always shows people as heavier than they are, or like an archer who always misses the target to the right. Biases can lead us to buy products that do us no good or to make foolish investments. They can lead us to run unreasonable risks, and to refuse to run reasonable risks. They can shorten our lives. They can make us miserable.
Biases present one kind of problem; noise is another. People are noisy not in the sense that we are loud, though we might be, but in the sense that our judgments show unwanted variability. On Monday, we might make a very different judgment from the judgment we make on Friday. When we are sad, we might make a different judgment from the one we would make when we are happy. Bias and noise can produce exceedingly serious mistakes.
AI promises to avoid both bias and noise. For institutions that want to avoid mistakes it is now a great boon. AI will also help investors who want to make money and consumers who don’t want to buy products that they will end up hating. Still, the world is full of surprises, and AI cannot spoil those surprises because some of the most important forms of knowledge involve an appreciation of what we cannot know and why we cannot know it. Life would be a lot less fun if we could predict everything."
14 octobre 2025
Conférences

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Adéquation et inadéquation de la sanction comme outil de régulation financière et sa transformation par la Compliance", intervention dans la table-ronde sur "Quel rôle pour la sanction dans la régulation ?", Colloque annuel de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF), Paris, 14 octobre 2025.
____
► Consulter le programme général de la manifestation
La manifestation est composée de deux tables rondes. La première table ronde a pour thème : La preuve des abus de marché entre l’AMF et le juge pénal : vers une convergence ?
🪑🪑🪑Autres participants à la 2ième table ronde, dont la modératrice est Sophie Schiller, membre de la Commission des sanctions, autour du thème : Quel rôle pour la sanction dans la régulation ?
🕴🏻Sébastien Raspiller, secrétaire général de l’AMF
🕴🏻Martine Samuelian, avocate associée, Jeantet
🕴🏻Vincent Villette, secrétaire général de la CNIL
____
► Résumé de l'intervention : Dans la table-ronde sur le rôle de la sanction, plusieurs interventions ont vocation à prendre place, au gré de la discussion elle-même. Elles sont par nature brèves et s'adressent à un public averti en matière de régulation financière.
La première intervention, visant plutôt à camper le sujet et à décrire l'intangible, est sur l'idée même que la sanction a un rôle dans la régulation financière. Par nature. Cela n'en pose pas moins difficulté. Cela n'est pas évident car si la sanction apparaît comme un "outil de régulation", alors c'est la perspective de régulation qui prédomine et qui "teinte" son outil qu'est la sanction. La "régulation", dont la "réglementation" n'est qu'un outil et qui n'est pas l'ensemble des règles applicables mais qui est un appareillage d'institutions, de règles et de décisions visant à établir l'équilibre un secteur et à maintenir cet équilibre, par nature instable, dans le temps, ce que ce secteur ne pourrait faire par ses seules forces (le Droit de la Régulation, droit en Ex Ante, se distinguant ainsi du Droit de la concurrence, droit en Ex Post).
Dans la perspective de la Régulation financière, comme dans les autres Régulations sectorielles, et dans le Droit commun de la Régulation, la sanction est un outil (et un outil comme un autre, simplement qui est plus puissant que les autres).
C'est la perspective retenue par l'Etat et le Régulateur lui-même, qui va le manier en le mêlant avec les autres outils, comme un mécanisme d'information, d'éducation, d'incitation, etc.
Mais la sanction, à travers le principe de l'autonomie du Droit répressif et la notion européenne de "matière pénale", se pense à travers les critères autonomes de gravité du fait imputé et de sanction infligé au sujet de Droit. En cela, la sanction est indissociable de la façon dont elle est infligée (le droit pénal est constitutionnellement indissociable de la procédure pénale).
En cela, la sanction n'est pas un outil teinté par la finalité globalement servie : la durabilité du système financier : elle vaut en tant que telle comme punition. La Commission des sanctions n'est pas alors le "bras armé" de l'AMF, c'est un "tribunal", comme le rappela l'arrêt Oury.
Peut-on être les 2. On le dit, on peut être à la fois carpe et lapin.
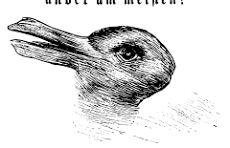
Ou suivant l'angle sous lequel l'on décide de regarder la Commission des sanctions, l'on y verra soit ce lapin, soit un canard.
C'est possible, et en pratique c'est souvent vrai. Mais si l'on est honnête, l'on admettra que la Régulation se nourrit d'information et que la procédure devant un tribunal répressif est construite sur le secret et les armes de celui qui, innocent ou coupable, est en risque puisque il est, ou sera, poursuivi.
Jamais l'on n'a pas sorti de cette difficulté. Toujours, on cherche à mettre en équilibre et le fait que
c'est en soi une sanction pour une personne qui en souffrira et que c'est aussi un outil systémique : il y a "dosage" entre la recherche du bénéfice systémique (qui diminue la protection des personnes au bénéfice du système) et le souci des personnes impliquées (qui diminue la protection présente et future du système). Le fléau de la balance va plus ou moins dans un sens. C'est souvent l'opinion publique, la place, le Législateur et (voire surtout) le juge du recours et ceux qui sont en dialogue (le juge pénal) qui font osciller.
C'est aussi la façon dont la Commission des sanctions, en ce qu'elle se définit elle-même comme bras armé de l'AMF (carpe) ou comme tribunal répressif (lapin) qui va dans son comportement procédural, choisir le rôle de la sanction dans la régulation, plus ou moins instrumentalisée (carpe) ou juridictionnalisée (lapin).
____
La seconde intervention, s'il doit y en avoir une, vise l'évolution de ce rôle de la sanction dans la régulation.
A partir de ces fondamentaux, une évolution du rôle de la sanction dans la régulation financière (évolution que l'on observe dans toutes les régulations sectorielles) consiste à internaliser les sanctions (dans leur conception par les textes, leur élaboration par les Commission des sanctions, leur application) dans les opérateurs sanctionnés, dans les secteurs économiques concernées, dans l'opinion concernée (les cercles pérelmaniens des auditoires s'appliquant).
Cette internalisation transforme la régulation (qui portent sur les structures des marchés) en supervision (qui portent sur les opérateurs de marché) puisque la sanction fait pénétrer la sanction dans l'opérateur, l'opérateur adoptant des engagements, la composition administrative étant le plus grand succès puisqu'il y a changement à l'avenir. Cette conception correspond à la nouvelle branche du Droit qu'est le Droit de la Compliance.
Le Droit de la compliance utilise la sanction comme une "incitation comme une autre", et (il faut raison garder sur ce point), parce que de nature systémique, le souci du système étant internalisé dans l'opérateur, il est assez peu sensible aux droits procéduraux. Privilégiant l'information, c'est le principe du débat contradictoire (qui fournit de l'information) et non plus des droits de la défense qui est valorisé. La coopération de la personne poursuivie est très valorisée et sa non-coopération devient incompréhensible.
L'internalisation des sanctions dans les opérateurs produit deux évolutions majeurs. Tout d'abord, ils doivent eux-mêmes sanctionner les abus de marché, les détecter et les prévenir. Les obligations spéciales de vigilance se multiplient. L'obligation de vigilance des opérateurs eux-mêmes devient un pilier de la régulation.
L'autre évolution est la libération de la Régulation par rapport au territoire. L'opérateur étant moins dépendant des frontières que ne sont les Régulateurs et auteurs de réglementations (mais le droit souple se propage, y compris en répression), des abus de marchés peuvent être appréhendés sur plusieurs territoires en même temps, notamment par des programmes de compliance globaux.
________
⛏️Aller plus loin sur la question :
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Exerçant un pouvoir de sanction, le Régulateur doit informer la "personne concernée" de son droit de se taire (cons. const., 26 sept. 2025), 2025
🕴🏻M.-A. Frison-Roche et J.-Cl. Magendie (dir.), 📘Politique de sanction et régulation des marchés financiers, 2009
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Une politique de sanctions peut-elle être commune au Juge et au Régulateur ?, 2009
2 octobre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Ch. Lapp, "L’usage de l’arbitrage international pour renforcer l’obligation de Compliance : l’exemple du secteur de la construction", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.471-487.
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cette contribution est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur souligne que l'arbitrage est un mode de résolution des litiges qui est particulièrement prégnant dans le secteur de la construction, non seulement parce que les opérateurs y recourent beaucoup mais parce que cette activité engendrent des difficultés qui se prêtent à l'arbitrage et dans le même temps concernent des questions de Compliance.
Pour produire la sécurité requise et prenant comme focus le plan de Vigilance, l'auteur examine la façon dont des litiges peuvent naître à propos de celui-ci et à propos de quoi. Au regard de cela, sont examinées d'une part les cas dans lesquels des arbitrages peuvent être organisés à côté de la compétence légalement attribuée au Tribunal judiciaire de Paris et d'autre part la façon dont les arbitres vont apporter des solutions aux difficultés qui leur sont soumises.
________
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
2 octobre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Th. Goujon-Bethan, "Les enjeux présents à venir de l’articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.693-719.
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur montre que le Code de procédure civile, parce qu'il est exceptionnellement bien conçu et dirigé, peut répondre à l'ampleur de la transformation que le Droit de la Compliance apporte.
Le Droit de la Compliance est normativement ancré dans ses Buts Monumentaux : ceux-ci sont portés en tant que tels devant le juge dans des "causes systémiques".
Or, le Code de procédure civile distingue, et les travaux des auteurs du Code comme ceux de la doctrine le montrent, qu'il faut distinguer le litige et le conflit. En effet, dans une "cause systémique" telle que le Droit de la Compliance les emporte nécessairement (climat, protection des internautes, égalité effective des êtres humains, durabilité des systèmes bancaires, etc.) ce sont des parties qui sont en litiges, tandis que le conflit embrasse lui les systèmes eux-mêmes et d'autres entités.
La procédure doit intégrer non seulement le litige mais encore le conflit. Cela implique notamment que l'on s'occupe non seulement du litige, mais encore du conflit, lequel ne s'éteint pas nécessairement avec le litige, et ne trouve pas les mêmes solutions que celles demandées par le litige. C'est notamment dans cette dernière perspective, essentiellement dans une procédure de "Cause Systémique de Compliance" que les techniques de médiation, d'amicus curiae, d'un juge qui se situe ex ante, etc., s'imposent. Elles sont disponibles à travers des articles du Code de procédure civile : il suffit que les juges, comprenant ce que sont les "Causes Systémiques de Compliance" s'en saisissent.
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeur Marie-Anne Frison-Roche
________
2 octobre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Fr. Ancel, "Devoir de vigilance et litiges commerciaux : une compétence à partager ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.727-740.
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur prend les questions procédurales soulevées par le devoir de vigilance en tant que celui-ci est la « pointe avancée » du droit de la compliance. Après avoir rappelé ce à quoi oblige la loi de 2017 en matière de Plan de Vigilance, insistant sur les 2 types d'actions instituées par la loi pour assurer le respect du devoir de vigilance : l'action préventive en cessation de l'illicite, ouverte après la mise en demeure et l'action en responsabilité civile exerçable dans les conditions du droit commun, intervenant une fois le dommage survenu.
C'est la loi de 2021 dite Confiance qui a visé le Tribunal judiciaire de Paris, dans une compétence que l'on peut davantage qualifiée de "spéciale" que d'exclusive. L'auteur revient en détail sur les disputes auxquelles cette disputes à la fois met fin et pourtant déclenche à son tour, revenant sur la jurisprudence de la Cour de cassation qui s'est référé à la nature même du plan de vigilance et l'objet du litige. Il ressort donc que le litige peut ne concerner que la validité du plan, ne concernant alors que le TJ Paris, ou concerner une dispute par exemple entre la société qui a élaboré le plan et un de ses associés, auquel cas la compétence se partage.
L'article détaille toutes les situations procédurales renvoyant à des disputes dans lesquelles le Plan de Vigilance est plus ou moins au centre, ce qui implique plus ou moins soit une incompétence, soit un sursis à statuer, soit une connaissance de l'entier litige par une autre juridiction que le TJ Paris, l'auteur proposant à chaque fois des méthodes pour que des jurisprudences s'élabore afin que l'Obligation de Compliance n'en sorte pas émiettée, alors même que d'autres juridictions, par exemple les tribunaux de commerce, connaîtront du devoir de vigilance en ce qu'il interfère avec les actions relatives aux sociétés commerciales, le Plan ayant un lien direct avec la gestion de celles-ci, avec la nouvelle définition de l'objet social des sociétés et avec l'exercice du pouvoir de direction des entreprises. Ce "syncrétisme judiciaire", qu'exprimait la jurisprudence de la Cour de cassation, s'inscrit selon l'auteur dans ce qu'est le Droit de la Compliance qui dépasse la distinction entre les branches classiques du Droit.
Concrétisant cette vision générale, l'auteur pose que lorsque l'action a pour objet la légalité ou la validité du Plan, elle relève donc de la compétence spécialement conférée par la Loi au TJ Paris. Mais lorsque le plan n'est évoqué que d'une façon accessoire, et/ou le devoir de vigilance évoqué à un titre autre, la compétence naturelle de la jurisprudence saisie demeure, par exemple si la nullité d'une stipulation contractuelle est alléguée. Il est possible que ce type de litige soit plus fréquent et plus important que les actions principalement fondées sur l'illégalité du plan de vigilance. Ce contentieux contractuel pourrait naître aussi du fait que l'entreprise impose par le contrat, au titre des "actions adaptées", le respect de sa propre obligation de vigilance à ses collaborateurs et partenaires.
Les juges, par exemple les juges consulaires, sont alors fondés à interpréter et appliquer, les obligations de vigilance, dans l'esprit de la loi, notamment au regard des buts poursuivis. Il sera important que se dégage une façon commune de faire.
________
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
2 octobre 2025
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Lefebvre - Dalloz, 2025, 816 p.
____
📘Parallèlement, un ouvrage en anglais, Compliance Obligation, est publié dans la collection éditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Bruylant.
____
📚Ce volume s'insère dans la lignée des ouvrages qui dans cette collection dirigée par Marie-Anne Frison-Roche sont consacrés à la Compliance.
___
► Présentation générale de l'ouvrage : La compliance est parfois présentée comme ce à quoi l'on ne peut échapper, ce qui revient donc à y voir l'obligation juridique par excellence, le Droit pénal étant alors son mode d'expression la plus adéquate. Elle est parfois présentée comme ce que l'entreprise entreprise par souci éthique, relevant alors de l'opposé qu'est l'autorégulation. L'on n'a donc pas pour l'instant une vision unitaire de L'Obligation de Compliance. L'on l'a d'autant moins que la multitude de textes, eux-mêmes évoluant et changeant sans cesse, injectent des obligations de compliance si multiples et si diverses que l'on renonce à charge une unité, en se disant qu'au cas par cas, l'on définira un régime et une contrainte juridique plus ou moins forte, visant un assujetti ou un débiteur ou un autre, au bénéfice de l'un ou d'autre.
Cette absence d'unité, du fait de l'absence de définition de L'Obligation de Compliance, rend l'application des textes difficile à prévoir et fait donc craindre le Juge qui pourtant va prendre de plus en plus d'importance.
Par cet ouvrage, qui pose les questions pratiques A quoi oblige la Compliance ? Qui est obligé ?, Jusqu’où est-on obligé ? Qui peut obliger ? et y apporte des réponses, les pratiques, contraintes et innovation de Compliance seront mieux maîtrisées et anticipées par tous ceux qu'elles concernent : les entreprises, les parties prenantes, les techniciens, les juristes, les conseils, les institutions, les juridictions.
____
🏗️Construction générale de l'ouvrage : L'ouvrage s'ouvre sur un article d'Introduction qui, s'appuyant sur le droit positif, porte sur la conception unifiée que l'on peut, voire que l'on doit, avoir de l' "Obligation de Compliance" en ce que les entités obligées par les diverse réglementées soient toujours obligées de construire des "structures de compliance" (ce qui est une obligation de résultat) pour obtenir des uns et des autres des comportements pertinent pour l'obtention de ce que les Législateurs visent (leurs "Buts Monumentaux"), ce qui est le cœur du disponible et constitue pour les entités obligées une obligation de moyens. A cette obligation juridique peut s'adosser des actions qui ne sont pas juridiques, les régimes ne devant pas se confondre.
Le premier Titre de l'ouvrage vise à cerner l'Obligation de Compliance. Pour cela, son Chapitre I porte sur la Nature de cette obligation. Le Chapitre II traite des Espaces de l'obligation de compliance.
Le Titre II vise à articuler l'Obligation de Compliance et des branches du Droit.
Le Titre III de l'ouvrage envisage la manière dont on donne la possibilité d'obliger et dont on se donne les moyens d'obliger. Pour cela, son Chapitre I porte sur la Convergence des Sources de l'Obligation de Compliance. Son Chapitre II envisage l'Arbitrage International comme renfort de l'Obligation de Compliance. Le Chapitre III aborde quant à lui la Médiation, en tant que Voix de la Compliance.
Le dernier Titre de l'ouvrage est consacré à la Vigilance, pointe avancée de l'Obligation de Compliance. Son Chapitre I est consacré à l'étude des différents secteurs, et analyse les Intensités de l'Obligation de Vigilance, Pointe Avancée du Système de Compliance, en leur sein. Le Chapitre II aborde les Variations de Tensions engendrées par l'Obligation de Vigilance, Pointe Avancée du Système de Compliance. Enfin, son Chapitre III traite des Modalités Nouvelles de l'Obligation de Compliance, mises en lumière par l'Impératif de Vigilance.
____
TABLE DES MATIÈRES
ANCRER LES OBLIGATIONS DE COMPLIANCE SI DIVERSES
DANS LEUR NATURE, LEURS RÉGIMES ET LEUR FORCE
POUR DÉGAGER L'UNITÉ DE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE
LA RENDANT COMPRÉHENSIBLE ET PRATIQUABLE
♦️ Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
TITRE I.
CERNER L’OBLIGATION DE COMPLIANCE
CHAPITRE I : LA NATURE DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE
Section 1 ♦️ La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 ♦️ De la dette à l’obligation de compliance, par 🕴️Bruno Deffains
Section 3 ♦️ Obligation de compliance et droits humains, par 🕴️Jean-Baptiste Racine
Section 4 ♦️ L'Obligation de Compliance et les mutations de la souveraineté et de la citoyenneté, par 🕴️René Sève
Section 5 ♦️ La définition de l''obligation de compliance confrontée au droit de la cybersécurité par 🕴️Michel Séjean
CHAPITRE II : LES ESPACES DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE
Section 1 ♦️ Entités industrielles et Obligation de compliance, par 🕴️Etienne Maclouf
Section 2 ♦️ L'Obligation de Compliance dans les chaînes de valeur, par 🕴️Lucien Rapp
Section 3 ♦️ Compliance et conflits de lois. Le droit international de la vigilance-conformité à partir de quelques applications récentes sur le continent européen, par 🕴️Louis d'Avout
TITRE II.
ARTICULER L’OBLIGATION DE COMPLIANCE AVEC DES BRANCHES DU DROIT
Section 1 ♦️ Droit fiscal et obligation de compliance, par 🕴️Daniel Gutmann
Section 2 ♦️ L'obligation processuelle, prototype de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 3 ♦️ Le droit des sociétés et des marchés financiers face à l'Obligation de Compliance, par 🕴️Anne-Valérie Le Fur
Section 4 ♦️ Transformation de la gouvernance et obligation de vigilance, par 🕴️Véronique Magnier
Section 5 ♦️ La compliance environnementale et climatique, par 🕴️Marta Torre-Schaub
Section 6 ♦️ Obligations de compliance et concurrence : les liaisons dangereuses ?, par 🕴️Jean-Christophe Roda
Section 7 ♦️ L'obligation de compliance en droit global, par 🕴️Benoît Frydman & 🕴️Alice Briegleb
Section 8 ♦️ Les juges du droit des entreprises en difficulté et les obligations de compliance, par 🕴️Jean-Baptiste Barbièri
TITRE III.
COMPLIANCE : DONNER ET SE DONNER LES MOYENS D’OBLIGER
CHAPITRE I : LA CONVERGENCE DES SOURCES
Section 1 ♦️ "Obligation sur Obligation vaut", par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 ♦️ Les technologies disponibles, prescrites ou proscrites pour satisfaire Compliance et Vigilance, par 🕴️Emmanuel Netter
Section 3 ♦️ Contrainte légale et stratégie des entreprises en matière de Compliance, par 🕴️Jean-Philippe Denis et 🕴️Nathalie Fabbe-Costes
Section 4 ♦️ La loi, source de l’Obligation de Compliance, par 🕴️Jean-Baptiste Blanc
Section 5 ♦️ Opposition et convergence des systèmes juridiques américains et européens dans les règles et cultures de compliance, par 🕴️Raphaël Gauvain et 🕴️Blanche Balian
Section 6 ♦️ A quoi les engagements engagent, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
CHAPITRE II : L’ARBITRAGE INTERNATIONAL EN RENFORT DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE
Section 1 ♦️ L'activation par l'arbitrage de l'Obligation de Compliance pour une place d'arbitrage durable, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 ♦️ L’usage de l’arbitrage international pour renforcer l’obligation de Compliance : l’exemple du secteur de la construction, par 🕴️Christophe Lapp
Section 3 ♦️ L’arbitre, juge, superviseur, accompagnateur ?, par 🕴️Jean-Baptiste Racine
Section 4 ♦️ Comment l'arbitrage international peut être un renfort de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Laurent Aynès
TITRE IV.
LA VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE
Section 1 ♦️ La Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
CHAPITRE I : LES INTENSITÉS DE L’OBLIGATION DE VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DU SYSTÈME DE COMPLIANCE
Section 2 ♦️ L’intensité de l’Obligation de Vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs financiers, par 🕴️Anne-Claire Rouaud
Section 3 ♦️ L’intensité du devoir de vigilance dans le secteur bancaire, par 🕴️Mathieu Françon
Section 4 ♦️ L’intensité de l’obligation de vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs numériques, par 🕴️Grégoire Loiseau
Section 5 ♦️ L’obligation de vigilance des opérateurs énergétiques, par 🕴️Marie Lamoureux
CHAPITRE II : LES DISPUTES AUTOUR DE L'OBLIGATION DE VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DU SYSTÈME DE COMPLIANCE, DANS SON RAPPORT AVEC LA RESPONSABILITÉ
Section 1 ♦️ Le rapport entre le droit de la responsabilité civile et l'obligation de compliance, par 🕴️Jean-Sébastien Borghetti
Section 2 ♦️ Repenser le concept de responsabilité civile à l’aune du devoir de vigilance, pointe avancée de la compliance, par 🕴️Mustapha Mekki
Section 3 ♦️ Tensions et contradictions entre les instruments relatifs à la vigilance raisonnable des entreprises, par 🕴️Laurence Dubin
Section 4 ♦️ Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
CHAPITRE III : LES MODALITÉS NOUVELLES DE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE, MISES EN LUMIÈRE PAR L'IMPÉRATIF DE VIGILANCE
Section 1 ♦️ Clauses et contrats, modalités de l’obligation de vigilance, par 🕴️Gilles J. Martin
Section 2 ♦️ La preuve de la bonne exécution de la Vigilance au regard du système probatoire de Compliance, par 🕴️Jean-Christophe Roda
TITRE V.
LE JUGE ET L'OBLIGATION DE COMPLIANCE
Section 1 ♦️ Devoir de vigilance et litiges commerciaux : une compétence à partager ?, par 🕴️François Ancel
Section 2 ♦️ Les enjeux présents à venir de l’articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, par 🕴️Thibault Goujon-Bethan
Section 3 ♦️ Le juge de l’amiable et la compliance, par 🕴️Malik Chapuis
Section 4 ♦️ Le Juge requis pour une Obligation de Compliance effective, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
L'OBLIGATION DE COMPLIANCE : VISION D'ENSEMBLE
♦️ L'obligation de compliance, charge portée par les entreprises systémiques donnant vie au Droit de la Compliance. Lignes de force de l'ouvrage L'obligation de compliance (en accès libre) , par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
________
2 octobre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-S. Borghetti, "Le rapport entre le Droit de la responsabilité civile et l'Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur rappelle que pour établir une responsabilité civile, il faut trouver tout d’abord une faute, c’est-à-dire un écart par rapport à une obligation, ce qui déclenchera une obligation secondaire, celle de réparer. Mais l’on peut aussi soutenir que c’est de la responsabilité que naîtrait cette obligation première, la responsabilité civile révélant alors une obligation qui n’existait qu’implicitement. C’est notamment la conception de Geneviève Viney, établissant alors entre la responsabilité et l’obligation un rapport à double sens. L’obligation de compliance l’illustre, notamment à travers l’obligation de vigilance conçue par la loi de 2017.
L’auteur consacre donc la première partie de son étude à la responsabilité civile comme suite d’une obligation de compliance. Après avoir discuté le point de savoir si les contraintes engendrées par la compliance doivent être précisément d’ « obligation » puisqu’il n’y a pas de créancier, ce qui ouvre donc la voie à une responsabilité délictuelle, il examine les conditions d'engagement de cette responsabilité, qui sont difficiles notamment en ce qui concerne les charges de preuve et la démonstration du lien de causalité, l'exigence concernant celui-ci pouvant évoluer en droit français vers l'admission d'une causalité proportionnelle comme l'admet désormais dans certains cas la jurisprudence allemande.
Puis l’auteur traite dans la seconde partie de sa contribution l’hypothèse de la responsabilité civile comme révélateur d’une obligation de compliance. Il souligne que les demandes formées, notamment dans les affaires dites TotalOuganda et Milieudefensie c. Shell visent à obtenir du juge une telle "révélation". L'auteur estime que l'on ne peut pas tirer de la loi de 2017 qui renvoie à l'article 1240 du Code civil des obligations car cet article est visé pour organiser les conséquences d'une violation de l'article L.225-102-4 du Code de commerce (donc au titre de l'obligation secondaire décrite ci-dessus) et non pas pour nourrir ce qu'exige cet article au titre de l'obligation première (définie (ci-dessus).
________
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
________
2 octobre 2025
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Régulations & Compliance", JoRC & Dalloz

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Lefebvre - Dalloz, 2025, 816 p.
____
📘Parallèlement, un ouvrage en anglais, Compliance Obligation, est publié dans la collection éditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Bruylant.
____
🧮Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques 2023 organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.
____
📚Ce volume s'insère dans la lignée des ouvrages qui dans cette collection sont consacrés à la Compliance.
► Lire les présentations des autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :
- les ouvrages suivants :
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Compliance et contrat, 2026
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Le système probatoire de la Compliance, 2027
- les ouvrages précédents :
🕴️M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), 📕Compliance & droits de la défense. Enquête interne - CJIP - CRPC, 2024
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕La juridictionnalisation de Compliance, 2023
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Les outils de la Compliance, 2021
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019
🕴️N. Borga, 🕴️J.-Cl. Marin et 🕴️J-.Ch. Roda (dir.), 📕Compliance : Entreprise, Régulateur, Juge, 2018
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Régulation, Supervision, Compliance, 2017
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📕Internet, espace d'interrégulation, 2016
📚Consulter tous les autres titres de la collection.
___
► Présentation générale de l'ouvrage : La compliance est parfois présentée comme ce à quoi l'on ne peut échapper, ce qui revient donc à y voir l'obligation juridique par excellence, le Droit pénal étant alors son mode d'expression la plus adéquate. Elle est parfois présentée comme ce que l'entreprise entreprise par souci éthique, relevant alors de l'opposé qu'est l'autorégulation. L'on n'a donc pas pour l'instant une vision unitaire de L'Obligation de Compliance. L'on l'a d'autant moins que la multitude de textes, eux-mêmes évoluant et changeant sans cesse, injectent des obligations de compliance si multiples et si diverses que l'on renonce à charge une unité, en se disant qu'au cas par cas, l'on définira un régime et une contrainte juridique plus ou moins forte, visant un assujetti ou un débiteur ou un autre, au bénéfice de l'un ou d'autre.
Cette absence d'unité, du fait de l'absence de définition de L'Obligation de Compliance, rend l'application des textes difficile à prévoir et fait donc craindre le Juge qui pourtant va prendre de plus en plus d'importance.
Par cet ouvrage, qui pose les questions pratiques A quoi oblige la Compliance ? Qui est obligé ?, Jusqu’où est-on obligé ? Qui peut obliger ? et y apporte des réponses, les pratiques, contraintes et innovation de Compliance seront mieux maîtrisées et anticipées par tous ceux qu'elles concernent : les entreprises, les parties prenantes, les techniciens, les juristes, les conseils, les institutions, les juridictions.
____
🏗️Construction générale de l'ouvrage : L'ouvrage s'ouvre sur un article d'Introduction qui, s'appuyant sur le droit positif, porte sur la conception unifiée que l'on peut, voire que l'on doit, avoir de l' "Obligation de Compliance" en ce que les entités obligées par les diverse réglementées soient toujours obligées de construire des "structures de compliance" (ce qui est une obligation de résultat) pour obtenir des uns et des autres des comportements pertinent pour l'obtention de ce que les Législateurs visent (leurs "Buts Monumentaux"), ce qui est le cœur du disponible et constitue pour les entités obligées une obligation de moyens. A cette obligation juridique peut s'adosser des actions qui ne sont pas juridiques, les régimes ne devant pas se confondre.
Le premier Titre de l'ouvrage vise à cerner l'Obligation de Compliance. Pour cela, son Chapitre I porte sur la Nature de cette obligation. Le Chapitre II traite des Espaces de l'obligation de compliance.
Le Titre II vise à articuler l'Obligation de Compliance et des branches du Droit.
Le Titre III de l'ouvrage envisage la manière dont on donne la possibilité d'obliger et dont on se donne les moyens d'obliger. Pour cela, son Chapitre I porte sur la Convergence des Sources de l'Obligation de Compliance. Son Chapitre II envisage l'Arbitrage International comme renfort de l'Obligation de Compliance. Le Chapitre III aborde quant à lui la Médiation, en tant que Voix de la Compliance.
Le dernier Titre de l'ouvrage est consacré à la Vigilance, pointe avancée de l'Obligation de Compliance. Son Chapitre I est consacré à l'étude des différents secteurs, et analyse les Intensités de l'Obligation de Vigilance, Pointe Avancée du Système de Compliance, en leur sein. Le Chapitre II aborde les Variations de Tensions engendrées par l'Obligation de Vigilance, Pointe Avancée du Système de Compliance. Enfin, son Chapitre III traite des Modalités Nouvelles de l'Obligation de Compliance, mises en lumière par l'Impératif de Vigilance.
____
TABLE DES MATIÈRES
ANCRER LES OBLIGATIONS DE COMPLIANCE SI DIVERSES
DANS LEUR NATURE, LEURS RÉGIMES ET LEUR FORCE
POUR DÉGAGER L'UNITÉ DE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE
LA RENDANT COMPRÉHENSIBLE ET PRATIQUABLE
♦️ Obligation de Compliance : construire une structure de compliance produisant des effets crédibles au regard des Buts Monumentaux visés par le Législateur, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
TITRE I.
CERNER L’OBLIGATION DE COMPLIANCE
CHAPITRE I : LA NATURE DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE
Section 1 ♦️ La volonté, le cœur et le calcul, les trois traits cernant l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 ♦️ De la dette à l’obligation de compliance, par 🕴️Bruno Deffains
Section 3 ♦️ Obligation de compliance et droits humains, par 🕴️Jean-Baptiste Racine
Section 4 ♦️ L'Obligation de Compliance et les mutations de la souveraineté et de la citoyenneté, par 🕴️René Sève
Section 5 ♦️ La définition de l''obligation de compliance confrontée au droit de la cybersécurité par 🕴️Michel Séjean
CHAPITRE II : LES ESPACES DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE
Section 1 ♦️ Entités industrielles et Obligation de compliance, par 🕴️Etienne Maclouf
Section 2 ♦️ L'Obligation de Compliance dans les chaînes de valeur, par 🕴️Lucien Rapp
Section 3 ♦️ Compliance et conflits de lois. Le droit international de la vigilance-conformité à partir de quelques applications récentes sur le continent européen, par 🕴️Louis d'Avout
TITRE II.
ARTICULER L’OBLIGATION DE COMPLIANCE AVEC DES BRANCHES DU DROIT
Section 1 ♦️ Droit fiscal et obligation de compliance, par 🕴️Daniel Gutmann
Section 2 ♦️ L'obligation processuelle, prototype de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 3 ♦️ Le droit des sociétés et des marchés financiers face à l'Obligation de Compliance, par 🕴️Anne-Valérie Le Fur
Section 4 ♦️ Transformation de la gouvernance et obligation de vigilance, par 🕴️Véronique Magnier
Section 5 ♦️ La compliance environnementale et climatique, par 🕴️Marta Torre-Schaub
Section 6 ♦️ Obligations de compliance et concurrence : les liaisons dangereuses ?, par 🕴️Jean-Christophe Roda
Section 7 ♦️ L'obligation de compliance en droit global, par 🕴️Benoît Frydman & 🕴️Alice Briegleb
Section 8 ♦️ Les juges du droit des entreprises en difficulté et les obligations de compliance, par 🕴️Jean-Baptiste Barbièri
TITRE III.
COMPLIANCE : DONNER ET SE DONNER LES MOYENS D’OBLIGER
CHAPITRE I : LA CONVERGENCE DES SOURCES
Section 1 ♦️ "Obligation sur Obligation vaut", par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 ♦️ Les technologies disponibles, prescrites ou proscrites pour satisfaire Compliance et Vigilance, par 🕴️Emmanuel Netter
Section 3 ♦️ Contrainte légale et stratégie des entreprises en matière de Compliance, par 🕴️Jean-Philippe Denis et 🕴️Nathalie Fabbe-Costes
Section 4 ♦️ La loi, source de l’Obligation de Compliance, par 🕴️Jean-Baptiste Blanc
Section 5 ♦️ Opposition et convergence des systèmes juridiques américains et européens dans les règles et cultures de compliance, par 🕴️Raphaël Gauvain et 🕴️Blanche Balian
Section 6 ♦️ A quoi les engagements engagent, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
CHAPITRE II : L’ARBITRAGE INTERNATIONAL EN RENFORT DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE
Section 1 ♦️ L'activation par l'arbitrage de l'Obligation de Compliance pour une place d'arbitrage durable, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 ♦️ L’usage de l’arbitrage international pour renforcer l’obligation de Compliance : l’exemple du secteur de la construction, par 🕴️Christophe Lapp
Section 3 ♦️ L’arbitre, juge, superviseur, accompagnateur ?, par 🕴️Jean-Baptiste Racine
Section 4 ♦️ Comment l'arbitrage international peut être un renfort de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Laurent Aynès
TITRE IV.
LA VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DE L’OBLIGATION DE COMPLIANCE
Section 1 ♦️ La Vigilance, pointe avancée et part totale de l'Obligation de Compliance, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
CHAPITRE I : LES INTENSITÉS DE L’OBLIGATION DE VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DU SYSTÈME DE COMPLIANCE
Section 2 ♦️ L’intensité de l’Obligation de Vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs financiers, par 🕴️Anne-Claire Rouaud
Section 3 ♦️ L’intensité du devoir de vigilance dans le secteur bancaire, par 🕴️Mathieu Françon
Section 4 ♦️ L’intensité de l’obligation de vigilance selon les secteurs : le cas des opérateurs numériques, par 🕴️Grégoire Loiseau
Section 5 ♦️ L’obligation de vigilance des opérateurs énergétiques, par 🕴️Marie Lamoureux
CHAPITRE II : LES DISPUTES AUTOUR DE L'OBLIGATION DE VIGILANCE, POINTE AVANCÉE DU SYSTÈME DE COMPLIANCE, DANS SON RAPPORT AVEC LA RESPONSABILITÉ
Section 1 ♦️ Le rapport entre le droit de la responsabilité civile et l'obligation de compliance, par 🕴️Jean-Sébastien Borghetti
Section 2 ♦️ Repenser le concept de responsabilité civile à l’aune du devoir de vigilance, pointe avancée de la compliance, par 🕴️Mustapha Mekki
Section 3 ♦️ Tensions et contradictions entre les instruments relatifs à la vigilance raisonnable des entreprises, par 🕴️Laurence Dubin
Section 4 ♦️ Compliance, Vigilance et Responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
CHAPITRE III : LES MODALITÉS NOUVELLES DE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE, MISES EN LUMIÈRE PAR L'IMPÉRATIF DE VIGILANCE
Section 1 ♦️ Clauses et contrats, modalités de l’obligation de vigilance, par 🕴️Gilles J. Martin
Section 2 ♦️ La preuve de la bonne exécution de la Vigilance au regard du système probatoire de Compliance, par 🕴️Jean-Christophe Roda
TITRE V.
LE JUGE ET L'OBLIGATION DE COMPLIANCE
Section 1 ♦️ Devoir de vigilance et litiges commerciaux : une compétence à partager ?, par 🕴️François Ancel
Section 2 ♦️ Les enjeux présents à venir de l’articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, par 🕴️Thibault Goujon-Bethan
Section 3 ♦️ Le juge de l’amiable et la compliance, par 🕴️Malik Chapuis
Section 4 ♦️ Le Juge requis pour une Obligation de Compliance effective, par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
L'OBLIGATION DE COMPLIANCE : VISION D'ENSEMBLE
♦️ L'obligation de compliance, charge portée par les entreprises systémiques donnant vie au Droit de la Compliance. Lignes de force de l'ouvrage L'obligation de compliance (en accès libre) , par 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
________
2 octobre 2025
Auditions par une commission ou un organisme public

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Audition par le collège thématique "RSE" de l'Observatoire des litiges judiciaires de la Cour de cassation, " Points de contact entre le Droit de la Compliance et la RSE", Cour de cassation, 2 octobre 2025.
____
► Résumé de la présentation : La présentation dure une demie-heure. Elle est construite en deux temps, tout d'abord une présentation générale sur les "points de contact entre Droit de la compliance et RSE", en ce qu'ils dépendent de la conception que l'on a en pratique du Droit de la compliance, puis, dans la mesure où cette perspective intéresse plus particulièrement le collège thématique, un approfondissement sur les conséquences processuelles qu'il convient d'en tirer.
PREALABLE. DISTINGUER NETTEMENT LE DROIT DE LA COMPLIANCE DE LA RSE, SEULE VOIE POUR LES ARTICULER
1. ne pas confondre la morale, source d'inspiration du Droit, et le Droit.
Le Droit a des sources multiples, économiques, sociales, morales et religieuses. Les impératifs moraux inspirent le Droit, guident ceux qui adoptent des règles juridiques, guident les comportements. Mais ce sont deux ordres différents. Kelsen a construit sa "théorie pure" du Droit pour protéger le système juridique afin qu'il ne soit qu'inspiré par des valeurs qui sont dans une Norme fondamentale hors du système juridique. Ce que l'on appelle RSE est une norme qui inspire de nombreux blocs de compliance, par exemple Sapin 2, la loi Vigilance, la CSRD, la CS3D, etc. mais, de la même façon que la responsabilité juridique ne transforme pas le Deutéronome en Droit, ces textes ne transforment pas la RSE en Droit. Le Droit demeure autonome, n'est pas l'agent d'efficacité de l'éthique, qui trouverait enfin la puissance du Droit à son service.
De la même façon que le Droit économique n'est pas la façon dont des "lois économiques" trouvent une plus grande efficacité. Cela serait une erreur de pénétration entre deux ordres, et une vassalisation pour le Droit qui deviendrait l'agent d'effectivité d'une norme qui lui est hétéronome. Les économistes ne veulent pourtant au bénéfice de ce qui serait la loi économique. Carl Schmitt le voulait au bénéfice de ce qui serait la loi politique. Il est impératif dans un Etat de Droit que le Droit garde son autonomie par rapport à l'économie, à la politique et à l'éthique (ESG, RSE).
2. la loi peut, pour des motifs moraux, imposer à l'entreprise des obligations juridiques légales
Le Droit l'a toujours fait.
3. la responsabilité morale et la responsabilité juridique sont distinctes : la première n'entraîne pas ipso facto la seconde
4 l'entreprise peut par sa volonté s'imposer des obligations qui expriment des choix moraux, dès l'instant qu'ils ne contredisent pas la loi : elle juridicise sa responsabilité morale, les deux obligations se superposant
🔴mafr, 📝"Obligation sur obligation vaut", 2025
I. CE QU'EST EN PRATIQUE LE DROIT DE LA COMPLIANCE, BATI SUR L'OBLIGATION DE COMPLIANCE A LAQUELLE L'ENTREPRISE EST ASSUJETTIE
1. définition faible et définition forte de la compliance : ne pas réduire le Droit à une peau de chagrin, aider par sa "juridictionnalisation" à ce que la branche naissante du Droit de la compliance grandisse dans sa conception européenne
🔴 mafr (dir.),📕 Pour une Europe de la Compliance, 2019
🔴 mafr (dir.),📕 Les buts monumentaux de la compliance, 2022
🔴 mafr (dir.),📕 L'obligation de compliance , 2025
2. le rôle central du juge dans le droit européen de la compliance, en construction
🔴 mafr (dir.),📕 La juridictionnalisation de la compliance , 2024
3. l'obligation de vigilance, pointe avancée de l'obligation de compliance,
🔴mafr, 📝La vigilance, pointe avancée et part totale de l'obligation de compliance, 2025
II. POINTS DE CONTACT ENTRE L'OBLIGATION DE COMPLIANCE DES ENTREPRISES CRUCIALES ET LA RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES
1. définition de l'obligation de compliance à laquelle l'entreprise cruciale est assujettie
2. "Obligation sur obligation vaut"
🔴mafr, 📝"Obligation sur obligation vaut", 2025
3. cumul possible des deux natures, engagement de droit, engagement de fait : régime juridique (ex. La Haye, 12 nov. 2024, Shell)
🔴mafr, 📝A quoi engagent les engagements, 2025
4. ll n'existe pas d'obligation juridique générale de veiller sur autrui ; il existe des obligations spéciales, une obligation spéciale sur l'entreprise maîtresse de sa chaine de valeur et, par exemple un souci éthique que l'entreprise, par sa volonté, peut juridiciser
🔴mafr, 📝Compliance, vigilance et responsabilité civile : mettre en ordre et raison garder, 2025
III. PERSPECTIVE PROCESSUELLES DES POINTS DE CONTACT ENTRE DROIT DE LA COMPLIANCE ET RSE
1. Nature transitivement systémique du contentieux de la compliance
🔴mafr, 📝Les causes systémiques portées devant le juge, 2021
🔴mafr, 📝Droit de la compliance et contentieux systémique, 2025
🔴mafr (dir.), 📕 Contentieux systémique émergent, 2025
2. Double primauté : trouver des solutions ; avoir souci du futur
🔴🧮Dans l’espace de justice, les pratiques juridictionnelles au service du futur, 2024
🔴Th. Goujon-Bethan, 📝Les enjeux présents et à venir de l'articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, 2025
3. Régression de la méthode punitive, efficacité du principe contradictoire et de l'accusatoire comme mode d'obtention des informations, engagements et "programmes"
🔴F. Ancel, 📝Devoir de vigilance et litiges commerciaux : une compétence à partager ?, 2025
🔴M. Chapuis, 📝Le juge de l'amiable et la compliance, 2025
🔴Th. Goujon-Bethan, 📝Les enjeux présents et à venir de l'articulation des principes de procédure civile et commerciale avec la logique de compliance, 2025
4. Préserver les droits de la défense et la sagesse probatoire dont les pavés sont attaqués dans le paradis de la RSE
🔴mafr, 📝Le juge, l'obligation de compliance et l'entreprise. Le système probatoire de la Compliance, 2023
🔴 mafr et M. Boissavy (dir.),📕 Compliance et droits de la défense. Enquêtes internes, CJIP, CRPC, 2024
🔴J.-Ch. Roda, 📝La preuve de la bonne exécution de la vigilance au regard du système probatoire de compliance,2025
____
2 octobre 2025
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Droit processuel, prototype de l'Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.209-233.
____
📝lire l'article
____
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
📚voir une présentation de la collection "Régulations & Compliance" dans laquelle le livre est publié
____
► Résumé de l'article : À première abord le Droit processuel semble la moins concernée de toutes par l'obligation de compliance car si les sujets de droit assujettis, principalement les grandes entreprises, se soumettent à celle-ci c'est précisément pour, grâce à cet Ex Ante, ne jamais avoir à faire avec la procédure, chemin qui mène au Juge, ce personnage de l'Ex Post qu'en contrepartie du poids de l'Obligation de compliance il leur a été fait promesse qu'elles ne verront jamais, toute perspective processuelle semblant signifier l'échec même de l'Obligation de compliance (I).
Mais non seulement les règles juridiques attachées à la procédure s'imposent parce que le Juge s'avère présent, et de plus en plus, dans les mécanismes de compliance mais encore ce sont des règles de Droit processuel et non pas une juxtaposition de procédure civile, procédure pénale, procédure administrative, etc., parce que l'obligation de compliance elle-même n'est pas enfermée ni dans le droit civil, ni dans le droit pénal ,dans le contentieux administratif, etc., ce qui donne en pratique primauté à ce qui les réunit toutes : le Droit processuel (II).
A cette raison que l'on pourrait dire "négative" de la présence du Droit processuel s'ajoute une raison positive, parce que le Droit processuel s'avère être le prototype du "Contentieux systémique de la Compliance, et notamment de la pointe avancée de celui-ci qu'est l'obligation de vigilance (III). Il gouverne notamment les actions par lesquelles les Juges peuvent être saisis (IV), les principes autour desquels les procédures se déroulent, avec une opposition accrue entre le principe du contradictoire qui épouse l'obligation de compliance puisque l'un et l'autre traduisent le principe d'information et les droits de la défense qui ne les servent pas nécessairement, heurt qui va poser une difficulté processuelle de principe (V).
Enfin, et la qualité de "prototype" se justifie alors plus encore, parce que le Droit de la compliance a juridictionnalisé les entreprises dans la façon dont celles-ci mettent en oeuvre leurs Obligation légale de Compliance, c'est en respectant et en s'appuyant sur les principes de droit processuel que cela doit être fait, notamment à travers non seulement les sanctions mais encore les enquêtes internes (VI).
________
1 octobre 2025
droit illustré
🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "La Justice en marbre. Dans l'église San Carlo de Noto, si on lève les yeux, la Justice est là, regardant la Prudence, la Force et la Tempérance", article de la Newsletter Droit & Art, octobre 2025.
____
🌐Consulter la publication de cet article dans la Newsletter MaFR Droit & Art : cliquer ici
____
🗺️lire une présentation générale de la ville sicilienne de Noto
____
► Résumé de l'article : Dans l'église San Carlo de la ville de Noto en Sicile, un statuaire rassemble la Justice, tenant une balance et dont les yeux ne sont pas bandés, qui regarde face à elle la statue de la Prudence,se penchant vers un enfant qui la regarde. Elle a de part et d'autre la statue de la Force, au pied de laquelle est l'Aigle, et la Tempérance, qui porte un sac très lourd.
Pour contempler les quatre vertus qui s'épaulent les unes les autres il faut d'abord monter les marches très nombreuses qui mènent au bâtiment puis au sein de celui-ci prendre le temps de lever les yeux car elles ont été placées en hauteur, loin du vacarme des passants.
____
🔓lire l'article ci-dessous⤵️

30 septembre 2025
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
 ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Si le stratégème probatoire du Roi Salomon n'avait pas fonctionné, document de travail, octobre 2025
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Si le stratégème probatoire du Roi Salomon n'avait pas fonctionné, document de travail, octobre 2025
____
📝Ce document de travail est la base de l'article à paraître dans les Mélanges dédiés à Pierre Crocq.
____
► Résumé du document de travail : Le
_____
🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
27 septembre 2025
Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Exerçant un pouvoir de sanction, le Régulateur doit informer la "personne concernée" de son droit de se taire (cons. const., 26 sept. 2025)", Newsletter MAFR Law, Compliance, Regulation, 27 septembre 2025
____
📧Lire par abonnement gratuit d'autres news de la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
____
► Résumé de l'article : Le Conseil constitutionnel a rendu le 26 septembre 2025 une décision n°2025-1164 , Société Eurotitrisation et autres qui déclare une disposition du Code monétaire et financier contraire à la Constitution.
Le Conseil déclare, et cela ne surprend pas notamment parce qu'il enrichit une jurisprudence débutée en 2016 affirmant régulièrement le caractère constitutionnel et autonome du "droit de se taire", que le fait pour le CMF de ne pas contraindre la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) à informer une personne concernée de son droit de se faire rend de ce meme fait le dispositif procédural organisé par ce texte (IV de l'art.L 621-15 CMF, qui ne formulait qu'en termes généraux l'obligation de respecter le principe du contradictoire et des droits de la défense, sans viser le droit de se taire) contraire à la Constitution.
Cette sanction, intègre donc la règle dans la loi française, car en censurant à effet immédiat un silence le Conseil injecte immédiatement le droit de se taire dans les procédues en cours devant la Commission des sanctions de l'AMF (I). La solution était prévisible et vaut pour toutes les Autorités de régulations (II). Mais elle montre les tensions entre l'exercice du pouvoir spécial de sanction, qui appelle le droit de se taire au profit des "personnes concernées" et le pouvoir général de régulation, dont la sanction n'est pourtant qu'un outil, régulation qui suppose l'obtention d'informations et supporte mal ce silence (III). Plus largement, c'est l'affrontement entre l'impératif des secrets et l'impératif de l'information qui se déroule (IV).
____
📧lire l'article publié le 27 septembre dans la Newsletter MAFR - Law, Compliance, Regulation
4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-B. Racine, "L’arbitre, juge, superviseur, accompagnateur ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : l'auteur pose dès le départ ce qui est en jeu en ces termes : "Quel rôle peut ou pourrait jouer l’arbitre dans les dispositifs de compliance ? Selon le rôle qu’il est amené à jouer, il peut ou pourrait venir en renfort de l’obligation de compliance. Poser cette question, c’est poser la question des pouvoirs de l’arbitre et de son office. C’est aussi, d’une certaine manière, renvoyer à la notion même d’arbitrage.".
Concrètement l'arbitre se saisit des questions de compliance en tant qu'il est un juge. Les litiges mettant en cause des allégations de faits de corruption l'illustrent, l'arbitre ne pouvant évidemment pas par sa sentence donner effet à une pratique de corruption, sauf à violer lui-même l'ordre public international. Mais en cela, l'arbitre n'applique qu'une norme légale, l'enjeu principal étant de nature probatoire, les outils de compliance servant souvent d'indices de la corruption elle-même. L'on quitte la source légale en abordant les normes émises par la CCI en matière de lutte contre la corruption et l'on entre véritablement dans l'obligation, au sens strict, apparaît lorsqu'un contrat apparaît.
Emergent des usages du commerce international, non seulement en matière de probité mais encore pour la protection des droits humains, dont l'arbitre peut être aujourd'hui le garant. Il peut le faire notamment à travers le contentieux émergent relatif au devoir de vigilance, soit directement lorsque les plans de vigilance sont en cause, et cela malgré la compétence du Tribunal judiciaire de Paris, soit si l'on imagine qu'un plan comporte lui-même un système de recours à l'arbitrage, ce qui impliquerait un changement de culture, ou si l'on considère que du droit souple sont en train d'émerger des usages du commerce international posant un devoir de vigilance que l'arbitre pourrait reprendre.
Dans la seconde partie de sa contribution, l'auteur prend une seconde configuration, plus audacieuse, à savoir un arbitre appréhendant la Compliance, en ce qu'il serait plus qu'un Juge, c'est-à-dire faisant plus que trancher un litige en application du Droit.
Cela serait concevable puisqu'on tend à considérer qu'il pourrait modifier les contrats et si l'on s'inspire de la technique des arbitrages pratiqués pour les engagements dans le Droit des concentrations. Pour donner à l'arbitrage la dimension régulatoire requise, il faudrait que le tiers puisse exercer une fonction de supervision, ce à quoi la notion de "litige" se prête guère d'autant plus qu'un arbitre n'étant institué que pour être juge, s'il cesse d'être cela il est difficile qu'il demeure arbitre.... Mais l'on pourrait pourtant concevoir qu'en Ex Post l'arbitre puisse exercer cette fonction de monitoring souvent requise en Compliance. La technique des disputes boards est à cet égard inspirante. Les deux matières, arbitrage et compliance, ont ainsi vocation à se rapprocher, car les deux limites classiques, l'arbitrabilité et le litige, sont en train d'évoluer pour ne plus faire obstacle à un tel rapprochements.
L'auteur peut donc conclure : "C’est aux différents acteurs de la compliance de penser à l’arbitrage, et à la souplesse, la plasticité et la liberté qu’il offre, pour éventuellement le configurer spécialement au service des buts de la compliance.".
________
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-B. Barbièri, "Les juges du droit des entreprises en difficulté et les obligations de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, sous presse.
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Désignant à première vue l'intersection de la Compliance et des procédures collective comme le "mariage de la carpe et du lapin", l'auteur montre que la logique en est sur de nombreux points communs, notamment par l'office qu'y exerce le Juge, car il s'agit toujours d'une délégation que l'Etat fait de Buts Monumentaux, les procédures collectives venant concrétiser la volonté de sauver une entreprise, des emplois, une industrie, une région, etc., dans ce qui est toujours un "intérêt public". Dans son office, le Juge des procédures collectives est confronté à des clauses de compliance, portant sur des engagements ou des informations ou organisant des monitorings.
L'auteur examine tout d'abord les cas dans lesquels le Juge des procédures collectives confronte le principe de primauté des procédures collectives sur cette organisation de compliance, soit au titre des contrats en cours, qui peuvent contenir des obligations de compliance notamment parce que les audits et les contrôles auront été renforcés ou qu'une résiliation automatique serait prévue (qui serait alors désactivée ?), soit parce que s'abattent les nullités de la période suspecte, parce que les clauses de compliance sont souvent déséquilibrées.
Puis dans une seconde partie, est examinée l'hypothèse dans laquelle les techniques de compliance vont venir en soutien des procédures collectives elles-mêmes et du But que celles-ci servent. En effet, parce qu'ils sont par nature préventifs, les mécanismes contractuels de compliance peuvent aussi prévenir les défaillances, par des clauses d'audit et de monitoring et la mise en place de reporting, au besoin sous le suivi du Juge associé à des mécanisme de conciliation.
Plus encore, il faut les utiliser pour restructurer les entreprises en difficulté. Le plan, qui peut être imposé aux créanciers, doit ouvrir la palette des instruments, pourrait peut-être viser cette classe de parties qui ne serait constituée que des créanciers bénéficiant de clauses de compliance, si l'on considère qu'ils constituent une "communauté d'intérêt économique suffisante". Ils pourraient alors eux-aussi avoir une délégation de surveillance sur la survie de l'entreprise, but monumental du plan. Dans le cas d'un plan de cession, une offre comprenant des engagements de compliance ne devrait pas être privilégiée puisque la loi expressément ne donne à ce plan pour but que d'assurer le maintien d'activités et d'apurer le passe. Mais l'avenir dira si le juge ne dépassera pas cela.
________
4 septembre 2025
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'activation par l'arbitrage de l'obligation de Compliance pour une place d'arbitrage durable", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2025, pp.451-470.
____
📝lire l'article
____
🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article : La première partie de l'étude mesure les rapports en évolution entre le Droit de l'Arbitrage et le Droit de la Compliance, qui dépendent de la définition même de la définition même de l'Obligation de Compliance (I). En effet, ces rapports ont été de nature négative tant que l'on a appréhendé la Compliance sous le seul aspect de la "conformité", c'est-à-dire de la seule obéissance aux règles et de la sanction. Ces rapports sont en train de se métamorphoser, parce que l'Obligation de Compliance renvoie à une définition positive et dynamique, ancrée dans les Buts Monumentaux que les entreprises ancrent dans des contrats qui structurent leur chaines de valeur.
S'appuyant sur cette évolution, la deuxième partie de l'étude vise à établir les techniques de l'arbitrage et l'office de l'arbitre pour accroître l'efficience systémique de l'Obligation de Compliance, renforçant ainsi l'attractivité de la place (II). C'est tout d'abord affaire de culture, celle de la Compliance devant pénétrer dans le monde arbitral, et réciproquement. Pour cela, il convient de tirer profit du fait qu'en Droit de la Compliance la distinction entre le Droit public et le Droit privé est moins prégnante, tandis que le souci de la longue durée de relations structurelles contractuellement forgées est premier.
Pour favoriser un tel mouvement de déploiement de l'Obligation de l'Obligation de Compliance, favorisant le renforcement d'une Place d'Arbitrage durable (III), le premier outil est le contrat. Puisque celui-ci structure les chaines de valeur et permet aux entreprises assujetties d'exécuter leur Obligation légale de compliance mais aussi d'y adjoindre leur propre volonté, des clauses ou offres relevant de l'arbitrage gagnent à y être insérées. En outre, des textes, non contraignants, peuvent dessiner un principe directeur pour que le souci des Buts Monumentaux soit pris en considération par les arbitres.
________
4 septembre 2025
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L. Aynès, "Comment l’arbitrage international peut être un renfort de l’Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteur part du constat premier comme quoi l'arbitrage international et la compliance sont naturellement ajustés puisqu'ils sont tous deux une manifestation de la mondialisation, expriment un dépassement des frontières, l'arbitrage pouvant reprendre les buts monumentaux de la compliance puisqu'il a engendré un ordre arbitral substantiellement global.
Mais l'obstacle réside dans la source de l'arbitrage demeure le contrat, l'arbitre n'exerçant qu'une juridiction temporaire dont la mission est donnée par ce contrat. Pourtant l'avènement de l'ordre global arbitral permet ce dépassement, l'arbitre puisant dans des normes dont les buts monumentaux de la compliance et les engagements des entreprises peuvent faire partie. Ce faisant l'arbitre devient un organe indirect de ce droit de la compliance dont on voit l'émergence.
Puis la contribution évoque une seconde évolution, qui pourrait faire de l'arbitre un organe direct de concrétisation de la compliance. Pour cela, il faut que l'arbitre non seulement contraigne à l'exécution d'obligation de faire, ce qui est déjà le mouvement au titre des mesures provisoire, mais encore ait une conception plus ample ce qu'est le conflit pour lequel une solution est requise, voire se libère un peu de cette source contractuelle qui le cerne. Cela est possiblement en train de se dessiner, en miroir de la transformation profonde de l'office du juge.
________
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

29 août 2025
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, Obligation de la compliance et contentieux systémique, document de travail, août 2025.
____
📝 Ce document de travail a été élaboré pour servir de base à l'article paru ultérieurement au Recueil Dalloz dans la Chronique MAFR - Droit de la compliance :
►Voir les présentations des chroniques précédentes :
- "Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler", 2024.
- "La loi, la compliance, le contrat et le juge: places et alliances", 2023
- "Contrat de compliance, clauses de compliance", 2022
- "L'aventure de la Compliance", 2020
- "Compliance et personnalité", 2019
____
► Résumé du document de travail : Les systèmes juridiques ont changé, le droit de la compliance dans son unicité traduit ce changement et y participe puissamment. Par de nouveaux blocs de règles de compliance, notamment au niveau européen, en matière de protection des données (RGPD), de lutte contre le blanchiment (AMLA), de protection de l'équilibre climatique (CS3D), de durabilité des systèmes bancaires et financiers (Union bancaire), des techniques (toujours les mêmes) ont été mises au point et imposées aux grandes entreprises qui doivent les manier : alertes, cartographie, évaluation, sanction, etc. Ces nouveaux blocs réglementaires n'ont de sens que par rapport à leurs "buts monumentaux" : en Ex Ante détecter des risques systémiques et prévenir des crises pour que les systèmes considérés ne s'écoulent pas, qu'ils "durent". Tous les instruments juridiques des corpus s'ancrent normativement dans ces buts monumentaux qui sont le coeur qui unifie le droit de la compliance (I).
De cet ancrage normatif nouveau et très amibiteux reposant sur la capacité pratique des entreprises à faire cela, c'est le juge qui en est le gardien (II). Il veille à ce que les dispositions techniques s'appliquent d'une façon téléologique dans chacun de ces blocs de compliance et que les réglementations s'appuient les unes par rapport aux autres car c'est toujours le même but systémique que toutes les réglementations de compliance servent : faire en sorte que les systèmes (bancaire, financier, climatique, numérique, énergétique, etc., ne s'effondrent pas, perdurent, que les êtres humains présents et futurs n'en soient pas broyés mais au contraire en bénéficient. Cette unité est encore peu perçue car les réglementations pulvérisent cette unité profonde du droit de la compliance dans la myriade de dispositions changeantes. Confier la "masse réglementaire" à des algorithmes accroît cette pulvérisation qui rend l'ensemble toujours plus incompréhensible et donc impossible à manier. Reconnaître au contraire au Juge sa place, c'est-à-dire au centre, permet de maîtriser cette nouvelle branche du Droit. Mais le juge n'a pas pour seul fonction de redonner de la clarté à un ensemble recouvert par la poussière de sa propre technicité.
Il y a transmission au contentieux de l'objet systémique du Droit de la Compliance. En effet le contentieux qui émerge du nouveau Droit de la Compliance est un contentieux lui-aussi fondamentalement nouveau, et ce par transitivité. En effet, le Droit de la Compliance a pour objet de rendre les systèmes durables (ou soutenables, ou résilients, le vocabulaire varie). Il en résulte un contentieux qui est lui-même un "contentieux systémique" (III), le plus souvent ouvert par une organisation contre un opérateur systémique. La place et le rôle de chacun en sont métamorphosés (IV).
____
🔓lire les développements ci-dessous⤵️
20 août 2025
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (34)
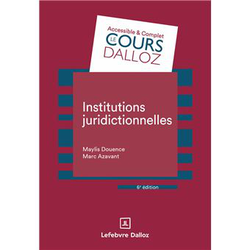
► Référence complète : M. Douence et M. Azavant, Institutions juridictionnelles, 1ière éd. 2010, 6ième éd. 2025, Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 2025, 425 p.
____
►Présentation de l'ouvrage : La nouvelle édition de cet ouvrage expose les "Institutions juridictionnelles", expression qui a remplacé heureusement celle "d'Institutions judiciaires", c'est-à-dire les principes, les structures et les personnes qui permettent la réalisation de la mission de trancher les litiges et de dire le droit. Sont ainsi analysés la justice administrative et judiciaire, les juridictions et les acteurs que sont les magistrats et les auxiliaires de justice, notamment les avocats.
L'ouvrage est destiné aux étudiants et à ceux qui préparent des concours administratifs ou par exemple l'examen d'entrée aux Écoles de formation des Barreaux.
____
📚 Dans la même collection, il s'articule avec les ouvrages de :
____
📚 Voir l'ensemble des ouvrages de la même collection 📎"Cours Dalloz -Série Droit privé"
________
20 août 2025
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Cours-Série Droit privé", Editions Dalloz (34)
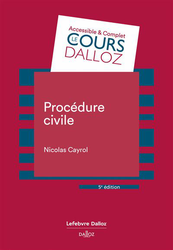
►Référence complète : N. Cayrol, Procédure civile, 5ème éd., Coll. "Cours Dalloz-Série Droit privé", Dalloz, 2025, 569 p.
____
►Présentation de l'ouvrage : L'étude de la procédure civile est indispensable à tous les étudiants désireux d'embrasser une « carrière judiciaire » : magistrat, avocat, huissier, etc. Par nombre d'aspects, la procédure civile est bien, en effet, un droit professionnel, un droit à l'usage des professionnels du procès. La matière figure d'ailleurs aux épreuves des concours et examens d'accès à ces professions.
Mais la procédure civile n'est pas seulement un droit professionnel : elle traite de problèmes qui intéressent tous les juristes, quels qu'ils soient, qu'ils pratiquent ou non la procédure. La connaissance des notions procédurales de base est nécessaire pour la bonne compréhension de nombreuses questions de droit.
___
📚Voir l'ensemble des ouvrages de la même collection "Cours Dalloz -Série Droit privé", créée et dirigée par Marie-Anne Frison-Roche,
et notamment ceux qui traitent des branches du Droit interférant avec la Procédure civile :
📕 Procédures civiles d'exécution
📕 Institutions juridictionnelles
_______

15 août 2025
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
____
 ► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La part du gracieux dans le traitement juridictionnel de la compliance, document de travail, août 2025.
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La part du gracieux dans le traitement juridictionnel de la compliance, document de travail, août 2025.
____
📗Ce document de travail a été élaboré pour constituer une contribution aux Mélanges offerts à Dominique d'Ambra remis et publiés en octobre 2026.
____
► Résumé du document de travail : Partant de la définition de l'office juridictionnel, des principes procéduraux qui en découlent et des pouvoirs que le juge exerce en conséquence, l'objet de cette étude est de mesurer la part de gracieux qui existe dans le traitement juridictionnel de la compliance. Elle est quasiment ignorée, alors qu'on devrait lui donner la première place. En effet, parce que des systèmes sont impliqués dans les cas de compliance portés devant le juge civil ou commercial, on assiste à un développement de cette part gracieuse. En effet, la matière gracieuse se distingue des procédures gracieuses unilatérales et cette part gracieuse tient à ce qu'examine le juge, éventuellement à l'occasion d'un litige.
La première partie de la contribution vise donc à décrire le développement naturel de la part gracieuse de l'office du juge pour appréhender les cas de compliance qui lui sont soumis. Cette part résulte du fait que, même déclenchés par un litige, ce qui est soumis au juge est une situation composée par un système, lequel ne peut pas défendre devant le juge civil ou commercial ses intérêts dans ce contentieux systémique issu de la nature même du Droit de la compliance et des obligations de compliance qu'il engendre. Plus encore, c'est le futur dont les intérêts doivent être considérés et protégés, ce que le juge doit faire directement.
Il en découle la seconde partie de la contribution, invitant à repenser la procédure et l'office du juge de la compliance, pour que la matière gracieuse y trouve sa part. Le juge doit ainsi vérifier qu'il n'y a pas de conflits d'intérêts dans la personne des litigants, y compris dissimulés et doit apprendre à connaître les systèmes impliqués. Le principe inquisitoire doit donc s'accroître. Mais en même temps, comme il s'agit avant tout non pas de trancher un litige mais de régler une situation systémique, le juge doit faciliter les mouvements des parties, le principe accusatoire doit lui-aussi monter en puissance. Cette activation d'une démarche gracieuse puissance, non pas comme une exception mais comme un principe plein en articulation avec un principe contentieux, le litige n'étant qu'un accès manié par des parties nécessaires pour permettre à des situations systémiques de compliance d'être réglées, doit être favorisée.
____
🔓lire le document de travail ci-dessous⤵️
19 juin 2025
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : L. Rapp, "Équilibres instables. L'office du juge à l'épreuve du devoir de vigilance", AJDA, 2025, Etude, n01074.
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
19 juin 2025
Base Documentaire : Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (A.C.P.R.)
► Référence complète : ACPR, Comm. sanct., déc. n°2024-02, 19 juin 2025, Banque Delubac et Cie
____
_______