Matières à Réflexions
2 juin 2021
Compliance : sur le vif

►Le parquet européen, arme majeure d'effectivité du Droit de la Compliance.
Le procureur de l'Union européenne sort de son berceau : le "parquet européen" commence ses activités. Long à se mettre en place, cet organe judiciaire européen est articulé à des procureurs délégués dans les Etat-membre. Il n'est pas un simple émanation d'organes nationaux mis en réseau ; de compétence autonome, il est l'organe au nom duquel l'action est faite.
A cette révolution de nature institutionnelle, s'ajoute une révolution substantielle : ce parquet européen peut poursuivre toute atteinte aux "intérêts financiers de l'Union européenne". Ces "atteintes aux intérêts financiers" sont conçues largement, incluant notamment les actes de corruption ou de détournement de fond.
En premier lieu, Didier Reynders souligne que cela met l'Etat de Droit au centre. Ce n'est plus l'Europe venant en appui des actions à coordonner entre Etats, les parquets nationaux ayant des difficultés techniques à coopérer efficacement entre eux, mais le Parquet européen qui permettra une action européenne unifiée et efficace entre procureurs délégués.
En deuxième lieu, cela continue le cordage d'efficacité entre la compliance, située en Ex Ante, le Droit de la Compliance consistant à "prévenir" et à "détecter" de tels comportements, et l'Ex Post, car il faut bien un juge pour que parfois la méconnaissance de ces obligations Ex Ante soient sanctionnées (➡️📝Frison-Roche, M.-A., Compliance et ordre public international: la conception française préservée par la cour d'appel de Paris, 2021) mais aussi une poursuite : le procureur est une figure majeure du Droit de la Compliance. En effet, pouvant poursuite, le procureur peut aussi ne pas poursuivre et échanger sa décision de fermer le dossier contre des engagements (Ex Ante) de l'entreprise : les "conventions judiciaires d'intérêt public" - CJIP. De fait, à travers l'opportunité des poursuites, une telle puissante flexibilité sera-t-elle retrouvée au niveau européen ?
En troisième lieu, la perspective de poursuite du Parquet Européen va inciter en Ex Ante les entreprises à prévenir, ou à poursuivre elles-mêmes (➡️🎤Frison-Roche, M.-A. et Roda, J.-C. (dir.), L'entreprise, instituée juge et procureur d'elle-même par le Droit de la Compliance, Lyon, 23 juin 2021) les auteurs de fraudes aux intérêts l'Union européenne. Au moment où l'Union s'engage dans des emprunts directs pour prêter plus encore, ce rôle de l'entreprise, parfois qualifié de "procureur privé", articulé à un procureur, désormais européen, est nécessaire.
Allons-nous vers l'alliance de tous les procureurs ?
_____
2 juin 2021
Publications

Référence générale : Frison-Roche, M.-A.., Rights, primary and natural Compliance Tools, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Compliance Tools, série "Regulation & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2021, p. 319-342
___
Résumé en français de l'article (publié en anglais)
Dans la conception traditionnelle de l'architecture des secteurs régulés par le Droit et dans le Droit de la Compliance qui prolonge les techniques étatiques de Régulation, les droits subjectifs ont peu de place. Mais cette configuration n'a plus lieu, au contraire les droits subjectifs sont aujourd'hui au cœur, et le seront de plus en plus. Ils sont et seront les outils premiers du Droit de la Compliance parce qu'ils constituent un "outil" d'une grande efficacité pour assurer le fonctionnement entier d'un système dont les buts sont si difficiles à atteindre. Parce qu'il faut faire feu de tout bois pour concrétiser ces buts, les Autorités publiques non seulement s'appuient sur la puissance des opérateurs cruciaux, mais encore distribuent des prérogatives aux personnes qui, ainsi incitées, activent le système de Compliance et participent à la réalisation du "but monumental". Les droits subjectifs peuvent s'avérer les outils les plus efficaces pour atteindre effectivement les buts fixés, à tel point qu'on peut les considérer comme des "outils premiers".
Mais il convient d'avoir plus de prétention et de concevoir les droits subjectifs comme les outils les plus "naturels" du droit de la Compliance. En effet parce que tous les Buts Monumentaux par lesquels le Droit de la Compliance se définit peuvent se ramener à la protection des personnes, c'est-à-dire à l'effectivité de leurs prérogatives, par un effet de miroir entre les droits subjectifs donnés comme moyens par le Droit aux personnes et les droits subjectifs qui constituent le but même de tout le Droit de la Compliance, notamment la protection de tous les êtres humains, même s'ils sont en situation de grande faiblesse, les droits subjectifs devenant un "outil naturel" du Droit de la Compliance. Nous ne sommes qu'à l'orée de leur déploiement et c'est sans doute sur eux que pourra se réguler l'espace digital dans lequel désormais nous vivons, afin que nous n'y soyons pas étouffés et qu'il constitue pour les personnes un espace civilisé.
____
Consulter une présentation générale du volume dans lequel l'article a été publié.
____
2 juin 2021
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection Compliance & Regulation, JoRC et Bruylant

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Tools, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll "Régulations & Compliance", 2021, 357 p.
____
📕Parallèlement, un ouvrage en français, Les outils de la Compliance, est publié dans la collection "Régulations & Compliance", co-éditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz
____
🧮Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires
____
Cet ouvrage en langue anglaise constitue le 1ier titre de cette collection entièrement consacrée au Droit de la Compliance, en ce que celui-ci est le prolongement du Droit de la Régulation.
📚Lire la présentation des autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :
🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Obligation, 2024
🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, 2023
🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Monumental Goals, 2023
📚Consulter les autres titres de la collection
📚Cette collection en langue anglaise s'articule avec une collection coéditée entre le Journal of Regulation & Compliance et Dalloz
____
► Présentation générale de l'ouvrage : The political dimension of Compliance Law lies in the goals it aims to achieve. To achieve them, the concern for these goals is internalized in "crucial operators", which may be obliged to concretize "monumental goals" set by public authorities. These public bodies control the Ex Ante reorganization that this implies for these companies and sanction Ex Post the possible inadequacy of the companies, which have become transparent to this end. The effectiveness and efficiency of this internalization, without which the statement of these goals is worth nothing, is based on the Compliance tools that are deployed.
These appear to be truly diverse but their substantial unity (topic which will be the subject of a forthcoming book) makes it possible to study the tools put in place from a unique perspective, by not isolating them in a particular branch of Law, Criminal law or International Law for example, but by measuring what is common to them, notably Anticipation, Trust, Commitment, Responsibility, Incentive, and so on. If the Compliance tools vary, it is not only according to the sectors, finance and banking appearing then as the advanced point of the general Compliance Law, for example in environmental matters, but also according to the countries and the cultures. It is in fact about them that legal cultures seem to oppose.
The book aims to understand these "tools" by going beyond the description of each instrument, for which we already have many monographs, for analyzing them through the issues of Risks, required Expertises, Training. Sovereignty claims, Incentives, mechanical aptitude of Technologies. It is through these themes that are analyzed by the authors, experts in the field, what we always want to understand better: Compliance Programs, Whistleblowing, Mapping, Sanctions, Extraterritoriality, etc.
____
📘Consulter le sommaire de l'ouvrage.
____
► Appréhender l'ouvrage à travers la table des matières ci-dessous et les résumés de chacun des articles :
INTRODUCTION
📝Frison-Roche, M.-A., Describing, designing and correlating Compliance Tools to Have a Better Use of It
I. LEGAL AND ECONOMIC APPROACHES TO COMPLIANCE TOOLS
📝Frison-Roche, M.-A., Building by Law the Unicity of Compliance Tools from the Definition of Compliance Law by its "Monumental Goals"
🕴️L. Benzoni et B. Deffains, 📝An Economic Approach to Compliance Tools: Finality, Measure, and Effectivity of Constrained or Chosen Compliance
II. RISK MAPPING, CENTRAL COMPLIANCE TOOL
III. PLACE AND USE OF INCENTIVES IN COMPLIANCE SYSTEMS
IV. THE REQUIRED EXPERTISES IN TERMS OF COMPLIANCE
V. THE GEOGRAPHICAL DOMINANCE OF COMPLIANCE TOOLS
VI. THE MEASURE OF COMPLIANCE TOOLS EFFECTIVITY
VII. TRAINING, ALPHA AND OMEGA OF COMPLIANCE
VIII. TECHNOLOGICAL TOOLS AND COMPLIANCE BY DESIGN
CONCLUSION
📝Amico, Th., Compliance or the passage from ex post to ex ante: A Copernican revolution for the criminal lawyer?
📝Banck, A., The maturity of the Compliance tool’s user, first criterion of the choice of the salient tool
📝Burlingame, R., Coppens, K., Power, N., Lee, D.H., Anti-Corruption Compliance: Global Dimension of Enforcement and Risk Management
📝Calandri, L., Incentive(s) and Self-Regulation(s): which place for Compliance Law in the Audiovisual Sector?
📝Causse, H., Compliance Training: Through and Beyond Traditional Legal Training
📝Frison-Roche, M.-A., Drawing up Risk Maps as an obligation and the paradox of the "Compliance risks"
📝Frison-Roche, M.-A., Incentives and Compliance, a couple to propel
📝Frison-Roche, M.-A., Resolving the contradiction between sanctions and incentives under the fire of Compliance Law
📝Frison-Roche, M.-A., Rights, primary and natural Compliance Tools
📝Frison-Roche, M.-A., Training: content and container of Compliance Law
📝Galland, M., The Regulator's Inspection of the Effectiveness of the Compliance Tools Implemented by the Company
📝Granier, C., The Normative Originality of Compliance by Design
📝Guillaume, N., Compliance risk mapping: first insights of challenges, limits and good practices
📝Guttierez-Crespin, A., Audit of Compliance Systems
📝Koenigsberg, S. and Barrière, F., The Development of Attorney's Compliance Expertise
📝Larouer, M., The Manifestation of Incentives Mechanisms in French Compliance Law
📝Merabet, S., Morality by Design
📝Pailler, L., Technological Tools, Compliance by Design and GDPR: the Protection of Personal Data from Design
📝Racine, J.-B., Geographical dominance in the choice and the use of Compliance Tools. Introductory remarks
📝Rapp, L., Incentive Theory and Governance of Space Activities
📝Roda, J.-C., Compliance by design in antitrust: between innovation and illusion
📝Salah, M., Conception and Application of Compliance in Africa
📝Tardieu, H., Data Sovereignty and Compliance
📝Thouret, T., Training and Compliance, Two Correlated Information Transmission Tools
________
1 juin 2021
Compliance : sur le vif

29 mai 2021
Compliance : sur le vif

26 mai 2021
Base Documentaire : 09. Juridictions étrangères
► Référence complète : Rechtbank Den Haag (Tribunal de La Haye), 26 mai 2021, aff. C/09/571932 / HA ZA 19-379, Vereniging Milieudefensie et a. c/ Royal Dutch Shell PLC.
____
____
🏛️lire la traduction française du jugement
____
📝commentaires de la décision :
- D. 2021, pp. 1968-1970, obs. A.-M. Ilcheva
- EEI, nov. 2021, n° 11, comm. 86, note F.-G. Trébulle
- JSS, 14 août 2021, n° 59, p. 14, tribune C. Lepage, V. Saintaman et B. Denis
- Gaz. Pal., 27 juillet 2021, n° 28, p. 24, art. n° 424w6, note M.-P. Maître
________
11 mai 2021
Base Documentaire : 05.1. CEDH
► Référence complète : CEDH, 3ième sect., 11 mai 2021, Halet c. Luxembourg, n° 21884/18.
____
____
► Voir l'arrêt de Grande chambre du 14 février 2023 qui casse cette décision.
________
5 mai 2021
Base Documentaire : 08. Juridictions du fond
Référence complète : Paris, 5 mai 2021, Carrefour
____
La société Carrefour Hypermarchés commande et achète des produits référencés par sa centrale de référencement, Carrefour Marchandises Internationales (CMI), notamment ceux de la la société I2C. Or, le responsable du référencement des produits de cette société s'était vu offrir des voyages par ce fournisseur (certes avant l'établissement de la Charte éthique).
Un audit avait révélé cela après l'adoption de la charte. Par conséquent, la société CMI a mis fin à sa relation commerciale avec ce fournisseur.
Contestée sur l'allégation du caractère brutal de la rupture des relations commerciale, la Cour estime que cela est justifié car la violation de la charte éthique pouvait fonder la rupture immédiate des relations commerciales, indépendamment de leur date en raison de leur gravité.
- Voir dans le même rattachement à l'obligation de vigilance sur les manquements du fournisseur, justifiant la cessation immédiate de toutes relations commerciales :
- Paris, 13 mars 2019, Monoprix , n°17/21477 ;
- Paris, 24 mars 201, Promod, n°19/15565
________
21 avril 2021
Base Documentaire : Doctrine
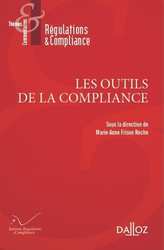
► Référence complète : Th. Amico, "La Compliance ou le passage de l'ex post à l'ex ante. Une révolution copernicienne pour l'avocat pénaliste ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 145-154.
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Après s'être référé à diverses définitions du Droit de la Compliance, l'auteur insiste sur l'utilité de l'avocat pénaliste en ce que celui-ci, connaisseur de l'Ex Post que constitue la sanction, peut être de bon conseil dans l'Ex Ante dans lequel se développent de nouveaux mécanismes de compliance, comme la cartographie des risques ou l'évaluation des tiers.
Abordant la dimension punitive du Droit de la Compliance, l'auteur montre que l'avocat pénaliste y a donc naturellement sa place, qu'il s'agisse des pouvoirs exercés par une Autorité administrative ou du Droit pénal proprement dit. En ce qu'il peut "anticiper les procédures pénales", l'avocat pénaliste est donc le mieux à même de faire en sorte que l'entreprise ne s'y expose pas, notamment dans une bonne maîtrise des enquêtes internes, écartant ainsi d'elle le risque pénal.
____
🦉Les étudiants de Marie-Anne Frison-Roche peuvent avoir accès au texte intégral
________
21 avril 2021
Base Documentaire : Doctrine
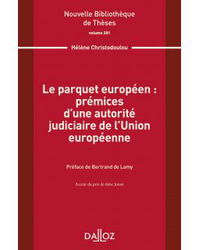
► Référence complète : H. Christodoulou, Le parquet européen : prémices d'une autorité judiciaire de l'Union européenne, préf. B. de Lamy, Dalloz, coll. "Nouvelle Bibliothèque de Thèses", vol. 201, 2021, 518 p.
____
Lire la synthèse des propositions de l'étude
____
► Résumé de l'ouvrage (fait par l'auteure) : "La libre circulation des délinquants n'a jamais été accompagnée de l'ouverture des frontières aux autorités de poursuite d'Europe. Cette situation paradoxale, partiellement résolue par une coopération judiciaire étroite entre les États membres, semble insoutenable à l'aune des phénomènes criminels actuels. La mise en place d'un nouvel acteur s'est donc imposée. Concrètement, le parquet européen, en ce qu'il aurait des pouvoirs propres transcendant ceux des États membres, disposerait d'une compétence pour diriger des enquêtes et déclencher des poursuites sur le territoire de l'Union, pour lutter, au départ, contre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne.
Après de multiples débats, le règlement lié à sa création, constituant le fruit d'un compromis délicat, a finalement été adopté le 12 octobre 2017. Dès lors, la mise en place d'une autorité de poursuite européenne ne relève plus d'un mythe, mais devient, en elle- même, une réalité empreinte de métamorphoses au sein de l'Union européenne. Cette dernière devrait influer tant sur les réactions des États membres que de l'Union elle-même, qui ne pourront rester inertes face à son apparition.
Cette imbrication de systèmes nationaux et européen a soulevé de nombreuses difficultés à la fois organiques et fonctionnelles qui ont été décryptées afin d'en comprendre les enjeux. L'étude du statut du parquet européen imposait de circonscrire corrélativement la notion d'autorité judiciaire au sein de l'Union européenne ; l'analyse de son fonctionnement supposait de déterminer les normes régissant son action et les organes de contrôle de ses prérogatives.
En définitive, cette étude invitera le lecteur à se questionner, plus largement, sur l'émergence d'une véritable justice pénale de l'Union européenne.".
________
31 mars 2021
Base Documentaire : Doctrine
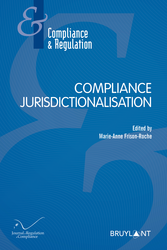
► Référence complète : E. Kleiman, "The objectives of compliance confronted with the actors of arbitration", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître.
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par l'auteur) : International arbitration, which remains the preferred method for the resolution of disputes arising from international commercial relations, has been overtaken by compliance, the manifestations of which are everywhere: arbitral institutions, arbitrators and courts exercising curial supervision of the international regularity of awards are regularly called upon to take into account rules of compliance.
Compliance has undeniably got a hold on the arbitration community. Being operators in an unregulated activity, arbitral institutions and arbitrators must generate trust; their ability to effectively self-regulate is a prerequisite for the success of arbitration and requires transparency and exemplarity. This self-imposed compliance is nowadays consubstantial to arbitration and is illustrated in such classic fields as prevention of conflicts of interest and control of arbitrators' availability, but also in the more recent domains of parity and diversity as well as reduction of the carbon footprint. Moreover, compliance has caught up with the ex post control of the international regularity of arbitral awards in matters involving allegations of corruption and money laundering. There is room for debate, particularly in France, because of the porosity of the boundaries between the methods that are specific to those mandatory rules of compliance that intend to prevent the most serious offences, and the methods that are specific to the establishment of the constituent elements of such crimes before criminal courts. This is an important issue, especially as the increasingly imperative nature of climate change and human rights regulations will extend the scope of these overlaps between compliance methods and the control of arbitral awards.
Arbitration is also taking over compliance. Arbitrators are called upon to rule on controversies arising from economic activities that are related to compliance: contracts relating to the implementation of preventive measures in the fields of anti-corruption, anti-money laundering and human rights as well as transactions relating to the reduction of the carbon footprint and climate change, etc. Moreover, compliance is also an arbitrable matter and arbitrators must apply or take into consideration the observance or disregard of rules of compliance when adjudicating commercial or investment disputes.
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
31 mars 2021
Conférences

 Référence complète: Frison-Roche, M.-A.,Compliance et Arbitrage : un adossement, rapport de synthèse in Frison-Roche, M.-A. & Racine, J.-B. (dir.) Compliance et Arbitrage, Colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherches sur la Justice et le Règlement des Conflits (CRJ) de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), avec le soutien de la Cour Internationale d'Arbitrage, Paris, 31 mars 2021.
Référence complète: Frison-Roche, M.-A.,Compliance et Arbitrage : un adossement, rapport de synthèse in Frison-Roche, M.-A. & Racine, J.-B. (dir.) Compliance et Arbitrage, Colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et le Centre de recherches sur la Justice et le Règlement des Conflits (CRJ) de l'Université Panthéon-Assas (Paris II), avec le soutien de la Cour Internationale d'Arbitrage, Paris, 31 mars 2021.
____
🗓️ Lire le programme de ce colloque
____
✏️Le rapport de synthèse a été réalisé au fur et à mesure que se déroulait le colloque : se reporter aux notes prises durant le colloque.
____
Voir le rapport de synthèse en vidéo
Voir l'intégralité du colloque en vidéo.
___
📅 Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour de la Juridictionnalisation de la Compliance.
📕 Les interventions ont servi de première base à la réalisation d'un titre dans l'ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche, dont la version française, La juridictionnalisation de la Compliance, est co-édité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz.
📘 Elles ont été de la même façon la première base pour la version anglaise de l'ouvrage, Compliance Juridictionalisation, co-édité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant.
_________
31 mars 2021
Base Documentaire : Doctrine
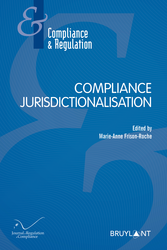
► Référence complète : J.-B. Racine, "Compliance and arbitration. An attempt at problematisation", in M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Jurisdictionalisation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître.
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Jurisdictionalisation, dans lequel cet article est publié
____
► Le résumé ci-dessous décrit un article qui suit une intervention dans le colloque Compliance et Arbitrage, co-organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Ce colloque a été conçu par Marie-Anne Frison-Roche et Jean-Baptiste Racine, co-directeurs scientifiques, et s'est tenu à Paris II le 31 mars 2021.
Dans le livre, l'article sera publié dans le Titre III, consacré à : Compliance andArbitration.
____
► Résumé de l'article : Under the consideration of the "Compliance Jurisdictionalisation", it is necessary to study in the links between Compliance and Arbitration. The arbitrator is a judge, he is even the natural judge of international trade. Arbitration is therefore naturally intended to meet compliance which transforms the action of companies in an international context. However, the links between compliance and arbitration are not obvious. It is not a question of providing firm and definitive answers, but rather, and above all, of asking questions. We are at the start of reflection on this topic, which explains why there is, for the time being, little legal literature on the subject of the relationship between Compliance and Arbitration. It doesn't mean there aren't connections. Quite simply, these relations may not have come to light, or they are in the making. We should research the existing or potential bridges between two worlds that have long gravitated separately: Compliance on the one hand, Arbitration on the other. The central question is: is or can the arbitrator be a compliance judge, and, if so, how?
In any event, the Arbitrator is thus in contact with matters requiring the methods, tools and logic of Compliance. In addition to the prevention and suppression of corruption, three examples can be given.
- Arbitration has been facing economic sanctions (notably embargoes) for several years. The link with Compliance is obvious, insofar as texts providing for economic sanctions are often accompanied by compliance mechanisms, as in the United States. The arbitrator is concerned as to the fate he reserves in the treatment of the dispute with the measures of economic sanctions.
- Competition Law is a branch that came into contact with Arbitration from the end of the 1980s. The arbitrability of this type of dispute is now established and arbitrators apply it regularly. At the same time, Compliance has also entered Competition Law, admittedly more strongly in the United States than in France. The existence, absence or insufficiency of a compliance program aimed at preventing violations of the competition rules are thus circumstances which may assist the arbitrator in the assessment of anti-competitive behavior.
- Environmental Law is also concerned. There is environmental Compliance, for example with regard to the French law of March 27, 2017 on the duty of vigilance. Companies are thus responsible for participating in the protection of the environment, by internalizing these concerns in their internal and external operations (in their sphere of influence). As soon as an arbitrator is in charge for settling a dispute relating to Environmental Law, the question of the relationship to Compliance, from this angle, naturally arises.
It is therefore the multiple interactions between Compliance and Arbitration, actual or potential, which are thus open.
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
__________
29 mars 2021
Base Documentaire : Soft Law
Référence compléte : Cukierman, C., A. et Bonnecarrère, Ph., Rapport du Sénat, La judiciarisation de la vie publique, 2022.
Mme Cécile CUKIERMAN, Rapporteur M. Philippe BONNECARRÈRE
____
24 mars 2021
Base Documentaire : Tribunal constitutionnel allemand (Cour de Karlsruhe)
► Référence complète : Bundesverfassungsgericht (Tribunal constitutionnel allemand), arrêt du premier sénat, 24 mars 2021 (publié le 29 avril 2021), n° 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20
____
🏛️lire la décision (en français)
____
🏛️lire le communiqué de presse (en français)
________
19 mars 2021
Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel
► Référence complète : Conseil constitutionnel, 19 mars 2021, décision n° 2021-891 QPC, Association Générations futures et autres
____
____
________
17 mars 2021
Base Documentaire : Soft Law
► Référence complète : D. Hever (dir.), Rapport sur les droits de la défense des personnes physiques dans l’enquête interne, mars 2021.
____
________
2 mars 2021
Base Documentaire : 08. Juridictions du fond
Référence complète: Tribunal administratif de Paris, 4ième section, 1ère Chambre, Oxfam France, Notre Affaire à tous, Fondation pour la Nature et l’Homme et Greenpeace France, 3 février 2021, n°1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1
Lire le communiqué de presse du Tribunal administratif de Paris
23 février 2021
Base Documentaire : Doctrine
►Référence complète : Quentin B. et Voiron F., La victime dans la procédure de CJIP : entre strapontin et siège éjectable, AJ pénal, 2021, p.15 et s.
____
2 février 2021
Base Documentaire : 05. CJCE - CJUE
Référence complète: CJUE, 2 février 2021, DB contre Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), affaire C‑481/19
Lire les conclusions de l'avocat général
Résumé de la conclusion de l'arrêt par la CJUE:
"Une personne physique soumise à une enquête administrative pour délit d’initié a le droit de garder le silence lorsque ses réponses pourraient faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal ou sa responsabilité pénale".
Pour aller plus loin, lire:
- Frison-Roche, M.-A., Résoudre la contradiction entre "sanction" et "incitation" sous le feu du Droit de la Compliance, 2021
- Frison-Roche, M.-A., Les droits subjectifs, outils premiers et naturels de la Compliance, 2021
29 janvier 2021
Base Documentaire : Juridictions étrangères diverses
► Référence complète : Gerechtshof Den Haag (Cour d'appel de La Haye), 29 janvier 2021, aff. C/09/365498, HA ZA 10-1677 et C/09/33089, HA ZA 09-0579, Milieudefensie, Fidelis Ayoro Oguru, Alali Efanga. c/ Shell Petroleum N.V.
____
🏛️lire la décision (en anglais)
________
Mise à jour : 14 janvier 2021 (Rédaction initiale : 14 décembre 2020 )
Conférences

► Référence générale : M.-A. Frison-Roche, "L'attractivité économique de l'impartialité, in "L'attractivité économique, l'office du juge et l'impartialité. Penser l'office du juge", colloque Cour de cassation, 14 décembre 2020.
___
____
📝 Lire le programme de ce colloque.
📝 Consulter le programme récapitulatif des colloques successifs du cycle.
____
📝 Lire le document de travail ayant servi de base à la réalisation de cette conférence. : Ce document de travail est sensiblement différent de la conférence, car il avait été conçu à l'origine. La conférence prend davantage en considération les conférences précédentes et les propos des deux autres intervenants, puisqu'il s'agit d'une Table-Ronde.
📊 Consulter les slides ayant servi de base
Les slides n'ont pas pu être projetés lors du colloque. A l'oral, il a été plus adéquat de développer plus longuement les propos introductifs, pour insister sur la dimension humaine et singulière de l'office du juge, attendue en matière économique. De ce fait, la seconde partie de la conférence n'a pas été faite à l'oral, les slides demeurent donc de ce seul fait les seuls supports.
____
► Résumé de la Conférence : Pour s'insérer dans l'ambition du cycle général de colloques qui est de "Penser l'Office du Juge" et dans celui-ci qui appréhende l'impératif d'attractivité économique de celui-ci, le propos dégage tout d'abord le rapport qui paraît contradictoire entre celui-ci et la distance que le juge doit conserver. Ainsi il est souvent affirmé que le juge devrait être à ce point internalisé dans les "places", notion économique de grande portée (à laquelle est consacrée la première partie de l'introduction, définissant la "place" à la fois comme un espace close et poreux et comme un "justiciable systémique") qu'il devrait ipso facto perdre sa distance, c'est-à-dire son impartialité. Comme les places sont en concurrence, même si l'on met en balance l'efficacité de la place, d'une part, et l'impartialité, d'une part, d'un juge qui lui est extérieur et se réfère au Droit, l'Impartialité en ressortirait nécessairement affaiblie. Il faudrait alors au cas par cas amener le juge à faire les concessions voulues.
Le propos vise à prendre la position contraire et poser que les places - notamment parce qu'il faut les distinguer fortement des marchés, dont elles furent les ancêtres - requièrent un juge, qui sont à la fois "singulier", c'est-à-dire avec une personnalité, un visage, des opinions, et en distance pour que sa fantaisie ne surprenne pas les places. En effet, celles-ci requièrent une justice humaine, et non pas mécanique et le juge singulier, dont le juge des référés ou l'arbitre sont l'épigone, répond à ce besoin. Mais pour réduire ces "marges de discrétion", façon dont l'économie qualifie l'impartialité d'une personne qui ne peut jamais être neutre, la façon de faire de ce juge doit être insérée dans des mécanismes qui diminuent ces marges. De cette façon, la place a alors un juge qui est toujours plus impartial, et ce faisant devient toujours plus attractive.
Pour obtenir cela en pratique, la place exprime deux attentes légitimes en tant que "justiciable systémique", dont la satisfaction accroit et l'impartialité du juge singulier et accroit l'attractivité de la place comme espace. Ce qui montre bien qu'attractivité de la place et impartialité du juge, parce qu'inséré dans des procédures et dans une institution et une famille juridictionnelle, ne sont non seulement pas contradictoires, mais sont au contraire convergents, l'un alimentant l'autre.
Concrètement, et la pratique juridictionnelle le montre, il faut consolider l’impartialité du juge singulier en l’insérant dans des processus collectifs. Comme il faut favoriser un rayonnement de l’impartialité par un renforcement de la « famille juridictionnelle ».
Pour consolider l'impartialité du juge singulier en l'insérant dans des processus collectif, il faut admettre sans hésiter la subjectivité du juge, la rechercher même, le juge des référés ou l'arbitre étant bien les épigones du juge adéquat. La réduction des marges de discrétion, définition de l'impartialité étant obtenue par l'insertion du juge dans une procédure dont il est seul le maître mais dans laquelle il n'est pas seul. Cela a pour conséquence technique qu'il est lui-même dans un débat contradictoire, non seulement pendant l'instance, mais encore avant celle-ci (dans les médias), par le jugement (et l'arrêt de la Chambre criminelle du 25 novembre 2020 est un modèle du genre) et après le jugement. En cela le juge montre que par son office il est dans le futur, comme le montrera la justice climatique. En outre pour limiter ses marges de discrétion, le juge singulier doit s'insérer dans un principe rationnel de cohérence, vertical et horizontal. Vertical parce qu'il intègre ce qu'il est dit et la technique de "l'avis déterminant" est à encourager, le juge singulier ne devant s'y soustraire que s'il a de "fortes raisons" pour le faire et selon cette règle générale Comply or Explain (qui est le contraire même de l'obéissance aveugle). Horizontal parce que le juge soit se tenir à ce qu'il a dit, l'estoppel étant elle-aussi une règle de logique. Mais surtout l'institution doit dégager le plus possible des "doctrines", par tous les moyens, dont les rapports annuels sont un exemple.
Pour consolider l'impartialité du juge singulier en renforçant la "famille juridictionnelle", il convient d'en avoir une conception plus large, ce qui pourrait mener à des "lignes directrices" communes à des juridictions diverses, et plus forte, en intégrant ceux qui entourent le juge pour mener jusqu'au jugement. En cela la procédure devant la Cour de Justice de l'Union européenne, travail sur un dossier commun, est un modèle. Si cette communauté était plus forte encore, l'office du juge rendrait un plus grand service encore qu'il ne fait déjà dans l'espace numérique.
Ainsi, des juges toujours humains, toujours divers, toujours singuliers, qui écoutent, considèrent et ajustent à la situation, qui au sein d'une famille juridictionnelle s'insèrent dans une doctrine institutionnelle qui les dépassent et les portent mais qu'ils transforment s'il y a une forte raison, toujours dite, pour ce faire : voilà l'impartialité incarnée rend ant une place économique et financière attractive.
_________
24 décembre 2020
Base Documentaire : 02. Lois
Référence complète: Loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée
22 décembre 2020
Base Documentaire : Juridictions étrangères diverses
► Référence complète : Cour Suprême de Norvège, 22 décembre 2020, People v Artic Oil.
____
🏛️Lire la décision (en anglais, traduction non-officielle)
________
9 décembre 2020
Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Dezeuze, E. , La proportionnalité des sanctions administratives en matière économique et financière, in Mélanges en l'honneur d'Alain Couret, Un juriste pluriel, Editions Francis Lefebvre et Dalloz, 2020, pp.683-701.
Consulter la présentation générale de l'ouvrage dans lequel cet article a été publié.