Matières à Réflexions
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

La "libéralisation" désigne le processus de fin légal d’une organisation monopolistique d’une économie, d’un secteur ou d’un marché, pour l’ouvrir à la concurrence.
Comme il est rare qu’une économie soit entièrement monopolistique (ce qui suppose qu’il y ait une concentration extrême du pouvoir politique), le phénomène concerne plus particulièrement des secteurs. La libéralisation si elle ne se traduit en droit que par une déclaration d’ouverture à la concurrence, ne se concrétise en fait que par une implantation beaucoup plus lente de celle-ci, car les opérateurs en place ont la puissance d’enrayer l’entrée de potentiels nouveaux entrants. C’est pourquoi le processus de libéralisation n’est effectif que si l’on met en place des autorités de régulation qui de force ouvrent le marché, en affaiblissant au besoin les opérateurs historiques et en offrant des avantages aux nouveaux entrants par une régulation asymétrique.
Cette régulation qui a pour fin de construire une concurrence, désormais permise par la loi.
C'est pourquoi dans un processus de libéralisation la régulation a pour but de concrétiser la concurrence en la construisant. Cette régulation transitoire a vocation à se retirer et les institutions mises en place à disparaître en devenant par exemple de simples chambres spécialisées de l’Autorité générale de concurrence, la régulation étant temporaire lorsqu’elle est liée à la libéralisation.
Elle est distincte de la Régulation des infrastructures essentielles qui, en tant que monopoles naturels, doivent être définitivement régulés. Assez souvent, dans des économies libérales, l’État a demandé à des entreprises publiques de gérer de tels monopoles, notamment dans les industries de réseaux, entreprises auxquelles il a confié également l'activité économique du secteur tout entier. Par le phénomène de libéralisation, la plupart des États ont choisi de conserver à cet opérateur, désormais opérateur historique en concurrence sur les activités en concurrence proposés aux consommateurs, la gestion de l'infrastructure. A ce titre, le Régulateur le contraint à deux titres : d'une façon transitoire pour que s'instaure la concurrence au bénéfice des nouveaux entrants, d'une façon définitive en tant qu'il a été choisi par l’État pour gérer le monopole économiquement naturel que constitue l'infrastructure.
Même dans les seuls rapports entre compétiteurs, la Régulation a du mal à reculer, et ce souvent du fait du Régulateur. Les lois sociologiques dégagées par Max Weber concernant l’administration montrent que les autorités de régulation, même au regard de la finalité de l'épanouissement concurrentiel, par exemple en matière de télécommunications, cherchent à demeurer, alors même que la concurrence a été effectivement construite, soit en se trouvant de nouvelles finalités (dans le secteur précité, le régulateur pourrait être le gardien de la neutralité du net), soit en affirmant pratiquer d'une façon permanente une "régulation symétrique".
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : D. Gutmann, "Tax Law and Compliance Obligation", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : The author takes up the hypothesis of a Compliance Law defined by its Monumental Goals, the realisation of which is entrusted to "crucial operators" and confronts it with Tax Law. The link is particularly effective since these operators possess what governments need in this area: relevant Information.
Going further, Compliance Law can give rise to two types of obligations on the part of these operators, either towards others operators who need to be monitored, corrected or denounced, or towards themselves, when they need to make amends.
In the first part of this contribution, the author shows that Compliance Obligation reproduces the mechanism of a Tax Law which, for large companies, is embroiled in a process of increasing Globalisation. It enables Governments to aspire to the "Monumental Goals" of combating tax optimisation and impoverishing governments, victims of the erosion of the tax base, in the face of the strategies of companies that are more powerful than they are themselves, by using this very power of firms to turn it against them. Companies become the willing or de facto allies of governments, particularly when it comes to recovering tax debts, or assist them in their stated ambition to achieve social justice. In this way, the State "manages" Tax Law by cooperating with companies.
In the second part, the author outlines the contours of this business Compliance Obligation, which is no longer simply a matter of paying tax. Beyond this financial obligation, it is more a question of mastering Information, particularly when multinational companies are subject to specific tax reporting obligations and are required to reveal their tax strategy, presumed to be transparent and coherent within the group : this legal presumption gives rise to obligations to seek information and ensure coherence, since a single tax strategy is not self-evident in a group.
The author emphasises that companies have accepted the principles governing these new compliance obligations and are tending to transform these obligations, particularly Transparency, into a communication strategy, in line with the ESG criteria that have been developed and a desire for fruitful relations with stakeholders. Therefore the tax relations developed by major companies are being extended not only to the tax authorities, but also to NGOs, by incorporating a strong ethical dimension. This is leading to new strategies, particularly in the area of Vigilance.
The author concludes: "A n’en pas douter, l’obligation de compliance existe bel et bien en matière fiscale." ("There is no doubt that the Compliance Obligation does exist in tax matters").
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
Enseignements

Une dissertation juridique suit les règles de construction et de rédaction généralement requises pour les dissertations d'une façon générale mais présente certaines spécificités.
Le présent document a pour objet de donner quelques indications. Elles ne valent pas "règles d'or", mais un étudiant qui les suit ne peut se le voir reprocher. La correction des copies tiendra compte non seulement du fait que les étudiants ne sont pas juristes, ne sont pas habitués à faire des "dissertations juridiques", mais encore prendra en considération le présent document.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

La Federal Communications Commission (FCC) est l'autorité de régulation indépendante qui aux États-Unis régule au niveau fédéral à la fois le contenant et le contenu des télécommunications.
En cela les États-Unis se distinguent de l'Union européenne, espace juridique dans lequel le plus souvent les institutions de régulation du contenant et du contenu sont distinctes (par exemple en France ARCEP / CSA/CNIL) et dans lequel les régulations des communications demeurent substantiellement au niveau des États membres de l'Union.
Comme les autres régulateurs audiovisuels, elle assure le pluralisme de l'information en limitant la concentration capitalistique - et donc du pouvoir - dans le secteur de la télévision et de la radio. L'on mesure ainsi que le système américain n'est pas dans son principe différent du système européen.
En outre, la FCC se caractérise tout d'abord par une très grande puissance, imposant à la fois des principes substantiels aux opérateurs, comme celui de la "décence", allant au nom de ce principe jusqu'à sanctionner des chaînes de télévision qui avaient laissé montrer une poitrine nue d'une femme. Le contrôle est donc plus substantiel qu'en Europe, ce contrôle venant en balance avec la liberté constitutionnelle d'expression qui est plus puissance aux Etats-Unis qu'en Europe. Il est vrai qu'aujourd'hui les entreprises maîtresses du numérique ont tendance à formuler pour nous ce qui est beau, bien et décent, à la place des autorités publiques.
La FCC a continué de développer les principes majeurs du système de communication publique, comme en 2015 celui de l'Internet ouvert (Open Internet) ou à formuler le principe de "neutralité du numérique", repris par une loi fédéral, ce principe ayant des implications économiques et politiques considérables.
Mais dans le même temps, marque générale d'un droit américain, le juge tempère ce pouvoir, selon le principe de Check and Balance. C'est ainsi que la Cour suprême des États-Unis par l'arrêt FCC v. Pacifica Foundation en 1978 ce pouvoir de contrôle direct du contenu mais en opère également le contrôle du contrôle.
L'élection en 2016 d'un nouveau président qui est entre autres choses totalement hostile à l'idée même de Régulation est une épreuve au sens probatoire du terme. Il a nommé en janvier 2017 un nouveau président de la FCC, hostile à toute régulation et notamment au principe de neutralité. La question qui se pose est de savoir si techniquement une régulation déjà établie sur ces principes peut résister, comment et combien de temps, à une volonté politique violemment et expressément contraire. Et que feront les juges.
Base Documentaire : Doctrine
Référence : Beauvais, P., Méthode transactionnelle et justice pénale, in Gaudemet, A. (dir.), La compliance : un nouveau monde? Aspects d'une mutation du droit, coll. "Colloques", éd. Panthéon-Assas, Panthéon-Assas, 2016, pp. 79-90.
Voir la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Concevoir l'Obligation de Compliance : faire usage de sa position pour participer à la réalisation des Buts Monumentaux de la Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
____
📝lire l'article
____
🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de la contribution : Plutôt que de se plonger dans les disputes de définitions, en cours du fait que le Droit de la Compliance est lui-même une branche du Droit naissance, l'idée de cette contribution est de partir des différents régimes de si multiples et diverses obligations de compliances auxquelles les lois et réglementations assujettissent les grandes entreprises : elles doivent parfois les appliquer à la lettre et parfois ne sont sanctionner qu'en cas de faute ou négligence. Cela renvoie à la distinction entre obligation de résultat et obligation de moyens.
Bien qu'il soit hasardeux de transposer à des obligations légales l'expression et le régime des obligations contractuelles, en partant de ce constat dans le système probatoire de la compliance d'une pluralité d'obligations de moyens et de résultat, suivant qu'il s'agit de telle ou telle obligation technique de compliance, au classement desquelles il faut tout d'abord procéder. Il apparait alors que cette pluralité ne constituera pas un obstacle définitif à la constitution d'une définition unique de ce qu'est l'Obligation de Compliance. Cela permet au contraire de l'éclaircir, de tracer les allées dans ce qui est si souvent qualifié de fatras juridique, de masse réglementaire immaitrisable.
En effet, en tant que l'entreprise obligée au titre du Droit de la Compliance participe à la réalisation des Buts Monumentaux qui fondent normativement celui-ci, obligation légale éventuellement relayée par le contrat voire par l'éthique, elle ne peut être qu'une obligation de moyens, en raison même de cette nature téléologique et de l'ampleur des buts visés, par exemple l'heureux dénouement de la crise climatique qui commence ou l'égalité effective souhaitée entre les êtres humains. Ce principe acquis laisse place au fait que ces comportements demandés sont jalonnés par des process mis en place par des outils structurés, le plus souvent légalement décrits, par exemple l'établissement d'un plan de vigilance ou des formations régulièrement organisées (effectivité), sont des obligations de résultat, tandis que les effets heureux produits par ce plan ou ces formations (efficacité) sont des obligations de moyens. C'est encore plus le cas lorsqu'il s'agit d'obtenir la transformation de l'ensemble du système, c'est-à-dire une solidité acquise du système, une culture d'égalité, un respect de chacun à l'égard de tous, ce qui relève de l'efficience.
L'Obligation de Compliance apparaît ainsi unifiée parce que graduellement, et quelles que soient les diverses obligations de compliance dont il s'agit, leur intensité ou leur secteur, ses préalables structurels de process sont n premier lieu des structures à établir auxquelles le Droit, à travers notamment le Juge, demandera qu'elles sont sont mises en place mais ne demandera pas plus, tandis que tendre vers la réalisation des Buts monumentaux précités sera une obligation de moyens, ce qui peut paraître plus léger, mais correspond à une ambition incommensurable, à la hauteur de ces Buts. En outre, parce que ces structures (les plateformes d'alerte, les formation, les audits, les contrats et les clauses, etc.), n'ont de sens que pour produire des effets et des comportements aboutissant à des modifications convergents vers les buts monumentaux, ce sont les obligations de moyens qui ont le plus d'importance et non pas les obligations de résultat. De cela aussi le Juge doit tenir compte.
Enfin, l'Obligation de compliance, qui consiste donc par cet intermaillage de multiples obligations de compliance de résultat et de moyens d'utiliser la position vise in fine à une efficience des systèmes, en Europe à une civilisation des systèmes, ce pour quoi les entreprises doivent montrer non pas tant qu'elles ont bien suivi les process (résultat) mais que cela a produit des effets qui convergent avec les buts recherchés par le Législateur (effets produits selon une trajectoire crédible). C'est ainsi que doit s'organiser et se comporter une entreprise cruciale, responsable Ex Ante.
________
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
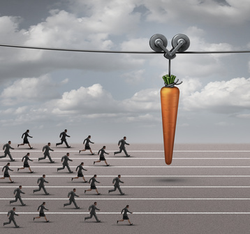
La théorie économique des incitations suppose implicitement qu’on ne peut contraindre un opérateur à agir contre sa volonté, ou à tout le moins qu’il est plus efficace de lui proposer des avantages de telles sorte qu’il fasse ce que l’on souhaite. En cela, cette conception s’oppose à la conception traditionnelle du Droit, qui pose à l’inverse que les sujets obéissent à l’ordre dicté par la norme juridique.
Mais sur des marchés globalisés, les opérateurs ont les moyens de désobéir et l’asymétrie d’information diminue le pouvoir de contrôle des Régulateurs ce qui fait douter de l’effectivité de la contrainte juridique : il ne suffit pas que le droit ordonne. Dans ces conditions, les textes, les régulateurs et les juges doivent produire des conditions qui incitent les agents à adopter des comportements conformes aux buts recherchés par les Régulateurs parce que les opérateurs y ont eux-mêmes intérêt.
Ainsi, si les systèmes de régulation quelque soit le secteur deviennent de plus en plus répressifs, même dans les économies libérales, ce n’est pas tant pour punir l’auteur des faits, mais pour inciter les tiers tentés d’en commettre d’analogues d’y renoncer. C’est le système de l’exemplarité. Cette pensée antérieure à Beccaria participe à la re-féoadalisation du Droit, démontrée par Pierre Legendre, associée au recul de l ‘État et à laquelle la Régulation participe pleinement. Les juges ont peu tendances à manier la répression de cette façon-là, ce qui crée un choc entre le droit pénal et le droit de la régulation, qui pourtant met la répression en son centre.
De la même façon, la régulation doit injecter des incitations positives, par exemple des récompenses pour communication d‘informations, ce qui incite à la délation, ou des incitations que le régulateur émet à l’égard du gestionnaire de réseau pour que celui-ci fasse des investissements dans l’entretien de celui-ci, contre l’intérêt immédiat de son actionnaire. Enfin, tout le droit et l’économie des brevets sont aujourd’hui pensés comme une incitation à innover. Mais, certaines incitations se sont révélées perverses telles les stock-options ou les bonus. En contrecoup, de nouveaux textes cherchent à réguler ceux-ci.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Juridiquement, l’État est un sujet de droit public qui se définit par un territoire, un peuple et des institutions. Il agit dans l'espace international et émet des normes. Politiquement, il a la légitimité requise pour exprimer la volonté du corps social et exercer la violence dont il prive les autres sujets de droit. Il est souvent été reconnaissable par sa puissance : son usage de force publique, sa puissance budgétaire, sa puissance juridictionnelle. Ces trois puissances déclinant ou étant concurrencées par des mécanismes privés, internationaux et donnant davantage satisfaction, l'on a prédit la disparition de l’État, pour la déplorer ou pour danser sur son cadavre.
Avec un tel arrière-plan, dans les théories actuelles de la Régulation , principalement construits par la pensé économique et à première vue l'on pourrait dire que l’État est avant-tout l'ennemi. Et cela pour deux raisons principales. La première est théorique et de nature négative. Les tenants de la théorie de la Régulation dénient à l’État les qualités politiques énoncées ci-dessus. L’État ne serait pas un "être" mais bien plutôt un groupe d'individus, fonctionnaires, élus et autres êtres humains concrets, n'exprimant rien d'autres que leurs intérêts particuliers, venant en conflit avec d'autres intérêts, et utilisant leurs pouvoirs pour servir les premiers plutôt que les seconds comme tout un chacun. La théorie de la Régulation, jouxtant ici la théorie de l'agence, a alors pour fin de contrôler les agents publics et les élus dans lesquels il n'y a pas de raison de faire confiance a priori.
La seconde est pratique et de nature positive. L’État ne serait pas une "personne", mais une organisation. L'on retrouve ici la même perspective que pour la notion d'entreprise, que les juristes conçoivent comme une personne ou un groupe de personnes tandis que les économistes qui conçoivent le monde à travers le marché la représente comme une organisation. L’État comme une organisation devrait être "efficace", voire "optimal". C'est alors la fonction pragmatique du Droit de la Régulation. Or, lorsqu'il est régi par le droit traditionnel, empêtré par les illusions quasiment religieuses de l'intérêt général, voire du contrat social, il est sous-optimal. Il s'agit de le rendre plus efficace.
Pour cela, en tant qu'organisation, l’État est notamment découpé, en agences ou en autorités administratives indépendantes, régulateurs qui gèrent au plus proche les sujets, ce qui pour effet heureux de diminuer l'asymétrie d'information et de faire renaître la confiance dans un lien direct. L’État unitaire, distant et sûr de lui est abandonné pour une conception souple et pragmatique d'un État stratège qui aurait enfin compris qu'il est une organisation comme une autre...
Le Droit de la concurrence adopte cette conception de l’État, dont il a posé dès le départ qu'il était un opérateur économique comme un autre. C'est ainsi qu'est souvent présentée une conception qui serait plus "neutre" du monde.
Les crises successives, qu'elles soient sanitaires ou financières, ont produit un effet de balancier.
L'on crédite de nouveau les notions d'intérêt général ou de biens communs d'un valeur autonome et la nécessité de dépasser les intérêts immédiats et de trouver des personnes pour porter des intérêts supérieurs ou de prendre en charge les intérêts d'autrui, même un autrui non immédiat, s'est fait jour.
Ainsi, l’État ou l'autorité publique, réapparaît dans la mondialisation. Le Droit de la Compliance ou la Responsabilité sociétale des entreprises cruciales sont en train de converger vers une considération de l’État, qui ne peut être réduit à une pure et simple organisation réceptacle des externalités.
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Segonds, M., Compliance, Proportionality and Sanction. The example of the sanctions taken by the French Anticorruption Agency, in Frison-Roche, M.-A. (ed.),Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, à paraître.
___
► Article Summary: Before devoting the developments of his article to the sole perspective of sanctions imposed under "Anti-corruption Compliance", the author recalls in a more general way that, as is the sanction, Compliance is in essence proportional: Proportionality is inherent to Compliance as it conditions any sanction, including a sanction imposed under Compliance.
This link between Proportionality and Compliance has been underlined by the French Anti-Corruption Agency (Agence française anticorruption - AFA) with regard to risk mapping, which must measure risks to arrive at effective and proportional measures. This same spirit of proportionality animates the recommendations of the AFA which are intended to apply according to the size of the company and its concrete organisation. It governs sanctions even more, in that punitive sanctions refer on one hand to Criminal Law, centered on the requirement of proportionality. Punitive sanctions It governs sanctions even more, in that punitive sanctions refer on the other hand to the disciplinary power of the manager who, from other sources of law, must integrate the legal requirement of proportionality when he/she applies external and internal compliance norms.
____
📝 consulter la présentation du livre, Compliance Monumental Goals, dans lequel l'article est publié
_______
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : S. Pottier, "In Favour of European Compliance, a Vehicle of Economic and Political Assertion", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Monumental Goals, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2023, pp. 459-468
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Monumental Goals, dans cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Today's monumental goals, particularly environmental and climatic ones, are of a financial magnitude that we had not imagined but the essential stake is rather in the way of using these funds, that is to determine the rules which, to be effective and fair, should be global. The challenge is therefore to design these rules and organize the necessary alliance between States and companies.
It is no longer disputed today that the concern for these monumental goals and the concern for profitability of investments go hand in hand, the most conservative financiers admitting, moreover, that concern for others and for the future must be taken into account, the ESG rating and the "green bonds" expressing it.
Companies are increasingly made more responsible, in particular by the reputational pressure exerted by the request made to actively participate in the achievement of these goals, this insertion in the very heart of the management of the company showing the link between compliance and the trust of which companies need, CSR also being based on this relationship, the whole placing the company upstream, to prevent criticism, even if they are unjustified. All governance is therefore impacted by compliance requirements, in particular transparency.
Despite the global nature of the topic and the techniques, Europe has a great specificity, where its sovereignty is at stake and which Europe must defend and develop, as a tool for risk management and the development of its industry. Less mechanical than the tick the box, Europe makes the spirit of Compliance prevail, where the competitiveness of companies is deployed in a link with States to achieve substantial goals. For this, it is imperative to strengthen the European conception of compliance standards and to use the model. The European model of compliance arouses a lot of interest. The duty of vigilance is a very good example. It is of primary interest to explain it, develop it and promote it beyond Europe.
________
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Regarder la vidéo expliquant le "droit à l'oubli".
Le "droit à l'oubli" est une invention récente et proprement européenne. Il a été conçu par la Cour de Justice de l'Union européenne dans l'arrêt Google Spain du 13 mai 2014, pour que dans ce monde sans temps, dans lequel toute information est éternellement conservé et disponible qu'est le monde numérique, l'individu ainsi exposé peuvent être protégé contre ce phénomène nouveau, puisque l'oubli n'existe plus, par le Droit qui par sa puissance le dote d'un "droit à être oublié". En cela le vocable de Right to be forgotten est plus exact.
Parce que le Droit est fait pour protéger les êtres humains, l'efficacité technologique qui a créé le monde digital est limitée par la prérogative juridique nouvelle de la personne à rendre inatteignable une information qui la concerne lorsqu'elle revêt un "caractère personnel". Cela fût repris par le règlement communautaire du 27 avril 2016, dit souvent RGPD, transposé dans les Etats-membres de l'Union européenne au plus tard le 25 mai 2018.
Plus que dans les législations qui ont repris l'idée d'une protection des personnes dans la maniement des "données" par autrui, exprimant davantage le souci de protéger le consommateur dans une économie de marché, il s'agit de protéger directement les personnes dans un monde technologique permettant l'obéïssance aveugle, l'Europe récusant ce modèle car la technique des fichiers lui ont laissé un souvenir terrible en raison de la Seconde Guerre mondiale. Or, le Droit est la mémoire des peuples et exprime "l'esprit" de ceux-ci (Savigny).
Base Documentaire : Doctrine
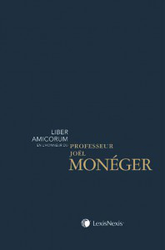
Référence complète Fox, E., The new world order, in Mélanges Joël Monéger, Liber Amicorum en l'honneur du Professeur Joël Monéger, LexisNexis, 2017, 818 p.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
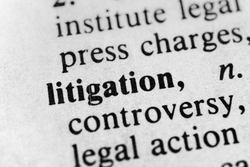
Les garanties de procédure dont bénéficie une personne dont la situation peut être affectée par un jugement à venir sont principalement constituées par la trilogie que constituent le droit de saisir le tribunal, c'est-à-dire de former une action en justice, les droits de la défense et le bénéfice du principe du contradictoire.
L'action en justice fût longtemps considéré comme un "pouvoir", c'est-à-dire un mécanisme inséré dans l'organisation de l'institution juridictionnelle, puisque c'est par l'acte de saisine, empruntant l'accès par laquelle la personne entre dans la machine juridictionnelle, que celle-ci se met en marche.
Mais notamment depuis les travaux de René Cassin et d'Henri Motulsky, l'action en justice est considérée comme un droit subjectif, c'est-à-dire une prérogative dont toute personne est titulaire pour demander à un juge que celui-ci statue sur la prétention que le demandeur articule dans une allégation, c'est-à-dire une histoire mêlant le fait et le droit dans un édifice et auquel il demande au juge de tirer comme conséquence de lui attribuer un bénéfice, par exemple l'annulation d'un acte qui lui fait grief, ou l'attribution de dommages et intérêts, ou le refus de le condamner (car la défense est également l'exercice du droit d'action).
L'action en justice est reconnue désormais non plus comme un pouvoir mais comme un "droit d'action", dont la nature est autonome de la demande qui est faite au tribunal : un droit subjectif processuel qui double le droit subjectif substantiel (par exemple le droit à réparation) et assure l'effectivité de celui-ci mais qui en est autonome. Cette autonomie et cette unicité par rapport à la variété des contentieux (civils, pénaux ou administratifs) fait du droit d'action un pilier du "Droit processuel" sur lequel se construit le droit européen et le droit constitutionnel. En effet, le Droit constitutionnel de la Régulation est en Europe avant tout constitué de principes processuels (droits de la défense, impartialité, droit d'action), le principe Non bis in idem n'étant qu'une expression du droit d'action, mais c'est une interdiction d'un double jugement pour un même fait ce qui n'interdit pas un double déclenchement de l'action (et pénale, et civile, et administrative). Cette unicité processuelle a contribué à diminuer la séparation jadis radicale entre le Droit pénal, le Droit administratif, voire le Droit civil, jadis nettement éloignés les uns des autres dans la construction traditionnelle des systèmes juridiques et qui convergent aujourd'hui dans le Droit de la Régulation et de la Compliance.
Plus encore, le droit subjectif d'action en justice est un droit humain. Et l'un des plus importants. En effet, il exprime "le droit au juge" parce que, par son exercice, la personne oblige un juge à lui répondre, c'est-à-dire à écouter sa prétention (le contradictoire découlant donc de l'exercice du droit d'action).
Ainsi le droit d'action paraît le propre de la personne, du justiciable, de la "partie". C'est pourquoi l'attribution par la Loi du pouvoir pour les Régulateurs de s'auto-saisir, ce que l'on comprend en raison de l'efficacité du procédé, pose difficulté dès l'instant que cela constitue celui-ci en "juge et partie", puisque le Régulateur est en matière répressive considéré comme un tribunal, et que le cumul de la qualification de tribunal et de la qualité de partie est une atteinte consubstantielle au principe d'impartialité. De la même façon l'obligation que le Droit de la Compliance engendre pour les opérateurs de se juger eux-mêmes les oblige à un dédoublement semblable qui pose maintes difficultés procédurales, notamment dans les enquêtes internes.
Ainsi le Droit classique et les Droits de la Régulation et de la Compliance s'écartent toujours plus l'un de l'autre. D'une façon générale, l'on distingue classiquement l'action publique, qui est exercée par le Ministère public (appelé souvent le parquet) par laquelle celui qui s'exprime (le procureur) demande la protection de l'intérêt général et l'action privée, exercée par une personne privée ou une entreprise, qui vise à satisfaire son intérêt privé légitime. L'existence de cet intérêt légitime suffit à la personne d'exercer son droit processuel d'action.
Mais en premier lieu, elle ne pourrait prétendre l'intérêt général parce qu'elle n'est pas agent de l’État et les organisations, comme les associations ou autres Organisations non-gouvernementales, poursuivent un intérêt collectif, ce qui ne saurait se confondre avec l'intérêt général l. Ce principe processuel selon lequel "nul ne plaide par procureur" est aujourd'hui dépassé. En effet et par souci d'efficacité, le Droit admet que des personnes agissent pour que la règle de droit s'appliquent à l'encontre de sujets qui, sans cette action-là, ne rendraient pas de compte. Par ce maniement procédural de la théorie des incitations, car celui qui agit est récompensé tandis qu'il sert l'intérêt général, concrétisant la règle de droit objective et contribuant à produire un effet disciplinaire sur un secteur et des opérateurs puissants, le droit procédural classique est transformé par l'analyse économique du droit. Le mécanisme américain de la class action a été importé en France par une loi récente, de 2014, sur "l'action de groupe" (assez restrictive) mais cette "action collective" continue de n'être pas admise dans l'Union européenne, même si la Commission européenne travaille à favoriser les mécanismes de private enforcement, participant de la même idée.
En second lieu, il peut arriver que le Droit exige de la personne titulaire qu'elle ait non seulement un "intérêt légitime à agir" mais encore une "qualité à agir". Cela est vrai notamment les divers mandataires sociaux au sein des opérateurs. Par souci d'efficacité, le système juridique tend à distribuer de nouvelles "qualités à agir" alors même qu'il n'y a pas forcément d'intérêt, par exemple dans le nouveau système des lanceurs d'alerte, qui peuvent agir alors qu'ils n'y ont pas d'intérêt apparent.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
La régulation est née de la nécessité de prendre en compte la spécificité des secteurs, souvent en accompagnement de la libéralisation de ceux-ci.
Mais, en premier lieu, des biens de différents secteurs peuvent être substituables. Ainsi, l’on peut se chauffer aussi bien au gaz qu’à l’électricité, la concurrence intermodale rendant moins pertinente la segmentation de la régulation du secteur de l’électricité et la régulation du secteur du gaz. Pareillement, un contrat d’assurance-vie est à la fois un instrument de protection pour l’avenir, un produit relevant donc de la régulation assurantielle, mais aussi produit financier placé auprès des consommateurs par des entreprises de banque-assurance, relevant donc de la régulation bancaire et financière. Cette intimité de la régulation par rapport à la technicité interne de l’objet sur lequel elle porte ne peut être effacée.
L'interrégulation qui va se mettre en place est d'abord institutionnelle. C’est pourquoi, une alternative s’ouvre : soit on fusionne les autorités, et ainsi la Grande Bretagne par la Financial Services Authority (FSA) a, dès 2000, fusionné la régulation financière et bancaire, ce que la France n’a pas fait (tandis que la France a fusionné la régulation des assurances et la régulation bancaire à travers l’ACPR). Ainsi, la première branche de l’alternative est la fusion institutionnelle, au risque de constituer des sortes de Titans, voire de reconstituer l’État. Soit on établit des procédures de consultation et de travaux communes, pour faire naître des points de contact, voire une base de doctrine commune contre les régulateur. L’autre branche de l’alternative consiste à respecter ce rapport initial entre régulation et secteur et de prendre acte des liens entre les secteurs à travers la notion proposée de « inter-régulation ». Cela suppose alors de mettre en place des réseaux entre des autorités demeurées autonomes, mais qui s’échangent des informations, se rencontrent, collaborent sur des dossiers communs, etc. Cette interrégulation peut d’abord être horizontale lorsque des autorités de plusieurs secteurs collaborent, par exemple l’autorité de contrôle prudentiel et l’autorité des marchés financiers, ou l’ARCEP et le CSA. Elle peut être aussi de type vertical lorsque les autorités de secteurs nationaux collaborent avec des autorités étrangères ou des autorités européennes ou internationales, comme le prévoit le processus Lamfalussy en matière financière (élargi aux secteurs de la banque et des assurances) ou le processus de Madrid en matière énergétique par lesquels chaque régulateur nationaux se rencontrent et travaillent en commun, avec et autour de la Commission européenne (technique de la comitologie).
L'interrégulation qui est ensuite notionnelle, un "droit commun" de la régulation s'élaborant, commun entre tous les secteurs. Ce "droit commun" (droit horizontal) est venu après la maturation des droits sectoriels de la régulation (droits verticaux). Il s'élabore de fait parce que les objets régulés se situent à la frontière de plusieurs secteurs, voire ignorent celle-ci : par exemple les produits financiers dérivés sur sous-jacent agricole ou énergétique. Plus encore, les "objets collectés" engendrent de l'interrégulation dans l'espace numérique. Ainsi, alors même qu'il est possible qu'Internet, donne lieu à une "interrégulation" avant de donner lieu à une régulation spécifique, celle-ci pouvant justifier que l'on se passe de la première.
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-B. Racine, "Compliance Obligation and Human Rights", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : The author asks whether human rights can, over and above the many compliance obligations, form the basis of the Compliance Obligation. The consideration of human rights corresponds to the fundamentalisation of Law, crossing both Private and Public Law, and are considered by some as the matrix of many legal mechanisms, including international ones. They prescribe values that can thus be disseminated.
Human rights come into direct contact with Compliance Law as soon as Compliance Law is defined as "the internalisation in certain operators of the obligation to structure themselves in order to achieve goals which are not natural to them, goals which are set by public authorities responsible for the future of social groups, goals which these companies must willingly or by force aim to achieve, simply because they are in a position to achieve them". These "Monumental Goals" converge on human beings, and therefore the protection of their rights by companies.
In a globalised context, the State can either act through mandatory regulations, or do nothing, or force companies to act through Compliance Law. For this to be effective, tools are needed to enable 'crucial' operators to take responsibility ex ante, as illustrated in particular by the French law on the Vigilance Obligation of 2017.
This obligation takes the form of both a "legal obligation", expression which is quite imprecise, found for example in the duty of vigilance of the French 2017 law, and in a more technical sense through an obligation that the company establishes, in particular through contracts.
Legal obligations are justified by the fact that the protection of human rights is primarily the responsibility of States, particularly in the international arena. Even if it is only a question of Soft Law, non-binding Law, this tendency can be found in the Ruggie principles, which go beyond the obligation of States not to violate human rights, to a positive obligation to protect them effectively. The question of whether this could apply not only to States but also to companies is hotly debated. If we look at the ICSID Urbaser v. Argentina award of 2016, the arbitrators accepted that a company had an obligation not to violate human rights, but rejected an obligation to protect them effectively. In European Law, the GDPR, DSA and AIA, and in France the so-called Vigilance law, use Compliance Lools, often Compliance by Design, to protect human rights ex ante.
Contracts, particularly through the inclusion of multiple clauses in often international contracts, express the "privatisation" of human rights. Care should be taken to ensure that appropriate sanctions are associated with them and that they do not give rise to situations of contractual imbalance. The relationship of obligation in tort makes it necessary to articulate the Ex Ante logic and the Ex Post logic and to conceive what the judge can order.
The author concludes that "la compliance oblige à remodeler les catégories classiques du droit dans l’optique de les adosser à l’objectif même de la compliance : non pas uniquement un droit tourné vers le passé, mais un droit ancré dans les enjeux du futur ; non pas un droit émanant exclusivement de la contrainte publique, mais un droit s’appuyant sur de la normativité privée ; non pas un droit strictement territorialisé, mais un droit appréhendant l’espace transnational" ("Compliance requires us to reshape the classic categories of Law with a view to bringing them into line with the very objective of Compliance: not just a Law turned towards the past, but a Law anchored in the challenges of the future; not a Law emanating exclusively from public constraint, but a Law based on private normativity; not a strictly territorialised Law, but a law apprehending the transnational space".
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Gibert, M., Faire la morale aux robots. Une introduction à l'éthique des algorithmes, Flammarion, 2021, 168 p.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
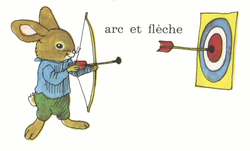
Le but pour lequel un mécanisme, une solution une institution ou une règle sont adoptés, institués ou élaborés, sont en principe extérieurs à ceux-ci. La connaissance de ce but est un outil pour mieux les comprendre et n'est que cela.
Au contraire, dans le Droit de la Régulation, le but est le cœur même. Pa définition, le Droit de la Régulation est un ensemble d'instruments qui s'articulent pour prendre leur sens par rapport à un but. Plus encore, ces instruments ne sont légitimes à représenter une contrainte que parce qu'ils concrétisent un but lui-même légitime. L'interprétation du Droit de la Régulation se fait à partir des buts poursuivis : le raisonnement est téléologique.
Cette nature téléologique explique que l'efficacité n'est plus un simple souci - comme pour les mécanismes juridiques ordinaires, mais bien un principe du Droit de la Régulation. Elle explique l'accueil, notamment à travers le Droit de l'Union Européenne de la théorie de l'effet utile. Ce lien entre les règles, qui ne sont que des moyens, et les buts, renvoie au principe de proportionnalité, qui impose qu'on ne déploie de contraintes et d'exceptions qu'autant qu'il est nécessaire, la proportionnalité étant la forme économique moderne du principe classique de nécessité.
Parce que le but est le centre, il doit être exprimé par l'auteur de la norme de Régulation, et ce d'autant plus s'il est de nature politique et ne se limite pas à pallier les défaillance techniques des marchés. Ce but peut alors être très varié : la gestion des risques systémiques, mais aussi la considération des droits fondamentaux des personnes, la préservation de l'environnement, la santé publique, la civilisation, l'éducation, etc. Le silence du législateur qui se limite à édicter des règles alors que celles-ci ne sont que des instruments, sans expliciter le but alors que celui-ci est une décision politique, est une faute dans l'art législatif.
Plus encore, afin que celui qui applique la loi, notamment le Régulateur et le Juge, ne dispose pas de marge d'interprétations excessive et ne se substituent pas au pouvoir politique, il faut que l'auteur de la norme ne vise qu'un seul but : celui qui applique la norme sera ainsi contraint. Ou, s'il en vise plusieurs, il faut alors qu'il les articule les uns par rapport aux autres, en les hiérarchisant par exemple. S'il ne le fait pas, celui qui applique la norme de Régulation devra lui-même choisir le but et exercer un pouvoir dont il n'est pas titulaire.
Cette désignation expresse d'un but a été fait pour l'Union Bancaire, Régulation et Supervision européenne dont le but premier est de prévenir le risques systémique et de résoudre les crises. De la même façon, le but de la Régulation des infrastructures essentielles est d'assurer un accès des tiers au réseau. De la même façon, lorsqu'il s'agit d'une régulation transitoire mise en place à la suite d'une libéralisation, le but est de mettre en place la concurrence dont le principe a été déclaré par la loi de libéralisation. Lorsque cela n'est pas nettement posé, il y a défaillance dans l'art législatif.
29 mai 2026
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "In Compliance Law, the legal consequences for Entreprises of their commitments and undertakings", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2026, à paraître
____
📝lire l'article (en anglais)
____
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
📚consulter la collection dans laquelle l'ouvrage s'insère : "Compliance & Regulation"
____
► Résumé de l'article: The innocents might believe, taking the Law and its words literally, that "commitments" are binding on those who make them. Shouldn't they be afraid of falling into the trap of the 'false friend', which is what the Law wants to protect them from (as stated in the prolegomena)?
Indeed, the innocent persons think that those who make commitments ask what they must do and say what they will do. Yet, strangely enough, the 'commitments' that are so frequent and common in compliance behaviours are often considered by those who adopt them to have no binding value! Doubtless because they come under disciplines other than Law, such as the art of Management or Ethics. It is both very important and sometimes difficult to distinguish between these different Orders - Management, Moral Norms and Law - because they are intertwined, but because their respective standards do not have the same scope, it is important to untangle this tangle. This potentially creates a great deal of insecurity for companies (I).
The legal certainty comes back when commitments take the form of contracts (II), which is becoming more common as companies contractualise their legal Compliance Obligations, thereby changing the nature of the resulting liability, with the contract retaining the imprint of the legal order or not having the same scope if this prerequisite is not present.
But the contours and distinctions are not so uncontested. In fact, the qualification of unilateral undertaking of will is proposed to apprehend the various documents issued by the companies, with the consequences which are attached to that, in particular the transformation of the company into a 'debtor', which would change the position of the stakeholders with regard to it (III).
It remains that the undertakings expressed by companies on so many important subjects cannot be ignored: they are facts (IV). It is as such that they must be legally considered. In this case, Civil Liability will have to deal with them if the company, in implementing what it says, what it writes and in the way it behaves, commits a fault or negligence that causes damage, not only the sole existence of an undertaking.
________
29 mai 2026
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "General Procedural Law, prototype of the Compliance Obligation", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2026, à paraître
____
📝lire l'article (en anglais)
____
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article: At first glance, General Procedural Law seems to be the area the least concerned by the Compliance Obligation, because if the person is obliged by it, mainly large companies, it is precisely, thanks to this Ex Ante, in order to never to have to deal with proceedings, these path that leads to the Judge, that Ex Post figure that in return for the weight of the compliance obligation they have been promised they will never see: any prospect of proceedings would be seeming to signify the very failure of the Compliance Obligation (I).
But not only are the legal rules attached to the Procedure necessary because the Judge is involved, and increasingly so, in compliance mechanisms, but they are also rules of General Procedural Law and not a juxtaposition of civil procedure, criminal procedure, administrative procedure, etc., because the Compliance Obligation itself is not confined either to civil procedure or to criminal procedure, to administrative procedure, etc., which in practice gives primacy to what brings them all together: General Procedural Law (II).
In addition to what might be called the "negative" presence of General Procedural Law, there is also a positive reason, because General Procedural Law is the prototype for "Systemic Compliance Litigation", and in particular for the most advanced aspect of this, namely the duty of vigilance (III). In particular, it governs the actions that can be brought before the Courts (IV), and the principles around which proceedings are conducted, with an increased opposition between the adversarial principle, which marries the Compliance Obligation, since both reflect the principle of Information, and the rights of the defence, which do not necessarily serve them, a clash that will pose a procedural difficulty in principle (V).
Finally, and this "prototype" status is even more justified, because Compliance Law has given companies jurisdiction over the way in which they implement their legal Compliance Obligations, it is by respecting and relying on the principles of General Procedural Law that this must be done, in particular through not only sanctions but also internal investigations (VI).
________
29 mai 2026
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection Compliance & Regulation, JoRC et Bruylant

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (ed.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2026.
____
📕En parallèle, un livre en français, L'Obligation de Compliance, a étépublié dans la collection "Régulations & Compliance" copubliée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz.
____
📚Ce livre est partie intégrante de cette collection créée Marie-Anne Frison-Roche pour développer le Droit de la Compliance et de la Régulation.
lire la présentation des autres ouvrages de la collection :
- livres ultérieurs :
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Evidential System, 2027
🕴️M.A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance and Contrat, 2027
- livres précédents :
🕴️M.A. Frison-Roche (ed), 📘Compliance Juridictionnalisation, 2023
🕴️M.A. Frison-Roche (ed), 📘Compliance Monumental Goals, 2022
🕴️M.-A. Frison-Roche (ed.), 📘Compliance Tools, 2021
____
► voir la présentation générale de cette 📚Series Compliance & Regulation, conçue, fondée et dirigée par Marie-Anne Frison-Roche, copubliée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant.
____
🧮ce livre suit le cycle de colloques 2023 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses Universités partenaires.
____
► présentation générale du livre : Compliance is sometimes presented as something that cannot be avoided, which is tantamount to seeing it as the legal obligation par excellence, Criminal Law being its most appropriate mode of expression. However, this is not so evident. Moreover, it is becoming difficult to find a unity to the set of compliance tools, encompassing what refers to a moral representation of the world, or even to the cultures specific to each company, Compliance Law only having to produce incentives or translate this ethical movement. The obligation of compliance is therefore difficult to define.
This difficulty to define affecting the obligation of compliance reflects the uncertainty that still affects Compliance Law in which this obligation develops. Indeed, if we were to limit this branch of law to the obligation to "be conform" with the applicable regulations, the obligation would then be located more in these "regulations", the classical branches of Law which are Contract Law and Tort Law organising "Obligations" paradoxically remaining distant from it. In practice, however, it is on the one hand Liability actions that give life to legal requirements, while companies make themselves responsible through commitments, often unilateral, while contracts multiply, the articulation between legal requirements and corporate and contractual organisations ultimately creating a new way of "governing" not only companies but also what is external to them, so that the Monumental Goals, that Compliance Law substantially aims at, are achieved.
The various Compliance Tools illustrate this spectrum of the Compliance Obligation which varies in its intensity and takes many forms, either as an extension of the classic legal instruments, as in the field of information, or in a more novel way through specific instruments, such as whistleblowing or vigilance. The contract, in that it is by nature an Ex-Ante instrument and not very constrained by borders, can then appear as a natural instrument in the compliance system, as is the Judge who is the guarantor of the proper execution of Contract and Tort laws. The relationship between companies, stakeholders and political authorities is thus renewed.
____
🏗️general construction of the book
The book opens with a substantial Introduction, putting the different sort of obligations of compliance in legal categories for showing that companies must build structures of compliance (obligation of result) and act to contribute with states and stakeholders to reach Monumental Goals (obligation of means).
The first part is devoted to the definition of the Compliance Obligation.
The second part presents the articulation of Compliance obligation with the other branchs of Law, because the specific obligation is built by Compliance Law, as new substantial branch of Law but also by many other branchs of Law.
The third part develops the pratical means established to obtained the Compliance Obligation to be effective, efficace and efficient.
The fourth part takes the Obligation of Vigilance as an illustration of all these considerations and the discussion about the future of this sparehead fo the Compliance Obligation .
The fifth part refers to the place and the role of the judges, natural characters for any obligation.
____
TABLE OF CONTENTS
ANCHORING THE SO DIVERSE COMPLIANCE OBLIGATIONS IN THEIR NATURE, REGIMES AND FORCE TO BRING OUT THE VERY UNITY OF THE COMPLIANCE OBLIGATION, MAKING IT COMPREHENSIBLE AND PRACTICABLE
🔹 Compliance Obligation: building a compliance structure that produces credible results withe regard to the Monumentals Goals targeted by the Legislator, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
TITLE I.
IDENTIFYING THE COMPLIANCE OBLIGATION
CHAPTER I: NATURE OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 Will, Heart and Calculation, the three marks surrounding the Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 🔹 Debt, as the basis of the compliance obligation, by 🕴️Bruno Deffains
Section 3 🔹 Compliance Obligation and Human Rights, by 🕴️Jean-Baptiste Racine
Section 4 🔹 Compliance Obligation and changes in Sovereignty and Citizenship, by 🕴️René Sève
Section 5 🔹 The definition of the Compliance Obligation in Cybersecurity, by 🕴️Michel Séjean
CHAPTER II: SPACES OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 Industrial Entities and Compliance Obligation, by 🕴️Etienne Maclouf
Section 2 🔹 Compliance, Value Chains and Service Economy, by 🕴️Lucien Rapp
Section 3 🔹 Compliance and conflict of laws. International Law of Vigilance-Conformity, based on applications in Europe, by 🕴️Louis d'Avout
TITLE II.
ARTICULATING THE COMPLIANCE OBLIGATION WITH OTHER BRANCHES OF LAW
Section 1 🔹 Tax Law and Compliance Obligation, by 🕴️Daniel Gutmann
Section 2 🔹 General Procedural Law, prototype of the Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 3 🔹 Corporate and Financial Markets Law facing the Compliance Obligation, by 🕴️Anne-Valérie Le Fur
Section 4 🔹 Transformation of Governance and Vigilance Obligation, by 🕴️Véronique Magnier
Section 5 🔹 The Relation between Tort Law and Compliance Obligation, by 🕴️Jean-Sébastien Borghetti
Section 6 🔹 Environmental and Climate Compliance, by 🕴️Marta Torre-Schaub
Section 7 🔹 Competition Law and Compliance Law, by 🕴️Jean-Christophe Roda
Section 8 🔹 The Compliance Obligation in Global Law, by 🕴️Benoît Frydman & 🕴️Alice Briegleb
Section 9 🔹 Environmental an Climatic Dimensions of the Compliance Obligation, by 🕴️Marta Torre-Schaub
Section 10 🔹 Judge of Insolvency Law and Compliance Obligations, by 🕴️Jean-Baptiste Barbièri
TITLE III.
COMPLIANCE: GIVE AND TAKE THE MEANS TO OBLIGE
CHAPTER I: COMPLIANCE OBLIGATION: THE CONVERGENCE OF SOURCES
Section 1 🔹 Compliance Obligation upon Obligation works, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 2 🔹 Conformity technologies to meet Compliance Law requirements. Some examples in Digital Law, by 🕴️Emmanuel Netter
Section 3 🔹 Legal Constraint and Company Strategies in Compliance matters, by 🕴️Jean-Philippe Denis & 🕴️Nathalie Fabbe-Coste
Section 4 🔹 Opposition and convergence of American and European legal systems in Compliance Rules and Systems, by 🕴️Raphaël Gauvain & 🕴️Blanche Balian
Section 5 🔹 In Compliance Law, the legal consequences for Entreprises of their Commitments and Undertakings, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
CHAPTER II: INTERNATIONAL ARBITRATION IN SUPPORT OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 How International Arbitration can reinforce the Compliance Obligation, by 🕴️Laurent Aynès
Section 2 🔹 Arbitration consideration of Compliance Obligation for a Sustainable Arbitration Place, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Section 3 🔹 The Arbitral Tribunal's Award in Kind, in support of the Compliance Obligation, by 🕴️Eduardo Silva Romero
Section 4 🔹 The use of International Arbitration to reinforce the Compliance Obligation: the example of the construction sector, by 🕴️Christophe Lapp
Section 5 🔹 The Arbitrator, Judge, Supervisor, Support, by 🕴️Jean-Baptiste Racine
TITLE IV.
VIGILANCE, SPEARHEAD OF THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 Vigilance Obligation, Spearheard and Total Share of the Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
CHAPTER I: INTENSITIES OF THE VIGILANCE OBLIGATION, SPEARHEAD OF THE COMPLIANCE SYSTEM
Section 2 🔹 Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Financial Operators, by 🕴️Anne-Claire Rouaud
Section 3 🔹 Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Digital Operators, by 🕴️Grégoire Loiseau
Section 4 🔹 Intensity of the Vigilance Obligation by Sectors: the case of Energy Operators, by 🕴️Marie Lamoureux
CHAPTER II: GENERAL EVOLUTION OF THE VIGILANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 Rethinking the Concept of Civil Liability in the light of the Duty of Vigilance, Spearhead of Compliance, by 🕴️Mustapha Mekki
Section 2 🔹 Contracts and clauses, implementation and modalities of the Vigilance Obligation, by 🕴️Gilles J. Martin
Section 3 🔹 Proof that Vigilance has been properly carried out with regard to the Compliance Evidence System, by 🕴️Jean-Christophe Roda
Section 4 🔹 Compliance, Vigilance and Civil Liability: put in order and keep the Reason, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
Title V.
THE JUDGE AND THE COMPLIANCE OBLIGATION
Section 1 🔹 Present and Future Challenges of Articulating Principles of Civil and Commercial Procedure with the Logic of Compliance, by 🕴️Thibault Goujon-Bethan
Section 2 🔹 The Judge required for an Effective Compliance Obligation, by 🕴️Marie-Anne Frison-Roche
________
CONCLUSION
THE COMPLIANCE OBLIGATION: A BURDEN BORNE BY SYSTEMIC COMPANIES GIVING LIFE TO COMPLIANCE LAW
(conclusion and key points of the books, free access)
29 mai 2026
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Arbitration consideration of Compliance Obligation for a sustainable Arbitration Place", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", 2026, à paraître
____
📝lire l'article (en anglais)
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
📚consulter la collection dans laquelle l'ouvrage s'insère : "Compliance & Regulation"
____
► Résumé de l'article: The first part of this study assesses the evolving relationship between Arbitration Law and Compliance Law, which depends on the very definition of the Compliance Obligation (I). Indeed, these relations have been negative for as long as Compliance has been seen solely in terms of "conformity", i.e. obeying the rules or being punished. These relationships are undergoing a metamorphosis, because the Compliance Obligation refers to a positive and dynamic definition, anchored in the Monumental Goals that companies anchor in the contracts that structure their value chains.
Based on this development, the second part of the study aims to establish the techniques of Arbitration and the office of the arbitrator to increase the systemic efficiency of the Compliance Obligation, thereby strengthening the attractiveness of the Place (II). First and foremost, it is a question of culture: the culture of Compliance must permeate the world of Arbitration, and vice versa. To achieve this, it is advisable to take advantage of the fact that in Compliance Law the distinction between Public and Private Law is less significant, while the concern for the long term of contractually forged structural relationships is essential.
To encourage such a movement to deploy the Compliance Obligation, promoting the strengthening of a Sustainable Arbitration Place (III), the first tool is the contract. Since contracts structure value chains and enable companies to fulfill their legal Compliance Obligation but also to add their own will to it, stipulations or offers relating to Arbitration should be included in them. In addition, the adoption of non-binding texts can set out a guiding principle to ensure that concern for the Monumental Goals is appropriate in order the Compliance Obligation to be taken into account by Arbitrators.
________
14 avril 2026
Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Conceiving the Compliance Obligation: Using its Position to take part in achieving the Compliance Monumental Goals", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître
____
📝lire l'article (en anglais)
____
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article: This article explains what companies' Compliance Obligation" is. Delving into the mass of compliance obligations, it uses the method of classification of those that are subject to an obligation of result and those that are subject to an obligation of means. It justifies the choice of this essential criterion, which changes the objects and the burden of proof of companies that are subject to an obligation of result when it comes to setting up "compliance structures" and are subject to an obligation of means when it comes to the effects produced by these compliance structures.
Indeed, rather than getting bogged down in definitional disputes, given that Compliance Law is itself a nascent branch of Law, the idea of this contribution is to take as a starting point the different legal regimes of so many different compliance obligations to which laws and regulations subject large companies: sometimes they have to apply them to the letter and sometimes they are only sanctioned in the event of fault or negligence. This brings us back to the distinction between obligations of result and obligations of means.
Although it would be risky to transpose the expression and regime of contractual obligations to legal obligations put by legislation, starting from this observation in the evidentiary system of compliance of a plurality of obligations of means and of result, depending on whether it is a question of this or that technical compliance obligation, we must first classify them. It would then appear that this plurality will not constitute a definitive obstacle to the constitution of a single definition of the Compliance Obligation. On the contrary, it makes it possible to clarify the situation, to trace the paths through what is so often described as a legal jumble, an unmanageable "mass of regulations".
Indeed, insofar as the company obliged under Compliance Law participates in the achievement of the Monumental Goals on which this is normatively based, a legal obligation which may be relayed by contract or even by Ethics, it can only be an obligation of means, by virtue of this very teleological nature and the scale of the goals targeted, for example the happy outcome of the climate crisis which is beginning or the desired effective equality between human beings. This established principle leaves room for the fact that the behaviour required is marked out by processes put in place by structured tools, most often legally described, for example the establishment of a vigilance plan or regularly organised training courses (effectiveness), are obligations of result, while the positive effects produced by this plan or these training courses (effaciety) are obligations of means. This is even more the case when the Goal is to transform the system as a whole, i.e. to ensure that the system is solidly based, that there is a culture of equality, and that everyone respects everyone else, all of which come under the heading of efficiency.
The Compliance Obligation thus appears unified because, gradually, and whatever the various compliance obligations in question, their intensity or their sector, its structural process prerequisites are first and foremost structures to be established which the Law, through the Judge in particular, will require to be put in place but will not require anything more, whereas striving towards the achievement of the aforementioned Monumental Goals will be an obligation of means, which may seem lighter, but corresponds to an immeasurable ambition, commensurate with these Goals. In addition, because these structures (alert mechanisms, training, audits, contracts and clauses, etc.) have real meaning if they are to produce effects and behaviours that lead to changes converging towards the Monumental Goals, it is the obligations of means that are most important and not the obligations of result. The judge must also take this into account.
Finally, the Compliance Obligation, which therefore consists of this interweaving of multiple compliance obligations of result and means of using the entreprise's position, ultimately Goals at system efficiency, in Europe at system civilisation, for which companies must show not so much that they have followed the processes correctly (result) but that this has produced effects that converge with the Goals sought by the legislator (effects produced according to a credible trajectory). This is how a crucial company, responsible Ex Ante, should organise itself and behave.
________
12 mars 2026
Conférences

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Obligation de compliance et gouvernance bancaire", in Chaire Éthiques des affaires : Compliance, ESG et Sustainability Reporting & Association Nationale des Juristes de banque (ANJB), Compliance et vigilance bancaire : la participation des acteurs du secteur bancaire et financier à la LCB/FT, Faculté de droit, Université Catholique de Lille, Lille, 12 mars 2026.
____
🧮consulter le programme complet de la manifestation
____
📶consulter les slides
____
► Présentation de cette conférence introductive du colloque : À partir d'une méthode retenir, trois perspectives seront prises.
En méthode, pour éclairer les tables-rondes qui font constituer la journée de rencontreS sans traiter le sujet à leur place ni prétendre répondre par avance aux questions qu'elles vont soulever, ni chercher à conclure par avance et sans avoir rien écouter, ce qui est parfois le vice des introductions qui sont si souvent des sortes de propos de clôture déguisés, avec juste quelques points d'interrogation pour donner le change, j'ai pris la vieille, vieille, méthode de l'introduction en "triple entonnoir".
Cela consiste à partir d'un autre point que celui objet du colloque lui-même, Compliance et vigilance bancaire : la participation des acteurs du secteur bancaire et financier à la LCB/FT, pour venir d'une façon extérieure et d'une première façon au sujet, d'en repartir pour s'accrocher à un deuxième point extérieur, et de le refaire encore une troisième fois, pour après ce triple déploiement, avoir en quelque sorte aéré le sujet afin de permettre aux orateurs suivant de se concentrer sur le sujet qui est très précis.
Cela est d'autant aisé que le thème retenu lui-même porte sur trois points : une ambition - particulière - (la "lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme"), un secteur - particulier (le "secteur bancaire") et une activité portée par des personnes - particulières - (la "participation des acteurs").
____
Mon premier point de départ est de poser ce qu'est le Droit de la Compliance pour rattacher ce qu'est le Droit de la Compliance à l'objet sur lequel il porte : le secteur bancaire. Car s'il s'agissait que de se "conformer la réglementation applicable", l'on ne comprend pas pourquoi le secteur bancaire est si concerné, si contraint, si exposé à la "compliance", qui ne serait que la façon anglaise de dire qu'il faut "se conformer". Il doit bien y avoir plus que de l'obéissance aux normes, plus que de la prévention des manquements, pour que cela soit si structurant et que le secteur bancaire soit en première ligne.
Il apparaît alors que le Droit de la Compliance n'est pas l'obeissance mécanique à des corpus réglementaire, mais la contribution par des opérateurs systémique à la concrétisation d'ambitions politiques essentielles pour le futur (les "Buts Monumentaux", négatifs et positifs). C'est à ce titre que le secteur bancaire, parce qu'il est composé d' "opérateurs cruciaux" est l'objet naturel de la compliance. Sa puissance ne doit pas lui être reprochée ; elle est indispensable. Dans une branche du Droit qui est en émergence, qui est systémique, qui est Ex Ante, qui est avant un Droit d'action dont l'objet est le futur. Se conformer n'en est qu'un outil.
⛏️Aller plus loin :
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝 Les buts monumentaux, coeur battant du Droit de la compliance, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Les buts monumentaux de la compliance, 2022
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Naissances d'une branche du droit : le Droit de la Compliance, 2024
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance et conformité: les distinguer pour les articuler, 2024
____
Mon deuxième point de départ est de partir des Buts Monumentaux , ancrage normatif du Droit de la compliance, pour le rattacher à cette ambition singulière et ici privilégiée de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, l'on doit s'étonner de certaines choses. En effet, si l'on se refuse au stade de l'introduction à entrer dans la technicité des textes et le contentieux de celui-ci, l'on peut se demander pourquoi ces deux objets sont ainsi associés. L'on mesurer la corrélation entre l'activité bancaire et le blanchiment d'argent. S'y associent d'ailleurs les notaires, ce que l'on appellait les commissaires-priseurs, les ..., brefs tous ceux qui manient l'argent. Même si l'on voit la ratio legis, il reste l'idée que celui qui n'est que le tuyau (pour reprendre la distinction familière dans la régulation des infrastructure essentielles de réseau) pourraît être aussi celui qui organise le contenu : le banquier blanchisseur. Et la diligence Ex Ante de compliance blanchit par avance ce soupçon qui demeure d'une sanction qui plane d'un Ex Post. Nous payons très cher cette représentation qui imprègne le Droit répressif, voire pénal, de la vigilance bancaire, notamment en matière de secret, de transparence, d'information et de prise de risque.
Mais pourquoi l'avoir étendu au financement du terrorisme ? Car le soupçon du banquier terroriste n'existe plus. Le cas redevient pur. Il s'agit d'internaliser dans les banques la charge régalienne d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard, avant les morts tombés. Le financement est le point faible et visible du mal systémique. Cela se conçoit. C'est passé de l'Ex Post (traitement finanier après le crime) à l'Ex Ante (traitement financier avant le crime). C'est d'une autre nature.
Mais c'est d'une autre nature. Il n'y a pas de raison d'arrêter ce mouvement de surveillance, car les mouvements d'argent informent tant sur les projets collectifs et individuels. Par exemple dans l'espace numérique. Il faut faire attention à cela, au regard du principe de liberté, dont le principe de non-immixtion n'est qu'une déclinaison.
⛏️Aller plus loin :
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Le couple Ex Ante - Ex Post, justification d'un droit spécifique et propre de la régulation, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Les engagements dans les systèmes de régulation, 2006
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝La responsabilité Ex Ante, pilier du Droit de la Compliance, 2022
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝LCompliance, Vigilance et Responsabilité civile : comprendre raison garder, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕L'obligation de compliance, 2025
____
Mon troisième point de départ est la "gouvernance", terme qui est assez mystérieux , car il relève davantage de la gestion de l'art politique de mobiliser les êtres humains que du droit. Pourquoi faut-il que les "acteurs" participent, alors que la norme juridique est obligatoire et que, le plus souvent, elle prend forme pénale ? Le mixage entre les plus violentes des normes, l'application des sanctions pécuniaires, voire privatives de libertés, étant revendiqué comme une victoire de la régulation, alors même que les principes processuels reculent est un noeud d'incompréhsion.
D'ailleurs, dans un ordre juridique, qui serait donc remis en cause par cette "gouvernance", c'est à l'Etat de dicter et aux banques assujetties d'exécuter. Mais si elles se chargent de tout, il devient difficile de maintenir ce dispositif, et sans doute n'est-il plus tenable si le But Monumental se déploie dans des dimensions qui excèdent concrètement celles de l'Etat mais correspondent à celles des banques. Le risque est alors de passer d'un gouvernant à un autre, risque social et politique qui s'accroit.
Concrètement, les opérateurs bancaies peuvent assumer ce renversement de deux façons. En premier lieu, en faisant effectivement "participer" les êtres humains qui les composent, à l'intérieur et à l'extérieur, leurs "partenaires" et les parties prenantes. Cela peut s'appeler une "gouvernance" dans une alliance par des buts, explicites, avec des contributions qui ne sont pas crues sur paroles mais qui sont apportées par des "structures de compliance", des "comportements crédibles" et des "trajectoires plausibles".
En cela, les banques mutualistes sont en meilleure position que les autres. Les mécanismes de formation, au centre du Droit de la Compliance, y jouent un rôle essentiel. En second lieu, les alliances avec les autorités publiques et les ancrages territoriaux, avec les évaluations concrètes sont décisifs. Le contrat devient alors non pas seulement le moyen obligé par lequel la banque assujettie exécute son obligation réglementaire mais l'outil juridique le plus classique par lequel elle exerce sa liberté pour contribuer en ce qui la concerne à la réalisation des buts monumentaux pour l'avenir du groupe social, aujourd'hui menacé.
On est loin et au-delà de la "conformité" : cela s'appelle le Droit de la Compliance.
⛏️Aller plus loin :
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Un droit substantiel de la compliance, appuyé sur la tradition européenne humaniste,in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Pour une Europe de la Compliance, 2019
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝La formation : contenu et contenant de la Compliance, in 🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Les outils de la compliance, 2020
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Contrat de compliance, clauses de compliance, 2022
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, ⚙️Compliance et Contrat, 2026
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 🏛️Mission donnée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Droit de la Compliance, Travaux en cours, 2025 - 2026.
________
23 février 2026
Conférences

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
🌐s'abonner à la Newsletter en vidéo MAFR Surplomb
🌐s'abonner à la Newsletter MaFR Droit & Art
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L'avenir de la compliance", cycle La compliance, Centre Perelman, Bruxelles, 23 février 2026.
____
🧮consulter le programme complet du cycle La compliance
____
► Présentation de cette conférence conclusive du cycle : L'avenir de la Compliance, bien malin qui le connaît. Celui qui pratique et étudie les textes, les contentieux, les structures et les comportements devra bien reconnaître qu'il ne sait pas ce que va devenir ce qui pourtant a émergé comme une nouvelle branche du Droit. On le reconnait assez peu, sans doute pour trois raison. En premier lieu, parce que la naissance d'une branche du Droit est un phénomène peu courant, dont les ondes perturbantes et régénérantes se font sentir et dans toutes les branches du Droit et dans les autres systèmes normatifs, accompagnant et traduisant le nouveau monde dans lequel nous sommes déjà entrés, que l'on en soit content ou non. En deuxième lieu, parce qu'il est désagréable (surtout si l'on est professeur...) de débuter et de conclure par le fait qu'on ne sait pas. En troisième lieu, parce que c'est très peu vendeur, et que dans le grand "marché de la compliance"qui est aujourd'hui ouvert et qui se développe, il est peu malin si l'on veut vendre des produits de conformité (qu'il s'agisse d'algorithmes, de nouveaux services à rattacher au plus niveau des entreprises, de spécialités dans les cabinets d'avocat, de nouvelles chaires dans les diverses Ecoles) de dire qu'on ne sait pas. Alors les experts disent qu'ils savent. Pour ma part, je rencontre de multiples personnes, qui sont "expertes" et qui sont "sachants". Ce qui est étonnant, c'est la diversité de leurs discours, ce qui fait douter de la solidité de la projection, notamment sur le sens des mots : par exemple non seulement les mots que l'on pourrait dire "nouveaux" (que l'on cherchera alors à ancrer dans des mots anciens) "compliance" et "gouvenance" mais aussi des mots que l'on connait sans doute mieux, comme "engagement" et "responsabilité" ou "sanction", c'est-à-dire les piliers même de la choses.
Pourquoi est-ce que c'est préoccupant, en dehors même qu'il est toujours mieux de savoir de quoi on parler, plutôt que chacun parle dans son coin, pour son corpus de compliance à lui, pour ses amis de pensée, la matière se silotant de plus en plus ? Parce que le Droit de la Compliance a pour l'objet l'Avenir.
Il sera donc posé en préalable que ne pas connaître l'avenir est une difficulté majeure lorsqu'il s'agit du Droit de la Compliance en ce que cette branche du Droit tient son unité en ce qu'elle est Ex Ante et que son objet est l'avenir. La difficulté n'est ni de la même nature ni de la même ampleur lorsqu'il s'agit du législateur, du "réglementeur", de l'entreprise assujettie (calculante ou politique), du juge confronté au Contentieux systémique de la Compliance.
Cela dit, dans une première partie l'on peut imaginer les avenirs ouverts à la Compliance (car cela relève de cela, tant il y a de candidats pour se saisir des instruments de puissance que constituent les "outils de la compliance"). Il n'est pas acquis que cet avenir relève du Droit. Les suites pourraient s'en charger. Ou l'ordre donné par le chef, et cela passerait d'autant mieux qu'il pose que certes il n'a pas souci des êtres humains mais qu'il manie la puissance de la compliance pour restaurer l'équilibre climatique : sauf à dire qu'il n'existe pas de Droit unifié de la compliance. Qu'il y en aurait une pour le climat et une autre pour les droits des êtres humains. Et alors qu'en est-il de la cohérence à venir du Droit européen, qui noue les 2 dans la CSRD et la CS3D ? Notamment dans les chaines de valeur. La question est alors celle-là : quelle sera à l'avenir l'unicité du Droit de la compliance ?
Dans une deuxième partie, puisqu'on ne sait pas comment cela va tourner, d'omnibus en omnibus, de gouvernement hostile au droit en gouvernement en appelant au droit, de jurisprudence en jurisprudence, de droit spécial en droit commun, il faut apprécier les avantages et les inconvénients des perspectives. Il n'y a jamais une perspective où tout serait bien et l'autre où tout serait mal, car dans ce cas, il n'y aurait ni choix ni politique: il suffirait d'avoir des informations, d'être "rationnel" et d'aller vers la bonne solution plutôt que la mauvaise. Au-delà des déclarations générales comme quoi un mixte de conformité et d'éthique est bienvenu, ce dont on ne doute pas dans les déclarations qui sont faites dans ce sens, il convient de regarder les avantages et les inconvéniets de ce vers quoi l'on peut aller. En premier lieu, il peut s'agir de la disparition du Droit de la compliance, avec l'avantage de l'allégement du poids réglementaire sur les assujettis et l'inconvénient de l'abandon des prétentions altruistes et globales (les deux pouvant se recoupe). En deuxième lieu, il peut s'agir d'une constitution d'un empire sur le monde, avec l'avantage d'une simplicité de l'empire américain extraterritorialisé soit par l'Etat soit par les entreprises et leur "gouvernance, soit par leur technologie, avec l'avantage d'un modèle occidental et l'inconvénient de l'écrasement de la mondialisation par la globalisation et la disparition des ambitions portées par les Etats. En troisième lieu, il peut s'agir d'une contribution à une guerre entre puissances, notamment par le DSA et par la guerre des données, avec l'avantage d'une maturité européenne d'un droit de la compliance prolongement du droit de la régulation et l'inconvénient que l'on pourrait passer à une guerre au sens métaphorique (ne jamais utiliser de métaphore en Droit) à une guerre. En quatrième lieu, il peut s'agir d'un nouvel Etat du Droit où les entreprises systémiques participent en alliance à concrétiser des buts monumentaux de nature politique décidés par les Etats et autorits politiques en préservant dans le futur ("durabilité") les systèmes afin que les êtres humains n'en soient pas broyés mais en bénéficient. L'inconvénient est qu'il faut réapprendre le Droit, car si cela n'a rien à voir avec la conformité, qui n'est qu'un instrument, le Droit de la compliance change toutes les branches du droit et oblige à intégrer d'autres techniques, notamment politiques et technologiques.
Dans une troisième partie, en pratique il faut tendre par anticipation à diminuer les inconvénients liés des défauts attachés à des futurs possibles du Droit de la Compliance, comme il faut tendre à accroître par anticipation les avantages liées aux qualités attachées aux futurs possibles du Droit de la Compliance. L'inconvénient réside dans la nature même du Droit de la compliance, à savoir sa grande puissance, car contrairement au Droit de la concurrence il appelle et accroît la puissance. Il faut donc pallier la perspective d'un accaparement des techniques de compliance, notamment celles liées à l'information, par ceux qui ne veulent les manier que pour consolider ou étendre leur puissance, en riant bien de l'éthique et des buts monumentaux. C'est alors les techniques de supervision d'une part et un office du juge renouvelé qui doivent être pensé. La qualité attachée aux futurs possibles tient au fait que l'on pourrait tenir un "droit global" (référence aux travaux notamment de Benoît Frydman) et que face à la possible disparition du Droit international public et la préservation impérieuse des chaines de valeur, notamment dans la contexte de possible guerre, l'alliance entre les entreprises systémiques supervisées et les autorités politiques en charge du futur du groupe social qui les légitime peut apparaître comm un système légitime, effectif, efficace et efficient.
____
⛏️Aller plus loin :
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Le Droit de la compliance, 2016
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Concevoir le pouvoir, 2021
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Naissances d'une branche du droit : le Droit de la Compliance, 2024
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Droit de la compliance et conformité : les distinguer pour mieux les articuler, 2024
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📕L'obligation de compliance, 2025
🕴🏻M.-A. Frison-Roche, 📝Droit de la compliance et contentieux systémique, 2025
________