Matières à Réflexions
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Le terme "manquement" est nouveau en Droit. Dans l'ordre juridique, le terme de "faute" est celui qui est retenu pour désigner le comportement d'une personne qui s'écarte d'une règle et doit être sanctionné, car par cet acte il a manifesté une intention dolosive qui peut lui est reproché. Mais la notion juridique de faute, qui fût centrale dans le droit classique de la responsabilité civile et était indispensable dans le droit de la responsabilité pénale a l'inconvénient majeure d'appeler une preuve : celle de l'intention de "mal faire". Cela paraît d'autant moins adéquat lorsqu'il s'agit d'apprécier le comportement d'organisations, comme le sont les entreprises, dont le comportement et la puissance doivent être maîtrisées davantage que les comportements fautifs de leurs dirigeants sanctionnées.
C'est pourquoi à la fois pour alléger la charge probatoire concernant les personnes physiques, notamment les personnes ayant le pouvoir et la fonction de décider pour autrui (les managers, les "hauts dirigeants") et pour mieux correspondre à la distribution du pouvoir d'action, dont sont désormais titulaires des organisations, notamment les entreprises, ce sont des "manquements" et non plus des fautes ou des négligences qui constituent les faits générateurs déclenchent l'engagement de leur responsabilité ou justifiant une répression.
Il s'agit plus particulièrement d'une répression administrative, laquelle a pour fin non pas la sanction des fautes mais la protection efficace des secteurs régulés. La sanction des manquements est donc à la fois plus facile, parce qu'il est toujours nécessaire de prouver l'intention, et plus violente, parce que les sanctions attachées peuvent porter sur une part des profits retirés, sur une part du chiffre d'affaires de l'opérateur ou peuvent prendre la forme d'engagements de l'opérateur pour le futur, forme très contraignante et nouvelle de sanction que la technique de compliance a insérée dans le droit.
Ainsi le manquement peut se définir comme un comportement, voire une organisation qui est en écart par rapport au comportement ou à la situation que l'auteur d'un texte a posé comme étant celui qu'il pose comme adéquat. Cette définition à la fois large, abstraite, téléologique et de prescription, qui permet d'appréhender non seulement les comportements mais les structures, fait de la sanction des manquements, un outil quotidien du Droit de la Régulation.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Les garanties de procédure dont bénéficie la personne sont principalement le droit d'action, les droits de la défense et le bénéfice du principe du contradictoire.
Alors que les droits de la défense sont des droits subjectifs qui sont des avantages données à la personne risquant de voir sa situation affectée par la décision que l'organe qui est formellement ou fonctionnellement qualifiée juridiquement comme étant un "tribunal", peut prendre, le principe du contradictoire est plutôt un principe d'organisation de la procédure, dont la personne peut tirer profit.
Ce principe, comme le terme l'indique, est - comme le sont les droits de la défense - de nature à engendre tous les mécanismes techniques qui le servent, y compris dans le silence des textes, impliquent une interprétation large de ceux-ci.
Le principe du contradictoire implique que le débat entre tous les arguments, notamment toutes les interprétations possibles, soit possible. C'est à titre exceptionnel et justifié, par exemple en raison de l'urgence ou d'une exigence justifiée de secret (secret professionnel, secret de la vie privée, secret industriel, secret défense, etc.) que le mécanisme contradictoire est écartée, parfois pendant un temps seulement (technique du contentieux différé par l'admission de la procédure sur requête).
Cette participation au débat doit être pleinement possible au débatteur, notamment l'accès au dossier, la connaissance de l'existence de l'instance, l'intelligibilité des termes du débat, non seulement les faits, mais encore la langue (traducteur, avocat, intelligibilité du propos), mais encore discussion sur les règles de droit applicables). Ainsi lorsque le tribunal relève d'office des règles de droit, il doit les soumettre au débat contradictoire avant d'en faire éventuellement application.
L'application du principe du contradictoire croise souvent les droits de la défense, mais en ce qu'il est lié à la notion de débat, il se développe d'autant plus que la procédure est de type accusatoire.
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : L. d'Avout, La cohérence mondiale du droit, Cours général de droit international privé, Académie de droit international de La Haye, t.443, 2025, 692 p.
____
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
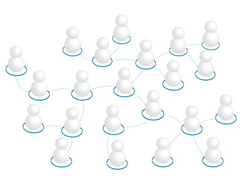
La conception traditionnelle de l’État pose que celui-ci sert l'intérêt général à travers ses services publics, soit directement (par ses administrations, voire par des entreprises publiques), soit par délégation (par exemple par le mécanisme de la concession. Le service public se définit généralement désormais d'une façon fonctionnelle, c'est-à-dire à travers des missions de service public que l'organisme doit réaliser, telles qu'assurer des transports en commun ou soigner la population quelle que soit la solvabilité des malades. On s'est alors longtemps contenté d'une sorte de "séquence figée" : État - service public - entreprise publique (par exemple l'école publique, La Poste, la SNCF ou EDF). La libéralisation des secteurs, la référence première au marché comme moyen d'efficace d'atteindre l'intérêt général , la référence première à la concurrence et le jeu du droit communautaire ont en convergence fait voler en éclats cette intimité.
Aujourd'hui dans un jeu dialectique la Régulation conserve ce souci des missions de service public en équilibre avec la concurrence, dans un contexte concurrentiel et sous le contrôle d'un Régulateur. Le système est plus complexe et plus difficile, car cet éclatement engendre des difficultés nouvelles, telles que l'asymétrie d'information ou l'insertion moins aisée de planifications à long terme, mais il correspond mieux à une économie ouverte et globalisée.
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : P.-Y. Gautier, « Contre le droit illimité à la preuve devant les autorités administratives indépendantes », Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Lucas de Leyssac, LexisNexis, 2018, p.181-193.
____
📘 Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article est publié
Base Documentaire : Soft Law
► Référence complète : Agence française anticorruption (AFA), Guide du contrôle comptable anticorruption, 2022.
____
____
📧 Lire le commentaire fait par Marie-Anne Frison-Roche de ce guide.
_______
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance


En principe le mécanisme même de marché est gouverné par la liberté, les libertés des agents eux-mêmes - liberté d'entreprendre et de contracter - et liberté concurrentielle qui marque le marché lui-même, la convergence de ces libertés permettant le fonctionnement autorégulé de la "loi du marché", à savoir la rencontre massifié des offres et des demandes qui engendre le prix adéquat ("juste prix").
Pour que cela fonctionne, il faut mais il suffit qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée et qu'il n'y ait pas de comportement par lesquels des opérateurs puissent entraver cette loi du marché concurrentiel, ces abus de marché étant l'abus de position dominante et l'entente.
Mais s'il s'agit des marchés financiers, lesquels sont des marchés régulés, les "abus de marchés" y sont sanctionnés au cœur même de la régulation. En effet, la régulation des marchés financiers suppose que l'information y soit distribué au profit des investisseurs, voire d'autres parties prenantes, éventuellement des informations non exclusivement financières. Cette intégrité des marchés financiers qui, au-delà de l'intégrité de l'information, doivent atteindre la transparente, justifie que l'information soit pleinement et également partagée. C'est pourquoi ceux qui ont titulaire ou doivent être titulaire d'une information qui n'est pas partagée par les autres (information privilégiée) ne doivent pas l'utiliser sur le marché tant qu'ils ne l'ont pas rendu publiques. De la même façon, ils ne doivent pas diffuser de mauvaises informations au marché. Pas plus qu'ils ne doivent manipuler les cours.
Ces sanctions ont été essentiellement conçues par la théorie financière américaine, concrétisées par les juridictions américaines, puis reprises en Europe. Dans la mesure où elles sanctionnent à la fois un comportement reprochable et constituent un instrument d'ordre public de direction et de protection des marchés, la question du cumul du droit pénal et du droit administratif répressif ne pouvait que se poser avec difficulté et agressivité.
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection Compliance & Regulation, JoRC et Bruylant

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance and Contract, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître
____
📕Parallèlement, un ouvrage en français, Compliance et contrat, est publié dans la collection coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz
____
🧮Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques 2023-2024, organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires
____
► Présentation générale de l'ouvrage :
____
📚Ce volume s'insère dans la lignée des ouvrages qui, dans cette collection en langue anglaise, sont consacrés à la Compliance.
► Lire la présentation des autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :
- les ouvrages suivants :
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📘Compliance Evidence System, 2025
- les ouvrages précédents :
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📘Compliance Obligation, 2024
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📘Compliance Jurisdictionalisation, 2024
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📘Compliance Monumental Goals, 2023
🕴️M.-A. Frison-Roche (dir.), 📘Compliance Tools, 2021
📚Consulter les autres titres de la collection.
____
🏗️Construction générale de l'ouvrage :
________
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L. d'Avout, "Compliance and conflict of laws. International Law of Vigilance-Conformity, based on recent applications in Europe", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par l'auteur, traduit par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : In the absence of constraints derived from the real international law, vigilance-compliance laws themselves determine their scope of application in space. They do so generously, to the extent that they often converge on the same operators and 'overlap' on the world stage. The result is a hybridation of the law applicable to the definition of Compliance Obligations; a law possibly written "with four hands" or more, which is not always harmonious and which exposes unilateral legislators to occasional retouching their work and their applied regulations.
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

La Federal Communications Commission (FCC) est l'autorité de régulation indépendante qui aux États-Unis régule au niveau fédéral à la fois le contenant et le contenu des télécommunications.
En cela les États-Unis se distinguent de l'Union européenne, espace juridique dans lequel le plus souvent les institutions de régulation du contenant et du contenu sont distinctes (par exemple en France ARCEP / CSA/CNIL) et dans lequel les régulations des communications demeurent substantiellement au niveau des États membres de l'Union.
Comme les autres régulateurs audiovisuels, elle assure le pluralisme de l'information en limitant la concentration capitalistique - et donc du pouvoir - dans le secteur de la télévision et de la radio. L'on mesure ainsi que le système américain n'est pas dans son principe différent du système européen.
En outre, la FCC se caractérise tout d'abord par une très grande puissance, imposant à la fois des principes substantiels aux opérateurs, comme celui de la "décence", allant au nom de ce principe jusqu'à sanctionner des chaînes de télévision qui avaient laissé montrer une poitrine nue d'une femme. Le contrôle est donc plus substantiel qu'en Europe, ce contrôle venant en balance avec la liberté constitutionnelle d'expression qui est plus puissance aux Etats-Unis qu'en Europe. Il est vrai qu'aujourd'hui les entreprises maîtresses du numérique ont tendance à formuler pour nous ce qui est beau, bien et décent, à la place des autorités publiques.
La FCC a continué de développer les principes majeurs du système de communication publique, comme en 2015 celui de l'Internet ouvert (Open Internet) ou à formuler le principe de "neutralité du numérique", repris par une loi fédéral, ce principe ayant des implications économiques et politiques considérables.
Mais dans le même temps, marque générale d'un droit américain, le juge tempère ce pouvoir, selon le principe de Check and Balance. C'est ainsi que la Cour suprême des États-Unis par l'arrêt FCC v. Pacifica Foundation en 1978 ce pouvoir de contrôle direct du contenu mais en opère également le contrôle du contrôle.
L'élection en 2016 d'un nouveau président qui est entre autres choses totalement hostile à l'idée même de Régulation est une épreuve au sens probatoire du terme. Il a nommé en janvier 2017 un nouveau président de la FCC, hostile à toute régulation et notamment au principe de neutralité. La question qui se pose est de savoir si techniquement une régulation déjà établie sur ces principes peut résister, comment et combien de temps, à une volonté politique violemment et expressément contraire. Et que feront les juges.
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : D. Gutmann, "Tax Law and Compliance Obligation", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : The author takes up the hypothesis of a Compliance Law defined by its Monumental Goals, the realisation of which is entrusted to "crucial operators" and confronts it with Tax Law. The link is particularly effective since these operators possess what governments need in this area: relevant Information.
Going further, Compliance Law can give rise to two types of obligations on the part of these operators, either towards others operators who need to be monitored, corrected or denounced, or towards themselves, when they need to make amends.
In the first part of this contribution, the author shows that Compliance Obligation reproduces the mechanism of a Tax Law which, for large companies, is embroiled in a process of increasing Globalisation. It enables Governments to aspire to the "Monumental Goals" of combating tax optimisation and impoverishing governments, victims of the erosion of the tax base, in the face of the strategies of companies that are more powerful than they are themselves, by using this very power of firms to turn it against them. Companies become the willing or de facto allies of governments, particularly when it comes to recovering tax debts, or assist them in their stated ambition to achieve social justice. In this way, the State "manages" Tax Law by cooperating with companies.
In the second part, the author outlines the contours of this business Compliance Obligation, which is no longer simply a matter of paying tax. Beyond this financial obligation, it is more a question of mastering Information, particularly when multinational companies are subject to specific tax reporting obligations and are required to reveal their tax strategy, presumed to be transparent and coherent within the group : this legal presumption gives rise to obligations to seek information and ensure coherence, since a single tax strategy is not self-evident in a group.
The author emphasises that companies have accepted the principles governing these new compliance obligations and are tending to transform these obligations, particularly Transparency, into a communication strategy, in line with the ESG criteria that have been developed and a desire for fruitful relations with stakeholders. Therefore the tax relations developed by major companies are being extended not only to the tax authorities, but also to NGOs, by incorporating a strong ethical dimension. This is leading to new strategies, particularly in the area of Vigilance.
The author concludes: "A n’en pas douter, l’obligation de compliance existe bel et bien en matière fiscale." ("There is no doubt that the Compliance Obligation does exist in tax matters").
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Association des professionnels du contentieux économique et financier (APCEF), La réparation du préjudice économique et financier par les juridictions pénales, 2019.
____
________
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Une Banque centrale est pour le Droit un objet assez mystérieux.
Malgré ce qu'ont pu en dire certaines autorités de concurrence, il ne s'agit pas d'une banque ordinaire. Elle est à la source de la création monétaire et a pour mission première de lutter contre l'inflation, concourant plus ou moins directement et d'une façon plus ou moins indépendante suivant les systèmes politiques et juridiques à la politique économique menée par les gouvernements.
Ainsi, si les Banques centrales ont toutes une statut constitutionnel qui leur garantit une autonomie, elles ont une mission plus limitée en Europe qu'aux États-Unis. Cela est encore plus net depuis que, la création monétaire exprimant le régalien, ce pouvoir a été transférée à la Banque centrale européenne (BCE), ce qui rend plus nécessaire encore une interprétation restrictive de ce que peut faire cette Banque centrale, comme l'a rappelé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) en 2015 à propos des programmes de politique monétaire non-conventionnels de la BCE.
Les Banquiers centraux ont, soit directement par un département, soit indirectement par une Autorité administrative indépendante (AAI) qui leur est adossée et qui, tout en étant indépendante, n'a pourtant pas la personnalité morale à leur égard (système français concernant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR) exerce sur le secteur bancaire et des assurances un pouvoir de régulation et de supervision.
A ce titre, ils sont régulateurs. Lorsque le pouvoir de créer de la monnaie leur a été ôtée, comme cela est le cas dans les États-membres de la zone Euro, c'est ce pouvoir de régulation et de supervision qui leur demeure propre, leur activité en matière de monnaie consistant à participer au mécanisme collectif européen.
Pour exercer sa mission de régulation et de supervision, les Banquiers centraux disposent de pouvoirs considérables, notamment d'agrément, de sanction et depuis 2013 et 2014, de résolution. Mais en cela, il faut considérer que, notamment au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, les Banquiers centraux sont comme des tribunaux et dans l'exercice de nombreux pouvoirs, les garanties de procédures doivent être conférés aux opérateurs qui font l'objet de ces pouvoirs-là.
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Deffains, B., Compliance and International competitiveness, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Monumental Goals, series "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, to be published.
____
► Résumé de l'article: Compliance, which can be defined first and foremost as obedience to the law, is an issue for the company in that it can choose as a strategy to do or not to do it, depending on what such a choice costs or brings in. This same choice of understanding is offered to the author of the norm, the legislator or the judge, or even the entire legal system, in that it makes regulation more or less costly, and compliance with it, for companies. Thus, when the so-called “Vigilance” law was adopted in 2017, the French Parliament was criticized for dealing a blow to the “international competitiveness” of French companies. Today, it is on its model that the European Parliament is asking the European Commission to design what could be a European Directive. The extraterritoriality attached to the Compliance Law, often presented as an economic aggression, is however a consubstantial effect, to its will to claim to protect beyond the borders. This brings us back to a classic question in Economics: what is the price of virtue?
In order to fuel a debate that began several centuries ago, it is first of all on the side of the stakes that the analysis must be carried out. Indeed, the Law of Compliance, which is not only situated in Ex Ante, to prevent, detect, remedy, reorganize the future, but also claims to face more “monumental” difficulties than the classical Law. And it is specifically by examining the new instruments that the Law has put in place and offered or imposed on companies that the question of international competitiveness must be examined. The mechanisms of information, secrecy, accountability or responsibility, which have a great effect on the international competitiveness of companies and systems, are being changed and the measure of this is not yet taken.
____
________
Base Documentaire : Doctrine
►Référence complète : Galli, M., Une justice pénale propre aux personnes morales : Réflexions sur la convention judiciaire d'intérêt public , Revue de Sciences Criminelle, 2018, pp. 359-385.
____
Enseignements : Droit de la Compliance

♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
♾️s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
Cette bibliographie générale rassemble quelques références générales, qui se superposent ou croisent les bibliographies plus spécifiques sur la compliance, à travers différentes matières ou différentes branches du droit, en droit français ou en droit étranger et supra national ayant une influence directe, de sorte que l'on puisse comprendre ce qui en résulte en droit français.
Elle est composée de documents de doctrine (ouvrages et articles), des textes législatifs ou réglementaires applicables en France et dans d'autres pays (et, le cas échéant, des projets de lois ou de règlements), ainsi que de documents de littérature grise.
Il peut être pertinent de croiser cette bibliographie avec la Bibliographie plus large relative au Droit commun de la Régulation, ou avec la Bibliographie relative au Droit de la Régulation bancaire et financière.
Consulter la bibliographie ci-dessous.
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : S-M.. Cabon, "Théorie et pratique de la négociation dans la justice pénale", in M.-A. Frison-Roche & M. Boissavy (dir.), Compliance et Droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître.
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance et Droits de la défense - Enquête interne, CIIP, CRPC, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'auteure définit la technique de "négociation" comme celle par laquelle "chaque interlocuteur va tenter de rendre compatibles par un jeu de coopération et de concessions mutuelles", ce qui va donc être utilisé dans la justice pénale française non pas tant par attraction du modèle américain, mais pour tenter de résoudre les difficultés engendrées par le flux des contentieux, le procédé s'étant élargi aux contentieux répressif, notamment devant les autorités administratives de régulation. Le principe en est donc la coopération du délinquant.
L'auteur souligne les satisfactions "pratiques" revendiqués, puisque les cas sont résolus, les sanctions sont acceptées, et les inquiétudes "théoriques", puisque des principes fondamentaux semblent écartés, comme les droits de la défense, l'affirmation étant faite comme quoi les avantages pratiques et le fait que rien n'oblige les entreprises à accepter les CJIP et les CRPC justifient que l'on ne s'arrête pas à ces considérations "théoriques".
L'article est donc construit sur la confrontation de "l'Utile" et du "Juste", parce que c'est ainsi que le système est présenté, l'utilité et le consentement étant notamment mis en valeur dans les lignes directrices des autorités publiques.
Face à cela, l'auteur examine la façon dont les textes continuent, ou pas, de protéger la personne qui risque d'être in fine sanctionnée, notamment dans les enquêtes et investigations, le fait qu'elle consente à renoncer à cette protection, notamment qu'elle apporte elle-même les éléments probatoires de ce qui sera la base de sa déclaration de culpabilité tandis que l'Autorité publique ne renonce pas encore au même moment à la poursuite étant problématique au regard du "Juste".
La seconde partie de l'article est donc consacrée à "l'Utile contraint à être Juste". A ce titre, l'auteur pense que l'indépendance du ministère public devrait être plus forte, à l'image de ce qu'est le Parquet européen, et le contrôle du juge judiciaire plus profond car la procédure actuelle de validation des CJIP semble régie par le principe dispositif, principe qui ne sied pas à la justice pénale.
________
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : S. Mouton, "Dimensions constitutionnelles de l'Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
________
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Segonds, M., Compliance, Proportionality and Sanction. The example of the sanctions taken by the French Anticorruption Agency, in Frison-Roche, M.-A. (ed.),Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, à paraître.
___
► Article Summary: Before devoting the developments of his article to the sole perspective of sanctions imposed under "Anti-corruption Compliance", the author recalls in a more general way that, as is the sanction, Compliance is in essence proportional: Proportionality is inherent to Compliance as it conditions any sanction, including a sanction imposed under Compliance.
This link between Proportionality and Compliance has been underlined by the French Anti-Corruption Agency (Agence française anticorruption - AFA) with regard to risk mapping, which must measure risks to arrive at effective and proportional measures. This same spirit of proportionality animates the recommendations of the AFA which are intended to apply according to the size of the company and its concrete organisation. It governs sanctions even more, in that punitive sanctions refer on one hand to Criminal Law, centered on the requirement of proportionality. Punitive sanctions It governs sanctions even more, in that punitive sanctions refer on the other hand to the disciplinary power of the manager who, from other sources of law, must integrate the legal requirement of proportionality when he/she applies external and internal compliance norms.
____
📝 consulter la présentation du livre, Compliance Monumental Goals, dans lequel l'article est publié
_______
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : B. Deffains, "Debt as the basis of the Compliance Obligation", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : The contribution builds on the definition of Compliance in that it requires large companies to contribute to the achievement of Monumental Goals, including the preservation of human rights and systems, e.g. climate system.
This requirement is confronted with the notion of Debt as it results today from classic and new works available in economic science. In fact, in the primitive economy, debt refers not only to exchanges, but also to an ethical and social obligation leading back to the collective. The Economic Analysis of Law has highlighted this situation, where some of the entities involved in a situation benefit from positive externalities, or endure negative externalities on their own, thus creating a situation of debt: this generates an obligation to correct market failure through an obligation to manage risks, as expressed by Compliance Obligation. This implies that economic calculation can be used to quantify this debt, leading to new proposals for biodiversity accounting.
The author then highlights the recognition of Debt as the source of an Compliance Obligation. This can be expressed through the classical notion of natural obligation, which can be traced back to the French Civil Code, or through more solidarist or political conceptions of Law, linked to moral responsibility, with the overall moral equilibrium referring to civic duty, superimposed on the accounting equilibrium. The political dimension is very much present, as shown by Grotius and Kant, then Bourgeois (solidarism), Rawls and Sen (social justice), who link the deep commitment of each individual with the group. This sheds light on the essential role played by the State and public institutions in formalising and enforcing the Compliance Obligation, not only to ensure its effectiveness, but also to make everyone aware of its fairness dimension.
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
Enseignements : Droit commun de la Régulation
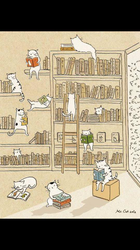
Retourner à la présentation générale du Cours.
Cette bibliographie générale rassemble quelques références générales, qui se superposent ou croisent les bibliographies plus spécifiques sur :
- Doctrine (par ordre alphabétique), la présentation distinguant quelques ouvrages généraux avant de répertorie des études pertinentes pour comprendre le "Droit commun de la Régulation"
- Textes de droit international, textes de systèmes juridiques étrangers,textes de l'Union européennes, textes de droit français
- Littérature grise
Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Terré, F., Concurrence et proportionnalité, in Parléani, G. (coord.), Mélanges en l'honneur du Professeur Claude Lucas de Leyssac, LexisNexis, novembre 2018, pp.467-471.
____
Lire une présentation générale des Mélanges dans lesquels l'article a été publié.
____
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

L'Office of Communications (Ofcom) est le régulateur britannique des communications.
Ce régulateur indépendant est compétent à la fois pour les services de télévisions, de radio, de télévision, mais encore de la poste.
A cela, s'ajoutent des missions très diverses, comme non seulement l'attribution des licences mais encore la protection des données ou encore les politiques publiques de diversité et d'égalité.
L'on peut considérer qu'il s'agit des compétences les plus larges que l'on peut conférer à un régulateur au regard des activités de "communication"
Base Documentaire : Doctrine
Référence générale, Cohendet, M.-A. et Fleury, M., Droit constitutionnel et droit international de l'environnement, Revue française de droit constitutionnel , PUF, » 2020/2, n°122, p.271-297.
___
Résumé de l'article :