Matières à Réflexions
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Le marché est normalement autorégulé. Il subit des défaillances ponctuelles lorsque des agents économiques ont des comportements anticoncurrentiels, principalement l’entente ou l’abus de position dominante sur les marchés ordinaires, les abus de marchés sur les marchés financiers, sanctionnés ex post par les autorités dans des décisions individuelles ponctuelles.
Mais certains secteurs sont atteints de défaillances structurelles, qui les empêchent, même sans intention malicieuse d’agents, d’atteindre ce mécanisme d’ajustement de l’offre et de la demande. Constitue ainsi une défaillance structurelle l’existence d’un monopole économiquement naturel par exemple un réseau de transport, qu’un autre agent ne viendra dupliquer une fois le premier réseau construit, ce qui interdit le jeu de la concurrence. Il faut alors une régulation a-concurrentielle, soit par nationalisation, soit par une tutelle étatique, soit par un contrôle opéré par une autorité de régulation, pour assurer l’accès de tous à une facilité essentielle. Constitue également une défaillance de marché l’asymétrie d’information, théorisée à travers la notion d’agence qui entrave la disponibilité et la circulation de l’information exhaustive et fiable sur les marchés, notamment les marchés financiers. Cette défaillance de marché porte en elle un risque systémique, contre lequel une régulation est définitivement construite et confiée aux régulateurs financiers et aux banques centrales.
Dans ces cas, la mise en place des régulations sont des réactions de l’État non pas tant par rejet politique du marché, mais parce que l’économie concurrentielle est inapte à fonctionner. Cela n’a rien à voir avec l’hypothèse où l’État prend distance par rapport au marché, non pas parce qu’il serait structurellement défaillant par rapport à son propre modèle, mais parce que le politique veut imposer des valeurs supérieures, exprimées par le service public, dont le marché ne satisfait pas toujours les missions.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Le secteur des assurances a toujours été régulé en ce qu’il présente un très fort risque systémique, la solidité des opérateurs économiques étant requise pour le fonctionnement du secteur et la faillite de l’un d’entre eux pouvant faire fléchir voire s’effondrer l’ensemble. En outre, l’assurance est le secteur dans lequel l’aléa moral (moral hazard) est le plus élevé, puisque l’assuré aura tendance à minimiser les risques auxquels il est exposé pour payer la prime la moins élevée possible, alors même que la compagnie s’expose à couvrir un accident dont elle ne peut par avance mesurer l’ampleur. Ainsi, la science de l’assurance est avant tout celle des probabilités.
L’enjeu récent de la régulation des assurances, à la fois institutionnel, à la fois la construction et les pouvoirs du régulateur du secteur, et fonctionnel, à savoir les relations que celui-ci doit avoir avec les autres pouvoirs, se situe principalement dans les relations entre le régulateur des assurances et le régulateur des banques, ce qui renvoie au concept de l'"interrégulation. En effet, si l’on s’en tient aux critères formels, les deux secteurs sont distincts et les régulateurs doivent être pareillement. Ainsi naguère existait d’une part l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM), sous la direction du ministère des finances, ainsi que le Comité des entreprises d’Assurance (CEA), et d’autre part les autorités de régulation bancaire, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) et la Commission Bancaire, département sans personnalité morale à l’intérieur de la Banque de France, institution autonome du gouvernement. Mais si l’on regarde les activités, on est alors sensibles au fait que les produits d’assurance, par exemple les contrats d’assurance vie, sont le plus souvent des produits financiers. On constate en outre, à travers la notion de « banque-assurance », que des mêmes entreprises pratiquent les deux activités économiques. En dehors du fait qu'en droit de la concurrence l'on définit les entreprises par l'activité de marché, il en résulte surtout que le risque de contamination et de propagation est commun entre l’assurance et la banque. C’est pourquoi, l’ordonnance du 21 janvier 2010 a créé l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) qui vise aussi bien les compagnies d’assurances que les banques, puisque leur solidité doit être soumise à des exigences analogues et à un organisme commun. La loi de juillet 2013 a confié à cette Autorité la mission d'au besoin organiser la restructuration de ces entreprises, devenant donc l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, l'ACPR.
Mais les règles substantielles ne sont pas pour autant unifiées, d’une part parce que les assureurs ne sont pas favorables à une telle assimilation, d’autre part parce que les textes, essentiellement la directive communautaire sur l’insolvabilité des compagnies d’assurances, demeurent propres à celles-ci, et en distance par rapport aux règles de Bâle s’appliquant aux banques, ce qui contredit le rapprochement institutionnel. La construction européenne reflète la spécificité du secteur assurantiel, le Règlement du 23 novembre 2010 ayant établi l'EIOPA qui est un quasi-régulateur européen pour les organismes de prévoyance, parmi lesquels figurent les sociétés d'assurance.
L'enjeu actuel de la Régulation assurantielle est précisément la construction européenne. Tandis que par l’Union bancaire, l’Europe de la régulation bancaire se construit, l’Europe de la Régulation assurantielle ne se construit. Déjà parce que, à juste titre, elle ne veut pas se fondre dans l’Europe bancaire, les négociations des textes de « Solvabilité II » achoppant sur cette question de principe. L’on retrouve cette vérité première : en pratique, ce sont les définitions qui compte. Ici : une compagnie d’assurance peut-elle se définir comme une banque comme une autre ?
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Les banques sont régulées car elles n’exercent pas une activité économique ordinaire, en ce que celles-ci engendrent un risque systémique. En effet, dans l’économie réelle, les banques jouent le rôle d’apporter du crédit aux entrepreneurs qui eux opèrent sur les marchés des biens et services, crédits financés surtout grâce aux dépôts faits par des déposants et dans une moindre mesure par les actionnaires, les capitalistes. C’est ainsi que le libéralisme et le capitalisme ont partie liée. Mais les banques ont le pouvoir de créer de la monnaie par le simple jeu d’écritures qu’elles font en écrivant dans leurs livres les prêts qu’elles accordent (monnaie scripturale). Dès lors, les banques partagent avec l’État ce pouvoir extraordinaire de posséder le pouvoir monétaire que certains qualifient de pouvoir souverain. Il est possible que le numérique remette en cause cela, la Régulation hésitant à se saisir des nouveaux instruments dit de "monnaie virtuelle" en tant que "monnaie" ou en tant d'instrument ordinaire de relations coopératives.
Cette nature essentiellement régalienne justifie en premier lieu que l’État choisisse les établissements qui bénéficieront du privilège de créer de la monnaie scripturale, la profession bancaire ayant toujours constitué un monopole. La régulation bancaire est donc d’abord un contrôle ex ante à l’entrée à la profession et à une surveillance de la qualité des personnes et des établissements qui y prétendent.
En outre, les banques et établissements de crédits prêtent par construction plus d’argent qu’ils ne disposent de fonds propres : l’ensemble du système bancaire repose nécessairement sur la confiance de chacun des créanciers de la banque, notamment les dépositaires, qui laissent à sa disposition les fonds dont la banque va ainsi faire l’usage. La régulation bancaire va donc intervenir pour établir des ratios prudentiels, c'est-à-dire ceux qui s’assurent de la solidité de l’établissement, posant ce que les banques peuvent prêter par rapport aux fonds propres et quasi fonds propres dont elles disposent effectivement.
En outre, les banques sont surveillées en permanence par leur régulateur de tutelle, le Banquier central (en France la Banque de France), qui assure la sécurité de tout le système puisque à travers elle, l’État est le prêteur en dernier ressort. Ce qui peut conduire une grande institution financière à prendre des risques excessifs, sachant que l’État la sauvera, ce que la théorie de l’aléa moral (moral hazard) a systématisé. Tous les systèmes monétaires et financiers sont construits sur ces banques centrales, qui sont autonomes des gouvernements, parce que ceux-ci sont trop dépendants des stratégies politiques et ne peuvent engendrer la même confiance que celle qu’apporte une banque centrale. Depuis que les missions des banques centrales se sont accrues et que les notions de Régulation et de Supervision se sont rapprochées, l'on a tendance à considérer qu'elles sont des Régulateurs à part entière.
Par ailleurs, la régulation bancaire est devenue centrale parce que l’activité bancaire n’est plus principalement aujourd’hui le prêt mais l’intermédiation financière.La Régulation bancaire croise alors la Régulation financière. En Europe, la Banque centrale européenne est au centre.
Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2017-2018

Le plan est actualisé chaque semaine au fur et à mesure que les leçons se déroulent en amphi.
Il est disponible ci-dessous.
Retourner à la présentation générale du cours, tel qu'il était bâti et proposé en 2018.
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : S. Mouton, "Dimensions constitutionnelles de l'Obligation de Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
________
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

La "libéralisation" désigne le processus de fin légal d’une organisation monopolistique d’une économie, d’un secteur ou d’un marché, pour l’ouvrir à la concurrence.
Comme il est rare qu’une économie soit entièrement monopolistique (ce qui suppose qu’il y ait une concentration extrême du pouvoir politique), le phénomène concerne plus particulièrement des secteurs. La libéralisation si elle ne se traduit en droit que par une déclaration d’ouverture à la concurrence, ne se concrétise en fait que par une implantation beaucoup plus lente de celle-ci, car les opérateurs en place ont la puissance d’enrayer l’entrée de potentiels nouveaux entrants. C’est pourquoi le processus de libéralisation n’est effectif que si l’on met en place des autorités de régulation qui de force ouvrent le marché, en affaiblissant au besoin les opérateurs historiques et en offrant des avantages aux nouveaux entrants par une régulation asymétrique.
Cette régulation qui a pour fin de construire une concurrence, désormais permise par la loi.
C'est pourquoi dans un processus de libéralisation la régulation a pour but de concrétiser la concurrence en la construisant. Cette régulation transitoire a vocation à se retirer et les institutions mises en place à disparaître en devenant par exemple de simples chambres spécialisées de l’Autorité générale de concurrence, la régulation étant temporaire lorsqu’elle est liée à la libéralisation.
Elle est distincte de la Régulation des infrastructures essentielles qui, en tant que monopoles naturels, doivent être définitivement régulés. Assez souvent, dans des économies libérales, l’État a demandé à des entreprises publiques de gérer de tels monopoles, notamment dans les industries de réseaux, entreprises auxquelles il a confié également l'activité économique du secteur tout entier. Par le phénomène de libéralisation, la plupart des États ont choisi de conserver à cet opérateur, désormais opérateur historique en concurrence sur les activités en concurrence proposés aux consommateurs, la gestion de l'infrastructure. A ce titre, le Régulateur le contraint à deux titres : d'une façon transitoire pour que s'instaure la concurrence au bénéfice des nouveaux entrants, d'une façon définitive en tant qu'il a été choisi par l’État pour gérer le monopole économiquement naturel que constitue l'infrastructure.
Même dans les seuls rapports entre compétiteurs, la Régulation a du mal à reculer, et ce souvent du fait du Régulateur. Les lois sociologiques dégagées par Max Weber concernant l’administration montrent que les autorités de régulation, même au regard de la finalité de l'épanouissement concurrentiel, par exemple en matière de télécommunications, cherchent à demeurer, alors même que la concurrence a été effectivement construite, soit en se trouvant de nouvelles finalités (dans le secteur précité, le régulateur pourrait être le gardien de la neutralité du net), soit en affirmant pratiquer d'une façon permanente une "régulation symétrique".
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Les États-Unis ont établi des autorités de régulation dès la fin du XIXème siècle : partant du principe du marché, ils ont tempéré celui-ci par la mise en place de régulateurs, après avoir constaté les défaillances de marché, par exemple en matière de transport, en cas de monopoles économiquement naturels ou de facilités essentielles. La tradition de l’Union européenne est inverse puisque les États, notamment l’État Français, ont estimé que des secteurs d’intérêt général, censés inaptes au schéma concurrentiel car ne correspondant pas au schéma de fonctionnement de la rencontre de l’offre et de la demande, et devant servir les missions de services publics, devaient être tenus par l’État, soit directement par des établissements publics, soit par des entreprises publiques sous tutelle des ministères.
L’évolution en Europe est venue du droit communautaire. En effet, après la seconde guerre mondiale, l’idée a été de construire un marché qui devait être" commun" aux pays européens afin qu’ils ne puissent plus à l’avenir se faire la guerre. Pour atteindre ce but, ont été levées les frontières entre eux grâce aux principes de libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux. De la même façon a été interdite la défense par chacun des États de ses propres entreprises nationales par des aides d’État pour que toute entreprise même étrangère puisse pénétrer sur son territoire, afin que s’établisse un marché intérieur commun. Enfin, un droit de la concurrence était nécessaire pour interdire aux entreprises et aux États d’entraver le libre fonctionnement du marché, ce qui aurait ralenti voire stoppé la construction de ce marché intérieur, qui constituait un but essentiellement politique du traité de Rome.
Pour exécuter ce but politique, la Commission européenne et la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE, précédemment appelée Cour de justice des communautés - CJCE - européennes jusqu’au Traité de Lisbonne) ont interdit tout comportement d’entente ou d’abus de position dominante, même de la part des entreprises publiques, ainsi que tout soutien des États (sauf en cas de crise). De la même façon, dans une parfaite logique politique, mais aussi dans une parfaite contradiction avec les traditions nationales européennes, des textes européens, règlements ou directives, ont libéralisés des secteurs naguère monopolistiques, tout d’abord les télécommunications puis l’énergie. Ce fut le cas pour les télécommunications avec la directive de 1993, de la directive de 1996 pour l’électricité et de la directive de 1998 pour le gaz.
En raison de la hiérarchie des normes, les États, sauf à être poursuivis devant la Cour de justice par la Commission européenne en action pour manquement, ont été obligés de transposer par des lois nationales ces textes européens. Ainsi, de force, le droit communautaire, à la fois par le droit général de la concurrence, mais surtout pour réaliser son but politique de construction d’un marché intérieur unique et initialement pacificateur, a déclenché en Europe un système de régulation économique dans tous les secteurs d’industries de réseaux, système qui était pourtant étranger à la culture des États membres. Ce n’était pas le cas des régulations bancaires et assurantielles, secteurs qui depuis toujours ont été menacés par un risque systémique, et à ce titre régulés et supervisés par les banques centrales nationales depuis très longtemps.
Le Droit communautaire a depuis pendant 30 ans plongé dans les Droits nationaux en les méconnaissant, ce qui a pu être profitable aussi, et sur la base du Droit de la concurrence, la dimension politique du projet européen ayant été oubliée, sans doute au fur et à mesure que la Guerre elle-même s'effaçait des esprits.
Les effets de la globalisation et de la crise financière ont constitué un nouveau tournant dans le Droit communautaire qui, depuis 2010, se construit non plus pour modifier les Droits nationaux - et les détruire en partie - mais pour construire un Droit communautaire nouveau et ne devant ni au Droit de la concurrence ni aux Droits nationaux : un Droit communautaire de la Régulation, qui fait place aux droits des personnes et tente de construire dans le temps un système robuste aux crises. C'est ainsi que par des textes de l'Union européenne de 2014 se construit à la fois une Union bancaire et un droit nouveau des Abus de marché qui vise à établir un droit commun de l'intégrité des marchés financiers.
L'un des enjeux est ce qui pourrait ou devrait être la réconciliation entre les deux Europe, l'Europe économique et toujours peu sociale d'une part et l'Europe des droits de l'Homme, laquelle repose sur la Convention européenne des droits de l'Homme. Cela n'est pas à l'ordre du jour.
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. M. Mohamed Salah, "Conclusions", in J. Andriantsimbazovina (dir.), Puissances privées et droits de l'Homme. Essai d'analyse juridique, Mare Martin, coll. "Horizons européens", 2024, pp. 297-314
____
► Résumé de l'article :
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
Base Documentaire : Doctrine
►Référence complète : Delalieux, G., La loi sur le devoir de vigilance des sociétés multinationales : parcours d’une loi improbable, Droit et Société, 2020/3, n°106, p.649-665.
____
►Résumé de l'article (fait par l'auteur) : Cet article propose une analyse des obstacles rencontrés par les défenseurs de la proposition de loi sur le devoir de vigilance (ONG et syndicats) en étudiant les efforts de plaidoyer et de lobbying déployés par ces derniers afin de réussir à faire déposer, examiner puis adopter cette loi dont le Gouvernement ne voulait pas initialement.
À l’aune de ce cas, le concept d’entrepreneur institutionnel est discuté puis relativisé par utilisation de la notion de fortuna, développée par Machiavel, afin de décrire le passage « improbable » de cette loi. Les résultats tendent ainsi à relativiser l’importance que des acteurs singuliers, y compris collectifs, peuvent avoir dans l’explication du changement institutionnel, au profit d’une analyse multi-niveaux du changement (micro, méso, macro).
________
Syndicats. Summary Corporate Duty of Vigilance in France: The Path of an Improbable Statute This article offers an analysis of the resistance encountered by defenders (NGOs and trade unions) of the French Law on Corporate Duty of Vigilance. These actors sought to behave as institutional entrepreneurs deploying intense advocacy and lobbying efforts in order to successfully have this bill tabled, examined, and ultimately passed by the French government. In light of this case, the concept of “institutional entrepreneurship” is discussed and then relativized by the use of Machiavelli’s notion of “Fortuna,” in order to describe the “improbable” adoption of this statute. The results tend to put into perspective the importance that individual actors, including collective ones, can have in the explanation of institutional change, in favor of a multilevel analysis of change (micro, meso, macro). Corporate social responsibility – Institutional entrepreneurship – MNC’s Duty of Vigilance – Non-governmental organizations – Trade union
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

L'Autorité Administrative Indépendante (AAI) est la forme juridique que le Législateur a le plus souvent choisi pour établir des autorités de régulation. L'AAI est seulement sa forme juridique mais le système juridique continental, comme est le Droit français, allemand, italien, etc., y ont attaché une grande importance, suivant en cela la tradition formaliste du droit public. Les Autorités de régulation sont donc avant tout définies comme des autorités administratives indépendantes.
L’élément essentiel est dans le dernier adjectif : le caractère "indépendant" de l’organisme. Cela signifie que cet organe qui n’est pourtant qu’administratif, donc ayant vocation à être placé dans la hiérarchie l’exécutif, n’obéit pas au Gouvernement. En cela, on a très souvent présenté les régulateurs comme des électrons libres, ce qui a posé le problème de leur légitimité, puisqu’ils ne pouvaient plus puiser en amont dans la légitimé du Gouvernement. Cette indépendance pose également la difficulté de leur responsabilité, de la responsabilité de l’État du fait de leurs agissements, et de la reddition de compte (accountability) quant à l’usage qu’ils font de leurs pouvoirs. En outre, l’indépendance des régulateurs est parfois mise en doute si c’est le gouvernement qui conserve le pouvoir de nommer les dirigeants de l‘autorité de régulation. Enfin, l’autonomie budgétaire du régulateur est cruciale pour assurer son indépendance, les autorités ayant le privilège de bénéficier d’un budget -qui n’est pas inséré dans la LOLF- étant cependant très peu nombreuses. On les qualifie alors non plus d' "autorité administrative indépendante" mais d'Autorité Publique Indépendante", le Législateur faisant la distinction entre les deux (loi du 20 janvier 2017).
Le deuxième point concerne le second adjectif : à savoir qu’il s’agit d’un organe "administratif". Cela correspond à l’idée traditionnelle selon laquelle la régulation est le mécanisme par lequel l’État intervient dans l’économie, selon l’image d’une sorte de déconcentration des ministères, dans le modèle scandinave de l’agence. Si l’on se laisse enfermer dans ce vocabulaire, on en conclut que cet organisme administratif rend une décision administrative qui fait l’objet d’un recours devant un juge. Ainsi en premier lieu, il s’agirait d’un recours de premier instance et non pas d’un jugement puisque l’autorité administrative n’est pas un tribunal. En second lieu, le juge naturel du recours devrait être le juge administratif puisqu’il s’agit d’une décision administrative rendue par une autorité administrative. Mais, l’Ordonnance du 1ier décembre 1986 sur la concurrence et la libéralisation des prix, parce qu’elle entendait précisément briser cette idée d’une économie administrée pour imposer la liberté des prix l’idée du libéralisme économique, a imposé que les attaques faites contre les décisions de régulateurs économiques prenant la forme d’AAI soient portées devant la Cour d’appel de Paris, juridiction judiciaire. Certains grands auteurs ont même alors pu en déduire que la Cour d’appel de Paris était devenue une juridiction administrative. Mais aujourd’hui, le système procédural est devenu d’une extrême complexité car suivant les AAI et suivant les différentes sortes de décisions adoptées, elles relèvent d’un recours soit devant la Cour d’appel de Paris, soit devant le Conseil d'État. Si l’on observe les lois successives qui modifient le système, on constate qu’après cette grande position de principe de 1986, le juge administratif reprend petit à petit sa place dans le système, notamment dans la régulation financière. Doit-on par logique en conclure que l’on revient à un esprit de régulation définie comme une police administrative et à une économie administrée par l’État ?
Enfin, le troisième terme est le nom lui-même : « l’autorité ». Il signifie en premier lieu d'une entité dont le pouvoir tient avant dans son "autorité". Mais il marque qu'il n'est pas une juridiction, qu'il prend des décisions unilatérales. C’était sans compter la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et le juge judiciaire ! En effet, l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme pose que toute personne a droit à un tribunal impartial en matière civile et pénale. Or, la notion de « matière pénale » ne se coïncide pas avec la notion française formelle de droit pénal mais vise la notion factuelle, large et concrète, de répression. Ainsi, par un raisonnement qui va à rebours, un organisme, quelque soit la qualification qu’un État lui aura formellement conférée, qui a une activité de répression, agit "en matière pénale". De ce seul fait, au sens européen, il est un tribunal. Cela déclenche automatiquement une série de garanties fondamentales de procédure, au bénéfice de la personne qui risque d’être l’objet d’une décision de sa part. Une série de jurisprudence, aussi bien de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou du Conseil constitutionnel a conforté cette juridictionnalisation des AAI.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

La présomption est une dispense de preuve lorsqu'elle est établie par la loi. Elle est un raisonnement probatoire lorsqu'elle est présentée devant un juge, raisonnement qui permet d'établir un fait pertinent à partir d'une preuve indirecte. Il constitue en cela un déplacement d'objet de preuve.
On distingue les présomptions légales, lorsque c'est le législateur qui a posé comme établi un fait, ce qui engendre alors non plus un déplacement d'objet de preuve, mais une dispense de preuve pour celui qui doit supporter normalement la charge de preuve.
Lorsque l'adversaire à l'allégation n'est pas autorisé à rapporter la preuve contraire à l'allégation, la présomption est irréfragable. Parce que la présomption irréfragable est une dispense définitive de preuve, elle soustrait la réalité d'un fait à l'obligation d'être prouvé. La présomption équivaut alors à une fiction. Parce qu'il s'agit d'un artefact, on affirme généralement que seul le législateur a le droit de poser des présomptions irréfragables. Ainsi, la présomption de vérité qui s'attache à la chose définitivement jugée est une présomption légale irréfragable. Celle-ci est alors une pure règle de fond, ici l'incontestabilité des décisions de justice contre lesquelles il n'existe plus de voies de recours d'annulation disponible.
A côté des présomptions légales, existent les "présomptions du fait de l'homme", expression traditionnelle pour désigner les raisonnements probatoires précités que les parties présentent au juge. Comme il s'agit de preuves véritables, ayant donc pour objet de reconstituer la vérité, elles ne peuvent pas être irréfragables, et ne peuvent entraîner qu'une alternance des charges de preuve, au détriment du défendeur à l'allégation. La présomption du fait de l'homme est toujours simple.
Si la jurisprudence établit pourtant des présomptions qu'elle pose comme incontestables, cela signifie simplement qu'elle a établie comme une règle de fond, comme la responsabilité des parents du fait des enfants, antérieurement une responsabilité pour faute présumée aujourd'hui une responsabilité aujourd'hui. Cela n'est que l'expression de la jurisprudence source de droit, c'est-à-dire de la jurisprudence au même niveau que le législateur.
____
Exemple concret
Une personne, A, est retrouvée blessée sur la chaussée. Elle prétend que l'auteur du dommage est le propriétaire d'un vélo qui a freiné brutalement et l'a renversée avant de prendre la fuite. Il n'y a pas de témoin. Elle soutient qu'il s'agit de son voisin, B, dont le vélo, est endommagé. Elle démontre qu'il existe sur le bitume des traces de peinture et de pneus, qui correspondent aux entailles du vélo de B., observation faite qu'il a changé ses pneus le lendemain même de l'accident.
A soutient le raisonnement suivant au juge : je dois démontrer que B m'a renversée (objet direct de preuve), ce que je ne peux faire directement. Mais je peux prouver que son vélo est endommagé, qu'il a changé les pneus, que les entailles du vélo correspondent aux traces relevées sur le sol où a eu lieu l'accident, que B a changé ses pneus le lendemain même de l'accident : on peut, par ces preuves indirectes, présume un lien de causalité. Ainsi, la preuve est apportée non directement, mais par raisonnement.
Si le juge admet le raisonnement, comme la présomption n'est pas irréfragable, la question probatoire ne sera pas réglée, il opérera simplement un renversement de charge de preuve. B, défendeur à l'allégation, sera recevable à démontrer que ces éléments, le changement des pneus, l'endommagement de l'ossature du vélo, ont d'autre chose. S'il apporte ces preuves, alors il aura brisé la présomption simple, et le demandeur, qui supporte le risque de preuve, aura perdu le procès. S'il ne les apporte pas, alors le demandeur, grâce à la présomption, aura gagné son procès.
_______
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

La concurrence est la loi du marché, au sens où elle lui serait "naturelle". Elle permet l’émergence du prix exact, que l’on désigne souvent sous l’appellation de « juste prix ». Elle signifie et requiert que les agents sur le marchés sont à la fois mobiles, c'est-à-dire libres d’exercer leur volonté, et atomisés, c'est-à-dire non regroupés entre eux. Cela est vrai pour ceux qui proposent un bien ou un service, les offreurs, comme pour ceux qui cherchent à les acquérir, les demandeurs : les offreurs cherchent à s’attirer les demandeurs pour que ceux-ci leur achètent les biens et services qu’ils proposent. En cela, ils sont entre eux en concurrence.
Sur le marché concurrentiel, les acheteurs se laissent aller à leur infidélité naturelle : quand bien même ils auraient précédemment acheté un produit à un offreur A, ils pourront - voire devront, car cela est rationnel - s’en détourner au profit d’un offreur B si celui-ci leur offre un produit plus attractif quant à sa qualité ou son prix. Le prix est l’information principale que mettent les offreurs sur le marché pour exciter cette mobilité concurrentielle des offreurs. Ainsi, la libre concurrence accélère la fluidifie du marché, la circulation des biens et services, fait monter la qualité des produits et services et fait baisser les prix. Il s’agit donc d’un système moral et vertueux, comme le voulait Adam Smith, système qui est donc le fruit des vices individuels. C’est pourquoi tout ce qui va injecter de la « viscosité » dans le système va être combattu par le Droit de la concurrence comme systémiquement « non vertueux » : non seulement les accords frontaux sur les prix mais encore et par exemple les clauses d’exclusivité, les accords par lesquels les entreprises retardent leur entrée sur le marché ou bien des droits de propriété intellectuelle qui réservent au titulaire de brevet un monopole.
Certes, le droit de la concurrence ne peut être réduit à une présentation d’une telle simplicité car il admet des organisations économiques qui s’éloignent de ce modèle de base, par exemple les réseaux de distribution ou les mécanismes de brevets sur lesquels est notamment construit le secteur pharmaceutique. Mais l’incidence est d’ordre probatoire : dans la sphère du droit de la concurrence, si l’on est dans un schéma qui ne relève pas de la figure fondamentale de la libre confrontation de l’offre et de la demande, il faudra démontrer la légitimité et l’efficacité de son organisation, ce qui est une charge lourde pour les entreprises ou les États en cause.
Ainsi,en matière de régulation, si l’on devait estimer que la régulation est une exception à la concurrence, exception admise par les autorités de concurrence mais dont devraient être démontrées sans cesse devant elles sa légitimité et son efficacité au regard de l’ordre concurrentiel, alors les organisations publiques et les opérateurs des secteurs régulés subiraient toujours une charge de preuve très lourde. C’est ce que considèrent souvent les autorités de concurrence.
Mais si l’on considère que les secteurs régulés relèvent d’une toute autre logique que la logique concurrentielle, aussi bien du point de vue économique que du point de vue juridique, le Droit de la régulation se référant notamment à la notion de service public et ayant ses institutions propres que sont les Autorités de régulation, alors certains comportements, notamment monopolistiques, ne sont pas illégitimes en soi et n’ont pas à se justifier face au modèle concurrentiel, car ils n’en constituent pas l’exception (par exemple le service public de l’éducation ou de la santé).
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A. Oumedjkane, "Le devoir de vigilance est-il soluble dans le droit des contrats publics ?", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance et contrat, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", à paraître
____
► Résumé de l'article (fair par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : Il analyse le devoir de vigilance, lequel constitue la pointe avancée du Droit de la Compliance dans la commande publique.
Cela est contrintuitif, puisque le devoir de vigilance est légal et que la loi donne compétence au juge judiciaire. Mais l'auteur souligne que les lois récentes, notamment les lois "résilience et climat" et "finance verte" visent expressément le devoir de vigilance pour constituer des causes d'exclusion de l'entreprise qui manque à son obligation de vigilance des commandes publiques.
L'auteur regrette que les textes à ce propos aient fait l'objet d'une rédaction approximative et variant de texte en texte, alors qu'il s'agit de régir la même situation : celle de l'exclusion d'une entreprise du champ de la commande publique parce qu'elle n'a pas rempli son obligation de vigilance; ce qui suppose des obligations pleinement réalisées, ou de n'avoir pas établi un plan de vigilance, ce qui n'est pas la même chose et manifeste moins d'exigence.
Il souligne également la question du contrôle qualitatif du plan de vigilance, contrôle approfondi ou au contraire obligation purement formelle. Là encore, il pense, comme la majorité de la doctrine, qu'il est raisonnable de se rapporter à une interprétation minimale, même si la loi sur le devoir de vigilance marque plus d'ambition.
Il estime que si le juge administratif était en effet confronté à un contrôle substantiel, en raison de la compétence, qu'il estime exclusive, du Tribunal judiciaire de Paris, il faudrait former des questions préjudicielles...
Dans ces conditions d'interprétation minimale, seule une absence de plan ou un plan formellement défaillant serait sanctionné dans le cadre de la commande publique... Mais cette interprétation est la moins adaptée à l’objectif de la législation elle-même, et que l'on pourrait en arriver que ce qu'une entreprise qui aurait été condamnée par le Tribunal judiciaire pourrait n'être pourtant pas exclue d'un marché public...
L'auteur estime enfin que cette nouvelle démarche incitative montre en réalité l'impuissance du Droit des contrats publics à produire par lui-même les effets recherchés sur les entreprises.
________
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L. Aynès, "How International Arbitration can reinforce the Compliance Obligation", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Compliance Obligation, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, coll. "Compliance & Regulation", à paraître
____
📘consulter une présentation générale de l'ouvrage, Compliance Obligation, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : The author takes as his starting point the observation that International Arbitration and Compliance are a natural fit, since they are both a manifestation of globalisation, expressing an overcoming of borders, with arbitration being able to take on the Compliance Monumental Goals, since it has engendered a substantially global arbitral order.
But the obstacle lies in the fact that the source of arbitration remains the contract, with the arbitrator exercising only a temporary jurisdiction whose mission is given by the contract. Yet the advent of the global arbitral order makes this possible, with the arbitrator drawing on norms that may include the Compliance monumental goals and corporate commitments. In so doing, the arbitrator becomes an indirect organ of this emerging compliance law.
The contribution then suggests a second development, which could make the arbitrator a direct organ of compliance. For this to happen, the arbitrator must not only compel the fulfillment of an obligation to act, as is already the case with provisional measures, but also have a broader conception of the conflict for which a solution is required, or even free himself somewhat from the contractual source that surrounds it. This may well be taking shape, mirroring the profound transformation of the judge's office.
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
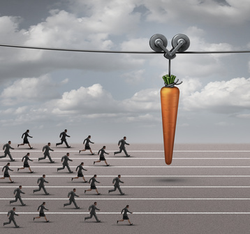
La théorie économique des incitations suppose implicitement qu’on ne peut contraindre un opérateur à agir contre sa volonté, ou à tout le moins qu’il est plus efficace de lui proposer des avantages de telles sorte qu’il fasse ce que l’on souhaite. En cela, cette conception s’oppose à la conception traditionnelle du Droit, qui pose à l’inverse que les sujets obéissent à l’ordre dicté par la norme juridique.
Mais sur des marchés globalisés, les opérateurs ont les moyens de désobéir et l’asymétrie d’information diminue le pouvoir de contrôle des Régulateurs ce qui fait douter de l’effectivité de la contrainte juridique : il ne suffit pas que le droit ordonne. Dans ces conditions, les textes, les régulateurs et les juges doivent produire des conditions qui incitent les agents à adopter des comportements conformes aux buts recherchés par les Régulateurs parce que les opérateurs y ont eux-mêmes intérêt.
Ainsi, si les systèmes de régulation quelque soit le secteur deviennent de plus en plus répressifs, même dans les économies libérales, ce n’est pas tant pour punir l’auteur des faits, mais pour inciter les tiers tentés d’en commettre d’analogues d’y renoncer. C’est le système de l’exemplarité. Cette pensée antérieure à Beccaria participe à la re-féoadalisation du Droit, démontrée par Pierre Legendre, associée au recul de l ‘État et à laquelle la Régulation participe pleinement. Les juges ont peu tendances à manier la répression de cette façon-là, ce qui crée un choc entre le droit pénal et le droit de la régulation, qui pourtant met la répression en son centre.
De la même façon, la régulation doit injecter des incitations positives, par exemple des récompenses pour communication d‘informations, ce qui incite à la délation, ou des incitations que le régulateur émet à l’égard du gestionnaire de réseau pour que celui-ci fasse des investissements dans l’entretien de celui-ci, contre l’intérêt immédiat de son actionnaire. Enfin, tout le droit et l’économie des brevets sont aujourd’hui pensés comme une incitation à innover. Mais, certaines incitations se sont révélées perverses telles les stock-options ou les bonus. En contrecoup, de nouveaux textes cherchent à réguler ceux-ci.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance


En principe le mécanisme même de marché est gouverné par la liberté, les libertés des agents eux-mêmes - liberté d'entreprendre et de contracter - et liberté concurrentielle qui marque le marché lui-même, la convergence de ces libertés permettant le fonctionnement autorégulé de la "loi du marché", à savoir la rencontre massifié des offres et des demandes qui engendre le prix adéquat ("juste prix").
Pour que cela fonctionne, il faut mais il suffit qu'il n'y ait pas de barrière à l'entrée et qu'il n'y ait pas de comportement par lesquels des opérateurs puissent entraver cette loi du marché concurrentiel, ces abus de marché étant l'abus de position dominante et l'entente.
Mais s'il s'agit des marchés financiers, lesquels sont des marchés régulés, les "abus de marchés" y sont sanctionnés au cœur même de la régulation. En effet, la régulation des marchés financiers suppose que l'information y soit distribué au profit des investisseurs, voire d'autres parties prenantes, éventuellement des informations non exclusivement financières. Cette intégrité des marchés financiers qui, au-delà de l'intégrité de l'information, doivent atteindre la transparente, justifie que l'information soit pleinement et également partagée. C'est pourquoi ceux qui ont titulaire ou doivent être titulaire d'une information qui n'est pas partagée par les autres (information privilégiée) ne doivent pas l'utiliser sur le marché tant qu'ils ne l'ont pas rendu publiques. De la même façon, ils ne doivent pas diffuser de mauvaises informations au marché. Pas plus qu'ils ne doivent manipuler les cours.
Ces sanctions ont été essentiellement conçues par la théorie financière américaine, concrétisées par les juridictions américaines, puis reprises en Europe. Dans la mesure où elles sanctionnent à la fois un comportement reprochable et constituent un instrument d'ordre public de direction et de protection des marchés, la question du cumul du droit pénal et du droit administratif répressif ne pouvait que se poser avec difficulté et agressivité.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Le contrôle est une notion si centrale en régulation que les termes anglais Regulation ou l'expression Regulatory system sont souvent traduits par le mot français "contrôle". En effet, le Régulateur contrôle le secteur dont il a la charge. Ce contrôle s’opère ex ante par l’adoption de normes de comportements, soit qu’il interdise des comportements, soit qu’il y oblige. En outre, il dispose souvent par exemple du pouvoir d’agrément d’entreprises entrant dans le secteur ou du pouvoir de certification de certains types de produits vendus sur les marchés dont il a la responsabilité. En outre, il surveille en permanence les secteurs dont il a la charge puisqu’il a pour fonction soit de les construire pour les mener jusqu’à la maturité concurrentielle soit qu'ils demeurent en équilibre entre le principe de concurrence et un autre souci, par exemple de veiller à ce qu’ils ne basculent pas dans une crise systémique. Ces contrôles ex ante distinguent radicalement l’autorité de régulation de l’autorité de concurrence qui n’intervient qu’ex post. Enfin, l’autorité de régulation contrôle le secteur ex post : en cela elle travaille en continuum temporel, en sanctionnant les manquements qu’elle constate de la part des opérateurs aux prescriptions qu’elle a adoptées. Elle dispose souvent d’un pouvoir de règlement des différents si deux opérateurs s’affrontent dans un litige entre eux et le portent devant elle.
Cette fonction de contrôle propre à l’autorité de régulation, fonction qu’elle partage souvent avec l’administration traditionnelle, et qui l’oppose à l’activité de l’autorité de concurrence et des tribunaux, est rendue difficile d’abord par son possible manque d’indépendance. En effet, si le régulateur doit contrôler un opérateur public, il peut risquer d’être capturé par le gouvernement, toute l’organisation du système de régulation devant donc veiller à son indépendance non seulement statutaire mais encore budgétaire par rapport à celui-ci. Ce risque de capture est d’ailleurs permanent non seulement du fait du gouvernement mais encore du fait du secteur. En second lieu, le contrôle peut être inefficace si le régulateur n’a pas les informations adéquates, fiables et en temps voulu, risque engendré par l’asymétrie d’information.
Pour lutter contre celle-ci, selon l’image enfantine du bâton et de la carotte, il faut tout à la fois donner au régulateur des pouvoirs pour extirper des informations que les opérateurs ne veulent pas fournir, les textes ne cessant de donner aux régulateurs de nouveaux pouvoirs, par exemple de perquisition. Symétriquement, les opérateurs sont incités à fournir des informations au marché et au régulateur par exemple à travers les programmes de clémence ou bien la multiplication des informations à insérer dans les documents sociétaires. Enfin l’équilibre est difficile entre la nécessité de lutter contre la capture du régulateur et la nécessité de réduire l’asymétrie d’information car le meilleur moyen pour celui-ci d’obtenir des informations du secteur est de fréquenter assidument les opérateurs : or, cet échange que ceux-ci acceptent très volontiers est la voix ouverte à la capture. C’est donc tout un art pour le régulateur de tenir à distance les opérateurs tout en obtenant d’eux des informations que seules des relations non tendues lui permettent d’obtenir.
Plus encore, le Droit de la compliance qui est en train de se mettre en place a vocation à résoudre cette difficulté majeure, le contrôlé devenant l'agent premier de mise en œuvre du Droit de la Régulation, dont les buts sont internalisés dans l'opérateur, opérateur crucial et global, le Régulateur veillant à la modification structurelle effective de l'opérateur pour concrétiser ces buts de régulation.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

La "compliance" est l'exemple-type d'un problème de traduction.
En effet, le terme anglais "Compliance" est le plus souvent traduit par le terme français de "Conformité". Mais à lire les textes, notamment en Droit financier, la "conformité" vise plutôt les obligations professionnelles, visant principalement la déontologie et la conduite des professionnels de marché, notamment des prestataires de service d'investissement. C'est à la fois une définition plus nette dans ses contours (et en cela plus sûre) et moins ambitieuse que celle exprimée par la "compliance". Il est dès lors et pour l'instant plus prudent de conserver, même en langue française, l'expression de "Compliance".
La définition de la Compliance est à la fois contestée et très variable, puisque selon les auteurs, elle va des seules obligations professionnelles des intervenants des marchés financiers jusqu'à l'obligation à ceux qui y sont soumis de respecter les lois et règlements, c'est-à-dire l'obligation générale que nous avons tous de respecter le Droit. A les lire, la Compliance serait le Droit lui-même.
Vue du point de vue du Droit, la Compliance est un ensemble de principes, de règles, d'institutions et de décisions générales ou individuelles, corpus dont l'effectivité est le souci premier, dans l'espace et dans le temps afin des buts d'intérêt général visés par ces techniques rassemblées soient concrétisés.
La liste de ces buts, qu'ils soient négatifs ("lutter contre" : la corruption, le terrorisme, le détournement de fonds publics, le trafic de drogues, le trafic d'êtres humain, le trafic d'organe, le trafic de biens toxiques et contagieux - médicaments, produits financiers, etc.) ou positifs ("lutter pour" : l'accès de tous aux biens essentiels, la préservation de l'environnement, les droits fondamentaux des êtres humains, l'éducation, la paix, la transmission de la planète aux générations futures) montre qu'il s'agit de buts politiques.
Ces buts correspondent à la définition politique du Droit de la Régulation.
Ces buts politiques exigent des moyens qui excèdent les forces des États, par ailleurs enfermés dans leurs frontières.
Ces buts monumentaux ont donc été internalisés par les Autorités publiques dans des opérateurs globaux. Le Droit de la Compliance correspond à une structuration nouvelles de ces opérateurs globaux. Cela explique notamment que les lois nouvelles mettent en place des répressions non seulement objectives mais structurelles, comme le font en France les lois Sapin 2 (2016) ou établissant une obligation de vigilance (2017).
Cette internationalisation du Droit de la Régulation dans les entreprises implique que les Autorités publiques supervisent désormais celles-ci, même si celles-ci n'appartiennent pas à un secteur supervisé, ni même à un secteur régulé, mais par exemple participent au commerce international.
Le Droit de la Compliance exprime donc une volonté politique globale relayé par un Droit nouveau violent, le plus souvent répressif, sur les entreprises.
Mais il peut aussi exprimer de la part des opérateurs, notamment les "opérateurs cruciaux" une volonté propre d'avoir eux-mêmes souci de ces buts globaux monumentaux, qu'ils soient de nature négative ou positive. Cette dimension éthique, exprimée notamment par la Responsabilité Sociétale, est la continuation de l'esprit du service public et le souci de l'intérêt général, élevés mondialement.
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : E. Maclouf, "Entités industrielles et Obligation de compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), L'Obligation de Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, coll. "Régulations & Compliance", 2024, à paraître
____
📕lire une présentation générale de l'ouvrage, L'Obligation de Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance - JoRC) : L'article prend le sujet sous l'angle des sciences de gestion et entreprend de résoudre le paradoxe d'organisations industrielles qui expriment l'ambition d'un progrès au bénéfice des personnes, ambition humaniste qui est contredite par les effets produits par cette industrialisation même qui sont dommageable à cette même humanité. L'Obligation de Compliance en ce qu'elle est fondée sur les Buts Monumentaux et s'ancre dans les organisations industrielles tente de résoudre ce paradoxe.
La science des organisations humaines vise à allouer le plus efficacement les ressources rares de la nature en faisant coopérer les individus, cette ingénierie produisant des destructions naturelles, industrielles et sociales plus ou moins anticipées. L'Obligation de Compliance porte l'espoir de mieux les prévenir (But monumental négatif) et les gérer, voire d'améliorer la vie des personnes (But monumental positif) en dépassant les disciplines traditionnelles et en se développant en Ex Ante. Mais les organisations industrielles peuvent aussi récuser le poids des contraintes ainsi engendrées sur elles, et parvenir à l'inverse à une dérégulation. Le débat est actuellement ouvert.
En effet, les entreprises en passant de la logique mécanique de conformité à la logique dynamique de l'Obligation de Compliance se trouvent en incertitude systémique et doivent décider de la stratégie à mettre en oeuvre, entraînant une managérialisation du Droit et autant de nouvelles décisions à prendre. La notion de "projet" revient alors au centre de la régulation des organisations industrielles, plus précisément celle de "projet humaniste" portée par l'Obligation de Compliance, dans de nouvelles configurations où chacun prend sa part dans la chaine de valeur.
L'auteur puise dans les travaux de Raymond Aron et dans le rapport Rueff-Armand pour montrer que le développement de l'organisation industrielle comme mode dominant d’agencement des activités humaines – fondé sur le calcul économique – portait un projet humaniste politiquement élaboré mais que sa réalisation était dès l’origine identifiée comme incertaine par ses auteurs. L’Obligation de Compliance émerge aujourd’hui comme une réponse nécessaire, la régulation des activités industrielles au service d’un progrès humain ne pouvant venir de la seule somme des actions individuelles (salariés, consommateurs, investisseurs), ni des forces stratégiques présentes dans l’environnement stratégique, ni des entités elles-mêmes.
En passant en revue les trente-deux propositions faites par MM. Gauvin et Marleix dans leur rapport d’évaluation, l'auteur montre l’Obligation de Compliance tend à évoluer vers des formes d’ingénieries managériales pour incarner réellement le projet humaniste dans notre contexte industriel. Elle crée des entités capables, au service de l'intérêt général, d’entrer en relation stratégique avec les entités industrielles et de négocier des Obligations qui permettraient d’introduire enfin le projet humaniste dans leur agenda stratégique : la loi dite "Sapin 2" en est un parfait exemple, incitant aux réponses stratégiques adéquates des organisations industrielles, qui ont modifié leurs procédures managériales, pour intégrer de nouveaux projets stratégiques et y impliquer les parties prenantes.
Cependant, parce que l'Obligation de Compliance vise à introduire des buts humanistes dans les projets industriels, elle se retrouve livrée aux forces stratégiques déjà présentes dans leurs activités, confiant aux différents organes des organisations le pouvoir et la mission de définir les stratégies par des délibérations qui seront ensuite, dans l'approche précitée de rationalité économique, déclinées en objectifs et en plans. Or la théorie des organisations montre qu’il n’existe pas un « but » dans une organisation industrielle mais une population de buts dynamiques aux issues incertaines. Contrairement à ce qui est généralement affirmé, la recherche de profit n’est d’ailleurs pas en soi un « but » car il existe une infinité d’agencements et de clés de répartition de la valeur possibles : c'est la condition sine qua non de sa survie, ce qui est différent. Ainsi une organisation rationnelle détermine son projet et doit exclure que, pour l'atteindre, elle ne risque de tomber en faillite. L'Obligation de Compliance vise à propulser des Buts monumentaux au sommet de projets industriels, mais, pour fixer ces projets, l'organisation doit résoudre les oppositions (la conflictualité) par un jeu complexe d'interactions dont les résultats échappent aux participants et leur revient comme des auto transcendances (Jean-Pierre Dupuy).
Pour mieux évaluer et piloter l'Obligation de Compliance, il faut donc observer et comprendre les mécanismes de réponses stratégiques des organisations industrielles. Bien au-delà de la logique de conformité, elles le font notamment en construisant des référentiels ou en contribuant à la construction de ceux-ci et en rattachant elles-mêmes expressément des buts comme la lutte contre la souffrance au travail ou l'égalité entre les femmes et les hommes comme relevant de l'Obligation de Compliance. Le législateur et les agents de régulation doivent donc intégrer, au besoin à l'aide de recherches interdisciplinaires avec les sciences de gestions, les dynamiques de cadrage stratégique des organisations.
Ainsi l'Obligation de Compliance doit être envisagée selon l'auteur comme des "réponses adaptatives face aux crises systémiques et à leurs causes", parant à l'anomie elle-aussi monumentale dont souffre notre société actuelle qui a perdu ses repères et se retrouve dans des incertitudes existentielles. Cette Obligation de Compliance a vocation, au besoin par la contrainte, aux entités industrielles de s'intégrer dans la société en devenant les vecteurs des droits humains et des attentes sociales et environnementales. Le succès de cette Obligation de Compliance suppose une certaine appropriation stratégique par les grandes entreprises des buts, ce qui rend cette Obligation elle-même incertaine.
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

Juridiquement, l’État est un sujet de droit public qui se définit par un territoire, un peuple et des institutions. Il agit dans l'espace international et émet des normes. Politiquement, il a la légitimité requise pour exprimer la volonté du corps social et exercer la violence dont il prive les autres sujets de droit. Il est souvent été reconnaissable par sa puissance : son usage de force publique, sa puissance budgétaire, sa puissance juridictionnelle. Ces trois puissances déclinant ou étant concurrencées par des mécanismes privés, internationaux et donnant davantage satisfaction, l'on a prédit la disparition de l’État, pour la déplorer ou pour danser sur son cadavre.
Avec un tel arrière-plan, dans les théories actuelles de la Régulation , principalement construits par la pensé économique et à première vue l'on pourrait dire que l’État est avant-tout l'ennemi. Et cela pour deux raisons principales. La première est théorique et de nature négative. Les tenants de la théorie de la Régulation dénient à l’État les qualités politiques énoncées ci-dessus. L’État ne serait pas un "être" mais bien plutôt un groupe d'individus, fonctionnaires, élus et autres êtres humains concrets, n'exprimant rien d'autres que leurs intérêts particuliers, venant en conflit avec d'autres intérêts, et utilisant leurs pouvoirs pour servir les premiers plutôt que les seconds comme tout un chacun. La théorie de la Régulation, jouxtant ici la théorie de l'agence, a alors pour fin de contrôler les agents publics et les élus dans lesquels il n'y a pas de raison de faire confiance a priori.
La seconde est pratique et de nature positive. L’État ne serait pas une "personne", mais une organisation. L'on retrouve ici la même perspective que pour la notion d'entreprise, que les juristes conçoivent comme une personne ou un groupe de personnes tandis que les économistes qui conçoivent le monde à travers le marché la représente comme une organisation. L’État comme une organisation devrait être "efficace", voire "optimal". C'est alors la fonction pragmatique du Droit de la Régulation. Or, lorsqu'il est régi par le droit traditionnel, empêtré par les illusions quasiment religieuses de l'intérêt général, voire du contrat social, il est sous-optimal. Il s'agit de le rendre plus efficace.
Pour cela, en tant qu'organisation, l’État est notamment découpé, en agences ou en autorités administratives indépendantes, régulateurs qui gèrent au plus proche les sujets, ce qui pour effet heureux de diminuer l'asymétrie d'information et de faire renaître la confiance dans un lien direct. L’État unitaire, distant et sûr de lui est abandonné pour une conception souple et pragmatique d'un État stratège qui aurait enfin compris qu'il est une organisation comme une autre...
Le Droit de la concurrence adopte cette conception de l’État, dont il a posé dès le départ qu'il était un opérateur économique comme un autre. C'est ainsi qu'est souvent présentée une conception qui serait plus "neutre" du monde.
Les crises successives, qu'elles soient sanitaires ou financières, ont produit un effet de balancier.
L'on crédite de nouveau les notions d'intérêt général ou de biens communs d'un valeur autonome et la nécessité de dépasser les intérêts immédiats et de trouver des personnes pour porter des intérêts supérieurs ou de prendre en charge les intérêts d'autrui, même un autrui non immédiat, s'est fait jour.
Ainsi, l’État ou l'autorité publique, réapparaît dans la mondialisation. Le Droit de la Compliance ou la Responsabilité sociétale des entreprises cruciales sont en train de converger vers une considération de l’État, qui ne peut être réduit à une pure et simple organisation réceptacle des externalités.
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance


Sur un marché ordinaire de biens et service, l'accès au marché est ouvert à tous, qu'il s'agisse de celui qui offre le bien ou le service (potentiel offreur) ou de celui qui désire se l'approprier (potentiel demandeur). La liberté de la concurrence suppose que ces nouveaux entrants puissent à leur volonté devenir des agents effectifs sur le marché, le potentiel offreur si son dynamisme entrepreneurial l'y pousse, et le potentiel demandeur s'il en a le désir et les moyens (pécuniaires, d'information et de proximité, notamment). L'absence de barrière à l'entrée est présumée ; une barrière résultant d'un comportement anticoncurrentiel sera sanctionnée ex post par l'autorité de concurrence.
La barrière est donc ce qui contrarie le principe d'accès au marché. C'est pourquoi l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), en ce qu'elle lutte contre les barrières pour assurer un libre-échange mondial, peut être considérée comme un précurseur d'une Autorité mondiale de la concurrence.
Mais il peut arriver qu'il soit nécessaire d'organiser par la force du Droit un accès, non seulement parce qu'il y a eu une décision de libéralisation un secteur naguère monopolistique, l'accès ne pouvant pas s'exercer par la seule force de la demande et par la seule puissance des potentiels nouveaux entrants, notamment par la puissance de fait des entreprises présentes anciennement monopolistiques. L'Autorité de régulation va construire les accès à des marchés sectoriels dont le seul principe du fonctionnement concurrentiel a été déclaré par le Droit. Cette nécessité peut aussi résulter de phénomènes entravant définitivement ce fonctionnement concurrentiel idéal, comme des monopoles naturels ou des asymétries d'information : le Droit va concrétiser cet accès en distribuant aux parties intéressées des droits subjectifs d'accès.
Il en est ainsi des droits d'accès des opérateurs aux réseaux d'infrastructure essentielle. Même si cet acte s'opère par contrat, celui-ci ne fait que concrétiser un droit subjectif d'accès conféré par la Loi à l'opérateur pour qu'il puisse pénétrer le marché. Cela est particulièrement vrai dans les secteurs de l'énergie et des télécommunications.
D'une façon plus politique et sans rapport direct avec une volonté d'installer la concurrence ou de pallier une défaillance de marché, cette organisation des accès peut encore être requise parce qu'il existe une décision politique d'assurer à chacun un accès à des biens communs. La décision jouxte alors la notion de "droit fondamental", par exemple le droit fondamental d'accès au système de soins ou aux médicaments vitaux, ou le droit fondamental d'accès au système numérique, droit subjectif dont le Régulateur devient le gardien à la fois en Ex Ante et en Ex Post.
Base Documentaire : Doctrine
Référence générale, Cohendet, M.-A. et Fleury, M., Droit constitutionnel et droit international de l'environnement, Revue française de droit constitutionnel , PUF, » 2020/2, n°122, p.271-297.
___
Résumé de l'article :
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : L. d'Avout, La cohérence mondiale du droit, Cours général de droit international privé, Académie de droit international de La Haye, t.443, 2025, 692 p.
____
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Segonds, M., Compliance, Proportionality and Sanction. The example of the sanctions taken by the French Anticorruption Agency, in Frison-Roche, M.-A. (ed.),Compliance Monumental Goals, series "Compliance & Regulation", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, à paraître.
___
► Article Summary: Before devoting the developments of his article to the sole perspective of sanctions imposed under "Anti-corruption Compliance", the author recalls in a more general way that, as is the sanction, Compliance is in essence proportional: Proportionality is inherent to Compliance as it conditions any sanction, including a sanction imposed under Compliance.
This link between Proportionality and Compliance has been underlined by the French Anti-Corruption Agency (Agence française anticorruption - AFA) with regard to risk mapping, which must measure risks to arrive at effective and proportional measures. This same spirit of proportionality animates the recommendations of the AFA which are intended to apply according to the size of the company and its concrete organisation. It governs sanctions even more, in that punitive sanctions refer on one hand to Criminal Law, centered on the requirement of proportionality. Punitive sanctions It governs sanctions even more, in that punitive sanctions refer on the other hand to the disciplinary power of the manager who, from other sources of law, must integrate the legal requirement of proportionality when he/she applies external and internal compliance norms.
____
📝 consulter la présentation du livre, Compliance Monumental Goals, dans lequel l'article est publié
_______
Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance

La Federal Communications Commission (FCC) est l'autorité de régulation indépendante qui aux États-Unis régule au niveau fédéral à la fois le contenant et le contenu des télécommunications.
En cela les États-Unis se distinguent de l'Union européenne, espace juridique dans lequel le plus souvent les institutions de régulation du contenant et du contenu sont distinctes (par exemple en France ARCEP / CSA/CNIL) et dans lequel les régulations des communications demeurent substantiellement au niveau des États membres de l'Union.
Comme les autres régulateurs audiovisuels, elle assure le pluralisme de l'information en limitant la concentration capitalistique - et donc du pouvoir - dans le secteur de la télévision et de la radio. L'on mesure ainsi que le système américain n'est pas dans son principe différent du système européen.
En outre, la FCC se caractérise tout d'abord par une très grande puissance, imposant à la fois des principes substantiels aux opérateurs, comme celui de la "décence", allant au nom de ce principe jusqu'à sanctionner des chaînes de télévision qui avaient laissé montrer une poitrine nue d'une femme. Le contrôle est donc plus substantiel qu'en Europe, ce contrôle venant en balance avec la liberté constitutionnelle d'expression qui est plus puissance aux Etats-Unis qu'en Europe. Il est vrai qu'aujourd'hui les entreprises maîtresses du numérique ont tendance à formuler pour nous ce qui est beau, bien et décent, à la place des autorités publiques.
La FCC a continué de développer les principes majeurs du système de communication publique, comme en 2015 celui de l'Internet ouvert (Open Internet) ou à formuler le principe de "neutralité du numérique", repris par une loi fédéral, ce principe ayant des implications économiques et politiques considérables.
Mais dans le même temps, marque générale d'un droit américain, le juge tempère ce pouvoir, selon le principe de Check and Balance. C'est ainsi que la Cour suprême des États-Unis par l'arrêt FCC v. Pacifica Foundation en 1978 ce pouvoir de contrôle direct du contenu mais en opère également le contrôle du contrôle.
L'élection en 2016 d'un nouveau président qui est entre autres choses totalement hostile à l'idée même de Régulation est une épreuve au sens probatoire du terme. Il a nommé en janvier 2017 un nouveau président de la FCC, hostile à toute régulation et notamment au principe de neutralité. La question qui se pose est de savoir si techniquement une régulation déjà établie sur ces principes peut résister, comment et combien de temps, à une volonté politique violemment et expressément contraire. Et que feront les juges.