Matières à Réflexions
7 mai 2020
Base Documentaire : Soft Law
Référence complète: Autorité des marchés financiers (AMF), Cartographie 2020 des marchés et des risques, Risques et tendances, Juillet 2020

24 avril 2020
Publications

Its subject is the confrontation between the current health crisis situation and the Compliance Law.
Summary. After defining Compliance Law, distinguishing the procedural and poor definition and the substantial and rich definition, the starting point is to admit the aporia: the type of health crisis caused by Covid-19 will be renewed and it is imperative to prevent it, even to manage it, then to organize the crisis exit. Public Authorities are legitimate to do so, but because this type of crisis being global and the State being consubstantially linked to borders, States are hardly powerful. Their traditional International Law shows their limits in this current crisis and one cannot hope that this configulration will improve radically.
In contrast, some companies and markets, notably the financial markets, are global. But the markets are not legitimate to carry out such missions and counting on the generosity of certain large companies is far too fragile in front of the "monumental goal" that is the prevention of the next health crisis, crisis which must never happen.
How to get out of this aporia?
By Compliance Law, basis of, in a literal and strong sense, the "Law of the Future".
We need to be inspired by the Banking and Financial Compliance Law. Designed in the United States after the 1929 crisis to tend towards the "monumental goal" of the absence of a new devastating crisis in the country and the world, this set of new legal mechanisms gave duty and power of supervision, regulation and compliance to market authorities and central bankers. These are independent of governments but in constant contact with them. Today, they claim to have as first priority the fight against climate change. Now and for the future, they must also be given the responsibility and the powers to prevent a global health disaster, similar to a global ecological disaster, similar to a global financial disaster. This does not require a modification of the texts because their mandate consists in fighting instability. Stability must become a primary legal principle, of which the fight against monetary instability was only a first example. By the new use that central banks must make of it by preventing and managing health crises, Compliance Law will ensure that the future will be not catastrophic.
15 avril 2020
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Gelblat, A. et Marguet, L., État d’urgence sanitaire : la doctrine dans tous ses états ?, Revue des droits de l'homme, avril 2020.
____
15 avril 2020
Base Documentaire : Doctrine
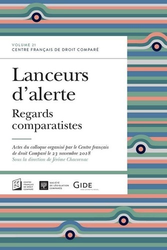
Référence complète: Chacornac, J. (dir.), Lanceurs d'alerte: regards comparatistes, Editions de la Société de Législation Comparée, Vol. 21, avril 2020, 192 p.
Cet ouvrage fait suite au colloque organisé par le Centre français de droit Comparé le 23 novembre 2018
Lire la quatrième de couverture
Lire la présentation de l'article de Marie-Anne Frison-Roche : L'impossible unicité de la catégorie des lanceurs d'alerte, qui constitue l'introduction de l'ouvrage.
_____
8 avril 2020
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Dreyfus, S.,L., American Extraterritoriality : A Contrarian View, in International Financial and White Collar Crime, Corporate Malfeasance and Compliance, CHRONIQUE, RTDF n°1, 2019, pp. 2-4.
Les étudiants de Sciences po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier "MAFR - Regulation & Compliance".
1 avril 2020
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : S. Merabet, Vers un droit de l'intelligence artificielle, préf. H. Barbier, Dalloz, coll. "Nouvelle Bibliothèque des Thèses", vol. 197, 2020, 509 p.
____
► Résumé de l'ouvrage (fait par l'auteur) : "Les études consacrées aux conséquences de l'intelligence artificielle sur le marché de l'emploi prédisent un large mouvement de remplacement de l'homme par la machine au cours des prochaines années. Le phénomène ne semble a priori pas inédit et rappelle celui intervenu au cours de la Révolution industrielle. Néanmoins, l'observation des catégories d'emplois menacés interpelle. Toutes les activités semblent concernées. Ainsi, banquiers, comptables, avocats, médecins voire même magistrats pourraient être exposés à cette nouvelle concurrence technologique. Le remplacement progressif de l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle ne semble pour l'heure connaître aucune autre limite que celle fixée par la technique. Pourtant, à l'étude, il apparaît que ces deux formes d'intelligences ne peuvent pas être tenues pour équivalentes par le droit. L'intelligence artificielle est en mesure d'imiter plusieurs manifestations de l'intelligence humaine, tel que le langage ou encore le calcul. À certains égards, l'intelligence artificielle surpasse même l'entendement humain. En revanche, d'autres manifestations de l'intelligence humaine lui font désespérément défaut. La conscience, la volonté ou encore les émotions sont étrangères à l'intelligence artificielle. Plus généralement, les dimensions subjectives de l'intelligence humaine ne sont pas accessibles aux systèmes informatiques, même les plus sophistiqués. Or, le droit se fonde de manière discrète mais certaine sur celles-ci. In fine, l'intelligence artificielle apparaît tout à la fois comme une forme d'intelligence diminuée et augmentée. C'est sur le constat de ces excès et carences de l'intelligence artificielle qu'il convient de penser le régime juridique qui doit lui être réservé. L'application à un système informatique intelligent de règles pensées pour les personnes peut s'avérer inadaptée. En effet, la confrontation entre le droit et l'intelligence artificielle révèle l'existence d'un paradigme sur lequel se fonde le droit positif. Le droit français s'appuie pour une large part sur la subjectivité inhérente à la personne humaine. Toutes les branches du droit semblent concernées, le droit civil comme le droit pénal ou encore le droit de la propriété intellectuelle. Dès lors, le régime juridique de l'intelligence artificielle apparaît bien incertain. L'objet de cette étude est donc de dissiper les doutes qui entourent la nature de l'intelligence artificielle en vue de la distinguer clairement de l'intelligence humaine. Aussi, le constat de l'absence d'identité de ces deux formes d'intelligence suppose d'une part de limiter le domaine de l'intelligence artificielle par la consécration d'un ordre public de l'Humanité, et d'autre part, d'adapter les règles pensées en considération de la subjectivité humaine à l'objectivité des systèmes informatiques intelligents. En définitive, l'appréhension juridique de l'intelligence artificielle est l'occasion d'une réflexion plus générale sur l'intelligence humaine et la place centrale qu'elle occupe dans notre ordonnancement juridique.".
________
23 mars 2020
Publications

Sans sollicitation, sur son fil d'actualité, celui qui évolue sur le réseau social construit par Facebook a trouvé le 23 mars 2020 au matin ce message :

22 mars 2020
Publications
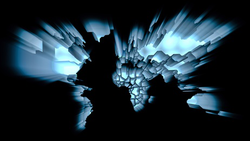
Ce document de travail sert de base à un article à paraître au Clunet.
Lorsque l'on rapproche les deux termes de "Compliance" et d' "Extraterritorialité", c'est souvent pour n'en éprouver que du mécontentement, voire de la colère et de l'indignation. Comment admettre que des décisions nationales de sanction ou d'injonction puissent avoir une portée extraterritoriale par le seul usage quasiment magique de ce qui serait l'impératif de "Compliance" ?! Sur la lancée, après avoir formulé une désapprobation de principe à l'égard d'un tel rapprochement constituant en lui-même une sorte de couple scandaleux, l'attention de ceux qui s'en offusque se concentre sur la façon dont l'on pourrait lutter contre le couplage, pour mieux casser ce lien noué entre la Compliance et l'Extraterritorialité.
Mais doit-on aller si vite ? Cette appréciation négative de départ est-elle exacte ?
En effet parti ainsi l'on explique fréquemment que les mécanismes contraignants de Compliance sont subis par ceux auxquels ils s'appliquent, notamment banques et compagnies pétrolières, qu'ils viennent de l'étranger!footnote-1750, qu'il se développent avec efficacité mais d'une façon illégitime, sans l'accord de celui qui doit s'y soumettre, celui dont la résistance est donc certes inopérante mais pourtant justifiée. Dans le même esprit, lorsqu'on se met à égrener les cas, comme autant de cicatrices, sorte de chapelet, voire de couronne d'épines, cas BNPP!footnote-1718, cas Astom!footnote-1717, etc., ces blessures non encore refermées se transforment de reproches faits aux règles, aux autorités publiques, voire en reproches faits à personnes dénommées.
Puis l'on quitte cette sorte de plainte contre X pour viser d'une façon générale ce qui serait cette épouvantable "Compliance", ce Droit qui serait à la fois hostile et mécanique, qui n'aurait pas su rester dans les limites des frontières. La Compliance est ainsi placée à l'opposé de la souverainteté et de la protection par le Droit, lesquelles supposent de demeurer dans ses limites!footnote-1716 et d'être en mesure de protéger les entreprises contre "l'étranger". Sous les généralités, cette présentation vise plus directement les Etats-Unis, qui utiliseraient "l'arme juridique", glissée sous ce qui est alors désigné comme "l'artifice du Droit" à portée extraterritoriale. Mais cet effet serait en réalité l'objet même de l'ensemble : leur volonté hégémonique pour mieux organiser au minimum un racket mondial, à travers notamment le Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) et au mieux un gouvernement mondial à travers notamment les embargos.
Ceux qui croiraient le contraire seraient bien des naïfs ou des sots ! Affirmation qui fait taire les contradicteurs, car qui aime ces costumes-là ? Ainsi l'opinion majoritaire, voire unanime, estime que les continents seraient mis en coupe réglée ; ce que la mafia n'avait pu faire, le Droit de la Compliance l'aurait obtenu, offrant le monde entier aux Etats-Unis grâce à l'extraterritorialité de leur Droit national.
Le Droit de la Compliance deviendrait ainsi la négation même du Droit, puisqu'il a pour effet, voire pour objet (dans cette présentation un objet à peine dissimulé par un Etat stratège, puissant et sans vergogne), de compter pour rien les frontières, alors que le Droit international public, en ce qu'il se construit entre les sujets de droit souverains que sont les Etats, présuppose le respect premier des frontières pour mieux les dépasser tandis que le Droit international privé prend le même postulat pour mieux accueillir la loi étrangère dans les situations présentant un élément d'extranéité!footnote-1726. Ainsi, naguère des juristes purent défendre la force du Droit ; mais par la Compliance, l'on en reviendrait à la triste réalité comme quoi seuls les puissants, ici les Etats-Unis, dominent et - ironie du sort - ce serait sous prétexte de Droit qu'ils le feraient ! Il faudrait donc être bien dupe, ou complice, ou valet, pour voir encore du juridique là où il n'y aurait que du rapport de force. Quand on est plus intelligent ou habile que cela, l'on devrait enfin comprendre que le "petit" ne peut qu'être l' "assujetti" du Droit de la Compliance, puisquil faudrait être puissant de facto pour en être sa source normative et son agent d'exécution. C'est alors vers ce Department of Justice (DoJ), ce mal-nommé, que les regards craintifs, haineux et résignés se tournent. Ainsi le Droit, qui a pour définition la défense du faible, serait devenu l'arme cynique du fort. La Compliance serait ainsi non plus seulement la négation du Droit : elle serait comme la honte du Droit.
Si l'on perçoit les choses ainsi, que faudrait-il faire ? La réponse est évidente : réagir !
Il faudrait sauver la Sauveraineté, la France, les entreprise, le Droit lui-même. Si c'est bien ainsi que la question se pose en amont, comment ne pas être d'accord en aval ? Il faudrait donc détruire le Droit de la Compliance et l'extraterritorialité du Droit américain qui aurait trouvé ce "cheval de Troie", expression si fréquemment utilisée. C'est la base des rapports administratifs disponibles, par exemple du rapport parlementaire "Berger-Lellouche"!footnote-1719 et du "Rapport Gauvain"!footnote-1720. L'un et l'autre développent largement les deux affirmations précédentes, à savoir que l'extraterrioralité des mécanismes de compliance est illégitime et nuisible, puisqu'il s'agirait d'un mécanisme inventé par les Américains et faisant du tort aux Européens, voire inventé par les Américains pour faire du tort aux Européens, la description étant faite dans des termes beaucoup plus violents que ceux ici utilisés. La description semblant acquise, les réflexions portent donc sur les remèdes, toujours conçus pour "bloquer" le Droit de la Compliance dans son effet extraterritorial.
Mais sans discuter sur l'efficacité des remèdes proposés en aval, il convient plutôt de revenir sur cette description faite en amont et si largement partagée. Car beaucoup d'éléments conduisent au contraire à affirmer que le Droit de la Compliance tout d'abord et par nature ne peut qu'être extraterritoire et qu'il doit l'être. Cela est justifié, que l'Etat dans lequel ses différents outils ont été élaborés soit ou non animé d'intentions malicieuses. La description qui nous est usuellement faite s'appuie le plus souvent sur des cas particuliers, dont l'on tire des généralités, mais l'on ne peut réduire le Droit de la Compliance au cas, déjà refroidi, BNPP, ou au cas toujours brûlant de l'embargo américain sur l'Iran. Plus encore, l'on ne peut prendre la question des embargos et en tirer des conclusions, légitimes pour elle, mais qui devraient valoir pour l'ensemble du Droit de la Compliance. Le fait que le Droit de la Compliance soit une branche du Droit au stade encore de l'émergence peut conduire à cette confusion qui consiste à prendre la partie pour le tout, mais c'est très regrettable car une critique justifieé pour les embargos ne l'est en rien pour tout le Droit de la Compliance, dont précisément le Droit des embargos n'est qu'une petite partie, voire un usage abusif. Cet emboîtement n'est pas souvent perçu, parce que la définition du Droit de la Compliance et son critère ne sont assez nettement cernés, à savoir l'existence d'un "but monumental"!footnote-1725, lequel précisément n'existe pas dans un embargo décidé unilatéralement par un ordre décrété par le président des Etats-Unis, mais qui existe dans tous les autres cas. Ce "but monumental" justifie pleinement une extraterritorialité, extraterritorialité qui est même consubstantielle au Droit de la Compliance (I).
Une fois que l'on a distingué les embargos, comme partie atypique, voire parfois illégitime, du Droit de la Compliance, il convient de poursuivre ce travail de distinction en soulignant que les Etats-Unis ont certes inventé le Droit de la Compliance!footnote-1721 mais en n'ont développé qu'une conception mécanique de prévention et de gestion des risques systèmiques. L'Europe a repris cette conception systèmique de protection des systèmes, par exemple financier ou bancaire, mais y a superposé une autre conception, puisant dans sa profonde tradition humaniste!footnote-1722, dont la protection des données à caractère personnel n'est qu'un exemple et dont le but monumental est plus largement la protection de l'être humain. Les crises sanitaires lui donne une illustration particulière. Ce souci premier justifie alors l'usage européen des mécanismes de Compliance pour interférer sur des objets globaux dans l'indifférence de leur localisation, parce que le but monumental le requiert, impliqué par l'objet, comme l'environnement ou la santé publique. Cela non seulement efface les frontières mais cela justifie que s'en élèvent d'autres. Ainsi le Droit de la Compliance étant d'une autre nature que le Droit de la Concurrence, il justifie des barrières légitimes aux objets, des contrôles sur les personnes, les biens et les capitaux (II).
En effet, cette branche du Droit nouvelle qu'est le Droit de la Compliance n'est pas réductible au Droit de la Concurrence!footnote-1723, pas plus qu'elle n'est pas réductible à une méthode. C'est un Droit substantiel, extraterritorial parce que les "buts monumentaux" qui lui donnent substantiellement son unité sont eux-mêmes extraterritoriaux. Cela peut contribuer directement à l'avenir d'une Europe exemplaire, qui d'une part pourra poursuite d'une façon extraterritoriale des buts monumentaux humanistes, en matière d'environnement ou de protection des informations personnelles ou de protection de la santé ou d'accès au Droit (notamment par la technique des programmes de compliance) et qui d'autre part, par les techniques de tracabilité des produits !footnote-1724, aura les moyens de ne faire entrer des produits fabriqués d'une façon indécente ou dangereuse, sauf aux pays qui n'accordent de valeur qu'au Droit de la concurrence à saisir l'OMC.
Lire ci-dessous les développements.
20 mars 2020
Base Documentaire : 03. Conseil d'Etat
Référence complète : C.E., 20 mars 2020, Président de l'Autorité des marchés financiers et Arkea Direct Bank
18 mars 2020
Publications

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., L'avocat, porteur de conviction dans le nouveau système de Compliance, Dalloz Avocat, mars 2020.
Cet éditorial ouvre un dossier thématique consacré à la Compliance.
Lui fait miroir un article de synthèse sur l'ensemble des contributions, paru en mai 2020 : "Avocat et Compliance - L'avenir du personnage et de son outil : Droit, Humanisme et Défense"
_____
Résumé de l'article :
Si l'on perçoit le Droit de la Compliance comme une agression de l'entreprise et un ensemble contraignant de mécanismes qui n'ont pas de sens et de valeur ajoutée pour elle, alors l'avocat a une utilité : celle de défendre l'entreprise. Il le peut non seulement dans la phase des sanctions, mais dès l'amont pour prévenir celles-ci.
Mais cette fonction n'est pas centrale.
Elle le devient si l'on conçoit le Droit de la Compliance comme étant un corps de règles substantielle, poursuivant un "but monumental" : la protection de la personne, but injecté par le Politique et repris par l'opérateur. De cela, il faut que l'entreprise convainque que chacun le reprenne, à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur. Cette convinction, dans un débat contradictoire, c'est l'avocat est au coeur pour la porter, car toujours convaincre ceux qui à la fin jugent (marché, opinion publique, etc.) c'est sa raison d'être.
____
18 mars 2020
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : Duchatelle, C., Ethique des affaires, pour une gouvernance intègre. Protéger - Conseiller - Remédier, L'Argus de l'assurance Editions, 2020, 124 p.
____
Cet ouvrage décrit les mécanismes de compliance à travers le risques de réputation, et lie donc les obligations de compliance comme un "risque de conformité", estimant que les entreprises doivent se doter d'une direction "Conformité et Ethique des affaires".
5 mars 2020
Conférences

Référence : Frison-Roche, M.-A., La mesure de l'effectivité et de l'efficacité des outils de la compliance (conception, présentation et modération des débats), in Les outils de la Compliance, Journal of Regulation & Compliance.
Voir les autres thèmes, autres dates et autres manifestations particulières du cycle dans son ensemble.
Cette conférence sert d'appui à la réalisation d'un ouvrage plus global portant d'une façon générale sur Les outils de la Compliance.
L'ouvrage Compliance Tools sera publié en même temps.
Présentation de la Conférence : Après avoir examiné différents outils spécifiques, comme La cartographie des risques ou Les incitations, et avant d'en aborder d'autres comme ceux relevant de la a Compliance by Design, celle-ci méritant aussi d'être examinée avec quelque distance dans sa prétention à être la solution à tout enjeu de compliance, il convient de regarder comment l'on mesure l'efficacité de tous ces outils de Compliance. En effet, puisque toutes les techniques sont des "outils", ils ne prennent sens qu'au regard d'une finalité qu'ils doivent atteindre effectivement. Cette effectivité doit être mesurée, et cela dès l'Ex Ante, l'entreprise devant en permanence donner à voir l'effectivité de la performance des outils de la Compliance.
Mais autant les normes prolifèrent, les discours se multiplient, les engagements sont pris, autant les techniques de mesure de l'effectivité de l'ensemble semblent assez faibles. Non pas que les sujets de droit astreints aux obligations de Compliance ou désireux de réaliser les buts systémiques ou de bien commun visés par la Compliance ne désirent pas en avoir, mais ces instruments de mesure semblent encore les moins construits, souvent déclaratifs ou de type discursifs, ou trop mécaniques. Dès lors, est-ce en partant du but que l'on cherche à atteindre que l'on doit mesurer l'efficacité des outils de Compliance, sans que cela transforme les tâches qui pèsent de grè ou de force sur les opérateurs en obligation de résultat ? Ou est-ce en demeurant en amont, par une seule "conformité" à ce qui leur est demandé, comme comportement et comme organisation structurelle, que les entreprises donnent à voir qu'elles ont effectivement rempli leur tâche, sans plus se soucier des effets produits sur la réalité des choses, cette réalité que ceux qui ont conçu la norme avaient en tête ?
Cette question a des implications majeure en terme de charge de preuve et de responsabilité, impliquant des organisations plaçant la confiance, coeur de la Compliance, plutôt dans des instruments technologiques connectant des data ou plutôt dans des personnes ayant le sens du bien commun. Cette question est aujourd'hui ouverte.
_____
4 mars 2020
Enseignements : Droits sectoriels de la régulation, semestre de printemps 2018

Le droit sectoriel de la régulation énergétique constitue un monde en soi, alors même que l'économie générale et la vie sociale ne peuvent pas fonctionner sans l'énergie, laquelle est elle-même très multiple et que l'énergie est en points de contact, voire en intimité, avec le Politique. Il en résulte la nécessité d'assimiler de nombreuses règles d'intelligibilité qui interférent en même temps et qui varient.
Il convient de voir plus longuement ces règles d'intelligibilité, de voir les questions ouvertes, car il est faux de qualifier ce secteur de "mature" (ce que l'on faisait il y a 10 ans), puis de prendre une décision de justice pour s'exercer au commentaire.
Pour comprendre ce droit sectoriel, qui est le reflet de la complexité technique de celui-ci et des enjeux politiques, il faut y retrouver la trace de la variété des moyens et des usages énergétiques, l'électricité ayant toujours une place particulière notamment par son lien avec le nucléaire. La construction d'un Droit européen de l'énergie paraît impossible en raison des liens de celle-ci avec le Politique, alors même que les liens tout aussi fort que l’Énergie a avec l'environnement appelle une telle construction. La Loi du 17 août 2015 sur la "transition énergétique" cherche à trouver une voie médiane.
Une fois cela fait, apparaissent un certain nombre de questions ouvertes, notamment :
- Faut-il souhaiter plus de principe concurrentiel dans le secteur énergétique ?
- Entre Régulation énergétique et Régulation environnementale, où est le nucléaire ?
- Pourquoi des Golden Shares dans les entreprises énergétiques "nationales" ?
- L'avenir de la Régulation énergétique est-il dans le numérique ,
Cela permet enfin de déboucher sur l'étude d'une question technique :
Renégociation de l'Accès au tarif de l'Energie Nucléaire
Commentez l'arrêt du Conseil d’État du 20 mars 2013, Association "Robin des Toits"
____
Accéder aux slides servant de base à la leçon.
Consulter la bibliographie générale du Droit commun de la Régulation
Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
20 février 2020
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Mounoussamy, L., Le smart contract, acte ou hack juridique ?, in Petites Affiches, n°37, 20 février 2020, pp. 12-19.
Résumé par les Petites Affiches : Dans cet article, l'auteur analyse l'arrivée du smart contract, système innovant né du développement des nouvelles technologies, dans un environnement juridique déjà structuré. Il commence par définir la nature du smart contract, et le positionne dans cet ensemble juridique mondialisé. Il en présente les impacts et les perspectives de développement, les forces et les faiblesses ainsi que l'intime relation que noues les technologies informatiques et le droit. Le smart contract est un outil dont l'utilisateur définira s'il viendra disrupter le contrat ou le parfaire.
4 février 2020
Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les outils de la Compliance et la Théorie des climats, in La prégnance géographique dans les outils de la Compliance, 4 février 2020, Nice.
Lire la présentation de cette conférence-débat sur La prégnance géographique dans les outils de la Compliance.
Se reporter aux autres conférences composant le cycle complet de conférences sur Les outils de la Compliance.
Lire la présentation générale du cycle de conférence.
Se reporter au document de travail sur lequel la conférence s'appuie.
Consulter les slides sur lesquels s'adosse la conférence.
Résumé de la Conférence : En partant de la "théorie des climats" de Montesquieu, affirmant que les êtres humains seraient d'une nature différentes dans les différents endroits du monde, ce qui requiert donc des règles de gouvernement différentes suivant les lieux, théorie qui fait écho au cantonnement géographiques que Pascal opérait des Lois, l'on peut penser que, comme pour toute règle, celle de la Compliance, qui s'assure de la conformité du comportement des êtres humains aux règles, celle-ci va varier suivant que l'on est en-deça ou au-delà des Pyrénées. Mais de cette dimension géographique si naturelle l'on peut au contraire et dans un premier temps douter. En effet en la présentant comme un simple process, que l'intelligence artificielle à base d'algorithmes pourrait prendre entièrement en charge, par son absence de substance cette dimension perd toute pertinence. Sauf à tomber dans l'autre excès consistant à poser que tout n'est question que de "culture de compliance" ou que celle-ci n'est l'habillage d'un pur rapport de force, entre zones géographiques, par exemple les Etats-Unis et l'Europe, et dans ce Droit de façade la géo-politique est à ce point tout qu'elle en aurait dévoré le Droit.
Il faut raison garder et au contraire organiser dans un deuxième temps une sorte de tryptique et trouver ce qui relève de l'accumulation d'informations techniques et immuables, ce qui relève de phénomès locaux mais auxquels des normes de compliance globale pourront être techniquement attachées en raison de leur "nature cruciale" et assumer aussi des "prétention politiques de buts monumentaux" qui contestent les frontières et les branches du Droit qui gardent celles-ci.
Si l'on parvient à faire cela, alors non seulement le Droit de la Compliance parvient à se défaire de ce qui le mine, c'est-à-dire sa tentation mécanique que lui propose la technologie et sa disparition par le pouvoir politique, gardant de la substance sans être violent. En effet par le respect de la géographie l'Occident n'a pas à dicter "sa" Loi. Il doit au contraire concrètement emprunter au Droit kanak qui ne définit pas le Droit comme ce qui est énoncé puis appliqué, mais comme un "chemin". Ainsi dans la technique des investissements responsables, parce que le Droit de la Compliance est téléologiques, il faut que le Sujet de droit, c'est-à-dire l'entreprise (qui est en position, par exemple qui investit) n'interdit pas mais organise la transition pour que le bénéficiaire du dispositifi ne soit pas lui-même sanctionné, par exemple abandonné à la corruption, mais accompagné vers la sortie du système. L'intégration du temps et la notion de "durée", commun au Droit de la Compliance et au Droit de la Régulation (le Droit de la Compliance étant l'internalisation des Régulations dans les entités aptes à les concrétiser) impliquant l'articulation entre le territoire et la durée (ce que ne permet en rien le Droit de la Concurrence).
29 janvier 2020
Enseignements : Droit de la Régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2020

Résumé de la leçon n°1. La "Régulation" ne se confond pas avec la "réglementation". Elle constitue un "Droit" spécifique, dont la "réglementation" n'est qu'un outil, comme le sont les lois, les décisions de justice, etc., qu'ils soient obligatoires (hard Law) ou pris en considération par ceux qui sont concernés (soft Law). La "Régulation" ne se confond pas davantage avec la "Supervision", avec laquelle elle se cumule, en matière bancaire et financière. Ainsi, en-deçà des multiples Codes, par exemple le Code monétaire et financier, ce sont avant tout les Autorités de régulation et de supervision qui fabriquent et font vivre ce "Droit de la Régulation bancaire et financière".
Il convient donc de débuter par les institutions françaises : l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Ces autorités sont elles-mêmes ancrées non seulement entre elles et entremaillées au niveau européen, dans des relations internationales constantes, mais encore elles sont ancrées dans le système juridique français, lequel se déploie entre les deux ordres de juridictions, juridictions judiciaires et juridictions administratives, substantiellement unis autour des principes constitutionnels, et s'ancre dans l'ordre de l'Union européenne. Mais de fait, parce que la banque, et plus encore la finance, ne sont pas contenus dans les frontières des systèmes juridiques, le Droit américain, plus proche du Droit britannique (Common Law) que du Droit européen continental (Civil Law) dont la France et l'Allemagne demeurent l'expression, demeure la source première d'influence.
Après avoir fixé quelques définitions et avoir rappelé le raisonnement privilégié en Droit de la Régulation, prenant l'une puis l'autre, la description de l'AMF, qui succéda à la COB, née en 1967 par copie de la SEC américaine, suppose que l'on expose son statut, sa composition, ses pouvoirs et les contrôles dont elle est l'objet.
De nombreux modèles institutionnels existent et on les expérimente les uns après les autres. Le secteur des banques et des assurances continue d'être régulé par une Autorité adossée à la Banque de France, l'ACPR, dont il convient de faire une semblable description.
Revenir aux bases avec le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.
Documentation spécifique à la leçon :
- Règlement général de l'Autorité des marchés financiers
- Présentation de l'AMF par elle-même
- Présentation de l'ACPR par elle-même
- La mission de la BCE vue par elle-même
- Loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
- Présentation de l'application mondiale et contestée du FCPA
Approfondir par la Bibliographie générale du Droit de la Régulation bancaire et financière
Revenir à la présentation générale du Cours.
Se reporter au plan général du Cours.
24 janvier 2020
Base Documentaire : Autorité des Marchés Financiers (A.M.F.)

17 janvier 2020
Publications

Ce document de travail sert de base à un article paru en mars 2020 dans la revue Dalloz Avocat.
Résumé du document de travail.
Si l'on perçoit le Droit de la Compliance comme une agression de l'entreprise et un ensemble contraignant de mécanismes qui n'ont pas de sens et de valeur ajoutée pour elle, alors l'avocat a une utilité : celle de défendre l'entreprise. Il le peut non seulement dans la phase des sanctions, mais dès l'amont pour prévenir celles-ci.
Mais cette fonction n'est pas centrale.
Elle le devient si l'on conçoit le Droit de la Compliance comme étant un corps de règles substantielle, poursuivant un "but monumental" : la protection de la personne, but injecté par le Politique et repris par l'opérateur. De cela, il faut que l'entreprise convainque que chacun le reprenne, à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur. Cette convinction, dans un débat contradictoire, c'est l'avocat est au coeur pour la porter, car toujours convaincre ceux qui à la fin jugent (marché, opinion publique, etc.) c'est sa raison d'être.
(Dans ce court document, les pop-up renvoient aux différents travaux qui sont eux-mêmes la source de l'affirmation de chacun des points)
16 janvier 2020
Base Documentaire : Doctrine
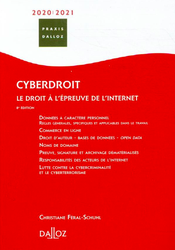
Référence complète: Féral-Schuhl, C., Cyberdroit. Le Droit à l'épreuve de l'internet, Collection Praxis Dalloz, Dalloz, 8e édition, 2020, 1731p.
16 janvier 2020
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète: Bolton, P., Desprez, L.A, Pereira da Silva, F., Samama, F., Swartzman, The green swan: central banking and financial stability in the age of climate change, Banque des Règlements Internationaux, Janvier 2020.
Lire l'ouvrage (disponible en format numérique)
Lire le document de travail élaboré par Amundi à propos de l'ouvrage
Résumé (fait par les auteurs) :
"Climate change poses new challenges to central banks, regulators and supervisors. This book reviews ways of addressing these new risks within central banks’ financial stability mandate. However, integrating climate-related risk analysis into financial stability monitoring is particularly challenging because of the radical uncertainty associated with a physical, social and economic phenomenon that is constantly changing and involves complex dynamics and chain reactions. Traditional backward-looking risk assessments and existing climate-economic models cannot anticipate accurately enough the form that climate-related risks will take. These include what we call “green swan” risks: potentially extremely financially disruptive events that could be behind the next systemic financial crisis. Central banks have a role to play in avoiding such an outcome, including by seeking to improve their understanding of climaterelated risks through the development of forward-looking scenario-based analysis. But central banks alone cannot mitigate climate change. This complex collective action problem requires coordinating actions among many players including governments, the private sector, civil society and the international community. Central banks can therefore have an additional role to play in helping coordinate the measures to fight climate change. Those include climate mitigation policies such as carbon pricing, the integration of sustainability into financial practices and accounting frameworks, the search for appropriate policy mixes, and the development of new financial mechanisms at the international level. All these actions will be complex to coordinate and could have significant redistributive consequences that should be adequately handled, yet they are essential to preserve long-term financial (and price) stability in the age of climate change."
8 janvier 2020
MAFR TV : MAFR TV - cas

Regarder la video qui présente et analyse la décision n°2019-796 du 29 décembre 2019 du Conseil constitutionnel, Loi de finance pour 2020.
Lire l'extrait ici pertinente de cette décision du Conseil constitutionnel.
_____
Pour lutter contre la fraude fiscale, la contrebande et le blanchiment d'argent qui en résulte, le Gouvernement avait souhaité prendre l'information là où elle se trouve, là où chacun a tendance désormais à étaler sa vie privée, et celle des autres : sur les réseaux sociaux.
C'est pourquoi le projet de Loi de finance pour 2020 prévoyait, à titre expérimental (3 ans), de conférer aux administrations fiscales et douanières de pouvoir collecter des données accessibles publiquement sur les plateformes aux fins de rechercher des "manquements et infractions en matière fiscale et douanière".
L'on avait pu s'en inquiéter au regard de la Constitution et notamment du "droit à la vie privée".
Il n'est pas étonnant que lors du contrôle opéré par le Conseil constitutionnel de la Loi de finance votée, l'alléguation d'une violation de la Constitution ait été formulée par les requérants.
Mais c'est le contraire qui arriva.
Tout d'abord, il était soutenu que le Gouvernement avait glissé cette disposition, qui serait attentatoire aux libertés, dans la Loi de finance pour mieux la masquer mais qu'elle est sans rapport, ce qui est contraire à la méthode constitutionnellement requise dans l'art législatif. Le Conseil rejette cette critique car c'est pour lutter contre la fraude fiscale et améliorer le recouvrement de l'impôt que ces informations sont collectées, but financier de l'Etat qui justifie une place dans une Loi de finance.
Substantiellement, s'il est vrai que le Conseil constitutionnel, par sa décision du 29 décembre 2019, Loi de finance pour 2020, déclare la loi contraire à la Constitution, ce n'est que sur une modalité accessoire du dispositif. En effet une disposition spécifique prévoyait la possibilité d'utiliser une majoration de 40% pour défaut ou retard de production de déclaration pour la recherche de manquement, ce qui est disproportionné. Mais cela ne touche en rien l'ensemble du dispositif qui est quant à lui validé dans son principe et dans son organisation technique.
Il est particulièrement important dans l'équilbre que le Conseil pose et les conséquences probatoires qu'il implique.
En effet et à la base, il y a le principe constitutionnel de la liberté d'expression, en ce que celle-ci est à la racine de la Démocratie. Lorsque les internautes postent des informations sur l'espace numérique publique, c'est un acte de cette nature et de cette portée. Ensuite, l'objet ainsi produit, l'information qui les concerne, la "donnée à caractère personnelle", est elle-aussi l'objet d'une protection constitutionnelle. En effet le droit à la vie privée est de valeur constitutionnelle et vient protéger également la personne.
Face à ces deux sources fondamentales, le Législateur et l'Etat qui captent des données sont qualifiés comme "y portant atteinte". Ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas légitimes à le faire. Mais ils doivent se justifier. C'est avant tout un système probatoire que le Conseil constitutionnel met en place. Tandis que la personne n'a pas à justifier l'usage qu'elle fait de sa liberté (d'expression) et de son droit (sur ses données), le Législateur doit justifier l'atteinte légitime qu'il y porte par un triple test : nécessité, ordre public, modalités adéquates et proportionnées.
I. CONFIRMATION DU NIVEAU CONSTITUTIONNE DU DROIT A LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL, S'ANCRANT DANS LA LIBERTÉ D'EXPRESSION, ET CONDITIONS CONSTITUTIONNELLES POUR Y PORTER LEGITIMEMENT ATTEINTE : NÉCESSITÉ, MOTIF D'INTERET GENERAL ET MISE EN OEUVRE ADEQUATE ET PROPORTIONNEE
Le Conseil constitutionnel s'appuie sur l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789, lequel vise d'une façon très générale quatre droits dont les personnes sont titulaires et que toute organisation politique vise à protéger : "la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression". De cette "liberté" si généralement visée, la jurisprudence constitutionnelle a tiré de nombreuses libertés plus précises et de nombreux droits.
Ainsi, le Conseil constitutionnel pose que la liberté de communication y est incluse ainsi que le "droit au respect de la vie privée". Par un raisonnement en poupée russe, dans ce droit au respect de la vie privée, le droit à la protection de ses "données personnelles", lui-même inclus dans le "droit au respect de la vie privée" est de valeur constitutionnelle.
En outre le Conseil se référence à l'article 11 de la Déclaration de 1789 qui se référe à la "liberté d'expression" et sa décision insiste spécifiquement sur le lien entre celle-ci et le mécanisme démocratique. Il le fait dans ces termes : " la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés.". Le Conseil souligne d'une façon pédagogique que si le Parlement a la tâche de veiller à garantir les droits (article 34 de la Constitution), ceux-ci présuppose ce fonctionnement démocratique, lequel dépend de la liberté d'expression.
Ainsi la liberté d'expression est à la racine d'un Etat de Droit. Il faut donc comprendre que l'Etat étant lui-même en charge de veiller au fonctionnement démocratique de la société et devant concrétiser les droits constitutionnels des personnes, il doit respecter ces deux éléments premiers.
L'essentiel du raisonnement, la portée de celui-ci, est dans cette préséance.
Le système est en effet le suivant : le principe est du côté unifié des personnes et de la démocratie (fondant et la protection des données personnelles et la liberté d'expression) qui, sans avoir à se justifier, bénéficient du droit à n'être pas atteintes dans leur droit tout d'abord de communiquer librement sur les divers supports numériques puis de n'être pas dépossédées contre leur consentement de ces informations ("données personnelles"), tandis que le Législateur s'il veut le faire ne peut le faire que s'il peut justifier d'une part d'un motif d'intérêt général et d'autre part de modalités adéquates et proportionnées.
C'est donc une sorte de système probatoire, dans lequel les parties ne sont pas à égalité, système dans lequel c'est la personne qui prévaut : en effet la personne va toujours prévaloir car elle exerce une liberté par laquelle la Démocratie vie (s'exprimer librement), ce qui génère des données sur lesquelles elle a un droit (droit au respect de ses données) ; puisque c'est son droit à valeur constitutionnelle, elle n'a pas à le justifier.
Certes le Législateur peut y porter atteinte, car tout principe supporte des exceptions et aucun droit, même constitutionnel, n'est sans limite. Ainsi si le Législateur peut justifier d'un "motif d'intérêt général", alors il pourrait prétendre avec succès limiter le droit constitutionnel de chacun à la protection de ses données personnelles. Mais s'il parvient à arguer d'un tel motif, cela ne vaudra pas blanc-seing : il faudra que les modalités soient adéquates et proportionnés.
Ici, le Conseil constitutionnel constate que le Législateur a effectivement porté atteinte au droit constitutionnel de toute personne à la protection de ses données personnelles qui, ici, s'ancre dans la liberté d'expression laquelle est le socle de la Démocratie. Le Législateur peut certes le faire mais il ne peut le faire que si cela est nécessaire, si cela est corrélé à un motif d'ordre public et les modalités sont adéquates et proportionnées. Un sorte de triple test....
En ce qui concerne la "nécessité", notion fondamentale pour toute atteinte aux libertés, il est souvent rappelé que le numérique a permis l'accroissement de la criminalité. Il est donc nécessaire que l'on recherche des nouveaux moyens de collecter l'information dans ce nouveau monde où il est si facile d'agir masquer Le Conseil constitutionnel souligne qu'il s'agit de rechercher des actes illicites rendus plus aisés par Internet. La loi vise trois types d'atteinte à l'intérêt public : la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et la contrebande. Cela rejoint le "motif d'ordre public", requis.
La troisième condition porte en aval sur les modalités, elle provoquera en partie la chute du législateur. En effet, le dispositif passe le test puisque les administrations fiscales et douanires ne peuvent capter que les informations volontairement mise à disposition de tout public par les internautes, la reconnaissance faciale est une technique exclue et les informations "sensibles" sont retirées de toute exploitation. Les mesures sont donc "proportionnées", nouvelle forme de l'exigence de nécessité, la loi confiant au Réglement la rédaction de texte pour faire en sorte que les algorithmes soient paraphrés pour que ce lien de nécessité demeurent entre l'ampleur de la captation et du traitement et les buts légitimes visés ....
En ce qui concerne les modalités,
II. PORTÉE DE L'ARTICULATION DU PRINCIPE CONSTITUTIONNEL POUR LA PERSONNE DE S'EXPRIMER DANS LE NUMÉRIQUE PUIS DE PROTÉGER SES DONNÉES PERSONNELLES ET DE L'EXCEPTION LÉGITIME DE L'ÉTAT A Y PORTER ATTEINTE
Parce que les deux premiers (principe de la liberté constitutionnelle d'expression, principe du droit constitutionnel de la personne sur les données qui la concernent) s'imposent sans qu'il soit besoin de les justifier, lorsque les textes seront silencieux, ce seront eux qui empliront ce silence.
Lorsque les Autorités ou un coconctractant, ou un Juge - dans son pouvoir de qualification des situations et des actes -, voudront faire prévaloir une autre considération, alors il faudra qu'ils se prévaloir d'un motif d'ordre public.
En effet les principes doivent être "conciilés", comme le dit le Conseil constitutionnel et les droits s'arrêtent là où les droits des autres commencent. Mais c'est à celui qui veut arrêter le principe de la liberté expression, le principe de la libre communication, le droit à la protection des données personnelles, de trouver le motif d'ordre public.
Celui-ci est dans le but : dans le cas présent, il s'agit de la lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent.
Comme on le sait, l'interprétation restrictive des textes répressifs n'exclut pas leur interprétattion téléologique.
C'est dans une telle perspective probatoire, tracée par le Conseil constitutionnel, que le système va vocation à s'appliquer d'une façon plus générale.
_____________________
24 décembre 2019
MAFR TV : MAFR TV - cas

Lire la décision.
_______________
En 2015, un document soi-disant émanant de l'entreprise Vinci est parvenu au média Bloomberg annonçant des résultats catastrophiques inattendus. Les deux journalistes l'ayant reçu l'ont dans l'instant répercutant sans rien vérifier, le titre Vinci perdant plus de 18%. Il s'agissait d'un faux grossier, ce qu'une vérification élémentaire aurait permis d'établir, vérification à laquelle les journalistes n'avaient pas faite.
4 ans plus tard, l'entreprise Bloomerg est sanctionnée pour le manquemement de "diffusion de fausse information" sur le marché financier, par une décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 11 décembre 2019.
L'entreprise poursuivie faisait valoir que c'était aux journalistes d'en répondre et non pas à elle, car elle avait mis en place et un logiciel de détection et un code de bonne conduite, alors même qu'aucun texte ne l'y contraint. Il convenait donc de ne pas la poursuivre.
La Commission des sanctions de l'AMF souligne qu'indépendamment de celà c'est une règle générale de la déontologie des journalistes qui oblige ceux-ci à vérifier l'authentificité des documents qu'ils diffusent, ce qu'ils n'ont en rien fait, alors qu'une vérification élémentaire leur aurait permis de mesurer qu'il s'agit d'un faux grossier.
Pourtant l'agence de presse Bloomberge avait demandé à la Commission des sanctions de poser une "question préjudicielle" à la Cour de justice de l'Union européenne sur l'équilibre à faire entre la liberté de la presse et des opinions d'une part et la protection des marchés et des investisseurs contre les "fausses informations" d'autre part.
Mais la Commission des sanctions de l'AMF estime que les textes sont "clairs" : il s'agit ici de l'article 21 du Réglement européen sanctionnant les abus de marché qui pose que si la liberté des journalistes doit être préservée, il faut que ceux-ci respectent leur propre déontologie, et notamment vérifient l'authenticité des documents sur lesquels ils s'appuient. Or, en l'espèce, ils ne l'ont en rien fait. Le manquement est donc constitué.
______
En outre, la Commission des sanctions se référe au Réglement européen sur les abus de marchés qui dans son article 21 vise le statut particulier à réserver à la liberté de la presse et au statut particulier des journalistes mais y associe cette obligation déontologique de vérification des documents. Or, la Commission des sanctions relève que cette obligation visée, et par la déontologie des journalistes et par le texte de référence de Droit financier, a été totalement méconnue par les deux journalistes. C'est donc à l'agence de presse d'en répondre.
Pourtant celle-ci soutenait que l'équlibre entre le principe de liberté de la presse et le principe de liberté d'opinion d'une part et le principe de la protection du marché financier et des investisseurs contre les fausses informations diffusées nécessite une interprétation du Droit de l'Union européenne, ce qui doit contraindre la Commission des sanction à saisir la Cour de Justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.
La Commission des sanctions écarte cette demande car elle estime que les textes communautaires sont "clairs", ce qui leur permet de les interpréter elle-même. Et précisément le Réglement européen sur les abus de marché dans son article 21 prévoit l'exception en faveur de la presse et des journalistes mais les contraint à respecter leur déontologie, notamment la vérification de l'authenticité des documents. En l'espèce, ils ne l'ont en rien fait. Ils sont clairement auteurs d'un manquement, imputable à l'entreprise.
________
Dans un cas moins net, l'on pourrait pu considérer que cet équilibre entre deux principes, tout deux d'intérêt public, est délicat et qu'une interprétation par la Cour de Justice serait toujours utile.
En effet et plus fondamentalement, le Droit financier demeure-t-il un Droit autonome, mettant en premier l'objectif la préservation de l'intégration du marché financier et la protection des investisseurs ou bien est-il la pointe avancée d'un Droit de l'information préservant chacun contre l'action de tout "influenceur" (catégorie à laquelle Bloomberg appartient) consistant à diffuser des informations inexactes (notion de "désinformaton") ?
Et cela n'est pas si "clair"....
_____________________
19 décembre 2019
Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Théorie juridique de la cartographie des risques, centre du Droit de la Compliance", D.2019, chronique Droit de la Compliance, p. 2432-2434.
____
► Résumé de l'article : L’action de cartographier les risques n’est pas pour l’instant définie par le Droit. Elle n’est que décrite à l’occasion de lois spéciales. Alors qu’elle est centrale pour prévenir en Ex Ante la survenance des crises ou de comportements dont on exclut la survenance, aucun régime juridique n’est disponible, faute d’une définition juridique opérée. Cette définition est ici proposée en 5 étapes, partant des lois spéciales et des cas particuliers pour aller vers une conception générale. La cartographie des risques apparaît alors comme un souci d’autrui pris en charge de gré ou de force par des opérateurs cruciaux, à travers un nouveau droit subjectif : le « droit d’être alarmé », la carte être le pendant structurel du personnage du lanceur d’alerte. Deux dispositifs du Droit de la Compliance.
____
Lire la traduction en anglais de cet article.
____
____
► Lire les chroniques parus ultérieurement
- "Compliance et conformité : les distinguer pour mieux les articuler", 2024
- "La loi, la compliance, le contrat et le juge: places et alliances", 2023
- "Contrat de compliance, clauses de compliance", 2022
- "L'aventure de la compliance", 2020
- "Compliance et personnalité", 2019
- "Théorie juridique de la cartographie des risques", 2019
► Lire les autres chroniques parues chez Dalloz dans la rubrique Chronique MAFR Droit de la Compliance
________
19 décembre 2019
Interviews
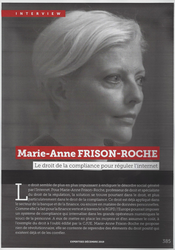
Frison-Roche, M.-A., Le droit de la compliance pour réguler l'internet, Entretien avec Sylvie Rozenfeld, Expertises, décembre 2019, p.385-390.
Résumé. Le droit semble de plus en plus impuissant à endiguer le désordre social généré par l’Internet. Pour Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit et spécialiste du droit de la régulation, la solution se trouve pourtant dans le droit, et plus particulièrement dans le droit de la compliance. Ce droit est déjà appliqué dans le secteur de la banque et de la finance, ou encore en matière de données personnelles. Comme elle l’a fait pour la finance verte et à travers le le RGPD, l’Europe pourrait imposer un système de compliance qui internalise dans les grands opérateurs numériques le souci de la personne. A eux de mettre en place les moyens et d’en assumer le coût, à l’exemple du droit à l’oubli édifié par la CJUE. Marie-Anne Frison-Roche ne propose rien de révolutionnaire, elle se contente de reprendre des éléments du droit positif qui existent déjà et de les corréler.
Lire la présentation du Rapport à propos duquel cet interview est donné : L'apport du Droit de la Compliance à la Gouvernance d'Internet.
12 décembre 2019
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète : Malik, A., La conformité dans les établissements financiers sous le prisme du droit pénal, thèse Toulouse, 2019.