Blog
Jan. 14, 2015
Blog

Oublions un instant l'objet même de l'arrêt AZF et limitons la lecture à la question procédurale tranchée par l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 janvier 2015.
Celui-ci est très remarquable et mérite pleine approbation en ce qu'il affirme l'obligation des juges de respecter l'impartialité de l'institution juridictionnelle, mise à mal si les personnes qui ont à faire à elle peuvent établir un "doute objectif" concernant l'impartialité d'un juge.
A travers cette affirmation, c'est un jeu de présomptions, la principale étant la présomption de l'impartialité du juge, que la Cour de cassation établit, mettant en juste mesure les charges et les objets de preuve en la matière.
Lire ci-dessous un commentaire développé de l'arrêt.
Nov. 16, 2014
Blog
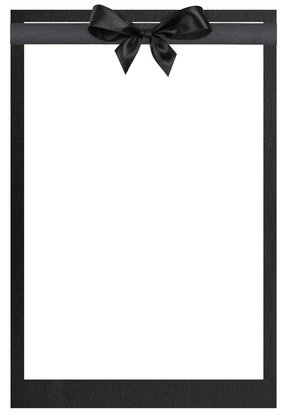 On le mesure en lisant dans la presse du jour des histoires de personnes qui se réveillent à la morgue et se font entendre au fond du tiroir dans lequel on les a déjà glissées, l'acte de décès pourtant dûment rempli par le médecin.
On le mesure en lisant dans la presse du jour des histoires de personnes qui se réveillent à la morgue et se font entendre au fond du tiroir dans lequel on les a déjà glissées, l'acte de décès pourtant dûment rempli par le médecin.
Rappelons deux choses. En premier lieu, le droit est un système de langage, composé d'éléments artificiels, d'artéfacts. En second lieu, il établit des catégories juridiques, auxquelles il attache des régimes juridiques. A partir de là, il fonctionne en puisant dans la réalité concrète de la multiplicités des situations dont la variété est infinie : il les fait entrer dans les quelques catégories juridiques construites par la volonté du législateur, voire du juge, pour déclencher sur les réalité la puissance des régimes juridiques préétablies.
Ainsi, le mot "vivant" et le mot "mort" sont des mots juridiques, des catégories auxquelles sont attachés des régimes juridiques composés : les personnes décédées ne sont pas traitées comme les personnes vivantes. On dispose des premiers, on dresse un acte juridique public - l'acte de décès qui modifie l'état civil de la personne -, on enterre la personne, ses biens sont répartis par le mécanisme de la dévolution successorale. A l'inverse, la personne vivante va et vient, demeure maîtresse d'elle-même et de ses biens.
Il est donc essentiel de savoir si une personne est vivante ou morte. Mais qui fixe le critère du passage d'une personne de l'état d'être vivant à l'état de personne décédée ? Ce ne peut être que le droit. Pourtant, c'est une circulaire de 1968 qui a fixé cela, par référence à un élément biologique, l'état du cerveau (double encéphalogramme plat). Dans la pratique, les médecins vont plus vite : quand le coeur ne bat plus et que le corps est froid, ils informent que la personne est décédée. Le coeur et le cerveau, ce ne sont pas les mêmes organes. Le moment est différent. Il y a donc problème.
D'ailleurs, un journal relate que le 6 novembre 2014 une dame âgée dont le médecin, constatant l'arrêt de la respiration et des battements du coeur, avait signé l'acte de décès, s'est réveillée à la morgue. Certes, le cas se déroule en Pologne, mais il pourrait se passer ailleurs, tant l'image du "dernier soupir"
C'est pour faciliter le prélèvement d'organes. On en manque tant ... Et le droit, lorsqu'il déploie son pouvoir sur la plus importante des questions pour les personnes, à savoir leur passage d'être indisponible à corps disponible, se fait en toute discrétion. Il se fait aussi à un niveau peu élevé de la hiérarchie des normes. C'est une circulaire de 1968 qui fixa la définition de la mort et c'est un texte réglementaire qui a, à travers l'article R. 1232-1 du Code de la santé publique, en déploie la définition. Ne croyons pas que le plus important soit dans la Constitution...
Nov. 15, 2014
Blog

La question a été posée dans un cas d'école au Conseil constitutionnel, qui a nettement répondu dans sa décision du 14 novembre 2014, QPC, M. Alain L.
Même si le dispositif est aujourd'hui abrogé, son appréciation par les juges suprêmes vaut le détour.
Une loi du 23 juin 1941 a eu pour objectif de préserver l'art et l'histoire français. Le nationalisme se portait particulièrement bien à l'époque. Le dispositif était en deux temps. Dans un premier temps (article 1ier de la loi), l'État pouvait refuser l'autorisation de sortie du territoire de l'oeuvre, présentant un intérêt national d'histoire ou d'art. Puis, dans un second temps (article 2 de la loi), il pouvait retenir l'oeuvre pour lui-même, transférant la propriété de celle-ci à une personne publique, ayant six mois pour le faire après un refus d'exportation qu'il aurait prononcé, le propriétaire ne pouvant pendant ce délai céder le bien.
La QPC a porté sur cette seconde disposition en tant qu'elle porte atteinte au droit de propriété privée sans nécessité publique, violant ainsi l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, partie intégrante du bloc de constitutionnalité.
Le Conseil répond qu'effectivement si le refus d'exportation poursuit un objectif d'intérêt général, en revanche le droit de "retenir" ainsi le bien pendant six mois sans que le propriétaire ne puisse rien faire de son bien, puis l'appropriation forcée par une personne publique, alors que la décision d'empêcher l'exportation a déjà été prise ne correspond pas aux critères établissant une "nécessité publique".
On ne peut qu'approuver une telle décision. Tout d'abord, parce que sans doute le Législateur de 1941 avait quelques arrières-pensées en s'appropriant des oeuvres d'art que certains propriétaires à l'époque voulaient sauver de quelques griffes dans cette sombre époque. Le Conseil d'État qui a transmis la QPC et le Conseil constitutionnel ne peuvent pas ne pas y penser. Ensuite, l'art est aussi un marché. On peut porter atteinte à celui-ci et restreindre la circulation. Oui, mais le refus d'exportation suffit. Pourquoi restreindre les acheteurs ? La "nécessité publique" ne justifie pas l'expropriation.
Surtout pas en 1941, quand on songe aux personnes qui voulaient vendre leurs tableaux pour fuir. Préserver l'Histoire, c'est peut-être pour l'État français de l'époque les exproprier, c'est surtout pour les juges de 2014 de songer à cette réalité de l'époque.
Nov. 10, 2014
Blog

Plus le droit avance, car on ne saurait dire si "avancer", c'est "progresser", plus on passe de l'idée de "chose protégée" à la notion de "être sensible" à la notion de "être conscient".
C'est-à-dire que l'on ne distingue plus l'animal de l'être humain.
En droit, cela signifie la fin de la distinction de la chose et de la personne.
Que des réalités passent du statut de "chose" au statut de "personne" n'est pas dramatique tant que cela n'ouvre pas la porte à l'inverse, à savoir l'entrée d'être humain dans la catégorie juridique des choses. En effet, si cela devait arriver, des êtres humains deviendraient entièrement disponibles à la puissance de personnes. Ce qui distingue une personne et une chose, c'est le rapport qui existe entre les deux : une chose est entièrement disponible à la personne tandis qu'une personne ne peut entièrement disposer d'une autre personne.
Dans une émission du 8 novembre 2014 sur France Culture, la philosophe Florence Burgat, auteur notamment d'un ouvrage en 2012 sur La condition animale et qui vient de publier un autre livre sur Violence et non-violence sur les animaux en Inde, s'étonne qu'on ne progresse pas davantage puisque nous devons prendre acte de la capacité de conscience des animaux, ceux-ci non seulement souffrant mais encore ayant des émotions, du chagrin, du stress, de l'angoisse, etc.
Mais cela renvoie à la part d'arbitraire que contient la règle juridique, toujours brutale puisque générale et abstraite, par rapport à la finesse et à la diversité de la réalité que le droit absorbe avec violence dans ses catégories. Le droit est certes poreux à la réalité dont il se saisit, mais il a aussi sa propre logique.
Admettons que le droit prenne acte non seulement de l'aptitude concrète à la sensibilité, mais encore de l'aptitude concrète à la conscience de bien des animaux, car il devra alors scinder parmi la catégorie jusqu'ici globale de la faune les animaux ainsi dotés et auxquels un régime spécifique s'appliquerait et les autres, l'exception de la tauromachie ayant sans doute du mal à demeurer, si c'est le critère même de la conscience qui s'attache à l'animal, alors l'on voit mal comment l'animal n'accéderait pas au statut de personne juridique.
C'est déjà le cas dans des systèmes juridiques, à travers la catégorie des "sujets de droit non-humain" dont les dauphins font partie.
Le danger tient alors dans la porosité des deux catégories, car si le chemin peut être fait de l'un vers l'autre, il pourrait être fait de l'autre vers l'un. Ainsi, la philosophe s'émeut des conditions dans lesquelles des vaches sont élevées, réduites à être des "machines à lait". Certes. S'émeut-on beaucoup des "machines à bébés" que sont beaucoup de mères-porteuses" dont les contrats posent qu'elles n'existent pas, puisque les contractants affirment sans frémir que l'enfant n'a pas de mère et qu'une fée leur a donné l'enfant ?
La sensibilité et l'anthropomorphisme expliquent cette évolution sociale et juridique au bénéfice des animaux. Ne produit-elle pas en même temps le chemin que l'on parcourt avec le même allant en sens inverse au détriment des femmes ?
Nov. 9, 2014
Blog

Vient de sortir le nouveau tome des Archives de Philosophie du Droit.
Il est consacré à La famille en mutation.
Lorsqu'on apprend la sortie d'un livre sur la famille, l'on songe à la phrase célèbre Quoi de neuf ? Molière.
En effet, le droit de la famille paraît le coeur du droit, celui qui est souvent présenté comme le plus facile, puisque le plus familier, parfois appris dès la première année des études de droit. Il y eut toujours un droit de la famille, puisqu'il y eut toujours des familles.
Et de songer au "pilier" que la famille représente et dans la société et dans le droit, tel que cela transparaît dans Flexible droit pour celui qui réécrit dans le Code civil les articles techniques d'un droit qu'il a voulu le plus proche possible des façons de faire de chacun et leur laissant place.
Pourtant le nouveau Volume des Archives de Philosophie du Droit montre que de la famille il reste peu et que le droit de la famille semble à son image du sable filant entre les doigts du législateur et du juge. Le maître du droit flexible craindrait en 1995 un droit "pulvérisé", l'on ne sait ce qu'il dirait aujourd'hui du droit de la famille.
Peut-être que l'impression de cette "mutation" est renforcée par le fait que de nombreuses contributions sont consacrées au contrat de maternité pour autrui, certains favorables, d'autres défavorables. La "mutation" est en tout cas marquée et chacun en prend acte. La question ouverte est de savoir si le droit continuera sur cette lancée-là.
Nov. 9, 2014
Blog

La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) a rendu un arrêt le 4 mars 2014, Grande Stevens, affirmant qu'en matière financière, l'État italien ne peut pour un même fait infliger à une personne et une sanction pénale et une sanction administrative.
Le Conseil constitutionnel vient de rendre une décision sur QPC le 24 octobre 2014, M. Stéphane R. et autres (Cour de discipline budgétaire et financière), concluant à la constitutionnalité d'un tel cumul. Par un arrêt du 23 juillet 2014, le Conseil d'État avait estimé que la question était suffisamment sérieuse pour qu'elle lui soit posée.
Les deux Considérants justifiant la solution la motivent ainsi :
Le premier pose "que le principe de nécessité des peine n'interdit pas au législateur de prévoir que certains faits puissent donner lieu à différentes qualifications ; que le principe de proportionnalité des peines ne fait pas obstacle à ce que, lorsque des faits peuvent recevoir plusieurs qualifications ayant un objet ou une finalité différents, le maximum des sanctions prononcées par la même juridiction ou autorité répressive puisse être plus sévère que pour des faits qui ne pourraient recevoir que l'une des ces qualifications ; que les sanctions prévues par les articles L.313-1, ..., du code des juridictions financières ne sont pas contraires aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines".
Le second pose que "le principe de la nécessité des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature disciplinaire ou pénale en application de corps de règles distinctes devant leurs propres ordres de juridictions".
Certes, le fait qu'il s'agit d'une des multiples ramifications de ce qu'il est convenu d'appeler L'affaire Tapie a peut-être joué. Mais les deux décisions de justice semblent bien en pleine contradiction. Décidément, les juges dialoguent de moins en moins ... S'il y a "bataille", qui restera sur le carreau ?
Nov. 2, 2014
Blog
 Un peintre pratiquant le street art est connu pour peindre sur les murs et tous autres supports urbains des chats jaunes;
Un peintre pratiquant le street art est connu pour peindre sur les murs et tous autres supports urbains des chats jaunes;
De gros, pacifiques et sympathiques chats jaunes.
Mais le statut juridique du street art est bien incertain. Or, tant qu'un phénomène n'est pas entré dans une catégorie établie par le système juridique, par la technique de la "qualification", le phénomène est comme en errance dans le système juridique.
Ainsi, là où la critique voit de l'art, parce que la locution utilise non seulement le mot art , mais encore le mot street , le droit s'accroche à ce terme-ci, pour qualifier le fait comme une dégradation.
Cela ne dérange guère les artistes, indifférents au fait que leur "travail", "oeuvre", "chose", soit effacé. L'éphémère est le lot du street art. Cela chagrine davantage les municipalités ou les entreprises qui supportent le coût du nettoyage.
C'est pourquoi la RATP en a eu assez de payer (et de devoir répercuter sur le coût du billet ou le montant des subventions publiques) les nettoyages. Elle est donc à l'origine des poursuites pénales contre celui-ci qui a dessiné ces gros chats jaunes sur les murs du métro parisien.
Lorsque le Tribunal correctionnel de Paris a déclaré par jugement du 29 octobre 2014 ces poursuites irrecevables, pour vice de procédure, il a reçu l'approbation publique.
Pourquoi ?
Sans doute parce que l'artiste est célèbre et ses chats par ailleurs exposés dans des galeries. Mais aussi parce que le chat est en train de devenir un animal "intouchable", animal préféré d'Internet, Internet sur lequel les internautes trouvent "évidente" la reconnaissance en train de se faire de l'animal comme "être sensible" par une loi nouvelle.
Nov. 1, 2014
Blog
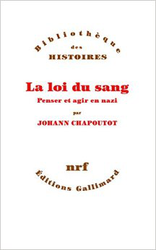
Le nazisme reste un mystère. Les ouvrages se déversent pour essayer de comprendre.
Notamment de comprendre la part que tant de phénomènes y prirent, par exemple le capitalisme, la culture occidentale elle-même, le nationalisme, la misère, l'humiliation, le Traité de Versailles, le charisme d'Hitler, etc.
Le droit y a aussi sa part.
Carl Schmidt n'a pas compté pour peu dans l'élaboration de la doctrine nazie, pensant le droit comme expression de la pensée, ce contre quoi Kelsen bâtit la théorie du "droit pur", qui met le droit en autonomie du politique et n'en est pas la forme.
Cette dimension juridique du nazisme, dans sa conception tout d'abord, dans sa mise en oeuvre ensuite, est essentielle. En effet, le système nazi était un système légaliste, l'efficacité passe par une multitude de textes et par des méthodes dont la juridicité ne fait pas de doute.
Cela peut paraître paradoxal, voire contrariant, puisque le nazisme est souvent présenté comme l'horreur et la brutalité absolues, c'est-à-dire ce à quoi le droit s'oppose "par nature". En effet, il est courant de définir le droit comme ce qui est doté d'une "force" qui s'oppose à la "force" : la force qui arrête la force. Ils sont en opposition absolue.
Pourtant, non seulement ils ont historiquement fait fort "bon ménage", législateur, juges et professeurs de droit offrant massivement leur service technique. Mais le lien entre nazisme et droit est plus intime encore et instruit sur les risque que le goût pour le droit comprend.
C'est notamment en cela le livre qui vient de sortir, La loi du sang. Penser et agir en nazi, mérite d'être lu.
Ecouter la présentation qui en a été faite sur France Culture le 20 octobre 2014.
Oct. 31, 2014
Blog

Les systèmes politiques sont désorientés face aux mouvements terroristes nouveaux, notamment celui qui a l'audace de prendre l'appellation d'État islamique.
Les États pensent à des solutions, mais la difficulté vient du fait que les personnes auxquelles ils sont confrontés n'ont pas encore commis d'actes. Leur acte consiste à partir pour rejoindre un mouvement, concrétisation de leur liberté d'aller et venir. Certes, l'État sait que ce déplacement n'a de sens que pour participer à des actions interdites, à savoir tuer en masse. Mais "sur le moment", l'acte en lui-même ne semble pas répréhensible.
Le Royaume-Uni a l'ingéniosité de faire renaître l'interdiction de la "double allégeance" pour affirmer que le seul fait de prétendre agir par obéïssance à un autre que la Couronne suffit à constituer un acte criminel (la "Haute trahison").
Dans sa chronique du 31 octobre 2014, Brice Couturier se demande s'il convient de "juger les jihadistes plutôt que de les refouler".
En effet, et d'une façon logique, il se demande s'il ne convient pas, plutôt que de restreindre leur liberté d'aller et de venir, de les laisser partir, passivement en les empêchant, peut-être activement en les autorisant. Si par la suite, s'il s'avère qu'ils commettent des actes répréhensibles, dans ce second temps, il sera possible, adéquat de les appréhender et de leur reprocher efficacement l'acte criminel enfin perpétré.
Brice Couturier affirme que cela serait plus légitime que de procéder comme le fait le projet de loi de lutte contre le terrorisme, déjà votée par l'Assemblée Nationale le 29 octobre 2014 et soumis désormais au Sénat.
En effet, ce texte réprime un comportement consistant notamment à consulter des sites Internet, à préparer des explosifs, à détenir des armes, à repérer des cibles, etc., sans qu'un acte ait été encore commis. Pour les pénalistes, cela n'est pas conforme à l'exigence du droit pénal classique, lequel exige un acte pour que la personne soit sanctionnée. La seule intention ne peut justifier une condamnation. L'infraction comprend non seulement l'élément légal et l'élément intentionnel, mais encore l'élément matériel. Nous verrons ce que le Conseil constitutionnel en dira.
Mais suivons ce raisonnement. Plutôt que de sanctionner avant l'acte, expulsons les personnes pour mieux qu'elles le commettent et ainsi, dans le respect de Beccaria, les sanctionner par la suite, les trois attributs de l'infraction étant réunis.
Comment attrape-t-on les personnes ayant rejoint le mouvement terroriste, à la fois international et infiltré, une fois que l'État a concrétisé leur liberté d'aller et venir par le biais paradoxal de l'expulsion ?
Oct. 27, 2014
Blog

La doctrine a applaudi lorsque la Cour de cassation, par un arrêt d'assemblée plénière du 27 février 2009, a accueilli en France le principe de l'estoppel.
Ce principe, jusqu'alors propre au droit de Common Law, interdit à une personne de se contredire non seulement dans une procédure, mais encore entre plusieurs procédures. Cela constitue une forme plus rationnelle et plus avancée du principe de loyauté processuelle.
Pourtant, n'appelle-t-on pas l'avocat "le menteur" ? La personne poursuivie dans un procès pénal n'a-t-elle pas le droit fondamental de mentir ? Dans cette joute qu'est le procès, tous les moyens ne sont-ils pas bons ? Quelle feuille de papier sépare la contradiction, le mensonge, la manoeuvre, le silence, l'éloquence, la rhétorique, la présentation ingénieuse, le débat, le contradictoire, le procès lui-même ?
L'arrêt que vient de rendre la Première chambre civile, le 24 septembre 2014, est de grande qualité, car il vient, certes d'une façon un peu elliptique, rappelé que l'estoppel joue entre les parties, et non pas entre la partie et le juge.
Il éclaire aussi sur l'office de la Cour de cassation, lui-même : le juge de cassation entre de plus en plus dans l'appréciation des faits. Ici, la Cour, "juge du droit", pose que les juges du fond ne pouvaient pas s'être trompés sur ce que voulait réellement le plaideur. Nous sommes dans une appréciation directe du cas. Pourquoi pas. Mais alors, il faudrait une motivation plus étayée. N'est-ce pas ce que vient d'expliquer le Premier Président ?
Oct. 26, 2014
Blog

Si l'on pose la question ainsi, à un esprit innocent ou au contraire à un juriste solidement formé : "un algorithme peut-il être loyal ?", il répondrait tout à trac : "quelle question stupide ... Bien sûr que non ! Comment un processus mathématique pourrait-il avoir une qualité de cette sorte, laquelle est de nature éthique, morale, et à ce titre n'est imputable qu'à des personnes ?". Peut-être la réponse viendra-t-elle avec condescendance : à question bête, réponse hautaine.
Effectivement, la loyauté est un comportement qui renvoie à une éthique, laquelle est en lien avec la morale.
Pourtant, l'on rencontre depuis quelque temps l'affirmation selon laquelle "les algorithmes doivent être loyaux". Cela fût affirmé par exemple dans le colloque du 23 octobre 2014 sur l'économie des plateformes numériques. Plus encore, c'est l'un des points forts du Rapport annuel du Conseil d'Etat 2014, Le numérique et les droits fondamentaux.
Comment peut-on avancer une telle affirmation, revenant à imposer à un processus mathématique un comportement moral ? En effet, pour imposer un devoir, encore faut-il que celui qui le subit en ait l'aptitude. Or, un processus mathématique n'a pas d'aptitude éthique. Ainsi, la formule n'a pas littéralement pas de sens.
En réalité, la formule est utilisée afin d'imputer à ceux qui conçoivent ou bénéficient des effets économiques des algorithmes, sur lesquels fonctionnent par exemple les moteurs de recherches ou les plateformes de rencontres et les réseaux sociaux, des obligations.
Ainsi, pour atteindre le régime, c'est-à-dire produire des obligations, l'on propose d'inventer par la seule force du droit la source d'obligation, laquelle serait "l'obligation de loyauté". Parce que le droit pourrait tout dire, l'on impute (au sens kelsénien du terme) cette obligation directement à une chose (ici les mathématiques).
Attention, les choses ne sont pas à ce point flexibles et la réalité n'est pas à ce point disponible au droit. Or, transformer les mathématiques en personnes, afin de pouvoir faire naître des obligations parce qu'on ne trouve pas d'autres pistes, c'est porter atteinte à la summa divisio que le droit établit entre les personnes et les choses.
Or, si l'on s'autorise à traiter des choses comme des personnes (ce que l'on fait ici), l'on ne doit pas s'étonner par ailleurs que beaucoup ne trouvent rien à redire - ni en droit, ni en morale --, lorsque l'on traite des personnes comme des choses;
Perdre la distinction entre les personnes et les choses fait perdre dans le droit non seulement son premier repère mais encore son premier garde-fou, contre sa tentation de disposer totalement de la réalité.
Oct. 26, 2014
Blog

Des mécontentements s'expriment à propos des professions juridiques.
Soit du point du vue des usagers, des clients, parce qu'elles leur coûteraient trop cher par rapport aux services rendus, ce surcoût venant du monopole que les droits exclusifs leur confèrent. Ainsi, parce qu'elles sont "réglementées" et constituent un monopole, elles seraient trop peu profitables au "client". C'est donc une opposition entre le marché et la réglementation qui est avancée. Le Gouvernement en a souci, parce qu'il veut que ceux qui recourent aux services des greffiers, des huissiers, des notaires et des avocats ne payent pas de surcoûts.
Soit du point de vue des professionnels eux-mêmes. Parce que ces professions sont composés majoritairement d'hommes et qu'ils sont âgés de plus de 50 ans. C'est donc l'idée de "caste" qui est ici pointée.
Dès lors, la concurrence devrait avoir pour double effet heureux de faire baisser les prix et, multipliant les professionnels, ouvrant la profession, en ouvrir les bras aux jeunes et aux femmes.
Coup double.
C'est ce qu'Emmanuel Macron, Ministre de l'Economie, est venu expliquer le 22 octobre 2014 devant l'Assemblée Nationale, reprochant aux professions de greffiers des tribunaux de commerce, aux notaires et aux huissiers d'être trop masculins et trop vieux. Il a affirmé que la réforme, qui introduit de la concurrence et lutte contre l'idée même de "réglementation", va lutter contre cette situation regrettable.
Il faudrait bien que la loi intervienne, puisque selon lui et pour reprendre ses termes "il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas dans les professions réglementées du droit".
Peut-on voir les choses aussi simplement ? Peut-on changer les moeurs par décret ? La situation tient-elle au caractère fermé des professions ou bien à tout autre chose, ce qui rendrait le "remède" inadéquat ?
Le 22 octobre 2014, Emmanuel Macron rappelle tous les chiffres devant
Oct. 23, 2014
Blog

La notion de "Cour suprême" est étrangère au système de droit français. Elle est familière au système de droit nord-américain.
Puis, par la réforme du 23 juillet 2008 et l'apparition de la Question Prioritaire de Constitutionnalité, l'on s'est demandé si le Conseil constitutionnel ne devenait pas une "Cour suprême". A la suite, le Conseil d'Etat se qualifia de "Cour suprême" des juridictions administratives. Voilà que le Premier Président de la Cour de cassation le fait concernant celle-ci dans un entretien dans la presse.
La France disposerait donc non plus de "Hautes Juridictions", mais de trois Cours suprêmes.
Abondance de biens ...
Encore faut-il disposer d'une définition de ce qu'est une Cour suprême.
A première vue, une Cour suprême est celle qui est saisie des cas déterminants dans un système juridique et y apporte une réponse qui s'impose. L'autorité est un élément caractéristique de la Cour suprême. La force de l'autorité de l'arrêt rendu peut être de droit et de fait. Mais pour que l'arrêt se déploie dans toute son autorité,cela suppose que la Cour puisse examiner le cas déterminant dans toutes ses dimensions, ce qui suppose que l'on ne réduise pas à sa seule dimension juridique;
En contrepartie, de fait, une Cour suprême doit pouvoir choisir les causes sur lesquelles elle va déployer cette activité en profondeur de juris-dictio et d'imperium. Cela suppose le pouvoir de filtrage.
Or, Monsieur Bertrand Louvel, nouveau Premier Président de la Cour de cassation, vient d'affirmer que la Cour de cassation doit se métamorphoser, se saisir parfois de l'ensemble d'un cas mais doit aussi ne se saisir que des cas importants.
L'on doit comprendre qu'il faut que la Cour de cassation ne soit plus la Haute Juridiction, juge du droit, mais soit une Cour suprême. Elle deviendrait alors aussi pleinement un contrepouvoir.
Accéder à l'entretien publié dans Le Figaro du 23 octobre 2014
Accéder au résumé de l'entretien publié dans Le Figaro du 22 octobre 2014.
Oct. 19, 2014
Blog

La presse qui relate les décisions de justice prend-elle le temps, la peine, de les lire ?
Par exemple, par une Ordonnance du 17 octobre 2014, Mme L. et autres, le Conseil d'État a suspendu l'application de la circulaire du 18 juillet 2014 qui supprime la condition de "mérite" pour des aides financières apportées aux étudiants. Ce juge des référés ne fait que suspendre l'application, l'instance au fond, en vue d'obtenir l'annulation, se poursuit et l'on ne connaît pas encore son résultat.
Mais la presse, par exemple l'article paru dans Le Monde, titre : "Le Conseil d'Etat annule la suspension des bourses au mérite". Pourtant, le Conseil d'État n'oblige pas à lire le texte même de ses décisions. Il y associe des communiqués de presse, accessible sur la première page de son site. Cela ne suffit pas, la presse confond une décision au fond, d'annulation, et une décision de référé, provisoire, de suspension. Pourtant la différence est importante : on ne sait pas encore à ce stade si cette circulaire est légale ou illégale.
Or, le grief développé au fond et ici pris en considération par l'Ordonnance du 17 octobre 2014 relève de l'art de la définition et de la qualification : le Gouvernement a le pouvoir de "fixer les conditions" : peut-on considérer que supprimer la condition relève encore de la fixation des conditions ?
Seul le Conseil d'État statuant au fond répondra à cette question, qui relève de la logique juridique.
Oct. 19, 2014
Blog

Le droit est construit par l'Histoire, qu'on l'admette, qu'on le théorise (Savigny et l'École historique du droit) ou qu'on ait l'illusion du droit écrit sur page blanche, comme le voulurent les Révolutionnaires français.
Les systèmes de Civil Law vivent plutôt dans l'illusion d'un Législateur tout puissant, souverain qui déchire les lois d'hier et en écrit de toutes neuves sur le papier frais du Journal Officiel. Le système de Common Law repose plus franchement sur la mémoire, donc sur l'Histoire, conservant toutes les règles, ensevelies dans l'humus des cas, dormantes, toujours prêtes à être réveillées au besoin, si un "cas nouveau" le requiert. C'est pourquoi un juriste de Common Law est moins "pris au dépourvu" qu'un juriste de Civil Law, lequel est surtout prompt à crier au "vide juridique" et se lancer dans un "appel au législateur" pour le combler.
Il ne faut donc pas s'étonner que face à ce qui désarçonne les États, à savoir le mouvement terroriste que certains appellent "État islamique" richissime, agissant par capillarité et sans pitié, le Royaume-Uni va puiser dans les règles juridiques de son droit médiéval, puisque celui-ci demeure vivant.
Le 16 octobre 2014, le Gouvernement britannique s'est prévalu d'une règle du XIVième siècle, construite dans le contexte de la Guerre de 100 ans, pour appliquer la qualification de crime de haute trahison afin de poursuivre les Britanniques qui rejoignent l'État islamique : on ne peut "prêter allégeance" à celui-ci, et respecter deux maîtres : l'"État islamique" et sa Majesté.
Oct. 16, 2014
Blog
 "Juge et contrat", thème classique ; "Relevé d'office de la règle de droit par le juge", thème classique. Quand on croise les deux, il en résulte l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1ier octobre 2014, UFC de l'Isère c/ Mutualité française de l'Isère.
"Juge et contrat", thème classique ; "Relevé d'office de la règle de droit par le juge", thème classique. Quand on croise les deux, il en résulte l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 1ier octobre 2014, UFC de l'Isère c/ Mutualité française de l'Isère.
Pour Motulsky, il allait de soi que le juge a l'obligation de relever d'office les règles de droit applicable et, par exemple, sanctionne l'illicéité d'une clause contractuelle, alors même que la partie au litige n'avait pas invoqué la règle de droit contrariée. En effet, le juge a l'apanage du droit et doit le concrétiser, tandis que la partie doit lui apporter l'édifice de faits qui constitue la prétention articulée, cela mais seulement cela.
Mais la Cour de cassation n'est aujourd'hui guère motulskienne .... Ainsi, le plus souvent, ses arrêts énoncent que le relevé d'office constitue pour les juges non pas un devoir mais bien plutôt un pouvoir. Dès lors le juge "peut" appliquer le droit sans que la partie au litige le lui demande, mais n'y est pas contraint par le système juridique. Pourtant, ce retour à la conception traditionnelle du procès civil s'arrête là lorsque l'ordre public réapparait, car la règle d'ordre public "demande" à être appliquée, indépendamment du désir que la partie au procès exprime de se la voir appliquer. Dans le cas présent, l'ordre public est constitué par le droit de la consommation. Cela est d'autant plus justifié lorsque le demandeur est une association de consommateurs, qui s'appuie sur des dispositions spécifiques du Code de la consommation lui permettant d'obtenir l'annulation de clauses abusives de tous les contrats particuliers, reflet d'un "contrat-type". Mais le professionnel échappe alors à la perspective d'annulation en construisant un nouveau type de contrat et le demandeur, dans cette action en cessation de comportement illicite, précurseur de l' "action collective" mise en place par la loi du 17 mars 2014), n'avait pas songé à viser non seulement l'ancien contrat-type mais encore le nouveau contrat-type.
La Cour de cassation rend un arrêt de cassation et de principe, en posant que "le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clause contractuelles invoquées par une parties dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
On note donc le principe : obligation de relever d'office le caractère abusif de la clause. Mais la Cour y met trois conditions : 1° la clause doit être invoquée par la partie ; 2° le juge doit "disposer" des faits pour l'application du droit ; 3° le juge doit disposer aussi des éléments de droit pour y procéder. A la réflexion, la Cour de cassation demeure peu motulskienne ...
Pourtant l'adage traditionnel ne pose-t-il pas que "la Cour connait le droit" ?
Oct. 15, 2014
Blog
 Dans cette courte présentation faite en juin 2014, le professeur Ejan MacKaay présente le mouvement Law and Economics.
Dans cette courte présentation faite en juin 2014, le professeur Ejan MacKaay présente le mouvement Law and Economics.
Auteur d'un ouvrage sur L'analyse économique du droit, dont on peut retrouver les développements dans un ouvrage anglophone, (Law and Economics For Civil Law Systems), appliquant cette méthode au système romano-germanique, Ejan MacKaay en fait une présentation très favorable.
Il insiste à juste titre sur le fait que le droit est inséré dans des mécanismes sociaux et qu'il est essentiel de tenir compte dès le départ des effets que le droit produit sur la société. Il souligne qu'il est rationnel de préférer la règle de droit qui aurait des effets sociaux les plus favorables. Il en déduit qu'il est donc pertinent d'étudier ces liens entre le droit et l'organisation économique de la société et de les prendre en considération dans la régulation sociale que constitue le droit.
On ne peut que souscrire à une telle présentation, tant la concision est remarquable (on sait qu'il faut beaucoup de maîtrise pour présenter en si peu de temps toute une matière, telle que Law and Economics).
La crainte que l'on ressent face à une telle école est que la démonstration de l'efficacité de telle règle de droit par rapport à telle autre passe du stade de l'information au stade de la prescription. En effet, l'efficacité n'est pas un critère absolu, c'est un critère relatif (l'on peut préfèrer une régle "juste" par exemple). En outre, vient un moment où l'auteur de la norme juridique doit choisir entre les solutions sociétaires, l'économie ne pouvant opérer seule "l'économie de la grandeur" (pour reprendre l'expression excellente de Laurent Thévenot et Luc Bolstanky).
Oct. 4, 2014
Blog
 Un couple divorce. L'enfant a sa résidence habituelle chez le père (ce que l'on continue le mécanisme de "garde").
Un couple divorce. L'enfant a sa résidence habituelle chez le père (ce que l'on continue le mécanisme de "garde").
La mère de l'enfant, alors âgée de 8 ans, ouvre à celle-ci un compte FaceBook.
Au bout de quelque temps, le père saisit le Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour obtenir la fermeture de ce compte.
Le juge ne le déboute pas, en estimant que cela ne relève pas de son office.
Au contraire, il y procède, en estimant qu'il est de l'intérêt de cette enfant qu'elle ne dispose plus d'un compte FaceBook, en ce que celui-ci a contribué à la "désocialiser".
Cela justifie donc pour les juges de première instance, comme pour les juges d'appel dans leur arrêt du 2 septembre 2014, qu'un ordre soit donné à la mère de l'enfant de fermer immédiatement le compte.
Oct. 3, 2014
Blog

Le même jour, le 2 octobre 2014, Alain Juppé et Manuel Valls ont affirmé leur condamnation du contrat de maternité pour autrui.
L'ancien Premier Ministre, de droite, l'actuel Premier Ministre, de gauche, convergent.
Ils convergent sur la condamnation de la pratique.
Ils convergent sur ce qui fonde cette condamnation : le contrat de maternité pour autrui (dit souvent "GPA") est une marchandisation des corps des femmes et des enfants.
Oct. 3, 2014
Blog
 Le même jour, le 2 octobre 2014, Alain Juppé et Manuel Valls ont affirmé leur condamnation du contrat de maternité pour autrui.
Le même jour, le 2 octobre 2014, Alain Juppé et Manuel Valls ont affirmé leur condamnation du contrat de maternité pour autrui.
L'ancien Premier Ministre, de droite, l'actuel Premier Ministre, de gauche, convergent.
Ils convergent sur la condamnation de la pratique.
Ils convergent sur ce qui fonde cette condamnation : le contrat de maternité pour autrui (dit souvent "GPA") est une marchandisation des corps des femmes et des enfants.
Sept. 29, 2014
Blog
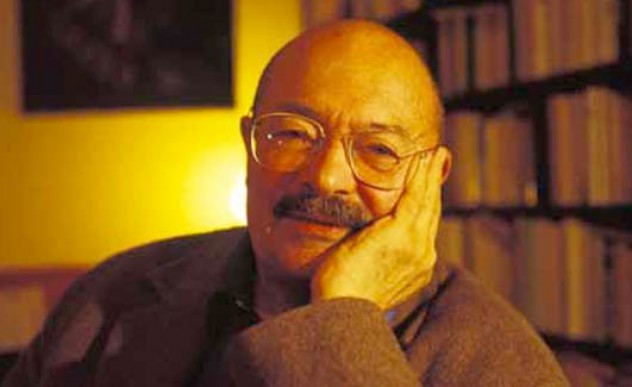 La liberté d'expression est une condition de la société démocratique. C'est pourquoi elle est à la fois un droit de l'homme et un principe constitutionnel. Peu importe que l'opinion ne soit pas "convenable". Il n'en fût pas toujours ainsi et Sade fût emprisonné en raison de ses écrits.
La liberté d'expression est une condition de la société démocratique. C'est pourquoi elle est à la fois un droit de l'homme et un principe constitutionnel. Peu importe que l'opinion ne soit pas "convenable". Il n'en fût pas toujours ainsi et Sade fût emprisonné en raison de ses écrits.
Mais de la même façon, lorsque Jean-Jacques Pauvert, décédé le 27 septembre 2014, publia en 1948 les oeuvres complètes de Sade, que les éditeurs se gardaient de faire, prenant soin d'ôter les passages les plus sulfureux et violents contre les hommes et contre Dieu, Pauvert fût poursuivi et condamné par la justice pénale pour "outrage aux bonnes moeurs".
Dans ce procès qui se déroula à Paris en 1956, André Breton écrivit aux juges pour leur expliquer d'une part que Sade était un moraliste. Était-ce un argument pertinent pour un juge ? D'autre part, il reprit l'argument selon lequel un auteur n'est pas responsable de ceux qui le lisent mal. Est-ce suffisant pour n'être pas responsable ? En troisième part, il insista sur le fait que Pauvert représentait la liberté d'expression. Cela ne suffit pas en première instance, même si le jugement de condamnation fût dans un second temps réformé en appel.
La littérature, qu'incarne aussi André Breton, peut-elle venir à la barre ?
Un procès, comme celui qui se déroula en 1956, aura-t-il lieu aujourd'hui ? Se déroulerait-il de la même façon ?
Enfin, ayons une pensée pour Jean-Jacques Pauvert, grand éditeur, pourchassé pour faire son métier, car il n'y a pas de littérature sans éditeur.
Sept. 28, 2014
Blog
 Qui ne connaît la jurisprudence Baby-Loup ?Sur le moment, chacun s'en est ému, a eu son opinion, a commenté les retournements entre le premier arrêt de la Cour de cassation, l'arrêt de résistance de la Cour d'appel de Paris sur conclusions flambloyantes du Procureur général, l'arrêt contraire et protecteur de la crèche de l'assemblée plénière de la Cour de cassation.Mais aujourd'hui, faute de subventions, la crèche va sans doute fermer. Le conseil municipal de Conflan-Saint-Honorine le dira le 29 mars 2014.
Qui ne connaît la jurisprudence Baby-Loup ?Sur le moment, chacun s'en est ému, a eu son opinion, a commenté les retournements entre le premier arrêt de la Cour de cassation, l'arrêt de résistance de la Cour d'appel de Paris sur conclusions flambloyantes du Procureur général, l'arrêt contraire et protecteur de la crèche de l'assemblée plénière de la Cour de cassation.Mais aujourd'hui, faute de subventions, la crèche va sans doute fermer. Le conseil municipal de Conflan-Saint-Honorine le dira le 29 mars 2014.
1. Cette fermeture est corrélée au procès. L'association dût changer de commune, en raison de l'affaire. La nouvelle commune n'est pas tenue par les engagements de l'autre.
2. La petite crèche Baby-Loup restera pour toujours célèbre, car dans tous les cours portant sur la laïcité, les étudiants entendront parler d'elle. Elle est entrée au Panthéon du droit.
3. C'est si souvent le cas : Rose Jand'heur et Agnès Blanco , ces deux petites filles d'une dizaine d'années, depuis longtemps disparues ... Savaient-elles, vieilles dames, que leur patronyme, Jand'heur, Blanco, était et serait récité, couché sur des copies, invoqué par les plus grands auteurs ?
A petites filles, grands cas. A petite crèche, grand destin dans le paysage du droit.
Sept. 26, 2014
Blog
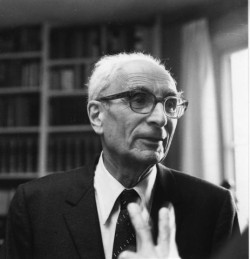 La filiation est un élément fondamental des sociétés.
La filiation est un élément fondamental des sociétés.
Il a été démontré en anthropologie que certaines règles étaient fondamentales pour l'équilibre des sociétés. Ainsi en est-il de la prohibition de l'inceste, entre les parents et les enfants, entre les frères et les soeurs.
L'une des raisons pour lesquels le droit prohibe d'une façon absolue les conventions de maternité pour autrui (que certains appellent "G.P.A.") tient au fait que non seulement le bébé est vendu comme une chose, non seulement la mère de celui-ci, la mère qui le porte, est alors une esclave, mais encore tient au fait que si on le permettait, l'on pourrait arriver à valider l'inceste.
Ainsi, lorsque les arrêts du 26 juin 2014 de la CEDH condamnèrent la France pour ne pas prendre en considération le lien entre l'enfant issu d'une "GPA" faite à l'étranger, le professeur de droit Muriel Fabre-Magnan affirma que le droit fondamental de la filiation était si heurté que l'on pouvait craindre dans un choc en retour la levée de la prohibition de l'inceste.
Trois mois après, le conseil d'éthique propose en Allemagne de lever la prohibition juridique de l'inceste entre frère et soeur. Ce n'est pas la solution technique qui est bouleversante, mais la motivation. En effet, le Conseil estime qu'il ne convient pas de sanctionner ainsi deux "adultes consentants" qui s'aiment.
Le consentement serait donc seul maître à bord.
Le marché, qui ne fonctionne que sur l'ajustement des consentements et ne connaît que cela, a gagné pour être le seul modèle de référence. Le marché devient le modèle de la société même.
Qu'en aurait dit Claude Lévi-Strauss ?
Sept. 25, 2014
Blog
 J'écoutais la radio dans le taxi en sortant de mon cours.
J'écoutais la radio dans le taxi en sortant de mon cours.
Les journalistes parlent sur toutes les ondes ce qui serait un "arrêt" rendu par la Cour de cassation. Celui-ci aurait admis l'efficacité en France de la procréation médicalement assistée (P.M.A.), lorsque l'une des femmes d'un couple lesbien l'a réalisée à l'étranger, sa conjointe voulant procéder par la suite à l'adoption de l'enfant.
Les journalistes affirment que l'arrêt est justifié par "l'intérêt supérieur de l'enfant" et qu'il "tire les conséquences de la loi du 17 mai 2013". Les journalistes expliquent que l'arrêt est conforme au Code civil et aux engagements internationaux de la France.
Cela suffit à écarter la prohibition du droit français de recourir à la P.M.A. par convenance, sans constat d'une stérilité médicalement constatée.
Rentrée à mon bureau, j'écoute les médias sur lesquels l'information repasse en boucle et je vais chercher le document.
Il ne s'agit en rien d'un arrêt, mais de deux avis, que les journalistes n'ont pas lus. En revanche, ils ont lu le "communiqué" que la Cour a diffusé dans toutes les salles de rédaction, qui exprime la philosophie de ce qui est présenté comme une décision. C'est de ce communiqué qu'est tirée cette sorte d' "auto-commentaire" que la Cour fait de ses avis, pourtant si laconiques, selon lequel sa position est conforme au droit interne et international de l'adoption.
En revanche, les deux avis, qui se réduisent à une phrase, ne contiennent aucune discussion et ne développent aucun motivation. Dans l'unique phrase, il est posé : il suffit désormais que le droit de l'adoption soit respecté et que l'intérêt de l'enfant ne soit pas contrarié pour que le non-respect du droit français par la pratique des adultes ne fasse pas obstacle à l'établissement de la filiation de l'enfant.
Par un simple avis, à peine motivé, la Cour anéantit et la loi et sa propre jurisprudence.
Sous l'Ancien Régime, l'on connaissait les arrêts de règlement. Nous connaissons désormais les "avis de règlements".
Lire les avis de la Cour de cassation du 22 septembre 2014
Lire les conclusions de l'avocat général.
Sept. 21, 2014
Blog
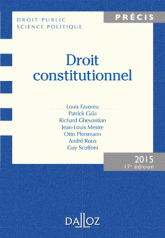 Spontanément, on répond "oui".
Spontanément, on répond "oui".
Car quand on regarde sa bibliothèque de droit, composée en grande partie de livres à couverture rouge et de livres à couverture bleue, ceux que l'on manie quand on est étudiant, ce qui forme notre esprit. Or, le Droit constitutionnel est un livre à couverture bleue (collection "Droit public" de Dalloz). Alors, n'allons pas chercher plus loin : le droit constitutionnel appartient au droit public.
Nous avons un autre indice, tout aussi solide. L'Université se compose de professeurs de droit public et de professeur de droit privé. A l'agrégation de droit public, le droit constitutionnel est au programme. A l'agrégation de droit privé et de sciences criminelles, il ne l'est pas.
Ainsi, pourquoi même poser la question ?
C'est pour ne pas l'avoir posée que le droit français, aveugle sur lui-même, est malhabile à percevoir et à manier le fait que le droit constitutionnel dépasse aujourd'hui très largement le droit public. Parce qu'il a aussi pour objet, peut-être pour coeur, les droits fondamentaux. Par exemple en matière de procédure, notamment de procédure pénale.
Mais celle-ci relève de l'agrégation de droit privé. Pourquoi l'on croyait que le droit constitutionnel était inséré dans le droit public, dont il constituerait une branche.
Ciel ! Faudrait-il recommencer nos études ?