Matières à Réflexions
2 juin 2021
Publications

Référence générale : Frison-Roche, M.-A.(dir.), Compliance Tools, série "Régulations & Compliance", coédition Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2021.
Cet ouvrage en langue anglaise constitue le 1ier titre de cette collection entièrement consacrée au Droit de la Compliance, en ce que celle-ci est le prolongement du Droit de la Régulation.
Consulter les titres de cette série en langue anglaise coéditée avec Bruylant.
Cette collection en langue anglaise s'articule avec une collection coéditée entre le Journal of Regulation & Compliance et Dalloz.
Ainsi, parallèlement, un ouvrage en français, Les outils de la Compliance, est publié.
Consulter les titres de la série en langue française coéditée avec Dalloz.
Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.
___
Présentation générale de l'ouvrage publié en anglais
The political dimension of Compliance Law lies in the goals it aims to achieve. To achieve them, the concern for these goals is internalized in "crucial operators", which may be obliged to concretize "monumental goals" set by public authorities. These public bodies control the Ex Ante reorganization that this implies for these companies and sanction Ex Post the possible inadequacy of the companies, which have become transparent to this end. The effectiveness and efficiency of this internalization, without which the statement of these goals is worth nothing, is based on the Compliance tools that are deployed.
These appear to be very diverse but their substantial unity (topic which will be the subject of a forthcoming book) makes it possible to study the tools put in place from a unique perspective, by not isolating them in a particular branch of Law, Criminal law or International Law for example, but by measuring what is common to them, notably Anticipation, Trust, Commitment, Responsibility, Incentive, and so on. If the Compliance tools vary, it is rather not only according to the sectors, finance and banking appearing then as the advanced point of the general Compliance Law, for example in environmental matters, but also according to the countries and the cultures. It is in fact about them that legal cultures seem to oppose.
The book aims to understand these "tools" by going beyond the description of each instrument, for which we already have many monographs, for analyzing them through the issues of Risks, required Expertises, Training. Sovereignty claims, Incentives, mechanical aptitude of Technologies. It is through these themes that are analyzed by the authors, experts in the field, what we always want to understand better: Compliance Programs, Whistle-blowing, Mapping, Sanctions, Extraterritoriality, etc.
____
Consulter le sommaire de l'ouvrage.
Lire l'avant-projet résumant l'ensemble des contributions de l'ouvrage.
Présentation des articles composant l'ouvrage :
-
Amico, Th., Compliance or the passage from ex post to ex ante: A Copernican revolution for the criminal lawyer?
-
Banck, A., The maturity of the Compliance tool’s user, first criterion of the choice of the salient tool
-
Burlingame, R., Coppens, K., Power, N., Lee, D.H., Anti-Corruption Compliance: Global Dimension of Enforcement and Risk Management
-
Calandri, L., Incentive(s) and Self-Regulation(s): which place for Compliance Law in the Audiovisual Sector?
-
Causse, H., Compliance Training: Through and Beyond Traditional Legal Training
- Frison-Roche, M.-A., Describing, designing and correlating Compliance Tools to Have a Better Use of It
-
Frison-Roche, M.-A., Building by Law the Unicity of Compliance Tools from the Definition of Compliance Law by its "Monumental Goals"
-
Frison-Roche, M.-A., Drawing up Risk Maps as an obligation and the paradox of the "Compliance risks"
- Frison-Roche, M.-A., Incentives and Compliance, a couple to propel
- Frison-Roche, M.-A., Resolving the contradiction between sanctions and incentives under the fire of Compliance Law
- Frison-Roche, M.-A., Rights, primary and natural Compliance Tools
-
Frison-Roche, M.-A., Training: content and container of Compliance Law
-
Galland, M., The Regulator's Inspection of the Effectiveness of the Compliance Tools Implemented by the Company
- Granier, C., The Normative Originality of Compliance by Design
-
Guillaume, N., Compliance risk mapping: first insights of challenges, limits and good practices
-
Guttierez-Crespin, A., Audit of Compliance Systems
-
Koenigsberg, S. and Barrière, F., The Development of Attorney's Compliance Expertise
-
Larouer, M., The Manifestation of Incentives Mechanisms in French Compliance Law
-
Merabet, S., Morality by Design
-
Pailler, L., Technological Tools, Compliance by Design and GDPR: the Protection of Personal Data from Design
-
Racine, J.-B., Geographical dominance in the choice and the use of Compliance Tools. Introductory remarks
-
Rapp, L., Incentive Theory and Governance of Space Activities
-
Roda, J.-C., Compliance by design in antitrust: between innovation and illusion
-
Salah, M., Conception and Application of Compliance in Africa
-
Tardieu, H., Data Sovereignty and Compliance
-
Thouret, T., Training and Compliance, Two Correlated Information Transmission Tools
2 juin 2021
Publications

Référence complète: Frison-Roche, M.-A., Describing, conceiving and correlating compliance tools, in order to use them adequately, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Compliance Tools, série Regulation & Compliance, Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2021, p. 9-32.
____
Résumé de l'article: L'article constitue l'introduction générale de l'ouvrage sur Les outils de la Compliance. Dans sa première partie il développe la problématique d'ensemble de ceux-ci. Dans sa seconde partie, il présente chacune des contributions, replacée dans la construction d'ensemble de l'ouvrage.
____
Lire une présentation de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié
2 juin 2021
Publications

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Training: content and container of Compliance Law, in Frison-Roche, M.-A. (dir.), Compliance tools, série "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Bruylant, 2021, p. 245-264
___
Résumé de l'article
Au premier titre, en tant que la formation est un outil spécifique de Compliance, elle est supervisée par les Régulateurs. Elle devient même obligatoire lorsqu'elle est contenue dans des programmes de Compliance. Puisque l'effectivité et l'efficacité sont des exigences juridiques, quelle est alors la marge des entreprises pour les concevoir et comment en mesure-on le résultat ?
Au second titre, tant que chaque outil de Compliance comprend, et de plus en plus, une dimension éducative, l'on peut reprendre chacun d'entre eux pour dégager cette perspective. Ainsi même les condamnations et les prescriptions sont autant de leçons, de leçons données, de leçons à suivre. La question est alors de savoir qui, dans ce Droit si pédagogique, sont les "instituteurs" ?
____
Cet article prend appui sur un document de travail bilingue, comprenant des développements techniques supplémentaires, des notes en pop-up et des liens hypertextes.
Consulter une présentation générale du volume dans lequel l'article a été publié.
____
2 juin 2021
Base Documentaire

Référence générale : Amico, Th., Compliance or the passage from ex post to ex ante: a Compernican revolution for the criminal lawyer?, in M.-A. (dir.), Compliance Tools, série "Regulation & Compliance", Journal of Regulation & Compliance et Bruylant, 2021, p. 165-172
Consulter une présentation générale du volume dans lequel l'article a été publié.
___
Résumé en français de l'article publié en anglais (résumé fait par Marie-Anne Frison-Roche)
Après s'être référé à diverses définitions du Droit de la Compliance, l'auteur insiste sur l'utilité de l'avocat pénaliste en ce que celui-ci, connaisseur de l'Ex Post que constitue la sanction, peut être de bon conseil dans l'Ex Ante dans lequel se développent de nouveaux mécanismes de compliance, comme la cartographie des risques ou l'évaluation des tiers.
Abordant la dimension punitive du Droit de la Compliance, l'auteur montre que l'avocat pénaliste y a donc naturellement sa place, qu'il s'agisse des pouvoirs exercés par une Autorité administrative ou du Droit pénal proprement dit. En ce qu'il peut "anticiper les procédures pénales", l'avocat pénaliste est donc le mieux à même de faire en sorte que l'entreprise ne s'y expose pas, notamment dans une bonne maîtrise des enquêtes internes, écartant ainsi d'elle le risque pénal.
Consulter les résumés des autres articles composant l'ouvrage.
____
2 juin 2021
Publications

► Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Building by Law the Unicity of Compliance Tools from the Definition of Compliance Law by its "Monumental Goals", in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Tools, series "Compliance & Regulation ", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) and Bruylant, 2021, pp. 35-46._
Summary of the article : The "tools of Compliance" do not stack on top of each other. They form a system, thanks to a unity drawn from the goals that all these multiple and different tools serve: the "Monumental Goals" by which Compliance Law is defined.
All these tools are configured by these goals and for mastering all these techniques, it is essential to put them all in perspective of what Compliance Law is, which is designed teleologically with regard to its goals. Extension of Regulatory Law and like it, Compliance Law is built on a balance between the principle of competition and other concerns that public authorities claim to take care of. Compliance Law has moreover more "pretensions" in this respect, for example in environmental matters. All the means are then good, the violence of the tools marrying without difficulty with the voluntary commitments since it is the goals which govern this branch of Law.
As legal solutions adopted show, a common method of interpretation and common levels of constraint for all Compliance Tools result from this definition. Starting from the goals (in which legal normativity is housed), the interpretation of the different tools is thus unified. Moreover, the different degrees of constraint do not operate according to the consideration of sources (traditional legal criterion) but by the goals, according to the legal distinction between obligations of means and obligations of results which result from the articulation between tools, of which the establishment is an obligation of result, and the goal, of which the achievement is only an obligation of means.
____
📝 Read the bilingual working paper on which rely this article.
📝 Read a general presentation of the book in which this article has been published.
____
2 juin 2021
Base Documentaire : Doctrine

Full reference : Banck, A., The maturity of the Compliance tool’s user, first criterion of the choice of the salient tool, in Frison-Roche, M.-A. (ed.), Compliance Tools, serie "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance and Bruylant, 2021, p. 225-228.
Read a general presentation of the book in which the article has been published.
___
Summary of the article (written by Marie-Anne Frison-Roche)
The author insists on the practical necessity for the firm to show immediately the documents attesting of the reality of Compliance mechanisms. IT tools helps companies to do that, but the crucial point is that everyone in the firm appropriates these tools.
To obtain it, it is necessary that the Compliance officer does not necessarily choose the tool which suits him or her best and pleases him or her the most but rather suits the one who will handle it, for example commercial teams on the ground, monitoring that the tool integrates the specificity of the sector and of the firm. The adjustment of the softwares must meet a maturity of its users in the firm, which must have a "culture of compliance" to take advantage of its tools. Thus more rudimental tools can be more efficient if the culture of Compliance is still weak, sophisticated tools could be unuseful if a prior minimum basis is not reach.
The author thus shows the link to be made between the maturity of the users and the technicality of the tools, the two having to progress together.
Read the summaries of the other articles of the book.
____
1 juin 2021
Compliance : sur le vif

29 mai 2021
Compliance : sur le vif

26 mai 2021
Base Documentaire : 09. Juridictions étrangères
► Référence complète : Rechtbank Den Haag (Tribunal de La Haye), 26 mai 2021, aff. C/09/571932 / HA ZA 19-379, Vereniging Milieudefensie et a. c/ Royal Dutch Shell PLC.
____
____
🏛️lire la traduction française du jugement
____
📝commentaires de la décision :
- D. 2021, pp. 1968-1970, obs. A.-M. Ilcheva
- EEI, nov. 2021, n° 11, comm. 86, note F.-G. Trébulle
- JSS, 14 août 2021, n° 59, p. 14, tribune C. Lepage, V. Saintaman et B. Denis
- Gaz. Pal., 27 juillet 2021, n° 28, p. 24, art. n° 424w6, note M.-P. Maître
________
26 mai 2021
Base Documentaire : Doctrine
17 mai 2021
Conférences

 Référence complète: Frison-Roche, M.-A., La place des entreprises dans la création et l'effectivité du Droit de la Compliance en cas de crise in (dir.) Les normes publiques et la Compliance en temps de crise : les buts monumentaux à l'épreuve, colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de droit de Montpellier, 17 mai 2021.
Référence complète: Frison-Roche, M.-A., La place des entreprises dans la création et l'effectivité du Droit de la Compliance en cas de crise in (dir.) Les normes publiques et la Compliance en temps de crise : les buts monumentaux à l'épreuve, colloque coorganisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et la Faculté de droit de Montpellier, 17 mai 2021.
Consulter les slides sur lesquelles s'appuie cette conférence.
Regarder la vidéo de cette conférence.
Lire le programme général de ce colloque
Lire le document de travail sur la base duquel la conférence a été élaborée.
___
Ce colloque s'insère dans le cycle de colloques 2021 organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et ses partenaires autour des Buts monumentaux de la Compliance.
Les interventions serviront de première base à la réalisation d'un ouvrage dirigé par Marie-Anne Frison-Roche, dont la version française, Les Buts monumentaux de la Compliance, est co-éditée par le JoRC et Dalloz et dont la version anglaise, Compliance Monumental Goals, est co-éditée par le JoRC et Bruylant.
____
Résumé de la conférence : Il s'agit d'observer la façon dont les entreprises agissent lorsque la crise advient et l'impact produit sur les "Buts Monumentaux de la Compliance". Il apparaît que les entreprises ont aidé, soit sur l'ordre des Autorités publiques, soit de leur propre initiative. Toute "épreuve" étant une "preuve", la leçon à tirer de la preuve sanitaire est à retirer face à la crise environnementale dont nous sommes déjà informés.
La crise montre la place et le rôle des entreprises pour que tout d'abord survive l'effectivité du Droit de la Compliance par le souci maintenu de ses buts, grâce à l'aide requise ou spontanée des entreprises.
Mais plus encore l'on a pu observer des entreprises actives en raison de leur "position" pour des buts qui n'étaient pas les leurs, comme l'environnement. L'on retrouve alors la définition générale du Droit de la Compliance comme l'alliance en Ex Ante entre Autorités publiques et opérateurs privés cruciaux, pour maîtriser le futur. Ce sont les juges qui les assignent à cette alliance, ici et maintenant. La crise sanitaire en accélère la construction.

15 mai 2021
Publications

 ► Référence générale : Frison-Roche, M.-A. Place et rôle des entreprises dans la création et l'effectivité du Droit de la Compliance en cas de crise, Document de travail, mai 2021.
► Référence générale : Frison-Roche, M.-A. Place et rôle des entreprises dans la création et l'effectivité du Droit de la Compliance en cas de crise, Document de travail, mai 2021.
____
Ce document de travail a été élaboré pour servir tout d'abord de base à une conférence dans le colloque du 17 mai 2021 : Normes publiques et Compliance en temps de crise : les buts monumentaux à l'épreuve.
Il sera également la base à un article dans l'ouvrage Les Buts Monumentaux de la Compliance, dont la version française est coéditée par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz.
____
► Résumé du document de travail : Cette réflexion a un objet très précis : la place des entreprises privées, au regard du thème général qui unit les contributions : "l'épreuve que constitue une crise". La crise constitue une "épreuve", c'est-à-dire qu'elle apporte des preuves. Prenons-là comme telle.
En effet, lors de la crise sanitaire, il apparait que les entreprises ont aidé les Autorités publiques à résister au choc, à endurer et à sortir de la crise. Elles l'ont fait de force mais elles ont aussi pris des initiatives dans ce sens. De cela aussi, il faut tirer des leçons pour la prochaine crise qui viendra. Il est possible que celle-ci soit déjà commencé sous la forme d'une autre crise global et systémique : la crise environnementale. Au regard de ce qu'on a pu observer et de l'évolution du Droit, des normes prises par les Autorités mais aussi par les nouvelles jurisprudences, que pourra-t-on attendre des entreprises face à celle-ci, de gré et de force ?
____
Lire ci-dessous les développements⤵️.
12 mai 2021
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : A. Beckers, , "L’image juridique évolutive des chaînes de valeur mondiales", Introduction au numéro spéciale les Chaines de Valeur mondiales, Revue internationale de droit économique, 2021, t. XXXV(4), 5-18.
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
12 mai 2021
Base Documentaire : Doctrine
► Référence complète : D. Cabrelli, , "Cartographie du déficit de responsabilité des sociétés transnationales de la Common Law pour les violations des droits de l'homme et des normes du travail à l'étranger", in n° spéc. les Chaines de Valeur mondiales, Revue internationale de droit économique, 2021, t. XXXV(4),
____
🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche
________
5 mai 2021
Base Documentaire : 08. Juridictions du fond
Référence complète : Paris, 5 mai 2021, Carrefour
____
La société Carrefour Hypermarchés commande et achète des produits référencés par sa centrale de référencement, Carrefour Marchandises Internationales (CMI), notamment ceux de la la société I2C. Or, le responsable du référencement des produits de cette société s'était vu offrir des voyages par ce fournisseur (certes avant l'établissement de la Charte éthique).
Un audit avait révélé cela après l'adoption de la charte. Par conséquent, la société CMI a mis fin à sa relation commerciale avec ce fournisseur.
Contestée sur l'allégation du caractère brutal de la rupture des relations commerciale, la Cour estime que cela est justifié car la violation de la charte éthique pouvait fonder la rupture immédiate des relations commerciales, indépendamment de leur date en raison de leur gravité.
- Voir dans le même rattachement à l'obligation de vigilance sur les manquements du fournisseur, justifiant la cessation immédiate de toutes relations commerciales :
- Paris, 13 mars 2019, Monoprix , n°17/21477 ;
- Paris, 24 mars 201, Promod, n°19/15565
________
21 avril 2021
Publications
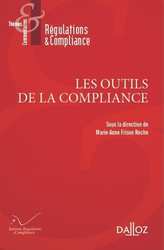
♾️ s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
Référence générale : Frison-Roche, M.-A. (dir.), Les outils de la Compliance, collection "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021.
____
Parallèlement, un ouvrage est publié en version anglaise Compliance Tools, co-édité entre le Journal of Regulation & Compliance et les éditions Bruylant.
Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.
____
Consulter la collection Régulations & Compliance dans laquelle l'ouvrage est publié
___
Présentation générale de l'ouvrage : La dimension politique du Droit de la Compliance réside dans les buts monumentaux que celui-ci vise et qui le définissent. Ces buts sont internalisés dans des « opérateurs cruciaux », qui de gré ou de force doivent se structurer et agir pour les concrétiser des « buts monumentaux », tels que fixés par des Autorités publiques et pouvant coïncider avec les intérêts propres à l’entreprise. Celle-ci conçoit et contrôle la réorganisation Ex Ante que cela implique, sous la supervision des Autorités publiques. Les entreprises, même si leurs activités ne sont pas régulées, deviennent de ce fait transparentes et doivent donner à voir Les Outils de la Compliance déployés effectivement pour atteindre efficacement ces buts. C’est une transformation majeure de la vie économique dans tous les pays car les Outils de la Compliance sont adoptés partout et ont une portée mondiale.
Ceux-ci paraissent très divers mais leur unité est profonde et la faire ressortir a le bienfait pratique de produire un régime juridique aussi unifié que possible, tout en permettant leur adaptation pays par pays, secteur par secteur, entreprise par entreprise. .
Cet ouvrage vise à comprendre ces Outils de Compliance pour mieux anticiper l’appréciation qui en sera faite par les Régulateurs, Superviseurs et Juridictions, ainsi que les nouvelles conceptions qu’en auront les auteurs des textes qui chaque jour en imposent de nouveaux, tandis que les entreprises doivent aussi en imaginer des plus adéquats possibles.
L’ouvrage appréhendant spécifiquement ceux sur lesquels on dispose de peu d’études alors qu’on les manie quotidiennement, comme la cartographie des risques ou les formations ou les droits, en laissant transparaître à travers des contributions plus transversales les outils plus familiers, comme les programmes de compliance, les sanctions, les lancements d’alerte ou les conventions judiciaires d’intérêt publics.
Un premier chapitre en opère une approche juridique et économique Une deuxième chapitre souligne le rôle de la cartographie des risques. Un troisième chapitre dessine le jeu des incitations. Un quatrième chapitre relève les expertises requises. Un cinquième chapitre insiste sur la prégnance géographique. Un sixième chapitre détaille la mesure de l’effectivité. Un septième chapitre explore la formation. Le huitième chapitre examine les outils technologiques. L’article de conclusion débouche sur les droits.
_________
Lire la présentation générale de l'ouvrage, comprenant la table des matières et l'introduction
Lire les présentations de chacun des articles composant l'ouvrage :
- Amico, Th., La Compliance ou le passage de l'ex post à l'ex ante: une révision copernicienne pour l'avocat pénaliste ?
- Banck, A., La maturité de l’usager de l’outil de la Compliance, premier critère du choix de l’outil adéquat
- Benzoni, L., et Deffains, B., Approche économique des outils de la Compliance: finalités, effectivité et mesure de la Compliance "subie" et "choisie"
- Burlingame, R., Coppens, K., Power, N. & Lee, D.H., Compliance : lutte internationale contre la corruption et gestion du risque
- Calandri, L., Incitation(s) et autorégulation(s) dans le secteur de l'audiovisuel : quelle place pour le Droit de la Compliance ?
- Causse, H., La formation en Compliance, par et au-delà de la formation classique
- Frison-Roche, M.-A., Décrire, concevoir et corréler les outils de la Compliance, pour en faire un usage adéquat
- Frison-Roche, M.-A., Construire juridiquement l'unité des outils de la Compliance à partir de la définition du Droit de la Compliance par ses "buts monumentaux"
- Frison-Roche, M.-A., Compliance et incitations, un couple à propulser
- Frison-Roche, M.-A., Résoudre la contradiction entre incitations et sanctions sous le feu du Droit de la Compliance
- Frison-Roche, M.-A., Dresser des cartographies des risques comme obligation et le paradoxe des "risques de conformité"
- Frison-Roche, M.-A., La formation : contenu et contenant du Droit de la Compliance
- Frison-Roche, M.-A., Les droits subjectifs, outils premiers et naturels du Droit de la Compliance
- Galland, M., Le contrôle par le Régulation de l'effectivité des instruments de compliance
- Granier, C., L'originalité normative de la Compliance by design
- Guillaume, N., Cartographie des risques de Compliance : premiers aperçus des enjeux, des limites et des bonnes pratiques
- Gutierriez-Crespin, A., L’audit du dispositif de compliance : un outil clé pour en vérifier la robustesse
- Koenigsberg, S. et Barrière, Fr, La construction de l'expertise de l'avocat en matière de compliance
- Larouer, M., Les manifestations des mécanismes incitatifs dans le Droit français de la Compliance
- Merabet, S., La morale by design
- Pailler, L., Les outils technologiques, la compliance by design et le RGPD : la protection des données dès la conception
- Racine, J.-B., La prégnance géographique dans le choix et l'usage des outils de la Compliance
- Rapp, L., Théorie des incitations et gouvernance des activités spatiales
- Roda, J.-C., Compliance by Design en antitrust: entre innovation et illusion
- Salah, M., Conception et application de la Compliance en Afrique
- Tardieu, H., Souveraineté des données et Compliance
- Thouret, Théo, Formation et Compliance, deux outils corrélés de transmission d'information
_____________
21 avril 2021
Base Documentaire : Doctrine
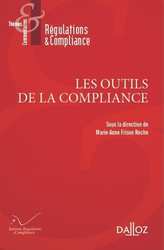
► Référence complète : A. Banck, "La maturité de l’utilisateur d'un outil de Compliance, premier critère du choix de l’outil adéquat", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 209-212.
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'auteur insiste sur la nécessité pratique pour l'entreprise de montrer à première demande les documents attestant de la réalité des mécanismes de Compliance. Les outils informatiques aident les entreprises pour y parvenir, mais l'essentiel est que chacun dans l'entreprise "s'approprie" ses différents outils.
Pour l'obtenir, il faut que le Compliance Officer ne choisisse pas nécessairement l'outil qui lui convient le mieux et lui plaît le plus mais convient plutôt à celui qui va le manier, par exemple les équipes de vente sur le terrain, en veillant à ce que l'outil intègre la spécificité du secteur et de l'entreprise. L'ajustement des logiciels doit donc rencontrer une maturité de ces usagers dans l'entreprise, qui doivent avoir une "culture de la Compliance" pour profiter des outils de celle-ci. Ainsi des outils plus rudimentaires que d'autres peuvent être plus performant si la culture de Compliance est encore faible, des outils sophistiquées pouvant être inutiles si une base minimale préalable n'est pas acquise.
L'auteur montre ainsi l'articulation à faire entre la maturité des utilisateurs et la technicité des outils, les deux devant progresser ensemble.
________
21 avril 2021
Base Documentaire : Doctrine
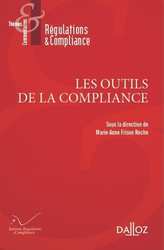
► Référence complète : L. Benzoni et B. Deffains, "Approche économique des outils de la Compliance: finalité, mesure, effectivité de la Compliance "subie" et "choisie"", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 39-50.
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Les auteurs se réfèrent aux travaux généraux de l'analyse économique du Droit pour exposer que les entreprises peuvent avoir intérêt à montrer par avance qu'elles obéissent à la loi dans une stratégie à long terme de réputation et de fiabilité, cette internalisation imposée par la Compliance et transformée par la Corporate Social Responsability rapportant à l'entreprise et son choix relevant ainsi de la rationalité et non de l'émotion.
Ainsi les mécanismes de Compliance cessent d'être "subis", l'entreprise ne faisant que minimiser la perspective d'une sanction future, pour être "choisis", l'entreprise endossant librement une "responsabilité", par exemple en matière environnementale ou de protection des droits humains, en dépassant les exigences légales (ce à quoi correspondent les "buts monumentaux" qui dépassent l'intérêt des associés et l'obligation légale). Le calcul d'investissement est plus difficile pour la seconde, difficilement quantifiable, que pour la première (calcul de probabilité). La loi PACTE donne place à la "compliance choisie" mais l'on en mesure mal l'effectivité : l'on attend la jurisprudence dans son maniement du Droit de la responsabilité. En outre, si le statut d' "entreprise à mission" est adopté, le but devient statutairement contraignant et la gouvernance de la société doit être modifié pour que le contrôle en interne des moyens mis en place. Mais, postulant que les entreprises ne recherchent que leurs avantages compétitifs, il ne s'agit que, par ce service de l'intérêt général, de conquérir de nouveaux bénéfices propres, la finalité lucrative de la compliance choisie montrant le caractère libéral de la Compliance.
Les auteurs soulignent que cette "compliance choisie" implique des outils d'analyse d'évaluation différents de ceux utilisés pour la "compliance subie". Dans la "compliance subie", il s'agit en application des travaux de Gary Becker de considérer l'aversion au risque, l'entreprise calculant ses chances d'être sanctionnée ou non par rapport au gain procuré par l'infraction (à charge pour ceux qui conçoivent le Droit de concevoir celui-ci selon le modèle des incitations) et au coût engendré par les outils interne de conformité. Les auteurs soulignent que l'incertitude des solutions juridiques, et ici de l'importance de la soft law, rend ces calculs difficiles et qu'en outre la rationalité des agents n'est pas totale, la perspective d'être punie étant rejetée en soi tandis que le respect de la règle est plutôt naturel, les entreprises étant donc "honnêtes" (théorie des biais cognitifs) et ne voulant pas être montrées du doigt (name and shame). L'économie comportementale pousse donc à la dépense en faveur de la "compliance subie", au-delà du calcul coût-avantage.
Dans le cas de la "compliance choisie", c'est l'économie de la concurrence qui dessine les solutions, parce que l'entreprise s'impose une contrainte pour en tirer un avantage compétitif, en ce que ces contraintes auto-imposées rencontrent des demandes sociétales, externe (par exemple l'environnement) ou interne (par exemple cohésion dans l'entreprise). Les gains externes sont l'image positive de l'entreprise par rapport à la réputation de ses concurrents. Ces investissements perdent vite leur efficacité parce que toutes les entreprises adoptent les mêmes, ce qui d'ailleurs transforme ces pratiques en normes juridiques communes. Les gains internes sont mesurés en sociologie des organisations par l'adhésion au projet de l'entreprise, réduisant l'inefficience-x interne dans un profit supérieur à l'investissement.
________
21 avril 2021
Base Documentaire : Doctrine
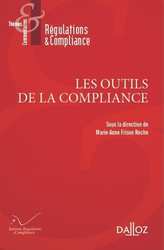
► Référence complète : S. Merabet, "La morale by design", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 287-298.
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Après s'être interrogé sur les rapports entre le Droit et la Morale, dont on a du mal à trouver des points de contact, l'auteur avance l'hypothèse que celle-ci pourrait trouver un espace de concrétisation dans la technologie de l'intelligence artificielle, alors même que beaucoup s'inquiètent des effets délétères de celle-ci. L'auteur considérant que la Compliance n'est qu'une méthode tandis que l'éthique serait la façon dont la morale est incorporée d'une façon assouplie dans le Droit, la technologie dite de l'Intelligence Artificielle pourrait donc exprimer la règle morale ("la compliance by design pourrait être l’outil adéquat pour permettre d’assurer l’effectivité des règles morales sans tomber dans les excès envisagés").
L'auteur prend appui sur des exemples pour estimer qu'ainsi la technologie pour d'une part exprimer la règle morale et d'autre part rendre celle-ci effective. La règle morale peut ainsi élaborée d'une façon équilibrée puisqu'elle l'est conjointement entre l'État et les opérateurs économiques, cette collaboration prenant la forme de principes généraux arrêtés par l'État des moyens choisis par l'entreprise. Son contenu serait également caractérisé par la recherche d'un "juste milieu", qui serait trouvé par cette répartition entre les principes moraux primaires dont l'expression serait le fait de l'État et les principes moraux secondaires dont l'expression serait déléguée aux entreprises.
Prenant donc ce qui seraient les principes de la Compliance, l'auteur les applique à l'Intelligence Artificielle, en montrant qu'on insère dans ces technologies non seulement le principe de neutralité mais encore les principes éthiques de non-malveillance, voire de bienveillance (principes premiers) que les entreprises déclinent ensuite en principes secondaires. Dès lors, "la compliance peut utilement être mise à profit pour convertir ces principes moraux fondamentaux en règles morales dérivées, source d’une plus grande effectivité.".
Aboutissant ainsi à une "morale by design", le système global dispose d'un outil d'effectivité supplémentaire. Cela suppose que les règles fondamentales et dérivées soient d'une qualité morale acquise car pour l'instant l'outil technologique ne peut assurer que leur effectivité et non pas la qualité morale des règles implémentées. Dans la détermination des "règles morales d'application", l'entreprise dispose de marges de liberté, utilisées via les outils technologiques.
________
21 avril 2021
Publications
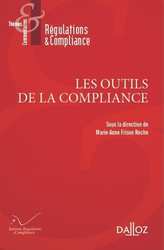
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance et incitations : un couple à propulser", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 123-130.
____
____
🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements et de références techniques supplémentaires, ainsi que de liens hypertextes
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : La théorie dite des incitations vise les mécanismes qui n'ont pas recours directement à la contrainte. Elles auraient donc peu de place dans le Droit de la Compliance puisque celui-ci semble saturé par les procédures de sanction, obsédées par les sanctions, les autorités pour les prononcer, les entreprises pour les éviter. Les sanctions seraient l'opposé même de l'incitation, puisqu'elles sont la forme la plus extrême de l'obligation. Mais même s'il faut réaffirmer que cette attention faite aux sanctions cache l'importance de tous les mécanismes Ex Ante de compliance, il faut dans un premier temps penser les sanctions elles-mêmes doivent être pensées comme des incitations. Pensées comme des incitations, les sanctions se définissent alors comme des outils pour aboutir de la part des uns et des autres aux comportements désirés par ceux qui ont mis en place ces dispositifs. Le Droit, notamment la jurisprudence sensible aux buts monumentaux consacre de plus en plus cette définition des sanctions.
La contradiction entre sanction et incitation ayant disparu, le Droit de la Compliance n'étant donc plus menacé dans son unité, l'association apparaît comme naturelle entre les mécanismes incitatifs et cette nouvelle branche du Droit, dès l'instant que celle-ci est défini d'une façon dynamique. Ce lien par la définition doit être dégagé dans un deuxième temps. En effet si le Droit de la Compliance est défini en plaçant sa normativité juridique dans les "buts monumentaux" qu'il poursuit, comme la disparition de la corruption, la détection du blanchiment d'argent afin que disparaisse la criminalité qui lui est sous-jacente, ou comme la protection effective de l'environnement, ou le souci concret des êtres humains, alors ce qui compte c'est non pas les moyens en eux-mêmes mais la tension effective vers ces "buts monumentaux". Dès lors, ce qui relevait précédemment des politiques publiques menées par les États, parce que ceux-ci ne sont définitivement pas en mesure de le faire, la charge en est internalisée dans les entreprises qui sont en position de tendre vers ces buts : les "opérateurs cruciaux", parce qu'ils en ont la surface, les moyens technologiques, informationnels et financiers.
Dans cette perspective-là, l'internalisation de la volonté publique provoquant une scission avec la forme étatique liée à un territoire qui prive le Politique de son pouvoir de contrainte, les mécanismes incitatifs apparaissent comme le moyens le plus efficace pour atteindre ces buts monumentaux. Ils apparaissent comme ce moyen "naturel" à la fois négativement et positivement défini. Négativement en ce qu'ils ne requièrent pas en Ex Ante de sources institutionnelles nettement repérables et localisées, pas plus qu'ils ne requièrent davantage en Ex Post de pouvoir de sanction : il suffit de substituer l''intérêt à l'obligation. Positivement les incitations relaient à travers les stratégies des opérateurs ce qui était la forme si souvent critiquée et moquée de l'action publique : le "plan". La durée est ainsi injectée grâce au mécanisme de la Compliance, comme l'on le voit à travers le développement de celle-ci dans le souci de l'environnement ("plan Climat"), ou à travers le mécanisme de l'éducation, laquelle ne se conçoit que dans la durée.
Pourtant l'opposition paraît radicale entre Droit de la Compliance et Incitations. Cela tient à trois convictions souvent développées et qu'il faut dépasser. En premier lieu l'idée que d'une façon générale il n'y aurait de Droit que s'il y a un mécanisme de contrainte immédiate qui est attachée à la norme. Dès lors que l'incitation ne reposerait pas sur l'obligation, alors elle ne serait rien... En deuxième lieu, et comme si cela était une sorte de consolation..., la Compliance non plus ne serait pas non plus vraiment du Droit... On dit si souvent qu'il ne s'agit que d'une méthodologie, un ensemble de process sans sens, des procédures à suivre sans chercher à comprendre, process que les algorithmes intègrent dans une mécanique sans fin et sans sens, ou qu'au contraire la Compliance serait emplie de sens par l'Ethique et la Morale, lesquelles sont loin du Droit. Tandis que les incitations s'adressent à l'esprit humain qui calcule, la Compliance serait donc soit un process par lequel les machines se connecteraient à d'autres machines, donc un supplément d'âme, là où le calcul n'a pas lieu d'être ... En troisième lieu, les solutions seraient à trouver dans le Droit de la concurrence, parce qu'il peut se passer des États, les soumettre et appréhender ce qui est a-sectoriel, notamment la finance et le numérique, le monde étant désormais financiarisé et numérisé. La violence du Droit de la concurrence, qui remonte dans l'Ex Ante grâce à des "sanctions de compliance" en appliquant notamment le droit des facilités essentielles, en continuant à nier la pertinence de la durée et en prenant comme souci la "puissance de marché", serait également incompatible avec un couplage avec des mécanismes incitatifs qui reposent sur de la durée et de la puissance de ceux auxquels ils s'appliquent, convergeant vers des buts, lesquels sont arrêtés par ce que le Droit de la concurrence a pour objet d'ignorer : le projet. Ce projet qui prétend construire le futur est pourtant celui du Politique et celui de l'entreprise, qui utilisent leur puissance déployée dans le temps pour le concrétiser. C'est sans doute que se joue l'avenir de l'Europe.
Pour dépasser cette triple difficulté, il faut donc dans un troisième temps relever les modifications de régime juridique apporté au Droit économique par le Droit de la Compliance, en ce que cette nouvelle branche est autonome du Droit de la Concurrence, voire et parfois son opposé, pour que l'insertion des mécanismes incitatifs permettent à des organisations, parfois méconnues ou contrées par le Droit de la Concurrence, d'atteindre des "buts monumentaux" auxquels il est impératif aujourd'hui de prétendre. Par exemple la prise en main des enjeux de climat ou la construction d'une industrie souveraine de la donnée. Cela est posé expressément par la Commission européenne, qui supervise de telles initiatives, la Supervision étant ce qui s'articule avec la Compliance, dans un nouveau couple qui prolonge la Régulation, remplace en Ex Ante le Droit de la Concurrence, branche pertinente pour l'Ex Post. Tous les textes qui sont en train de l'exprimer reposent sur ce couple reformé : Compliance et Incitation.
Ce couple suppose que l'on reconnaisse en tant que telle l'existence des entreprises en tant qu'elles portent un projet, qui est autre que la création de richesses marchandes circulant sur un marché, qui peut être un projet industriel propre à une zone géographique à la fois économique et politique. La Régulation se déploie pour d'une part se détacher de la notion de secteur et d'autre part se transformer en supervision des entreprises cruciales dans la correspondance entre le projet et l'action, ce qui renvoie à la notion de "plan". En cela la supervision bancaire n'est que le bastion avancé de tous les plans thématiques, énergétiques, climatiques et sanitaires, ou plus largement industriels et technologiques pouvant par incitation être mis en place, cette conception de la Compliance permettant de bâtir des zones qui ne soient pas réduites à l'échange marchand instantané. L'incitation correspond au fait que le Droit de la Compliance s'appuie sur la puissance de l'entreprise pour atteindre ses propres buts politiques, par exemple lutter contre la désinformation dans l'espace numérique ou obtenir un environnement sain. Cela suppose que la Compliance cesse de n'être conçue que comme un mode d'effectivité des règles, par exemple du Droit de la concurrence, pour être reconnue comme une branche substantielle du Droit. Une branche qui exprime des buts politiques. Une branche qui s'ancre dans les entreprises cruciales dont elle reconnait l'autonomie par rapport aux marchés. Ce qui permet, notamment par le couplage avec les mécanismes incitatifs amenant à des fonctionnements collaboratifs à long terme supervisés par des autorités publiques, à n'être pas régis par le simple Droit de la concurrence, inapt à concrétiser des projets.
________
21 avril 2021
Base Documentaire
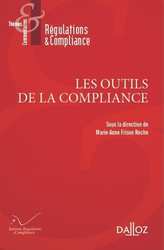
► Référence complète : C. Granier, "L’originalité normative de la Compliance by design", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 267-278.
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'auteur développe l'idée que la Compliance by design représente une "originalité normative", en ce qu'elle vise, par une relation complexe entre l'obligatoire et le volontaire, à assurer l'effectivité des "normes premières" contenues dans les "buts monumentaux" fixés par les pouvoirs publics. La normativité de la Compliance by design est originale car ces procédés se situent dès la mise en place des processus techniques, ce à quoi renvoie l'expression "by design", ce qui renforce la dimension Ex Ante du Droit de la Compliance, l'informatique incrustant cette normativité dans les structures mêmes, par un mariage entre technologie et compliance.
Il en résulte une application "automatisée" de la norme, intégrée dans un programme informatique, qui par exemple bloque l'accès à des données si l'usager n'a pas correctement exprimé son consentement, chaine d'événements mécaniquement provoqués par l'effet d'événements (ou non-évènements) précédents (comme dans les smart-contracts), ensemble fonctionnant en total Ex Ante, en dehors de toute perspective de sanction étatique crainte, la contrainte étant réintégrée dans l'aptitude technique. Cette primauté de la technique pose la question de l'interprétation des normes ainsi incorporées, question que l'auteur laisse ouverte puisqu'elle pourrait mener à des machines qui "interprètent" elles-mêmes les normes.
Cette application automatisée est présentée comme plus "efficace", qualité essentielle dans l'atmosphère de Compliance puisqu'ainsi à la fois la norme ne dépend pas des acteurs privés et peut bénéficier de leur puissance technique. Mais l'on mesure aujourd'hui que l'auteur des normes techniques secondes insère lui-même des normes qui ne devraient être présentes qu'au premier niveau, l'entreprise insérant ses propres pratiques et valeurs, la Compliance by design relevant alors de l'autorégulation.
Plus encore, l'auteur montre que dans la conception même de la norme, dans le design, la question est de désigner l'auteur de l'intégration de la norme dans l'algorithme et les modalités de l'insertion. L'auteur étant interne à l'entreprise, cela constituerait une privatisation de la norme, puisque la norme même seconde ne peut pas être totalement dépourvue d'insertion de valeurs, la Compliance bouleversant donc l'organisation des sources du Droit. Dans une situation que l'auteur désigne comme une "inconnue", sauf à ce qu'apparaissent des "juristes-codeurs", le juriste est disqualifié par son incapacité technique puisqu'il s'agit d'une insertion technologique, la translation du juridique vers l'algorithme, par la traduction en code informatique puis l'insertion dans l'architecture informatique de l'entreprise, transformation la règle juridique. Par exemple par le choix de la sévérité de la sanction mécanique choisie au niveau secondaire pour donner effectivité à une interdiction édictée au niveau premier. L'auteur montre ainsi que ce contrôle d'effectivité des normes de premier niveau, contrôle d'effectivité qui est mis en place au second niveau, impacte directement les normes de premier niveau. Par exemple décider de demander l'autorisation, ou l'expression d'un consentement, ou interdire l'accès, lorsqu'un contenu a été réprouvé par une norme de premier niveau, norme de premier niveau qui ne précise pas le mode de contrôle de cette réprobation que la Compliance by design doit y attacher. Or, la Compliance by design n'étant pas une autorégulation, les autorités publiques contrôlent sa mise en place et en oeuvre, comme le fit la CNIL à propos d'Androïd. Ce type de contrôle va se développer.
________
21 avril 2021
Publications
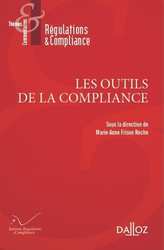
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les droits subjectifs, outils premiers et naturels du Droit de la Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, pp. 301-323.
____
____
🚧lire le document de travail bilingue sur la base duquel cet article a été élaboré, doté de développements supplémentaires, de références techniques et de liens hypertextes
____
📕consulter la présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : Dans la conception traditionnelle de l'architecture des secteurs régulés par le Droit et dans le Droit de la Compliance qui prolonge les techniques étatiques de Régulation, les droits subjectifs ont peu de place. Mais cette configuration n'a plus lieu, au contraire les droits subjectifs sont aujourd'hui au cœur, et le seront de plus en plus. Ils sont et seront les outils premiers du Droit de la Compliance parce qu'ils constituent un "outil" d'une grande efficacité pour assurer le fonctionnement entier d'un système dont les buts sont si difficiles à atteindre. Parce qu'il faut faire feu de tout bois pour concrétiser ces buts, les Autorités publiques non seulement s'appuient sur la puissance des opérateurs cruciaux, mais encore distribuent des prérogatives aux personnes qui, ainsi incitées, activent le système de Compliance et participent à la réalisation du "but monumental". Les droits subjectifs peuvent s'avérer les outils les plus efficaces pour atteindre effectivement les buts fixés, à tel point qu'on peut les considérer comme des "outils premiers".
Mais il convient d'avoir plus de prétention et de concevoir les droits subjectifs comme les outils les plus "naturels" du droit de la Compliance. En effet parce que tous les Buts Monumentaux par lesquels le Droit de la Compliance se définit peuvent se ramener à la protection des personnes, c'est-à-dire à l'effectivité de leurs prérogatives, par un effet de miroir entre les droits subjectifs donnés comme moyens par le Droit aux personnes et les droits subjectifs qui constituent le but même de tout le Droit de la Compliance, notamment la protection de tous les êtres humains, même s'ils sont en situation de grande faiblesse, les droits subjectifs devenant un "outil naturel" du Droit de la Compliance. Nous ne sommes qu'à l'orée de leur déploiement et c'est sans doute sur eux que pourra se réguler l'espace digital dans lequel désormais nous vivons, afin que nous n'y soyons pas étouffés et qu'il constitue pour les personnes un espace civilisé.
________
21 avril 2021
Base Documentaire
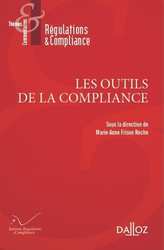
► Référence complète : L. Pailler, "Les outils technologiques, la Compliance by design et le RGPD : la protection des données dès la conception", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 279-286.
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'auteur estime que le RGPD a fait changer le "paradigme" de la protection des données pour la porter dans la Compliance, en ce que les responsables de traitement doivent assurer l'effectivité des règles définies par le Règlement, ce dont ils rendent des comptes. En outre, la donnée, traitée par l'algorithme, est "un moyen de compliance" lorsqu'elle est utilisée pour les plans de vigilance et tous les autres outils, cette brique étant commune à tout le Droit de la Compliance. Pour respecter le Droit, et notamment protéger les personnes, la Compliance by design continue à intégrer la "conformité" dès la conception de ses outils par des normes techniques (Privacy Enhancing Technologies - Pet’s), juridicisées par le RGPD.
L'auteur analyse les moyens technologiques de la protection des données dès la conception de l'outil, qui viennent compléter la loi et le contrat. Il s'intègrent dans les "mesures" requises pour protéger les personnes, par exemple les transferts vers les pays-tiers, ces moyens technologiques étant classés selon leur degré d'effectivité. Si l'opérateur est libre dans le choix de la technologie, mais le Droit exige et contrôle qu'il soit non seulement effectivement protecteur mais encore robuste, facile d'utilisation et compatible avec les outils de l'utilisation. L'auteur souligne que la notion de "effectivité" englobe ces exigences particulières. Cette effectivité, qui doit être prouvée à priori ("documentée") est contrôlée par les Autorités dans le caractère approprié des mesures techniques, leur mise en oeuvre efficace et leur effet concret.
Même si l'opérateur n'est soumis qu'à l'état de la technique, il doit faire évoluer ses moyens techniques, aidé par les autorités (cf. "pack de compliance" de la CNIL). Même si les autorités visent à optimiser les coûts, il doit les supporter, la mise en contexte et la finalité du traitement ne rendant finalement proportionnel. Ainsi si le risque est très élevé pour les personnes, il faudra insérer des techniques plus protecteurs encore que ceux du Droit de la Compliance.
________
21 avril 2021
Base Documentaire : Doctrine
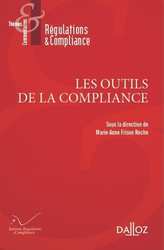
► Référence complète : M. Larouer, "La manifestation des mécanismes incitatifs dans le Droit français de la Compliance", in M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, p. 99-106.
____
📕consulter une présentation générale de l'ouvrage, Les outils de la Compliance, dans lequel cet article est publié
____
► Résumé de l'article (fait par le Journal of Regulation & Compliance) : L'auteur développe en introduction l'idée comme quoi le Droit lui-même accueille la notion d'incitation comme lui étant consubstantielle, prenant notamment appui sur les code de conduite.
Puis l'article développe des manifestations de droit incitatif comme outil de compliace tout d'abord en matière de lutte contre la corruption : la décision de la Commission des sanctions de l'Agence française anticorruption montre que les recommandations de cette Agence incitent l'entreprise à s'y conformer, la protégeant alors d'une sanction si elle s'y soumet mais ne lui interdise pas de s'organiser d'une autre façon. Par ailleurs l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation a posé que le manquement à un obligation contractuelle qui n'est pourtant que la reprise d'une contrainte logée dans un programme de compliance qui vise un tiers justifie la résiliation du contrat.
D'une façon plus générale, l'auteur montre que le système juridique incite les entreprises à intégrer la Compliance par la publication des plans de vigilance et des perfomance extrafinancière, tout en notant que les entreprises n'y procédent pas toujour.
L'article conclut d'ailleurs que le Droit français de la Compliance dans son usage des incitations n'en est qu'à ses "prémices".
________
21 avril 2021
Responsabilités éditoriales : Direction de la collection "Régulations & Compliance", JoRC & Dalloz
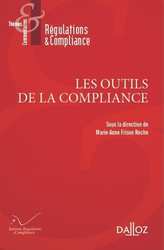
🌐 suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn
🌐 s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law
____
► Référence générale : M.-A. Frison-Roche (dir.), Les outils de la Compliance, coll. "Régulations & Compliance", Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et Dalloz, 2021, 323 p.
____
📘Parallèlement, un ouvrage en anglais, Compliance Tools, est publié dans la collection édité par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et les Éditions Bruylant.
____
📅Cet ouvrage vient à la suite d'un cycle de colloques organisés par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) et des Universités qui lui sont partenaires.
____
Ce volume s'insère dans la ligne des ouvrages qui, dans cette collection, ont été consacrés à la Compliance, antérieurement et ultérieurement à celui-ci.
📚Lire les présentations des autres ouvrages de la Collection portant sur la Compliance :
📕M.-A. Frison-Roche (dir.), L'obligation de compliance, 2025
📕M.-A. Frison-Roche et M. Boissavy (dir.), Compliance & Droit de la défense, 2024
📕M.-A. Frison-Roche (dir.), La juridictionnalisation de la Compliance, 2023
📕M.-A. Frison-Roche (dir.), Les Buts Monumentaux de la Compliance, 2022
📕M.-A. Frison-Roche (dir.), Pour une Europe de la Compliance, 2019
📕N. Borga, J.-Cl. Marin, J.-Ch. Roda (dir.), Compliance : l'Entreprise, le Régulateur et le Juge, 2018
📕M.-A. Frison-Roche (dir.), Régulation, Supervision, Compliance, 2017
📕M.-A. Frison-Roche (dir.), Internet, espace d'interrégulation, 2016
📚Consulter les présentations des autres titres de la collection.
____
► Présentation générale de l'ouvrage : La dimension politique du Droit de la Compliance réside dans les buts monumentaux que celui-ci vise et qui le définissent. Ces buts sont internalisés dans des « opérateurs cruciaux », qui de gré ou de force doivent se structurer et agir pour les concrétiser des « buts monumentaux », tels que fixés par des Autorités publiques et pouvant coïncider avec les intérêts propres à l’entreprise. Celle-ci conçoit et contrôle la réorganisation Ex Ante que cela implique, sous la supervision des Autorités publiques. Les entreprises, même si leurs activités ne sont pas régulées, deviennent de ce fait transparentes et doivent donner à voir Les Outils de la Compliance déployés effectivement pour atteindre efficacement ces buts. C’est une transformation majeure de la vie économique dans tous les pays car les Outils de la Compliance sont adoptés partout et ont une portée mondiale.
Ceux-ci paraissent très divers mais leur unité est profonde et la faire ressortir a le bienfait pratique de produire un régime juridique aussi unifié que possible, tout en permettant leur adaptation pays par pays, secteur par secteur, entreprise par entreprise. .
Cet ouvrage vise à comprendre ces Outils de Compliance pour mieux anticiper l’appréciation qui en sera faite par les Régulateurs, Superviseurs et Juridictions, ainsi que les nouvelles conceptions qu’en auront les auteurs des textes qui chaque jour en imposent de nouveaux, tandis que les entreprises doivent aussi en imaginer des plus adéquats possibles.
L’ouvrage appréhendant spécifiquement ceux sur lesquels on dispose de peu d’études alors qu’on les manie quotidiennement, comme la cartographie des risques ou les formations ou les droits, en laissant transparaître à travers des contributions plus transversales les outils plus familiers, comme les programmes de compliance, les sanctions, les lancements d’alerte ou les conventions judiciaires d’intérêt publics.
Un premier chapitre en opère une approche juridique et économique Une deuxième chapitre souligne le rôle de la cartographie des risques. Un troisième chapitre dessine le jeu des incitations. Un quatrième chapitre relève les expertises requises. Un cinquième chapitre insiste sur la prégnance géographique. Un sixième chapitre détaille la mesure de l’effectivité. Un septième chapitre explore la formation. Le huitième chapitre examine les outils technologiques. L’article de conclusion débouche sur les droits.
____
► Lire l'introduction de l'ouvrage et sa table des matières
____
► Appréhender l'ouvrage à travers la table des matières ci-dessous et les résumés de chacun des articles :
INTRODUCTION
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Décrire, concevoir et corréler les outils de la compliance, pour en faire un usage adéquat
I. APPROCHES JURIDIQUE ET ÉCONOMIQUE DES OUTILS DE LA COMPLIANCE
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Approche juridique des outils de la compliance. Construire juridiquement l'unité des outils de la compliance à partir de la définition du Droit de la compliance par ses "buts monumentaux"
🕴️L. Benzoni et 🕴️B. Deffains, 📝Approche économique des outils de la compliance : finalité, mesure, effectivité de la compliance "subie" et "choisie"
II. LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES, OUTIL CENTRAL DE LA COMPLIANCE
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Dresser des cartographies des risques comme obligation et le paradoxe des "risques de conformité"
🕴️N. Guillaume, 📝Cartographie des risques de compliance. Premiers aperçus des enjeux, des limites et des bonnes pratiques
III. PLACE ET MANIEMENT DES INCITATIONS DANS LES SYSTÈMES DE COMPLIANCE
🕴️L. Rapp, 📝Théorie des incitations et gouvernance des activités spatiales
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Résoudre la contradiction entre "sanction" et "incitation" sous le feu du Droit de la compliance
🕴️M. Larouer, 📝La manifestation des mécanismes incitatifs dans le droit français de la compliance
🕴️H. Tardieu, 📝Souveraineté des données et compliance
🕴️L. Calandri, 📝Incitation(s) et autorégulation(s) : quelle place pour le droit de la compliance dans le secteur audiovisuel ?
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Compliance et incitations : un couple à propulser
IV. LES EXPERTISES REQUISES EN MATIÈRE DE COMPLIANCE
🕴️A. Gutierrez-Crespin, 📝L’audit du dispositif de compliance : un outil clé pour en vérifier la robustesse
🕴️S. Koenigsberg et 🕴️Fr. Barrière, 📝La construction de l'expertise de l'avocat en matière de compliance
🕴️Th. Amico, 📝La Compliance ou le passage de l'ex post à l'ex ante. Une révolution copernicienne pour l'avocat pénaliste ?
V. LA PRÉGNANCE GÉOGRAPHIQUE DES OUTILS DE LA COMPLIANCE
🕴️J.-B. Racine, 📝Propos introductifs. La prégnance géographique dans le choix et l'usage des outils de la compliance
🕴️M. M. Salah, 📝Conception et application de la compliance en Afrique
🕴️R. Burlingame, 🕴️K. Coppens, N. Power et 🕴️D.H. Lee, 📝Compliance : lutte internationale contre la corruption et gestion des risques
VI. LA MESURE DE L'EFFECTIVITÉ DES OUTILS DE LA COMPLIANCE
🕴️M. Galland, 📝Le contrôle par le régulateur de l'effectivité des instruments de compliance mis en place par l'entreprise
🕴️A. Banck, 📝La maturité de l’utilisateur d'un outil de compliance, premier critère du choix de l’outil adéquat
VII. LA FORMATION, ALPHA ET OMÉGA DE LA COMPLIANCE
🕴️H. Causse, 📝La compliance : par et au-delà de la formation juridique classique
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝La formation : contenu et contenant de la compliance
🕴️Th. Thouret, 📝Formation et compliance : deux outils corrélés de transmission d'information
VIII. LES OUTILS TECHNOLOGIQUES ET LA COMPLIANCE BY DESIGN
🕴️J.-Ch. Roda, 📝La compliance by design en antitrust : entre innovation et illusion
🕴️C. Granier, 📝L'originalité normative de la compliance by design
🕴️L. Pailler, 📝Les outils technologiques, la compliance by design et le RGPD : la protection des données dès la conception
🕴️S. Merabet, 📝La morale by design
CONCLUSION
🕴️M.-A. Frison-Roche, 📝Les droits subjectifs, outils premiers et naturels du Droit de la compliance
________