Matières à Réflexions
17 mai 2017
Base Documentaire : Doctrine
17 mai 2017
Base Documentaire : Doctrine
Référence : Dion, N., L'idée d' "entreprise-système" en droit des sociétés. Libre propos , in Mélanges Joël Monéger, Liber Amicorum en l'honneur du Professeur Joël Monéger, éd. LexisNexis, 2017, pp. 151-164.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation"
21 avril 2017
Blog

Par le site "Open culture", il est possible d'écouter Hayao Miyazaki qui, en mars 2017, affirmait que les jeux videos dont les dessins sont faits par des procédés d'intelligence artificielles sont des "insultes à la vie".
Lire ci-dessous l'histoire, les propos que le Maître a tenus, son conception de ce qu'est la création et un travail "réellement humain", ce qui est fait écho aux définitions données par Alain Supiot, qui lui aussi réfléchi sur ce que font les robots.
Cela ramène à la notion même de "création" et de travail créateur.
_____
Lire ci-dessous.

30 mars 2017
Publications

Ce working paper a servi de base à un article publié ultérieurement dans les Mélanges en l'honneur de Jean-Jacques Daigre, Autour du droit bancaire et financier, en 2017.
Compliance. Confiance. Deux mots qui reviennent de plus en plus souvent sous nos yeux de lecteurs ou à nos oreilles d'auditeurs. Et pourtant ils ne semblent pas bien s'assortir. Ils paraissent même se repousser l'un l'autre.
En effet, la compliance est ce par quoi les autorités publiques font confiance à certains opérateurs privés, non pas en eux-mêmes, mais à leurs capacités structurelles à capter mécaniquement l'information dont ces autorités ont besoin (I).
Cela suppose une vision du monde dans lequel les entreprises sont puissantes et sont seules puissantes mais ne sont pas vertueuses, tandis que les autorités publiques, comme le Ministère public ou les régulateurs, sont faibles mais sont seuls vertueux. Une telle conception de la compliance transforme les entreprises en automates. Une telle vision du monde n'a pas d'avenir : on ne peut faire confiance qu'à des êtres humains, dont il faut accepter le caractère faillible, la compliance étant alors l'expression d'un rapport noué sur une confiance qui se donne à voir entre des opérateurs non mécaniques, à savoir les institutions publiques et les opérateurs privés qui peuvent l'un et l'autre avoir en commun souci d'un intérêt qui les dépasse et que l'on appelait naguère l'intérêt général (II).
De cette réalité sans doute nouvelles pour des entreprises privées mais qui explique l'étrange intimité entre le violent Droit de la compliance et le nouvel ordre spontané de la Responsabilité sociétale des entreprises, c'est à celles-ci de faire la preuve de ce souci d'autrui qu'elles partage avec les Autorités publiques, sauf à retomber dans une compliance réduite à des procédures coûteuses, vides sans fin jalonnées de sanctions sans contrôle.
C'est ainsi aux entreprises de faire que cette branche du Droit de la Compliance en train de naître devienne ce qui peut être le meilleur, alors qu'il est possible qu'elle devienne ce qui serait donc le pire.
25 mars 2017
Interviews

Référence générale : Ockrent, Ch., Politique étrangère, 25 mars 2017, Guerres économiques. Les nouvelles armes du Droit, France Culture, 25 mars 2017.
Débat avec Marie-Anne Frison-Roche, Antoine Garapon, Frédéric Marty et Bertrand du Marais.
Écouter l'émission et lire la présentation qui en est faite.
24 mars 2017
Conférences
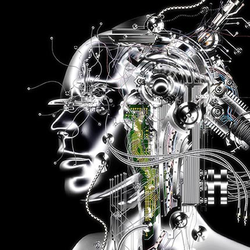
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le droit des data, in Association Française de Philosophie du Droit et Cité des Sciences et de la Techniques, Vers de nouvelles humanités ? L’humanisme face aux nouvelles technologies, 24 mars 2017, auditorium de la Cité des sciences et de l’industrie.
Regarder la vidéo de la conférence.
Consulter le document du programme complet du colloque (23 et 24 mars 2017).
Consulter en lien le programme.
Retrouver les activités passées et présentes de l'Association française de philosophie du Droit.
Les travaux du colloque seront publiés dans le tome 59 des Archives de Philosophie du Droit (APD). Voir la présentation de quelques volumes des Archives de Philosophie du Droit.
Le "Droit des data" semble se constituer en branche du droit nouvelle, sans doute parce que des textes les visent, en leur ensemble et parce qu'ils ont pour sous-jacent spécifique l'informatique et l'espace qu'elle a fait naître, le numérique. Mais doit-on même admettre ce redécoupage du système juridique et de l'enseignement dynamique qu'on en fait ?
Pourquoi y associer si souvent l'adjectif big , à la fois si attractif et effrayant, nouveau Big Fish qui nous ramène à l'enfance ?
Ne sommes-nous pas pulvérisés dans un premier temps et reconstruits par d'autres, qui disposent ainsi de nous comme on le fait de marionnettes à tel point qu'on en vient à parler de "quasi-propriété" parce que la propriété des êtres humains à laquelle les entreprises songent pourtant serait un mot trop violent mais trop exact ?
A quoi ressemble le "Droit des data" car, puisqu'il est nouveau, soit il faut trouver ses racines, soit il faut trouver des comparaisons pour références, afin qu'il ressemble à autre chose qu'un bric-à-brac de textes qui définissent par exemple la "banque de données" comme un "ensemble de données" ou de casuistiques qui colmatent les cas, l'éthique étant confiée par désespoir à la notion si étrangement venue de "design" ?
La ressemblance la plus nette et qui permettrait de mieux le comprendre est sans doute de l'anticiper, c'est le Droit financier.
Or, les données sont le plus souvent la projection de l'être humain lui-même.
Et à propos de celui, Législateur et Juge n'auraient rien à dire ?
Que vaut la parole humaine face à ce flot de chiffres qui mime si parfaitement la langue humaine et si servilement que les ingénieurs donnent aux robots l'allure de jeunes filles souriantes et toujours consentantes ?
Contre la servilité consentante, modèle du marché global, c'est la Parole de la Personne humaine que le Droit des data doit préserver.
La Parole humaine, elle se formule en Questions. Et non pas de demandes. Elle se forge en Savoir. Et non pas en information.
Cette Parole humaine, que les data, série de chiffres ne peuvent imiter, ce sont les artistes qui la portent.
C'est donc à eux qu'il faut donner la parole.
Et la servir. D'en faire que la glose. Dans deux exercices de style. En s'inclinant tout d'abord devant un artiste pythique qui a décrit en 1972 notre engloutissement sous l'information et les images immobiles. Puis en s'inclinant devant l'artiste qui est le dernier homme que le premier appelle, l'homme qui par son art exprime la bravoure humaniste.
Le courage, c'est tout ce dont nous avons besoin.
Mais en avons-nous ?
Voir les slides préparés pour servir de support à la conférence.
Regarder la vidéo de l'intervention, laquelle, pour des raisons techniques, ne correspondit pas aux slides.
.
1 mars 2017
Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Schmidt, D., L’office du juge en droit des OPA et des abus de marché, in Bulletin Joly Bourse, n°2, Lextenso, 2017, p.117.
Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier " MAFR - Regulation & Compliance"
22 février 2017
Base Documentaire : Doctrine
17 février 2017
Blog
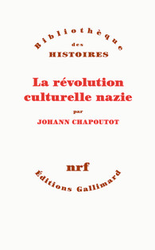
Johann Chapoutot prend le système nazi au sérieux. Non seulement comme machine de destruction des êtres humains, comme machine administrative, comme machine de fascination des êtres humains, amenés à servir ladite machine, mais comme machine intellectuelle à prendre au sérieux.
Prendre au sérieux un système, c'est le comprendre. Ce n’est pas admettre. C’est en souligner l’ossature pour mieux l’identifier, y attacher des marqueurs, pour en reconnaître des traces ici et maintenant.
Oui, il faut s'intéresser au système de pensée nazi (I), continuer de chercher à comprendre le droit nazi (II), admettre la part que les intellectuels ont pris dans la construction d’un système qui a révolutionné la vision intellectuelle du monde en faisant prédominer une nature imaginaire, construction intellectuelle dans laquelle le Droit et les professeurs de droit ont une grande place (III). Ce qui nous permet de se demander, non sans effroi, si nous ne sommes pas aujourd’hui confrontés à une semblable « révolution culturelle », dont nous ne mesurons pas l’ampleur, dont nous ne voulons pas voir l’ossature, et à laquelle éventuellement nous collaborer (IV).
Lire ci-dessous les développements.
31 janvier 2017
Base Documentaire : Doctrine
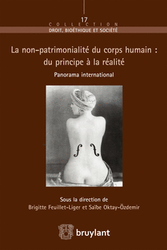
Référence complète : Feuillet-Liger, B. et Oktay-Ozdemir, S. (dir.), La non-patrimonialité du corps humain : du principe à la réalité. Panorama international, coll. "Droit, Bioéthique et Société", n°17, éd. Bruylant, 2017, 418 pages.
Lire une présentation générale de l'ouvrage..
Lire l'article de Marie-Anne Frison-Roche, La GPA, ou comment rendre juridiquement disponible les corps des êtres humains par l’élimination de la question.
31 janvier 2017
Publications
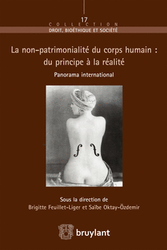
Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La GPA, ou comment rendre juridiquement disponible les corps des êtres humains par l’élimination de la question, in Feuillet-Liger, B. et Oktay-Ozdemir, S. (dir.), La non-patrimonialité du corps humain : du principe à la réalité. Panorama international, coll. "Droit, Bioéthique et Société", n°17, éd. Bruylant, 2017, p. 365-382.
Pour une présentation générale de l'ouvrage.
Lire une présentation détaillée de l'ouvrage.
Ce article s'appuie sur un working paper qui inclut des développements supplémentaires, des références des notes et des liens hypertextes.
Le système juridique a posé sur le principe premier de la dignité de la personne humaine le principe secondaire de l'indisponibilité du corps de celle-ci, puisque disposer du corps humain permet d'une façon transitive de disposer de la personne comme l'on ferait d'une chose. Dans la mesure où le Droit a posé la summa divisio entre la "personne" et les choses comme première protection des personnes, il s'oppose ainsi à la cession des personnes à travers ce qui serait la disponibilité de fait ou de droit de leur corps.
L'engendrement par des femmes fertiles d'un enfant à seule fin de le délivrer à des personnes qui ont conçu le projet de devenir les parents de celui-ci (Gestation pour autrui -GPA) bute sur les deux principes articulés de la dignité des deux personnes que sont la mère et l'enfant et de l'indisponibilité des corps de la femme et de l'enfant. C'est pourquoi les entreprises qui organisent cette industrie qui alimente ce commerce mondial développent un discours juridique visant à désincarner cette pratique non pas tant pour justifier cette mise à disposition des corps des femmes afin de livrer les bébés à ceux qui versent les honoraires aux intermédiaires afin de devenir parents mais plus radicalement pour que la question même de la disponibilité ou de l'indisponibilité des corps impliqués par la pratique de la GPA soit une question qui ne se pose pas.
Il est pourtant nécessaire de rappeler qu'il n'y a GPA qu'appuyée sur une réalité corporelle, celle de la grossesse (I). Pour passer sous silence cet usage du corps de la femme, la GPA est présentée par ceux à qui cela rapporte comme un "don", cette qualification non-patrimoniale de ce qui est cédé, don pur de bonheur, permettant de rendre juridiquement licite l'usage du corps et la cession de l'enfant (II). La filiation est alors promue comme issue de la seule volonté et de la seule affection, qui fait naître l'enfant, l'effacement des corps permettant de mieux en disposer dans un marché mondial hautement profitable. Un Droit qui se scinde ainsi de la réalité corporelle devient proprement délirant.
20 janvier 2017
Base Documentaire : 02. Lois
Référence complète: Loi n°2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
18 janvier 2017
Base Documentaire
Référence complète : Gaudemet, Y., La régulation économique ou la dilution des normes, Revue de droit public, p.23 et s.
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive de Sciences po dans le dossier "MAFR - Régulation"
Dans cet article critique, Yves Gaudemet affirme que le Droit de la Régulation économique illustre le phénomène plus général de la "dilution des normes, phénomène auquel est consacré le dossier ici consacré par la Revue de Droit public au "Désordre normatif".
Il estime que le Droit de la Régulation économique l'illustre en ce qu'il fait subir aux normes une sorte de "dilution".
Cela tient tout d'abord au vocabulaire, où règne ce qu'il qualifie le "désordre des mots", affectant la sécurité juridique. Le "Droit souple" est le moyen d'une "régulation bavarde", faite de proclamations, de recommandations et de lignes directrices.
Le juge devient alors le "régulateur ultime", puisqu'il applique à ce Droit souple un contrôle de proportionnalité.
Les "actes de régulation" eux-mêmes sont dilués entre eux, puisque les Autorités peuvent les utiliser d'une façon alternée, les pouvoirs s'appuyant les uns sur les autres, notamment le pouvoir de sanction, avec une "utilisation indifférenciée par les autorités de régulation des nombreux outils qu'elles ont à leur disposition", le tout s'appuyant le plus souvent sur un pouvoir d'auto-saisine. Par exemple l'auto-saisine pour émettre un avis. Yves Gaudemet cite l'ARCEP qui pour prendre une décision s'appuie sur de futures lignes directrices ....
L'auteur reprend à son compte les reproches formulés en 2010 par le Rapport Dosière-Vaneste sur la production normative excessive des Autorités de Régulation, et le Rapport du Conseil d'État de 2001 sur les AAI qui leur reproche "l’ambiguïté magique" de leur activité.
Yves Gaudemet propose de ramener de ramener le champs de la Régulation dans la "langue du Droit" et de soumettre son contrôle aux "qualifications du Droit".
Dans la seconde partie de l'article, qui confronte la Régulation économique et l'Ordre du Droit, Yves Gaudemet attend de la jurisprudence, ici principalement celle du Conseil d'État qu'elle discipline cette régulation, telle qu'exprimée par les arrêts du 21 mars 2016, Fairwesta et Numericable.
De cette façon là, les Autorités de Régulation deviennent responsable de l'exercice de leur pouvoir normatif d'émettre du Droit souple.
5 janvier 2017
Blog

Le juge a le pouvoir de "qualifier", c'est-à-dire de donner à une situation de fait ou de droit sa nature, quelle que soit les termes qu'ont utilisé les personnes. Cet office du juge est exprimé par l'article 12 du Code de procédure.
Ainsi, les réseaux sociaux utilisent le terme "amis".
Ce terme a des conséquences juridiques très importantes. En effet, en droit les relations amicales supposent par exemple un désintéressement, l'ami travaillant gratuitement au bénéfice de l'autre. Mais déjà la Cour d'appel de Paris à laquelle FaceBook avait raconté cette fable, se présentant comme le constructeur désintéressé uniquement soucieux de permettre aux internautes de nouer des liens d'amitié, avait répondu en février 2016 que le souci premier de cette entreprise florissante était bien plutôt le profit. Comme on le sait, le profit et la gratuité font très bon ménage.
De la même façon, une relation amicale suppose un souci que l'on a de l'autre, une absence de distance, une certaine chaleur. En cela, une relation amicale est toujours partiale.
C'est pourquoi logiquement lorsqu'un avocat fût l'objet d'une procédure disciplinaire devant le conseil de l'ordre, il demanda la récusation de certains de ces confrères siégeant dans la formation de jugement en évoquant le fait qu'ils étaient "amis" sur FaceBook, ce qui entacherait leur impartialité, les instances disciplinaires étant gouvernées par le principe subjectif et objectif d'impartialité.
Par un arrêt du 5 janvier 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, comme la Cour d'appel, refuse de suivre un tel raisonnement.
En effet, celui-ci n'aurait de sens que si en soi les personnes en contact sur un réseau social étaient effectivement des "amis". Mais ils ne le sont pas. Comme le reprend la Cour de cassation dans la motivation de la Cour d'appel, "le terme d’ « ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession".
Ce sont des personnes qui ont des choses en commun, ici une profession, mais cela peut être autre chose, éventuellement un sujet de dispute, même si les études récentes montrent que les personnes se rejoignent plutôt sur des opinions communes.
Mais il ne s'agit tout d'abord que d'un renvoie à une "appréciation souveraine" des faits. Ainsi, si la personne avait apporté la preuve d'une opinion partagée sur le réseau montrant un préjugé - même abstraitement formulé - lui étant défavorable, le résultat aurait été différent. De la même façon, comme cela est souvent le cas, des liens personnels se nouent, par des photos plus personnelles, des échanges plus privés, etc., alors le résultat aurait été différents.
Ainsi, les contacts sur un réseau sociaux ne sont pas en soi des "amis", mais ils peuvent l'être ou le devenir. L'enjeu est donc probatoire. Montrer un lien virtuel n'est pas suffisant, mais c'est une première étape, qui peut mener à la démonstration, qui continue de reposer sur le demandeur à l'instance, d'un lien personnel et désintéressé, ce qui renvoie à la définition juridique de l'amitié, excluant notamment l'impartialité.
5 janvier 2017
Base Documentaire : 02. Cour de cassation
15 décembre 2016
Base Documentaire : Doctrine
Référence complète: Marechal, A. et Legris, B., La composition administrative de l'AMF: un premier bilan très positif, Bulletin Joly Bourse, Décembre 2016, pp. 539-542
Mise à jour : 5 décembre 2016 (Rédaction initiale : 8 septembre 2016 )
Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Droit et confiance. Un rapport difficile, in Universités d'été de la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes et de l'ordre des experts-comptables de la région Paris-Ile de France, Osons la confiance, 8 septembre 2016, Paris.
Consulter les slides ayant servi de base à la conférence.
Regarder la vidéo de la conférence.
Lire la contribution à l'ouvrage La confiance ayant servi de support aux Universités d'été.
2 décembre 2016
Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse et libres propos conclusifs, in Lasserre, V. (dir.), "articulation des normes privées, publiques et internationales", Université du Maine, 2 décembre 2016.
Consulter les slides servant de support à la conférence.
Un article sera publié dans un ouvrage à paraître en 2017.
Le "Droit souple" est l'expression sur laquelle l'on converge désormais, puisque le Conseil d’État l'a voulu... La première question que l'on se pose est de savoir s'il constitue une nouveauté, comme on le dit souvent ou bien s'il ne révèle pas ce qu'a toujours été le Droit, pour ceux qui se souviennent avoir lu avant la publication du Rapport du Conseil d’État un ouvrage dont le titre est Flexible Droit ....
La deuxième question tient dans une présentation du Droit souple soit comme une pure méthode, embrassant dès lors tout le droit et au-delà du droit, ou bien comme un nouveau droit substantiel. Cela mène à une troisième question, car l'on hésite à voir dans le Droit souple un phénomène général et abstrait, ou bien au contraire caractéristique de certains secteurs du droit, principalement le droit du commercial international et le droit financier, là où l’État de fait n'aurait plus guère prise.
Vient alors à l'esprit une troisième question, qui est presque un soupçon : au jeu du Droit souple, qui est gagnant ?
Mise à jour : 30 novembre 2016 (Rédaction initiale : 29 septembre 2016 )
Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Le Droit de la compliance", D.2016, Chron., pp.1871-1874.
____
► Résumé de l'article : les contraintes pesant sur les entreprises au titre de la compliance se multiplient et s'alourdissent. Mais la notion est contradictoire, incertaine, "étrange", l'expression de "conformité" n'étant qu'une translation.
La compliance apparaît aujourd'hui comme l'internalisation mondiale d'une régulation publique, souvent conçue aux États-Unis, dans les entreprises, transformées en agents d'effectivité de buts mondiaux monumentaux : équité concurrentielle, lutte contre le terrorisme ou des États jugés indignes (embargos).
Plutôt que d'emprunter des solutions éparses, il est essentiel de construire un "Droit de la compliance", proprement européen, à l'aune duquel chacun devra rendre compte. Cette nouvelle branche du Droit est construite téléologiquement sur ses Buts Monumentaux. Elle est portée par les entreprises cruciales. Le Juge y est au centre.
____
____
🚧lire le document de travail sur la base duquel l'article a été rédigé.
____
Lire la présentation du cycle de conférences organisé par le Journal of Regulation & Compliance (JoRC) en 2016 autour de la Compliance.
L'ouvrage en résultant, Régulation, Supervision, Compliance a été publié dans la série Régulations & Compliance co-éditée par le JoRC et les Editions Dalloz.
________
28 novembre 2016
Base Documentaire : Doctrine
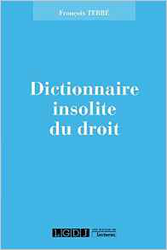
Référence complète : Terré, F., Dictionnaire insolite du droit, LGDJ-Lextenso, 2016, 169 p.
22 novembre 2016
Base Documentaire : Jurisprudence
Référence complète: Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 22 novembre 2016, BLCM, 15-11.063
16 novembre 2016
Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : Teubner, G., Fragments constitutionnels. Le constitutionnalisme sociétal à l'ère de la globalisation, traduction et préface d'Isabelle Aubert, coll. "Bibliothèque de la pensée juridique", Classique Garnier, 2016, 326 pages.
____
____
► Lire la préface d'Isabelle Aubert
________
29 octobre 2016
Blog

Le Parlement décide. Par principe.
Depuis le Code civil, il a posé que le corps humain fait partie des "choses hors commerce" (article 1128 ancien du Code civil). Depuis les lois de bioéthique de 1994, il a posé que les conventions de gestation pour autrui sont atteintes de nullité absolue (article 16-7 du Code civil).
Il peut changer la règle et poser que les femmes peuvent convenir d'engendrer des enfants à fin de les céder à des personnes qui ont le projet de faire venir au monde des enfants qui leur soient rattachés par un lien de filiation. A supposer que la Constitution supporte une telle disponibilité du corps de la mère et de l'enfant, le Législateur peut le décider. On peut se demander si la Constitution ne l'exclut pas, puisque la décision du Conseil constitution du 17 mai 2013 sur la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe a inscrit une "réserve de constitutionnalité" à ce propos, liant le pouvoir législatif. Mais cette question de hiérarchie des normes n'est pas ici le sujet.
Le sujet de cet article est celui-ci : si le Parlement français veut renverser le principe de prohibition de la GPA, qu'il le fasse. Certains le lui demandent. Par exemple Monsieur et Madame Mennesson, à travers leur association CLARA, pour la légalisation de la GPA en France. Pourquoi pas. L'on peut être adepte de la loi de l'offre et de la demande, estimer que chacun peut avoir intérêt à satisfaire son "désir", désir d'enfant d'un côté, désir de compensation financière de l'autre, les intermédiaires (agences, médecins, avocats) étant rémunérés pour cela, les juges étant là pour éviter les "dérives". Pourquoi pas.
Mais il faut que le Parlement assume. Qu'il dise que la prohibition actuelle que la législation français exprime est rétrograde, archaïque, etc., et qu'il faut la renverser.Qu'il le dise. Qu'un projet de loi, ou qu'une proposition de loi, soit déposé proposant la réforme de l'article 16-7 du Code civil, son abrogation ou sa réécriture, par exemple pour l'adoption d'une "GPA éthique", sur le modèle britannique.
Or, ce n'est pas du tout ce qui arrive. Ce qui vient d'être déposé le 11 octobre au Sénat est une "proposition autorisation la transcription à l'état civil français des actes de naissance des enfants nés à l'étranger du fait d'une gestation pour autrui.
Pourquoi un tel objet ?
- En premier lieu pour ne pas heurter le Parlement lui-même qui dirait NON si on lui demande plus ouvertement de ne plus protéger les femmes et les enfants en admettant la licéité de la GPA. L'idée est donc d'obtenir une légalisation de fait à travers l'efficacité - sans aucune entrave - de toutes les GPA réalisées à l'étranger.
- En deuxième lieu, pour ne pas heurter le Conseil constitutionnel qui confronté à une question d'état civil pourra peut-être ne pas retrouver les termes de la réserve de constitutionnalité qu'il avait insérée et laissera peut-être passer la loi, ce qui permettrait dans un second temps de faire passer l'insertion de la GPA par une admission plus visible dans une loi ultérieure.
- En troisième lieu, pour briser la jurisprudence européenne et française. En effet, la proposition est très habilement rédigée. Elle se présente comme la conséquence de l'arrêt de section de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH) du 26 juin 2014, Mennesson (la même personne que le mandataire de l'association militant pour la légalisation de la GPA en France). Mais cet arrêt n'admet que la reconnaissance en droit national de la filiation entre l'enfant et le "père biologique". Or, la proposition évacue cette condition et vise à obliger à une "transcription automatique" tout lien de filiation entre l'enfant et tout "parent", c'est-à-dire tout "parent d'intention", ce qui brise à la fois la jurisprudence de la CEDH et la jurisprudence de la Cour de cassation qui a suivi (Ass. Plén., 3 juillet 2015). Mais cela, les sénateurs auteurs de la proposition ne gardent de l'écrire....
- Cette proposition de loi vise à briser la jurisprudence européenne et française pour installer carrément le système juridique de l’État de Californie, qui est purement et simplement la loi du marché.
- En quatrième lieu, la proposition de loi est émise pour participer à la technique d'encerclement des tribunaux français, alors que la Cour de cassation doit rendre un arrêt sur le statut des "parents d'intention", qui est le sujet majeur pour l'industrie de la GPA. Les quelques sénateurs qui ont fait cette proposition de loi si complaisantes le 11 octobre 2016 le font au même moment que l'Organisation Mondiale de la Santé change sa définition de l'infertilité, qui cesserait d'être un fait physique et biologique pour devenir un fait social, ce qui conduit à la notion de ... "parent d'intention".
Ainsi, le Parlement, parce qu'il est Parlement, serait légitime à changer la règle et à affirmer que désormais la GPA est admis en France, dès l'instant qu'il affronte et le contrôle de la constitutionnalité d'une telle affirmation et qu'il assume la portée politique d'une telle affirmation qui met au plus offrant les femmes et les enfants.
Parce que les pro-GPA savent que le Parlement ne le fera pas et qu'ils trouvent tout de même quelques sénateurs pour les aider, voilà ce que cela produit : une proposition de loi qui apporte quelques petits pavés vers ce qui devrait êtrela route vers la mise en place de l'industrie de l'humain qu'est la GPA. Sans que le Parlement ne s'en aperçoive vraiment et avec ici la collaboration de quelques parlementaires.
Lire ci-dessous une analyse développée.
24 octobre 2016
Blog
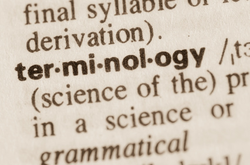
Les pro-GPA savent qu'ils ne doivent pas affronter les Parlements et l'opinion publique d'une façon frontale.
C'est pourquoi ils obtiennent le changement d'autres mots pour obtenir un "effet de ricochet". Ici changer ce que veut dire "l'infertilité" pour imposer la GPA commerciale : un fois que le sens du mot "infertilité" est changé (ce qui passe inaperçu), alors par un effet de ricochet, l'on ne pourrait refuser la GPA. Sans que les entreprises aient à obtenir une loi en bonne et due forme. Juste en invoquant devant les tribunaux nationaux le "standard international" glissé précédemment dans le "droit global".
L'admission de la GPA, les entreprises ne la demandent pas aux Parlements qui la refuseraient. Ils l'obtiennent en Soft Law, via l'Organisation Mondiale de la Santé, pour obtenir un seconde "effet ricochet". Car une fois que l'OMS a formulé un "droit individuel à se reproduire", alors l'effet de contrainte vient dans un second temps. Sans que les entreprises aient à intervenir dans ce second temps. Juste en rappelant le "standard international" glissé précédemment dans le "droit global".
Où l'on mesure que dans les techniques de stratégie, l'essentiel est de choisir son moment : le plus en amont possible, le plus doucement possible. Glisser un noeud coulant et attendre que les Etats ne soient plus en position pour défendre les femmes et les enfants, ne se réveillant que lorsqu'un "droit individuel à se reproduire" aura été mis en place. En affirmant que celui-ci aurait une force obligatoire supérieur à de simples systèmes juridiques nationaux.
En effet, dans la stratégie d'encerclement mise en place depuis plusieurs années par les entreprises qui ont pour but d'installer l'industrie de fabrication massive d'enfants pour les délivrer à ceux qui les ont commandés, le Droit est utilisé afin de détruire la prohibition de vente des êtres humains.
Pour cela, dans cette "façon douce" de faire, la sophistique visant avant tout à reconstruire les définitions pour que cette réalité de la GPA consistant à transformer des êtres humains en choses vendues - les mères et leurs enfants, l'enjeu est de détruire toute référence au corps de la femme.
Pour cela, il faut détruire la définition de "l'infertilité". Les lobbies pro-GPA viennent de l'obtenir de la part de l'Organisation Mondiale de la Santé. La presse britannique le relate.
Il n'est surtout pas fait de bruit autour de ce mouvement de changement de définition, ni dans le fait qu'il prend place dans cette enceinte non juridique qu'est l'Organisation Mondiale de la Santé.
En effet, il s'agit de préparer deux "effets retard", ayant vocation à contraindre dans un second temps les juridictions et les Parlements nationales.
Dans le but d'imposer la GPA, dans un second temps mais en liant dés à présent les systèmes juridiques nationale, la définition médicale de l'infertilité n'est plus ... médicale et tient désormais dans le fait que ... l'on n'a pas d'enfant et que l'on désire en avoir (I).
Dans le but d'imposer la GPA, les inventeurs de cette définition soulève que cette définition nouvelle constitue un "standard international" qui sera - plus tard - envoyé aux États qui devront en tirer toutes conséquences dans leurs systèmes juridiques (II). Or, les mêmes auteurs estime que cette définition est liée à ce qu'ils qualifient expressément comme "le droit pour chacun d'avoir des enfants". C'est-à-dire de bénéficier d'une GPA.
Voilà comment les entreprises qui entendent installer sans contrainte le marché mondial de la GPA procèdent en toute discrétion et, l'année prochaine, se prévaudront de "normes internationales scientifiques" qui leur seraient extérieures, sans avoir jamais affronter elles-mêmes les forces politiques des pays dans lesquelles elles veulent implanter leur industrie si profitable.
Face à ces manœuvres si bien conçues et auxquelles les experts venues du monde médical et juridique se prêtent, il faut dire NON.
En effet, ce ne sont pas les médecins qui font la loi. Et encore moins la soft law qui peut renverser la prohibition de la marchandisation des femmes et des enfants. Même en douceur.
Lire l'analyse détaillée ci-dessous.
11 octobre 2016
Base Documentaire
Référence complète : Martineau-Bourgnineaud, V., La légalisation de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) au service du dialogue social : idéologie ou utopie ? , Petites Affiches, 11 octobre 2016, p.6-11.
L'auteur relève que l'expression de "responsabilité sociale de l'entreprise" est peu définie. La Commission Européenne y voit la "responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société", les salariés faisant partie de ses "parties prenantes", et la norme ISO 26000 de 2010 sur la gouvernance intégrant les relations de travail.
La RSE a pénétré le Droit par la loi de 2001 sur les "nouvelles régulations économiques", tandis que la loi de 2010 réformant le droit des sociétés cotées et important le principe "appliquer ou expliquer" oblige à inclure dans le rapport annuel de gestion des données sociales et environnementales. En cela ce rapport RSE promeut le dialogue social.
L'auteur pose donc que "cette nouvelle idéologie" est entrée dans le Droit.
Cette "consécration d'une idéologie" consiste à "créer un cadre réglementaire qui place l'homme au cœur des préoccupations de l'entreprise", en changeant pour cela sa gouvernance. En obligeant à la diversité dans les conseils d'administration, notamment leur féminisation et la présence des salariés. Le dialogue social prend la forme aussi de la participation des institutions représentatives du personnel dans le "reporting social et environnemental" et leur participation sur la stratégie de l'entreprise, puisque les discussions à ce propos prennent pour base les reportings précités. On constate cependant que les comités d'entreprise sont peu associés.
C'est sans doute pour cela que l'auteur considère que la RSE comme dialogue social relève plutôt d'une "utopie"...
Le dialogue social participe pourtant de la performance économique de l'entreprise et la loi dite Rebsamen du 17 août 2015 s'en prévaut, la loi du 8 août 2016, dite El Khomri inclut dans la "base de données économiques et sociales" et le taux de féminisation des conseils d'administration et le nombre d'accords collectifs.
Mais l'auteur estime qu'à mettre dans le dialogue social des éléments qui n'en relèvent pas - comme l'environnement ou le sociétal - on affaiblit le dialogue social.
L'auteur conclut son article d'une façon très critique en ces termes :
"La RSE à l'épreuve du droit nus enseigne que l'élément matériel de la RSE, les obligations légales (reporting, diversité des conseils d'administration, régle complain or explain...), et l'élément psychologique, son caractère volontaire impulsé par les dirigeants de l'entreprise sont indissociables. Alors que la RSE entend mettre l'humain au coeur des préoccupations de l'entreprise, on constate qu'il y a complète dissociation entre le discours affiché et la réalité économique et sociale. ..... cette RSE légalisée devient un instrument sophistique au service de ce but exclusif en permettant aux entreprises de se draper de vertus dans le but d'acheter la paix sociale, les conflits sociaux étant l'ennemi juré de la productivité.".
Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article en accédant via le drive au dossier "MAFR - Régulation"