Interviews
13 juin 2013
Interviews

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L'État ne peut démettre seul le président d'Orange, Les Échos, p. 5, 13 juin 2013.
3 septembre 2012
Interviews
16 mai 2012
Interviews
4 mai 2012
Interviews
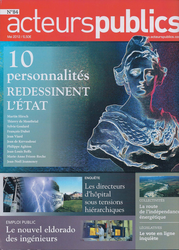
Accéder à la réaction de Marie-Anne Frison-Roche à l’article de Thierry de Montbrial dans le même numéro, p. 36.
Lire le résumé de l'interview ci-dessous.
16 mai 2011
Interviews
1 mars 2011
Interviews

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Avocats : La gouvernance en question", Journal des Bâtonniers, n°9, nov.-déc.janv. 2010-2011, p.12-13.
___
► présentation de l'entretien : Cet entretien porte sur l’organisation présente et future des ordres d’avocats. Après avoir défini leur rôle de gouvernance et de régulation de la profession, est examiné le rapport de l’avocat au marché et la conséquence de l’Ordre défini comme garant d’une crédibilité professionnelle, basée sur une déontologie, qui assoit la confiance, valeur première sur un marché. Sont ensuite examinés les débats actuels de dimension des ordres, de mutualisation des moyens, etc.
L’entretien est l’occasion de définir la gouvernance en tant que celle-ci est un ensemble de procédés qui aboutit à l’expression d’une adhésion à la règle de la part de celui à qui celle-ci s’applique. En cela, la gouvernance, par rapport à l’organisation hiérarchique, ne se manifeste pas par la puissance mais par l’adhésion à des valeurs communes. L’organisation d’une profession par des Ordres doit en être le reflet.
Cela ne veut pas dire que ce type d’organisation professionnelle est antinomique du marché. En effet, le marché par nature est un espace risqué. Il en résulte que la confiance y est une valeur rare, que les agents économiques achètent. La confiance que l’avocat peut provoquer notamment grâce à la déontologie est ainsi une valeur de marché. Les Ordres en sont les garants.
Dès lors, il importe peu l’ancienneté ou non des institutions : l’essentiel est d’émettre des normes de comportements dans lesquels d’une part les avocats se reconnaissent et donc adhèrent et d’autre part dans lesquels les tiers accordent confiance. La discipline construit la crédibilité de l’ensemble.
Pour bien ajuster les ordres à leur mission, question d’actualité, il faut reconstituer des causalités. Ainsi, si la dimension trop restreinte des périmètres des barreaux est à l’origine de la difficulté de formation, la solution est éventuellement dans la mutualisation des moyens de formation et le recours à de nouvelles technologies. Mais si la cause est bien plutôt le décalage entre ce qui est appris et ce qui est nécessaire à l’exercice de la profession, la question de la dimension des Ecoles et de leurs moyens perd de sa pertinence.
De la même façon, sur la question cruciale du maintien des ordres locaux, il faut d’abord déterminer si l’on rattache un barreau à une juridiction, dans une conception de la profession liée au juridictionnel, ce qui conduit à choisir entre tribunal et Cour d’appel ou si l’on conçoit la profession davantage comme une activité économique, ce qui conduit à rattaché les périmètres des Ordres à des notions comme la ville ou de bassin d’activités.
Il est possible que la diversité des organes représentatifs, notamment Conférence des Bâtonniers et CNB, soit le reflet de cette diversité d’approche, toutes deux légitimes, justifiant la superposition à première vue irrationnelle, des structures professionnelles.
Pour conclure, l’on pourrait dire, dans un monde où les frontières s’effacent et les réseaux se développent, que les professions doivent plus que jamais être la colonne vertébrale des sociétés et des marchés. Les professions elles-mêmes doivent être gouvernées de l’intérieur, car pour les réguler il faut les connaitre et que le professionnel adhère à qui les gouverne, mais d’une façon crédible pour l’extérieur. L’enjeu essentiel, en lui-même et pour les marchés et les agents économiques qui ont recours aux avocats, c’est le crédit qu’ils peuvent faire à la déontologie spécifique et effective de ceux-ci. En cela, les ordres sont les gardiens de l’identité de l’avocat, qui est sur le marché sur le marché sans être un commerçant.
______
28 février 2011
Interviews

Référence complète : La gouvernance en question, Journal des Bâtonniers, n°9 novembre-décembre-janvier 2010-2011, p. 12-13.
Cet entretien porte sur l’organisation présente et future des ordres d’avocats. Après avoir défini leur rôle de gouvernance et de régulation de la profession, est examiné le rapport de l’avocat au marché et la conséquence de l’Ordre défini comme garant d’une crédibilité professionnelle, basée sur une déontologie, qui assoit la confiance, valeur première sur un marché. Sont ensuite examinés les débats actuels de dimension des ordres, de mutualisation des moyens, etc.
Accéder à une présentation plus générale.
Lire une présentation plus détaillée ci-dessous.
22 novembre 2010
Interviews

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, «"Entretien autour de l'ouvrage Droits et libertés fondamentaux" , entretien avec Monique Canto, France Culture, Emission Questions d'éthique, 22 novembre 2010.
___
► Présentation synthétique de l'entretien : L'entretien aborde tout d'abord la définition même des libertés et droits fondamentaux, son évolution et sa diversité. Il montre que leur montée en puissance a été contestée, notamment parce qu’en réalité, faute de moyens, ils seraient vides, mais la critique tombe si l’on pose que ces droits ne visent que les droits essentiels. En outre, le souci des libertés et droits fondamentaux met ceux-ci au cœur du système juridique et par cela le juge. Celui-ci prend plus particulièrement la forme du juge constitutionnel. La montée en puissance du juge est donc corrélative. En ce qui concerne les droits eux-mêmes, ils croisent la notion de dignité, qui trouve un équilibre difficile avec la protection que la liberté assure à la volonté des personnes. De cela aussi, le droit est familier, puisqu’il met sans cesse en balance les contraires. Mais, parce que le juge est au cœur de tout, le droit le plus fondamental est celui d’accéder à un tribunal impartial et d’obtenir de lui un jugement exécuté.
► Présentation de la discussion:
Monique Canto-Sperber débute l’entretien à propos de la définition même des libertés et droits fondamentaux, car les libertés publiques ne sont pas une notion nouvelle et l’on en retrouve l’idée notamment dans la philosophie des Lumières.
Marie-Anne Frison-Roche insiste sur le fait que la notion de droits fondamentaux est elle plus contraignante en ce qu’il s’agit non plus de possibilité d’action d’un individu dans un espace public ouvert, mais de prérogatives effectives établissant un lien de créance, dont le débiteur sera le plus souvent l’Etat.
La discussion s’engage alors sur l’effectivité de ces droits car la puissance publique ne peut pas tout et la critique des droits fondamentaux leur reproche de ce fait d’être vide. Marie-Anne Frison-Roche répond que les droits fondamentaux sont essentiels en tant qu’ils sont "de base", c’est-à-dire qu’ils visent ce qui est nécessaire à la vie, biologique et sociale, notamment par le rattachement à la notion de vie décente. La question de niveau de protection est ensuite de nature politique et dépend du prix que le groupe social accepte pour satisfaire tel ou tel niveau d’effectivité du droit à la santé, du droit à l’éducation, etc. En outre, les droits fondamentaux, parce qu’ils ne dépendent pas de la seule volonté d’action de l’homme libre, supposent une concrétisation, plus problématique et pourtant plus essentielle. C’est au juge que revient cette tâche, à travers le devoir de l’Etat d’offrir une protection juridictionnel, devoir qu’exprime le fondamental article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789. En cela, le juge est lui-aussi au cœur du système et monte en puissance. Les deux sont liés. Ainsi, la jurisprudence récente sur la garde à vue montre que le Conseil constitutionnel est le maître de l’évolution des principes procéduraux.
Ainsi, l’insertion dans notre système juridique de la question prioritaire de constitutionnalité confie au Conseil constitutionnel le soin de formuler des libertés et droits fondamentaux, d’en être le garant stable, face à un législateur de plus en plus vibrionnant. Par l’intervention de plus en plus forte du juge, les droits fondamentaux changent : ils sont de moins en moins formels, ils se concrétisent. Ainsi, la question du corps humain, généralement occultée par le droit, apparaît et pose la question très difficile de la définition de la dignité.
Monique Canto-Sperber se demande comment définir la dignité et qui doit le faire, notamment n’est-ce pas la personne elle-même qui doit définir ce qui atteint ou non sa propre dignité, notamment en raison de son état de santé ?
Marie-Anne Frison-Roche, reprenant les diverses jurisprudences sur la question, celle du "lancer de nain" ou celle de l’exposition Our Body , montre que la volonté n’a pas de prise sur la dignité. L’entretien s’achève sur le constat que par une évolution très forte, le droit français a été bouleversé par les libertés et droits fondamentaux, qui sont au cœur du système juridique et sont en train de faire des juges constitutionnels une Cour suprême, sur le modèle nord-américain.
_________
25 août 2010
Interviews
4 décembre 2009
Interviews

Référence complète : La cinquième édition du concours d'arbitrage est lancée !, Interview de Frison-Roche M-A., et Wehrli Y., par Olivia Dufour, Petites affiches, n°242, 4 décembre 2009, p. 3-6.
Cette interview a été faite à propos du concours international d'arbitrage de Paris créé à l'initiative de Marie-Anne Frison-Roche en 2005 dans la Chaire Régulation de Sciences po.
Depuis, l'origine de ce concours d'arbitrage international simulé se tient chaque année et co-organisé avec le soutien d'entreprises internationale, par exemple TOTAL (partenaire de la Chaire Régulation) ou le cabinet Clifford.
C'est pourquoi, en décembre 2009 Marie-Année Frison-Roche directeur de la Chaire Régulation et Yves Wehrli managing partner du cabinet Clifford ont répondu à la presse juridique pour présenter l'édition du concours qui s'est déroulé en 2010.
30 mai 2007
Interviews
Référence complète : Marie-Anne Frison-Roche ou la passion de penser le droit, in Les Petites Affiches, mai 2007, n°108, pp. 3 à 5.
15 décembre 2005
Interviews

Référence complète : Canivet, G. et Frison-Roche, M.-A., Faire coïncider les visions économique et judiciaire, Banque et Droit, déc.2005, p.46-48.
Cet interview fût donné à l'occasion du cycle de conférences conçu par la Chaire Régulation de Sciences po, dirigée par Marie-Anne Frison-Roche, et la Cour de cassation, dirigée par Guy Cassation :Droit, économie, justice et secteur bancaire.
En 2006, un ouvrage, Les banques entre Droit et Économie, a été publié dans la collection "Droit et Économie"
24 février 2005
Interviews
► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, «"Entretien sur le pouvoir de transaction pour l’Autorité des Marchés Financiers", Petites Affiches du 24 février 2005, pp.4-5., interview réalisée par Olivia Dufour pour Les Petites Affiches, Lextenso, 24 février 2005, pp.4-5.
___
► lire l'entretien : 💬 Lire l'interview
____
► Questions posées par Les Petites Affiches et Résumés des réponses apportées par MAFR
Q. D
Résumé de la réponse de MAFR : El
Q. D
Résumé de la réponse de MAFR : El
Q. D
Résumé de la réponse de MAFR : El
_________
13 avril 2001
Interviews
Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, "La loi sur les Nouvelles Régulations Économiques", D.2001, Interview, pp.1930-1933.
28 septembre 2000
Interviews

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., "Les États-Unis n'imposeront pas leur droit à la planète entière", entretien mené par Bruna Basini et Laurence Ville, L'Expansion, n°629, septembre 2000, pp.161-164.

