Les fiches récentes
9 mars 2020
droit illustré

Joachim du Bellay offre ce poème, qui est demeuré célèbre en ce qu'il exprime dans le style de la plainte l'expression de l'amour nostalgique d'un pays perdu.
Mais si l'on s'attachait ici à la mention dans son premier vers, qui fait son titre : "France, mère ... des lois" ?
L'on s'aperçoit alors que la mention en est faite en frontispice du poème pour ne plus jamais apparaître.
Qu'en est-ce de cet sorte d'hommage implicite, effanescent ?
I. LE POEME OFFERT A LA FRANCE, MERE DES LOIS
France, mère des arts, des armes et des lois
France, mère des arts, des armes et des lois,
Tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle :
Ores, comme un agneau qui sa nourrice appelle,
Je remplis de ton nom les antres et les bois.
Si tu m'as pour enfant avoué quelquefois,
Que ne me réponds-tu maintenant, ô cruelle ?
France, France, réponds à ma triste querelle.
Mais nul, sinon Écho, ne répond à ma voix.
Entre les loups cruels j'erre parmi la plaine,
Je sens venir l'hiver, de qui la froide haleine
D'une tremblante horreur fait hérisser ma peau.
Las, tes autres agneaux n'ont faute de pâture,
Ils ne craignent le loup, le vent ni la froidure :
Si ne suis-je pourtant le pire du troupeau.
II. UNE MENTION SUFFIT-ELLE A HONORER LE PAYS LEGISLATEUR ?
ss
5 mars 2020
Conférences

Référence : Frison-Roche, M.-A., La mesure de l'effectivité et de l'efficacité des outils de la compliance (conception, présentation et modération des débats), in Les outils de la Compliance, Journal of Regulation & Compliance.
Voir les autres thèmes, autres dates et autres manifestations particulières du cycle dans son ensemble.
Cette conférence sert d'appui à la réalisation d'un ouvrage plus global portant d'une façon générale sur Les outils de la Compliance.
L'ouvrage Compliance Tools sera publié en même temps.
Présentation de la Conférence : Après avoir examiné différents outils spécifiques, comme La cartographie des risques ou Les incitations, et avant d'en aborder d'autres comme ceux relevant de la a Compliance by Design, celle-ci méritant aussi d'être examinée avec quelque distance dans sa prétention à être la solution à tout enjeu de compliance, il convient de regarder comment l'on mesure l'efficacité de tous ces outils de Compliance. En effet, puisque toutes les techniques sont des "outils", ils ne prennent sens qu'au regard d'une finalité qu'ils doivent atteindre effectivement. Cette effectivité doit être mesurée, et cela dès l'Ex Ante, l'entreprise devant en permanence donner à voir l'effectivité de la performance des outils de la Compliance.
Mais autant les normes prolifèrent, les discours se multiplient, les engagements sont pris, autant les techniques de mesure de l'effectivité de l'ensemble semblent assez faibles. Non pas que les sujets de droit astreints aux obligations de Compliance ou désireux de réaliser les buts systémiques ou de bien commun visés par la Compliance ne désirent pas en avoir, mais ces instruments de mesure semblent encore les moins construits, souvent déclaratifs ou de type discursifs, ou trop mécaniques. Dès lors, est-ce en partant du but que l'on cherche à atteindre que l'on doit mesurer l'efficacité des outils de Compliance, sans que cela transforme les tâches qui pèsent de grè ou de force sur les opérateurs en obligation de résultat ? Ou est-ce en demeurant en amont, par une seule "conformité" à ce qui leur est demandé, comme comportement et comme organisation structurelle, que les entreprises donnent à voir qu'elles ont effectivement rempli leur tâche, sans plus se soucier des effets produits sur la réalité des choses, cette réalité que ceux qui ont conçu la norme avaient en tête ?
Cette question a des implications majeure en terme de charge de preuve et de responsabilité, impliquant des organisations plaçant la confiance, coeur de la Compliance, plutôt dans des instruments technologiques connectant des data ou plutôt dans des personnes ayant le sens du bien commun. Cette question est aujourd'hui ouverte.
_____
4 mars 2020
Enseignements : Droits sectoriels de la régulation, semestre de printemps 2018

Le droit sectoriel de la régulation énergétique constitue un monde en soi, alors même que l'économie générale et la vie sociale ne peuvent pas fonctionner sans l'énergie, laquelle est elle-même très multiple et que l'énergie est en points de contact, voire en intimité, avec le Politique. Il en résulte la nécessité d'assimiler de nombreuses règles d'intelligibilité qui interférent en même temps et qui varient.
Il convient de voir plus longuement ces règles d'intelligibilité, de voir les questions ouvertes, car il est faux de qualifier ce secteur de "mature" (ce que l'on faisait il y a 10 ans), puis de prendre une décision de justice pour s'exercer au commentaire.
Pour comprendre ce droit sectoriel, qui est le reflet de la complexité technique de celui-ci et des enjeux politiques, il faut y retrouver la trace de la variété des moyens et des usages énergétiques, l'électricité ayant toujours une place particulière notamment par son lien avec le nucléaire. La construction d'un Droit européen de l'énergie paraît impossible en raison des liens de celle-ci avec le Politique, alors même que les liens tout aussi fort que l’Énergie a avec l'environnement appelle une telle construction. La Loi du 17 août 2015 sur la "transition énergétique" cherche à trouver une voie médiane.
Une fois cela fait, apparaissent un certain nombre de questions ouvertes, notamment :
- Faut-il souhaiter plus de principe concurrentiel dans le secteur énergétique ?
- Entre Régulation énergétique et Régulation environnementale, où est le nucléaire ?
- Pourquoi des Golden Shares dans les entreprises énergétiques "nationales" ?
- L'avenir de la Régulation énergétique est-il dans le numérique ,
Cela permet enfin de déboucher sur l'étude d'une question technique :
Renégociation de l'Accès au tarif de l'Energie Nucléaire
Commentez l'arrêt du Conseil d’État du 20 mars 2013, Association "Robin des Toits"
____
Accéder aux slides servant de base à la leçon.
Consulter la bibliographie générale du Droit commun de la Régulation
Consulter le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance
15 février 2020
Interviews

Lire la Présentation faite par France Culture de Guillaume Dustan et de l'émission qui lui est consacrée.
Ecouter l'émission.
Revenir sur le Colloque précédemment consacré à Guillaume Dustan.
Lire le Document de travail de préparation.
12 février 2020
Enseignements : Droit de la Régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2020
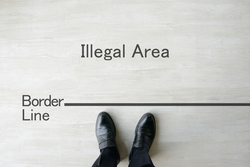
Résumé de la leçon : Dans une conception classique et du Droit et du "libre marché", le principe est la liberté d'action de la personne. Même si l'exercice de cette liberté, voire d'un droit subjectif peut causer un dommage, par exemple un dommage concurrentiel, c'est en quelque sorte le prix légitime d'une société libre et concurrentielle. Ainsi dans une conception libérale, seul l'abus est sanctionné, c'est-à-dire l'exercice fautif que l'on fait de sa liberté ou de son droit, allant parfois jusqu'à l'exigence d'une faute qualifiée.
Mais les secteurs bancaires et financiers ne sont pas gouvernés par le principe de libre concurrence. Ils sont gouvernés par le principe de régulation, le principe de concurrence n'y a qu'un rôle adjacent. Cela ne pourra qu'engendrer de graves difficultés lorsque le Droit de la concurrence et le Droit bancaire et financier font s'appliquer d'une façon cumulée ou confrontée sur une même situation.
Les marchés financiers sont construits sur le principe de régulation qui pose le principe de transparence et de partage d'une information exacte : c'est ainsi que l'intégrité des marchés financiers est assurée, l'Autorité des Marchés financiers en étant le gardien.
La prévention et la sanction des "abus" de marché est donc non pas une part résiduelle du Droit financier, mais un pilier de celui-ci, contrairement au Droit des marchés ordinaires concurrentiels, sur lesquels l'opacité et le non-partage des informations est la règle.
Cela explique l'état du droit des "abus de marché", dont l'effectivité de la prohibition est essentielle pour le bon fonctionnement ordinaire des marchés financiers. Leur prohibition nationale a été harmonisée par le Droit de l'Union européenne, à travers des textes dont les signes reprennent l'appellation anglaise : Market abuses (ainsi le nouveau Règlement communautaire sur les abus de marché est dit Règlement MAR (Market Abuses Regulation) et la directive qui l'accompagne MAD (Market Abuses Directive) .
Il sanctionne un certain nombre de comportements, qui portent atteinte à l'intégrité des marchés,
Mais il n'exprime plus des exceptions par rapport à un principe : des fautes par rapport à des libertés ou à des droits. Il exprime des moyens par rapport à des principes dont la sanction des abus ne constitue que la concrétisation de principes dont ils sont la continuité même : l'efficacité du marché, son intégrité, sa transparence, l'information de l'investisseur.
C'est pourquoi la sanction des abus de marché ne sont pas du tout un phénomène périphérique par rapport à la Régulation des marchés financiers et à l'activité et au fonctionnement des bancaires, comme l'est le Droit pénal : elle est au contraire à la fois ordinaire et centrale. Cette différence des deux ordres publics va se retrouver dans la question lancinante de la sanction pénale et de la sanction administrative des mêmes abus de marché (par exemple "manquement d'initié" et "délit d'initié", qui ont tendance à se cumuler dans des techniques de répression qui seront l'objet de la prochaine leçon.
_____
Accéder aux slides servant de support à la leçon sur les abus de marché.
Revenir aux bases avec le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.
Documentation de base, spécifique à la leçon
Doctrine
- Barrière, F., La cybercriminalité boursière, 2020,
- Boursier, M.-E., L’irrésistible ascension du whistleblowing en droit financier s’étend aux abus de marché , 2016,
- Conac, P.-H., La loi du 21 juin 2016 réformant le système de répression des abus de marché , 2016,
- Frison-Roche, M.-A., L'impossibilité d'unicité juridique de la catégorie des lanceurs d'alerte, 2020,
- Frison-Roche, M.-A., Vers une conformité au droit européen, in "Conformité, Entre prévention et sanction", 2015.
Textes
- Règlement de l'Union Européenne sur les Abus de Marché , 2014 (entré en application le 3 juillet 2016)
- Loi du 21 juin 2016 réformant le système de sanction des abus de marché
- Article 465-1 du Code Monétaire et Financier
- Soft Law
- Autorité des marchés financiers, La cybercriminalité boursière, 2019
- CEDH, 4 mars 2014, Grande Steven c/ Italie,
- Conseil const., 18 mars 2015, EADS,
- Cour d'appel de Paris, 7 mars 2000, KPMG,
- C.E., 20 juin 2016, Société Bryan A. c/ AMF
- AMF, 25 avril 2019, Iliad
- AMF, 11 décembre 2019, Bloomberg
- AMF, 4 décembre 2019, Morgan Stanley
- France Culture, La dimension criminelle des crises, 7 février 2018
______________
Approfondir par la Bibliographie générale du Droit de la Régulation bancaire et financière
Revenir à la présentation générale du Cours.

4 février 2020
Organisation de manifestations scientifiques

Le cycle de conférence Les outils de la Compliance a débuté en novembre 2019 et se déroule jusqu'en juin 2020. Il est organisé par The Journal of Regulation & Compliance et toutes ses Universités partenaires. Il comprend une conférence plus particulièrement consacrée au thème de "La prégnance géographique dans le choix et l'usage des outils de la Compliance".
Conférence – Débat
Mardi 4 février 2020, 16h30– 19h30
à la Faculté de droit et de science politique,
Avenue du Doyen Louis Trotabas, 06050 Nice Cedex.
Amphithéâtre Bonnecarrère, Villa Passiflore,
Présentation du thème :
La compliance est un phénomène mondial. En cela, elle illustre la problématique d’un droit global. Il ne faut cependant pas en déduire que la compliance est appliquée de la même manière partout dans le monde. Comme toute institution juridique, elle est intégrée à un cadre juridique préexistant, façonné par la culture et l’histoire.
L’objectif du colloque est d’explorer la prégnance géographique dans les outils de la compliance, c’est-à-dire la manière potentiellement différente dont ces outils sont choisis et utilisés selon la zone géographique concernée. Les trois espaces géographiques étudiés seront principalement l’Europe, les Etats-Unis et l’Afrique. Occasion sera ainsi donnée de mettre en valeur les convergences et les divergences dans la mise en œuvre des outils de la compliance dans une vision géographique de l’institution.
Sous la direction scientifique de Jean-Baptiste Racine, professeur à l'Université Côté d'Azur (Faculté de droit et de science politique de Nice), GREDEG-CREDECO, CNRS UMR 7321
Avec les interventions de :
- Jean-Baptiste Racine, professeur de droit à l'Université Sophia-Antipolis, Nice
- Mahmoud Mohammed Salah, professeur de droit à l'Université de Nouakchott, Mauritanie
- Karen Coppens, Dechert LLP
- Mads Andenas, professeur de droit de l'Université d'Oslo, Norvège
- Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit à Sciences Po, Paris
_________
Se reporter aux modalités d'inscription pour cette conférence.
Consulter le calendrier des manifestations passées à venir.
Consulter la présentation de l'ouvrage qui résultera du cycle de conférences.
Revenir à la présentation générale du Cycle de conférences.
La participation à chaque séance est validée au titre de la formation continue des avocats (2h).
Inscription : anouk.leguillou@mafr.fr
_________
Cette conférence sert également d'appui à la réalisation d'un ouvrage plus global portant d'une façon générale sur Les outils de la Compliance, dans lequel les conférenciers ont vocation à contribuer par un article. L'ouvrage Compliance Tools sera publié en même temps.
4 février 2020
Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Les outils de la Compliance et la Théorie des climats, in La prégnance géographique dans les outils de la Compliance, 4 février 2020, Nice.
Lire la présentation de cette conférence-débat sur La prégnance géographique dans les outils de la Compliance.
Se reporter aux autres conférences composant le cycle complet de conférences sur Les outils de la Compliance.
Lire la présentation générale du cycle de conférence.
Se reporter au document de travail sur lequel la conférence s'appuie.
Consulter les slides sur lesquels s'adosse la conférence.
Résumé de la Conférence : En partant de la "théorie des climats" de Montesquieu, affirmant que les êtres humains seraient d'une nature différentes dans les différents endroits du monde, ce qui requiert donc des règles de gouvernement différentes suivant les lieux, théorie qui fait écho au cantonnement géographiques que Pascal opérait des Lois, l'on peut penser que, comme pour toute règle, celle de la Compliance, qui s'assure de la conformité du comportement des êtres humains aux règles, celle-ci va varier suivant que l'on est en-deça ou au-delà des Pyrénées. Mais de cette dimension géographique si naturelle l'on peut au contraire et dans un premier temps douter. En effet en la présentant comme un simple process, que l'intelligence artificielle à base d'algorithmes pourrait prendre entièrement en charge, par son absence de substance cette dimension perd toute pertinence. Sauf à tomber dans l'autre excès consistant à poser que tout n'est question que de "culture de compliance" ou que celle-ci n'est l'habillage d'un pur rapport de force, entre zones géographiques, par exemple les Etats-Unis et l'Europe, et dans ce Droit de façade la géo-politique est à ce point tout qu'elle en aurait dévoré le Droit.
Il faut raison garder et au contraire organiser dans un deuxième temps une sorte de tryptique et trouver ce qui relève de l'accumulation d'informations techniques et immuables, ce qui relève de phénomès locaux mais auxquels des normes de compliance globale pourront être techniquement attachées en raison de leur "nature cruciale" et assumer aussi des "prétention politiques de buts monumentaux" qui contestent les frontières et les branches du Droit qui gardent celles-ci.
Si l'on parvient à faire cela, alors non seulement le Droit de la Compliance parvient à se défaire de ce qui le mine, c'est-à-dire sa tentation mécanique que lui propose la technologie et sa disparition par le pouvoir politique, gardant de la substance sans être violent. En effet par le respect de la géographie l'Occident n'a pas à dicter "sa" Loi. Il doit au contraire concrètement emprunter au Droit kanak qui ne définit pas le Droit comme ce qui est énoncé puis appliqué, mais comme un "chemin". Ainsi dans la technique des investissements responsables, parce que le Droit de la Compliance est téléologiques, il faut que le Sujet de droit, c'est-à-dire l'entreprise (qui est en position, par exemple qui investit) n'interdit pas mais organise la transition pour que le bénéficiaire du dispositifi ne soit pas lui-même sanctionné, par exemple abandonné à la corruption, mais accompagné vers la sortie du système. L'intégration du temps et la notion de "durée", commun au Droit de la Compliance et au Droit de la Régulation (le Droit de la Compliance étant l'internalisation des Régulations dans les entités aptes à les concrétiser) impliquant l'articulation entre le territoire et la durée (ce que ne permet en rien le Droit de la Concurrence).
29 janvier 2020
Enseignements : Droit de la Régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2020

Résumé de la leçon n°1. La "Régulation" ne se confond pas avec la "réglementation". Elle constitue un "Droit" spécifique, dont la "réglementation" n'est qu'un outil, comme le sont les lois, les décisions de justice, etc., qu'ils soient obligatoires (hard Law) ou pris en considération par ceux qui sont concernés (soft Law). La "Régulation" ne se confond pas davantage avec la "Supervision", avec laquelle elle se cumule, en matière bancaire et financière. Ainsi, en-deçà des multiples Codes, par exemple le Code monétaire et financier, ce sont avant tout les Autorités de régulation et de supervision qui fabriquent et font vivre ce "Droit de la Régulation bancaire et financière".
Il convient donc de débuter par les institutions françaises : l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Ces autorités sont elles-mêmes ancrées non seulement entre elles et entremaillées au niveau européen, dans des relations internationales constantes, mais encore elles sont ancrées dans le système juridique français, lequel se déploie entre les deux ordres de juridictions, juridictions judiciaires et juridictions administratives, substantiellement unis autour des principes constitutionnels, et s'ancre dans l'ordre de l'Union européenne. Mais de fait, parce que la banque, et plus encore la finance, ne sont pas contenus dans les frontières des systèmes juridiques, le Droit américain, plus proche du Droit britannique (Common Law) que du Droit européen continental (Civil Law) dont la France et l'Allemagne demeurent l'expression, demeure la source première d'influence.
Après avoir fixé quelques définitions et avoir rappelé le raisonnement privilégié en Droit de la Régulation, prenant l'une puis l'autre, la description de l'AMF, qui succéda à la COB, née en 1967 par copie de la SEC américaine, suppose que l'on expose son statut, sa composition, ses pouvoirs et les contrôles dont elle est l'objet.
De nombreux modèles institutionnels existent et on les expérimente les uns après les autres. Le secteur des banques et des assurances continue d'être régulé par une Autorité adossée à la Banque de France, l'ACPR, dont il convient de faire une semblable description.
Revenir aux bases avec le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.
Documentation spécifique à la leçon :
- Règlement général de l'Autorité des marchés financiers
- Présentation de l'AMF par elle-même
- Présentation de l'ACPR par elle-même
- La mission de la BCE vue par elle-même
- Loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
- Présentation de l'application mondiale et contestée du FCPA
Approfondir par la Bibliographie générale du Droit de la Régulation bancaire et financière
Revenir à la présentation générale du Cours.
Se reporter au plan général du Cours.