Votre avis peut protéger l’Internet libre et ouvert dans la Communauté européenne ! Rendez-vous sur savetheinternet.eu dès maintenant pour transmettre un message à vos régulateurs nationaux et à l’ORECE : dites-leur de protéger la neutralité du Net
Message qui s'affiche le 18 juin 2016 à tout ouverture de Firefox
L''évolution d'une organisation économique et sociale construite sur des données définies comme des informations pures est radicale!footnote-447 ; l'ampleur des enjeux est en train d'être mesurée ; la pauvreté des solutions pour l'instant élaborées pour rendre compte d'une telle révolution apparaît !footnote-446. Il en résulte que l'on a pu désigner comme a pu une "épreuve"!footnote-450.
En effet, si l'évolution est à ce point radicale, alors le schéma des régulations en ce qu'elles sont cloisonnées secteur par secteur est à revoir, comme l'est la distinction entre régulation économique et régulation des libertés publiques!footnote-331. Il faut donc mesurer les conséquences régulatoires d'un monde pensé comme une architecture de données ayant pris leur autonomie par rapport à leurs sources, architecture autonome mais que l'on entend encore réguler au regard de l'usage que l'on va en faire (I). Parce qu'actuellement, l'enjeu majeur est ce que vont devenir les personnes dans ce nouvel monde qui pourrait bien fonctionner "sans personne", il convient de mesurer le rôle que les "personnes concernées" pourraient ou doivent y jouer (II).
I. LES CONSÉQUENCES RÉGULATOIRES DU RAPPORT ENTRE LA DONNÉE ET SON SOUS-JACENT
Le droit est tout à la fois un art pratique et l'expression d'une action politique. Il doit tout à la fois "prendre le monde comme il est" et néanmoins encore prétendre le dessiner car le droit est ce par quoi s'exerce l'action politique. Le Droit de la Régulation exprime ces deux faces. Ainsi le Droit de la Régulation doit prendre acte que les données se sont détachées des objets sur lesquels elles portent. Mais parce que le Droit de la Régulation est un droit téléologique, il doit se reconstruire à partir des finalités poursuivies, celles imposées à ceux qui récoltent les données mais aussi celles que poursuivent les États et les Régulateurs. Il convient donc de reconnaître que la "donnée" est une information dont l'objet sur lequel elle porte n'est que la source et dont elle est autonome (A). Le lien dont la Régulation doit avoir souci est celui qui existe entre la donnée, qui, même dans le monde "réel", est toujours virtuelle, et l'usage qui peut en être potentiellement fait (B). C'est pourquoi, dans cet univers de virtualité et de potentialité, c'est vers l'interrégulation et vers une régulation de l'interconnexion qu'il faut tendre (C).
A. LA DONNÉE, INFORMATION AUTONOME DE L'OBJET SUR LEQUEL ELLE PORTE
Nous sommes dans une double transformation : celle qui mène vers une économie de l'information et celle qui mène vers une économie de l'accès. Les deux mouvements sont pavés de données. En effet, c'est par les données, notamment des données à caractère personnel, que les entreprises affinent l'accès. La notion de "données personnelles" n'est d'ailleurs plus à limiter à la notion de personnes physiques!footnote-209.
Par exemple la comptabilité est un ensemble de données paradoxalement détaché de l'entreprise!footnote-210. Mais il convient de généraliser le propos. Si l'on pose que les informations sur les réalités sont des objets existant indépendamment de celles-ci, non seulement cela restitue mieux le monde économique dans lequel nous vivons désormais (1), mais encore cela élimine un certain nombre de discussions aussi difficiles qu'inutiles (2).
1. La réalité des données, objets économiques virtuels autonomes des réalités sur lesquelles ils portent
En effet et en premier lieu , la finance peut elle-même se définir comme une information sur l'état du monde, information devenue autonome de celui-ci. Par exemple, une action est un titre qui est chargé des informations sur la société dont l'actionnaire est le créancier tandis que l'option est un instrument financier qui anticipe l'état futur du monde, mais dans le même temps ce sont des titres qui sont détachés de leur sous-jacent. Ainsi, le titre est détaché en premier lieu du rapport de créance entre le titulaire du titre et la société, de la même façon qu'il est détaché en second lieu de l'état futur du monde. Cette autonomie leur permet de circuler sur des marchés qui leur sont propres : marchés des actions, marchés des obligations, marchés des options, etc. Le monde (la société commerciale, l'état futur du marché) n'est donc pas l'objet de l'information, mais la simple source de la donnée, qui une fois née circule d'une façon autonome. Les produits financiers appelés littéralement "produits dérivés" sont exemplaires de cela. Cette déconnexion est certes source de risques, mais c'est un fait.
Si la finance a pris effectivement son autonomie par rapport au monde qu'elle ne se contente pas de traduire, alors même que le fonctionnement de l'industrie financière a un impact considérable sur celui-ci, les conséquences régulatoires sont considérable : en effet, si par un effet boomerang le monde est réduit à être un "amas de données financières", alors le monde doit être régulé par le régulateur financier. C'est sans doute la représentation du monde qu'ont eu les commanditaires du rapport demandé au président de l'Autorité des marchés financiers à propos de la régulation des produits agricoles : puisque le monde agricole est happé par la finance, la seule façon de le réguler est d'en confier la régulation au régulateur financier!footnote-287.
En second lieu, l'autonomie de l'information par rapport à son objet concerne la personne elle-même. En effet, l'information sur la personne n'est pas qu'un "reflet" de celle-ci : elle est un découpage de celle-ci. Par exemple un goût alimentaire ou vestimentaire ou une façon de passer son temps libre est un découpage de la personne. D'une façon fine, il a été montré que l'information la plus importante que produit la personne à partir d'elle-même consiste dans "l'attention" qu'elle porte à telle ou telle chose, information précieuse pour l'entreprise qui vend cette chose et tout ce qui y est corrélé ou analogue. Se constitue ainsi les marchés numérique de "l'attention"!footnote-359. Le fait qu'une personne aime boire de l'alcool par exemple ne la restitue pas en son entier, ou le fait qu'elle ait fait des études au Royaume-Uni ne la donne pas à voir en elle-même. L'information est toujours parcellaire. Ce qui va changer par Internet et plus particulièrement par la puissance informatique qui en est le socle technique, c'est le traitement de cette information. Par la compréhension d'une personne, l'entreprise ou l’État obtiendra la compréhension des personnes proches d'elle, semblables à elle, analogues à elle, connectées à elle, passera de goût en goût, dressera des cartographies des "attentions", dessinera le futur!footnote-385. Les "fiches S" ne sont pas autre chose.
Ainsi, l'information devient autonome et prend de la valeur indépendamment de la personne à propos de laquelle elle a été forgée. La personne n'en est que la "source". L'expression de "méta-donnée" renvoie à ce travail de forge qui construit ces éléments autonomes et épars pour donner de la pertinence. La constitution de fichiers, par nature ciblés, par nature construit pour servir un but, n'est pas nouveau. Mais le changement produit par Internet devient qualitatif en ce que c'est la personne elle-même qui se livre donnée par donnée à tous les exploitants qui le désirent, n'ayant pas l'impression que les livres de chair qu'on lui demande lui coûtent, puisqu'elle a l'impression de demeurer intacte en n'ayant donné qu'une "information", ne mesurant pas qu'elle se livre ainsi elle-même.
Ainsi, si l'on cherche à qualifier plus exactement le rapport entre la réalité et la donnée, par exemple là où habite une personne d'une part et son adresse postale, d'autre part, la première n'est pas l'objet de la seconde : la réalité est la source de la construction d'une information qui est "l'adresse" , laquelle va constituer une "valeur". A ce titre, le fait qu'il s'agisse d'une adresse portant sur une rue ou bien qu'il s'agisse d'un courriel est indifférent. Cette même valeur pourra dans un second temps être utilisée à de multiples fins : permettre l'envoi de document pour scolariser les enfants, envoyer des publicités ciblées, comprendre des rassemblements potentiels de personnes, anticiper les dangers potentiels de ces rassemblements potentiels, etc. Tout est construction, à partir d’une adresse, qui n’est pas l’objet, mais la source.
Pour formuler mieux ces qualifications, le rapport pertinent doit être établi entre une "réalité-source" (qui est tangible) et une "information-valeur" (qui est virtuelle, car toute information est virtuelle). Cette valeur se concrétise par l'usage qui en est fait : en détenant une adresse, on peut opérer l'envoi de la police!footnote-324, l'envoi d'une publicité, l'envoi d'une convocation, etc. Cette valeur est potentielle car à l'instant où l'adresse est insérée dans une liste, tous ces usages sont possibles. Or, la valeur accordée aux potentialités constitue aussi le principe de fonctionnement des marchés financiers, autre marque de l'analogie entre Internet et la finance!footnote-360.
Ainsi, ce qui va affecter l'information et déclencher la réaction du Droit, c'est l'usage qui en est potentiellement fait, ce n'est pas la nature de sa source!footnote-211.
2. L'absence d'influence de la nature de la réalité-source sur laquelle porte l'information-valeur
Pourtant, dans le droit classique, il est usuel d'affirmer qu'en transparence le statut de la chose se retrouve dans l’information sur la chose. Par exemple, s’il s’agit d’une information portant sur un événement de la vie d'une personne, l'on considère qu'elle en est "titulaire" et que les tiers ne peuvent en disposer sans son accord, tandis qu'à l'inverse s'il s’agit d’une adresse postale ou d’une date de naissance, il s’agit d’un fait qui produit une donnée que l’on considérera comme une « donnée publique ». La distinction dont on admet pourtant la fragilité entre le privé et le public est encore à l'oeuvre!footnote-212.
Des centaines d’études ont cherché à déterminer le statut juridique des « données publiques » et ont conclu qu’il ne pouvait y avoir d’appropriation des « données publiques », qu’il devait y avoir libre accès, absence de rémunération, absence de contrôle et de protection, etc. Est-ce tout à fait soutenable ? En revanche, s’il s’agit d’un objet privé (ma maison que l’on photographie, mon article que l’on reproduit), alors si on émet une information à son propos qui ne se distingue pas du simple picorage que constitue le « droit de citation », qui n'est pas une construction nouvelle à partir de ma propre donnée, alors celui qui a profité de l’information dépendra du premier titulaire. La chaîne de la connaissance, laquelle est pourtant un bien public, est brisée.
Nous payons très cher une distinction artificielle entre ce qui seraient des données "publiques" et ce qui seraient des données "privées". Si on regarde vers le passé, le contentieux autour des bases d'information de jurisprudence en est la trace. Si on regarde vers l'avenir, la difficulté à construire un instrument rassemblant l'information sur les propriétés privées, ce qui constitue un bien public, en est un autre exemple.
Il est pourtant essentiel que l'on pense l'enjeu économique et social que constitue cette valeur en se dispensant de qualifier la donnée de "privée" ou de "publique", car l'information est un bien commun dont la source est souvent un phénomène privé et cela n'est pas pertinent de garder cette distinction propre à la source pour manier l'information elle-même. Ainsi, le jour où l'on se dispense de cette distinction l'on pourra concevoir un cadastre numérique efficace, bien commun, à partir des informations privées apportées directement par ceux qui y ont intérêt, c'est-à-dire les propriétaires.
Pour l'instant, les règles reposent sur l'idée que la nature de la source de la donnée contamine la donnée : l'information sur une adresse postale est une information publique, l'information sur un repas de famille est une information privée. Or, dans l'économie de l'information, les deux données sont de même nature. On le comprend plus nettement à partir d'exemples plus nets encore : l'état civil est un document public, mais l'âge est devenue une information à caractère privé. Le nom et le prénom sont des données publiques mais la pratique religieuse sur laquelle de fait ils renseignent sont des informations privées!footnote-386. Comment qualifier l'information à partir de sa source, dès l'instant qu'il est aisé de connaître l'âge d'une personne en connaissant sa date de naissance ? L'information en elle-même est neutre, la seule chose qui compte sera l'usage potentiel qui en sera fait. Pour prendre un autre exemple encore, le patrimoine relève de la vie privée mais les déclarations fiscales sont des documents publics. L'information est donc neutre, sauf à contrôler l'usage nocif qui peut en être fait. L'exemple récent de la demande par l'administration fiscale allemande de communication des certificats de baptême des français résidant actuellement en Allemagne!footnote-295 montre que seul l'usage, ici fiscal, permet de déterminer s'il faut ou non entraver la circulation de l'information ou non.
En cela, Internet est un espace qui accroît cet effet de neutralisation, renvoyant comme le marché financier au modèle walrasien du "marché pur". La neutralisation résulte de cette rupture entre la donnée et sa source, c'est-à-dire ce sur quoi elle porte. Ainsi, les entreprises ayant construit les moteurs de recherche réduisant le monde à un parc de données dont elles sont les jardiniers gracieux, insistent sur leur "neutralité" : elle signifie qu'ils fournissent une "information sur une information", à savoir l'accès à une information par rapport à laquelle ils entendent demeurer extérieurs. Cette présentation élaborée principalement pour éloigner toute responsabilité montre aussi que dans cette économie de l'information, il s'agit d'informations autonomes les unes des autres : l'information sur le monde réel est autonome de celui-ci et constitue une valeur autonome tandis que l'information d'accès à la première information est également autonome de celle-ci et constitue également une valeur qui lui est autonome. Là encore, Internet correspond à un modèle de "marché pur", car tout y est atomisé, pulvérisé, pour mieux être mis en masse.
L'écosystème numérique qui s'est construit sur la puissance informatique du web est en train de bâtir une nouvelle façon de vivre qui fond sur l'ancien monde, comme le fait la finance, elle-même intégrée dans Internet. Cette puissance est bâtie sur cette autonomie conquise par rapport à l'objet. La régulation ne peut donc prendre prise que si le Droit de la Régulation conserve ce qui fait partie de sa définition : partir des finalités. Les Régulateurs des libertés ont toujours fait ainsi. La perspective économique doit le faire également et résister en cela à cette construction d'Internet en "marché pur".
B. LA DONNÉE, JANUS DE LA SOCIÉTÉ VIRTUELLE
La donnée présente deux faces. D'un côté, elle est une information pure, qui a vocation à être toujours disponible dans le monde numérique si l'on veut que l'économie et la société de l'information se construisent (1). Cela ne peut se faire sans régulation. De l'autre côté et dans le même temps, le Droit peut décider que la donnée doit rester imprégnée par la source d'où elle est née, stoppant ainsi sa neutralisation (2). C'est également un effet de régulation.
1. La régulation de la donnée pour la rendre accessible dans l'espace numérique
La "donnée" peut donc se définir comme une information pure et autonome de sa source. En cela, elle est naturellement apte à circuler, à être elle-même source d'une autre valeur, à s'agréger. Elle est un objet de marché. Elle est même l'objet de marché par excellence, correspondant à une économie mondialisée de l'information. Il en résulte une "bataille mondiale des données"!footnote-484.
C'est pourquoi les nouveaux textes de l'Union européenne, laquelle vise à la construction d'un marché intérieur, vont avoir pour but, c'est-à-dire pour objet, de faciliter la circulation des données!footnote-325. Puisque les données sont constituées d'informations, de toutes sortes d'informations sans qu'on ait à se soucier ex ante de leur source, il convient de faciliter leur circulation, la circulation étant la condition première du marché et l'Europe s'étant construite sur les trois libertés de circulation!footnote-288.
Ainsi dans une perspective économique les données doivent "circuler" pour que se constitue un marché : c'est une tautologie, puisque c'est la circulation des biens qui fait le marché. Mais le terme même de "circulation" n'est pas le plus approprié. En effet, le terme est adéquat pour un bien corporel qui "bouge". Cela est encore approprié pour les idées ou les discours qui "circulent" car ils passent de personne en personne, lesquelles sont des personnes concrètes et situées sur un territoire donnée. Mais l'espère numérique n'a pas de corporéité. A proprement parler, l'on n'y "circule" pas. Les données ne doivent pas y "circuler", elles doivent y être toujours "disponibles" où que soient par ailleurs ces trois éléments ou personnes : la source de la donnée d'une part (le paysage, la personne, la civilisation, etc.), le fabricant de la donnée (l'entreprise qui la façonne, l'adosse à d'autres, etc.) et le consommateur de la donnée (l'internaute)!footnote-305.
Ainsi, la régulation des données sur Internet doit porter non pas tant sur une "circulation" mais sur une disponibilité permanente de la donnée, précisément comme si elle ne bougeait pas dans l'espace virtuel, alors même que la source, le fabricant et le consommateur de la donnée ne sont pas situés au même endroit et quant à eux bougent. C’est ce qu’exprime d’une façon plus exacte le terme nouveau de « portabilité ». Si les trois personnes précitées peuvent concrètement bouger et avoir toujours à portée la donnée, c’est que l’espace numérique est en réalité immobile et toujours accessible. N’est-il pas tant de dire de l’espace numérique l’inverse de ce qu’affirma Copernic « mais pourtant il ne bouge pas ».
Or, de nombreuses données sont imprégnées du droit national qui les a vu naître, lorsqu'il s'agit d’œuvres de l'esprit, lesquelles sont des informations revêtues par le droit de la propriété intellectuelle et entrave la libre disponibilité du bien dès l'instant que, par exemple, son consommateur change de lieu et déclenche de ce fait l'application d'un autre régime juridique applicable à la donnée. Le droit d'auteur notamment doit se combiner avec le mécanisme de disponibilité qui exige une unification des régimes juridique car il doit y avoir neutralisation des déplacements physiques des personnes concernées pour que la virtualité des données trouve son plein effet.
La régulation des données devient alors principalement la régulation de l'accès aux données, ce qui déplace l'objet de la régulation, l'accès premier mais aussi ce que l'on pourrait appeler "l'accès continué", le consommateur continuant à y avoir accès alors qu'il s'est déplacé, allant notamment dans un territoire régi par un droit différent de celui où il s'est connecté une première fois. C'est tout l'enjeu de la portabilité, bientôt transformé en droit subjectif!footnote-362. Cela est classique en Droit de la régulation, construit sur le "droit subjectif d'accès"!footnote-306. Le droit d'accès est un principe libéral qui permet tout d'abord à celui qui a permis la fabrication de la donnée de contrôler celle-ci, première mesure de la loi Informatique et libertés, permettant à chacun d'avoir accès au fichier en ce qui le concerne et organisant l'information de chacun de ce droit. Mais le principe est plus central encore, ce qui explique que les plateformes et les moteurs de recherche soient à la fois les "entreprises cruciales"!footnote-326 du numérique et le souci juridique premier.
En effet et d'une façon plus générale, l'accès aux données est le point central de la régulation des données, lorsque celles-ci ne sont appréhendées que comme des informations pures. C'est parfois ainsi que l'on définit la "neutralité d'Internet" ou plus exactement l"Open Internet", consacré le 26 février 2014 par la Federal Communication Commission. et le prochain Règlement européen, conçu par la Commission en 2012, ayant franchi l'étape du Parlement européen en 2014 et ayant été approuvé par le trilogue en décembre 2015, pose que les données doivent être accessible à tout consommateur pour que se développe à la fois une économie de la connaissance et une société démocratique. L'on cesserait donc d'opposer protection de l'individu, développement du système économique et société démocratique. C'est pourquoi le fonctionnement de l'État est directement concerné. L'ouverture de ses "données" est non seulement ouverte à tous, la CADA étant le précurseur de l'Open Data!footnote-363, mais c'est l’État en train d'élaborer qu'il s'agit d'observer, démocratie participative par le numérique. Ainsi, la Securities Exchanges Commission a accru en septembre 2014 l'accès de tous au processus d'élaboration normative en son sein, l'"Open Data" s'appliquant désormais à l’État en train de bouger et non plus sur ses normes achevées!footnote-327. Tout devant être "disponible à chaque instant", les normes sont remplacées par des flux normatifs, les images sont remplacés par des films (il est ainsi usuellement affirmé que la comptabilité devient un film), ces flux étant déversés dans l'espace numérique.
Mais contrairement au cinéma, les images successives et rattachées les unes aux autres par une histoire ne se détruisent pas les uns les autres au fur et à mesure qu'elle se succèdent, Internet étant un espace dans lequel les images étant des données immobiles et toujours disponibles, elles perdent le sens que leur donnait "l'histoire" pour devenir disponibles à d'autres fins!footnote-329.
Cette disponibilité pure de la donnée ne signifie pas qu'on ne doivent ou ne puisse plus protéger la source d'où est extraite l'information. Cela n'implique pas davantage que, du seul fait qu'elle soit accessible, cette donnée doive être gratuite ou que l'accès à celle-ci en tant que tel doive l'être.
Le fait que l'information d'une façon générale est un bien commun , comme l'est l'éducation ou la santé, ne justifie pas en soi que son accès soit gratuit. Les entreprises qui construisent et gèrent les réseaux sans lesquels Internet n'existerait pas contestent de ne pouvoir justifier que par des raisons techniques de gestion des congestions de flux les priorités donnés à certains internautes ayant payé des abonnements plus onéreux, contestant en outre l'assimilation du réseau qu'Internet constitue à un simple réseau téléphonique!footnote-330.
2. La régulation de la donnée pour la colorer par la source d'où elle est fabriquée
Retournons la médaille. La donnée peut avoir été extraite d'une source qui pouvait n'être pas disponible pour une telle extraction!footnote-289. En cela, soit la donnée abîme ce sur quoi elle porte, car celle-ci ne supporte pas d'être simple source de valeur. économique. Soit la donnée ne peut échapper à ce point à ce qui a permis sa construction. L'Union européenne a imposé le lien maintenu entre la donnée et sa source à propos des "données à caractère personnel". Comme si l'Europe réinventait le droit d'auteur, notamment un quasi-droit moral, comme modèle du pouvoir de celui qui est la source de la fortune de celui qui a fabriqué l'objet.
Le Droit ne qualifie pas clairement ce lien. L'idée est que la personne demeure encore un peu dans la donnée, parce que l'information détachée de la personne évoque encore un peu celle-ci. L'idée est que la personne demeure encore un peu « dans la donnée », parce que l'information détachée de la personne évoque encore un peu celle-ci, comme l’auteur d’une œuvre demeure dans celle-ci, conception romantique que l’Europe continue d’avoir du droit d’auteur. L'expression même de "caractère personnel" invite à voir encore la personne dans la donnée. Mais à lire les présentations et commentaires des textes, il est dit que la personne est alors "comme propriétaire" de la donnée. Les "comme si" ne sont jamais une bonne qualification en droit!footnote-364. Il est vrai que l'on ne sait jamais bien qualifier ces valeurs que l'individu porte d'une façon intime et pour toujours ... mais dont il se sépare (l'image), qui sont sans prix ... mais qu'il vend chaque jour, etc. La notion de "biens de la personnalité" qui fût proposée montre bien l'embarras.
Sans doute vaudrait-il mieux penser le rapport de titularité entre la donnée et sa source selon le modèle du droit d'auteur, puisqu'il en est la source, pour justifier ce lien maintien entre l'information pure et circulant sur un marché et la personne qui en fût le creuset.
Mais surtout les personnes ne sont pas les seules sources d'information dans le monde. La nouvelle summa divisio entre les informations à caractère "personnel" pour lesquelles tant de précaution sont prises et les autres, disponibles purement et simplement, est-elle si pertinente ? Des informations méritent sans doute de n'être pas laissées au seul mécanisme de marché, lequel pose une disponibilité de principe. Une régulation devrait être plus largement conçue à propos des données "sensibles", lesquelles ne sont pas toutes personnelles!footnote-294.
En effet, l'on s'aperçoit que si l'on ne régule que les données déjà répertoriées par une régulation sectorielle, telle l'information financière, l'information bancaire, ces régulations répertoriant les données sensibles!footnote-290, en ne visant que les "données à caractère personnel" hors des secteurs par ailleurs régulées, on laisse alors aux entreprises qui tiennent les espaces sur Internet le point de déterminer les données "sensibles". C'est ainsi que FaceBook ou Google ont établi des chartes posant les données qui ne doivent pas circuler sur l'espace numérique qu'ils maîtrisent. Est ainsi prohibée la nudité féminine mais non les croix gammées. Il est vrai qu'il s'agit ici d'opérateurs qui se prévalent de leur neutralité!footnote-472, leur permettant d'en rester au premier stade du contrôle téléologique qu'impose la régulation des données, c'est-à-dire des informations qui donnent à voir immédiatement l'usage potentiel qui en sera fait. On aimera les croire lorsqu'ils affirment que les croix gammées ne donnent pas à voir l'usage contraire au Droit qui en sera fait.
En outre, des données "sensibles" mériteraient d'être régulées, c'est-à-dire de faire l'objet d'une régulation ayant à la fois pour but de les faire circuler aisément, en les rendant partout et par tous disponibles, et de mettre en équilibre de ce principe de circulation un autre principe.
Le fait qu'une donnée soit à la fois une valeur économique ayant vocation à circuler pour qu'une économie dynamique de l'information se construise et qu'en même temps un équilibre se fasse pour que des dangers potentiels attachés aux données "sensibles" soient pris en considérés, y compris en ex ante, c'est la définition même du Droit de la régulation. En effet, celui-ci est l'appareillage qui met en équilibre d'une façon dynamique le principe de concurrence et un autre principe!footnote-291.
Le fait que pour l'instant, faute d'une régulation des données sensible, ce sont les maîtres des réseaux et des plateformes qui organisent cette régulation, montre l'immaturité du système. Le fait que l'Autorité de la concurrence intervienne, pour limiter les excès de l'exercice de ce pouvoir disciplinaire, par exemple par une décision Google du 8 septembre 2015!footnote-292 imposant des obligations de transparence, c'est-à-dire agissant comme un régulateur, ce qu'une autorité de concurrence n'est pas, montre que le système doit progresser.
Pour cela, il faut penser d'une façon plus générale la façon dont les données "sensibles" sont régulées, conformément au droit de la régulation, c'est-à-dire par rapport à la concordance nécessaire entre les conséquences des comportements, des organisations ou des structures d'une part, et les finalités recherchées par la régulation d'autre part.
C. LA RÉGULATION DES DONNÉES PAR L'ANÉANTISSEMENT DE LEUR NEUTRALITÉ
Il peut paraître paradoxal d'évoquer une régulation des données. En effet, les données sont des informations et en principe en démocratie on ne régule pas l'information. C'est le principe et sans doute dans une économie de l'information ne faut-il pas non plus l'oublier. La régulation des données se conçoit néanmoins, soit en considération de leur nocivité potentielle (1), soit en fonction de leur sous-jacent ou de leurs effets (2),
1. La régulation des données en raison de leur nocivité potentielle
Si l’on donne la prévalence à la notion de données, sans l’indifférence de ce sur quoi elle porte, il faut alors revenir à la définition du droit de la régulation, droit gouverné par les buts!footnote-213 et ne qualifier une donnée disponible sur Internet en lui associant un qualificatif pertinent (critique, sensible, etc.) que par rapport à l’usage potentiel.
En effet, le Droit de la Régulation est un droit pragmatique, qui pose des principes directeurs concrets. Il consiste à confronter les buts qu'il a lui-même fixés - c'est en cela qu'il est éminemment politique - et les résultats des comportements, organisations ou structures que des Autorités observent en permanence!footnote-365, pour qu'il y ait coïncidence. Parce que Droit de la Régulation exprime un ordre public!footnote-214, si une telle coïncidence n'est pas observée, le Droit intervient pour interdire, pour obliger, pour prescrire, car c'est le but poursuivi par le Droit, parce que le Politique l'aurait démocratiquement posé, qui doit l'emporter sur le résultat qui adviendrait normalement par le seul jeu des forces économiques.
C'est ainsi que la Régulation de la puissance liée à la constitution et à la détention des fichiers a été conçue et cette méthode n'a pas varié.
Les premiers cas de figure sont simples. C'est le cas où une personne prend des informations sur une autre pour savoir s'il est un homme ou une femme. Par exemple parce qu'il s'agit d'un formulaire d'état civil. On estime d'ordinaire que la personne qui fait la déclaration a une obligation de déclaration exacte et qu'il s'agit d'une "donnée publique". Il peut s'agir aussi d'un site de rencontre sur internet où Il faut "renseigner" la case!footnote-366. Parce que le but n'est plus pour l’État de connaître sa population!footnote-217 mais plutôt de faire une rencontre adéquate, l'on va estimer que la personne communique une donnée personnelle et recherche une personne qui lui correspondre (du même "genre" ou non). Il peut encore s'agir d'une donnée qui sera exploitée par un tiers comme un élément parmi d'autres de persécution, en lien avec l'orientation sexuelle.
Les décisions en matière de données à caractère personnelle sont toujours construites sur le même raisonnement, à savoir le contrôle de l'intérêt légitime de l'usage, même potentiel de l'organisation même potentielle des données entre elles. C'est la dangerosité de la construction qui est appréciée, l'information étant la première des armes. L'on peut prendre le cas examiné par l'arrêt du Conseil d'État du 19 juillet 2010!footnote-293SNES, par lequel le Conseil d'État exige une justification précise de "l'intérêt légitime" d'un fichier nominatif de tous les enseignants par le Ministère de l'éducation nationale.
L'on peut ainsi considérer qu'il y a trois hypothèses :
La première hypothèse correspond à celle dans laquelle la donnée est en elle-même empoisonnée, substantiellement nocive lorsqu'elle est dans les mains d'un tiers et ne peut être extraite de sa source dont elle est indétachable. Le Droit vise ici l'idée d' "intimité de la vie privée", notion qui dessine un cercle autour de la personne, marquant que ces informations ne peuvent être détenues en secret, manipulées et diffusées par des tiers, car en touchant ces informations, le tiers heurte la personne elle-même, dans sa liberté ou dans sa dignité. C'est le droit civil à travers sa protection des "droits de la personnalité"!footnote-369 et le droit public dans sa protection des "libertés publiques" qui assurent cette fonction. La fluidité numérique rend certes cette tâche plus ardue mais le droit classique est déjà en place et continue de s'adapter!footnote-368 pour y parvenir.
La deuxième hypothèse correspond à celle dans laquelle la donnée présume un usage nocif pour la source d'où elle est extraite, mais c'est une présomption simple. La personne qui procède à l'extraction ou qui en bénéfice peut échapper à la prohibition en démontrant "l'intérêt légitime" de ce qu'elle fait. Parce qu'il s'agit d'une régulation, la démonstration doit être faite en ex ante, par exemple auprès de l'administration ou d'un régulateur. C'est le cas où il y a constitution de fichiers contenant des informations sur la personnes qui ne concernent pas l'intimité de sa vie privée.
La troisième hypothèse correspond à celle dans laquelle la donnée ne présume pas un usage nocif mais qu'il est possible de montrer, avant ou après sa réalisation un usage abusif. Elle ne justifie qu'une intervention ex post. Plus le système politique et le système économique seront libéraux et plus la Régulation adoptée sera de ce troisième type. L'on peut considérer que le cas Safe Habor dans lequel les États-Unis et l'Europe se sont affrontés révèlent en cela une différence culturelle profonde, les États-Unis préférant un contrôle simplement Ex Post à l'initiative de juridictions, les Européens préférant une sécurité Ex Ante. Il en a résulté le coup d'arrêt de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 octobre 2015!footnote-372, et l'appel immédiat des autorités politiques à un nouveau dispositif international.
Cela montre d'une façon plus générale que la régulation va intervenir non plus pour permettre à celui qui a été la source de la donnée d'avoir encore son mot à dire lors d'une circulation encouragée de celle-ci mais, autre mode classique du droit de la régulation - en cela contraire au droit de la concurrence -, de "colorer" la donnée en fonction de son sous-jacent ou de son effet sur le secteur ou sur la société.
2. La régulation des données colorées par leur sous-jacent ou par leur effet
Le droit de la concurrence neutralise les objets, ce qui les rend échangeables et facilite la « circulation » - c’est-à-dire leur disponibilité en tous lieux que soit la personne concernée, tandis que le droit de la régulation concrétise les objets. Cette « reconcrétisation » peut être désignée comme la « revanche du sous-jacent »..
C'est certainement le cas lorsqu'il s'agit des personnes physiques : c'est alors le terme même de "sous-jacent" qui doit être ici récusé. C'est en effet un tropisme économique qui réduit la personne à n'être que la source des richesses que sont les informations fragmentées la concernant, lesquelles ne prenant de valeur qu'ajustées à d'autres, alors que la "personne" est une invention juridique posée sur chaque être humain pour que tout à la fois il soit incommensurable aux autres et parfaitement égal en droit à tous les autres êtres humains!footnote-373.
En effet, il a été rappelé que la "donnée" n'est jamais qu'une information. Or, le statut de l'information est incertain, en droit comme dans les autres disciplines. A la fois Catala a montré en premier que l'information est l'objet d'une "propriété" : nous sommes propriétaires des informations que nous produisons!footnote-299. Mais il a été montré dans le même temps que l'information est un système général car une information particulière ne "vaut rien" sans référence à un système général dans lequel elle se place et qui lui donne un sens. Par exemple une information comptable ou financière particulière n'a de valeur qu'insérée dans un système comptable et financière qui n'appartient pas l'émetteur, sans même évoquer la langue dans laquelle est exprimée l'information, ou les couleurs utilisées par l'image qui sont "communes". Ainsi, l'information est aussi un bien commun, inappropriable.
L'information particulière n'existe qu'en tant qu'elle est reliée à une source (par exemple une entreprise, une personne, un lieu, une époque, etc.) et qu'elle appartient à un système qui permet son maniement et lui ôte dans certains cas sa neutralité, si le Droit en décide ainsi.
Tout l'enjeu politique et régulatoire est dans ce "si en décide ainsi".
En effet, si l'information a pour objet ou pour effet d'informer le public, et que le Droit décide que l'information du public est à propos de cela un objectif essentiel dans un système démocratique (parce que la personne concernée est une "personne publique", par exemple), alors la neutralité de la donnée est anéantie par ce critère politique intégré par le Droit : en tant que la donnée alimente le débat démocratique, elle sera protégée, puisqu'une nouvelle qualification juridique lui est imputée. La donnée devient un élément de l'information du public, voire du pluralisme politique. Dans un tel cas, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) aura compétence, puisqu'il est en charge du pluralisme politique dans le secteur audiovisuel, tandis que la Cour européenne des droits de l'Homme interférera puisque le fondement politique de la liberté d'expression sera activée.
Si l'on rattache la donnée non plus à son effet mais à sa source, en constatant qu'elle est le résultat d'une extraction de ce qu'est la personne d'une façon consubstantielle - ce que le Droit exprime à travers la notion étroite d' "intimité", le Droit peut refuser la prise d'autonomie totale de la donnée par rapport à la personne qui en est la source. C'est le cas pour les "données à caractère personnel". Il faudra alors faire la balance entre les deux appréhensions : c'est pourquoi les textes communautaires qui limitent l’appréhendions par les tiers des données à caractères personnels desserrent l'étau lorsque l'information démocratique est en jeu. Mais pourquoi s'arrêter à cet cas-là du lien entre une donnée et une personne, car les données devant perdre leur "neutralité" ne se limitent au cas des données "personnelles" ?
Le Droit peut rétablir un lien entre la donnée et sa source même si la donnée n'a pas de "caractère personnelle". Pour prendre un exemple, un contentieux est né à propos de la comptabilité d'une entreprise. Une entreprise a agi en justice contre son expert-comptable pour la façon dont celui-ci a émis des données comptables reproduisant un état de l'entreprise que celle-ci estime dolosif. Pourquoi pas ? Cela montre que la personne morale est bien la source de données dont l'auteur est un tiers qui est apte à répondre de l'émission d'informations autonomes dont la discordance avec la source peut engager sa responsabilité non seulement à l'égard des investisseurs par rapport auxquels il est un "tiers de confiance" et un axillaire du Régulateur, mais encore par rapport à l'entreprise dont il parle.
De la même façon, dans un espace numérique pensé comme "libertaire" les données sont créées indépendamment de leurs sources, c'est-à-dire ce que l'on appelle usuellement l'objet sur lequel porte l'information!footnote-303. Mais lorsqu'il y a discordance entre la donnée et sa source, ce n'est pas au titre d'un droit de propriété que celui sur lequel porte l'information (car on n'est pas "propriétaire de sa vie privée")!footnote-375 mais d'un lien perdurant d'une façon minimale entre la donnée et sa source, opposable à celui qui construit l'objet économique qu'est la donnée.
En effet, le "sous-jacent" peut n'être pas réduit à l'état de "source inerte" de la donnée. Ainsi, lorsqu'une plateforme financière développe des produits dérivés sur des produits agricoles, l'interrégulation peut consister à donner une mission à l'autorité financière qui préserverait la fonction du secteur agricole qui consiste à nourrir les populations, en contrant la "spéculation excessive sur les matières premières agricoles"!footnote-315, ce qui est une façon pour un régulateur d'un secteur (le secteur financier) de prendre en considération la spécificité d'un autre secteur (agro-alimentaire), force d'interrégulation. La considération du sous-jacent peut être plus impérieuse lorsque c'est le sous-jacent qui va impliquer le type de régulation, en neutralisant la forme technique que cela prend y compris par le déploiement numérique. Il n'y a pas d'effet de nature, il s'agit d'un choix politique. Ainsi, en matière de santé connectée, en décidant que celle-ci relève d'une régulation de la santé publique, les logiciels étant alors pour la force de la qualification juridique considérés comme des "produits de santé" relevant de ce fait des autorités de régulation sanitaire, les États-Unis ont fait un choix politique!footnote-376.
C. LA RÉGULATION DES MISES EN CONNEXION DES DONNÉES
Le Conseil d’État dans son arrêt du 19 juillet 2010!footnote-296 pose que l'interconnexion est en elle-même une donnée, laquelle peut mettre en danger de personnes, dès l'instant qu'elle ne correspond pas à un intérêt légitime dont peut se prévaloir celui qui la fabrique.
Il convient d'approuver une telle perspective car la régulation des données c'est avant tout la régulation de l'interconnexion des données.
L'interconnexion des données s'opère aujourd'hui principalement de deux façons, par les objets et par les sous-espaces sur Internet, que sont principalement les plateformes. L'on ne peut donc concevoir de régulation d'Internet sans interrégulation.
1. L'interrégulation par contraction, à travers des objets dans lesquels convergent les données
Ce que l'on désigne désormais comme les "objets connectées" sont des objets matériels qui sont les supports physiques des messages, prestations et informations pertinentes qui permettent, pour reprendre l'expression de Michel Serres, à l'individu de tenir le monde dans sa main. Plus encore, par ces objets connectés, il tient le monde à sa main, achevant ainsi le fantasme de la consommation, les compétences et les disponibilités convergeant vers lui, sa propre mobilité n'étant plus un obstacle du fait de la disponibilité permanente des informations sur le numérique, regroupées, reconstruites et transmises selon une finalité qui est l'objet de la prestation d'ensemble : par exemple la santé.
La réglementation de l'objet connecté correspond bien à la définition du Droit de la régulation pensé par les finalités seule mais ferme exigence d'une coïncidence ou au minimum d'une non-contradiction entre la finalité offerte par l'entreprise qui propose le faisceau de prestation sur l'objet connecté et la finalité recherchée ou sauvegardée par le Régulateur!footnote-343.
La Régulation peut alors se faire par "contraction", c'est-à-dire qu'au lieu de faire converger les régulations spécifiques de tel ou tel type d'informations qui confluent par l'objet connecté, l'un la régulation médicale, l'autre la régulation des données à caractère personnel, l'autre la régulation de la profession libérale, l'autre la régulation de sécurité nationale, etc., il faut mais il suffit de réguler l'objet connecté lui-même, puisqu'il a été fabriqué pour que tout converge en lui.
De la même façon que la Régulation a toujours eu pour objet et pour effet de lutter contre la neutralisation de la vie par l'économie, ici la Régulation redonne de la corporéité aux règles en se détournant des données elles-mêmes, qui sont par nature immatérielle, pour se saisir de l'objet connecté, qui est lui par nature matériel.
La Régulation prendra alors pour objet une mise en norme des objets eux-mêmes, l'imposition de normes techniques homogènes et émises ou admises par le Régulateur, etc.
S'il en est ainsi, l'interrégulation se fait par "contraction", du fait de l'objet physique qu'est principalement le téléphone portable. C'est alors à première vue le Régulateur des communications électroniques qui a vocation à exprimer cette interrégulation.L'on en reviendrait aux premiers temps de la Régulation, ce que l'on pourrait appeler le "temps des ingénieurs" où chaque objet corporel technique (le train, le téléphone, etc.) appelle une régulation propre, façonnerait la régulation. Ainsi, paradoxalement, le numérique, royaume de l'immatériel, du fait que la convergence dans un objet à corporéité qu'est le téléphone portable, déclencherait un retour en arrière dans la conception de la Régulation, l'offrant au Régulateur du téléphone, puisque désormais "tout est dans notre téléphone", y compris donc la Régulation de tout.
Pourtant lorsqu'on observe l'interrégulation la plus avancée, à savoir la e-santé aux États-Unis, l'évolution a été différente. Plutôt que de confier cette régulation à la Federal Communication Commission (FCC), le Législateur fédéral a choisi de convier cette régulation aux Régulateurs de la santé. Pour cela, il a fallu mais il a suffit de qualifier les logiciels qui permettent les connections de "produit de santé". On mesure ici à quel point la souplesse de la technique juridique de qualification peut servir des choix politiques. De la même façon, il ne semble pas que le Régulateur des communications électroniques ait vocation à réguler les activités bancaires et financières. Si les entreprises de téléphonie elles-mêmes se mettent à se déployer sur des activités régulés, par exemple bancaires!footnote-378, cela n'est pas forcément une raison pour concentrer la Régulation elle-même, car l'objet connecté n'est lui-même que le moyen d'accès à un "espace de convergence de données", lequel mérite seul un mécanisme d'interrégulation.
2. L'interrégulation des espaces clos de convergence des données sur Internet
Au regard de la régulation, Internet est un espace très nouveau, notamment pour deux raisons. Il est à la fois moins que le marché et plus que le marché.
Il est "moins que le marché", non pas parce qu'il serait gratuit, car le gratuit est un faux-semblant sur Internet!footnote-308, les internautes apportant précisant leurs "données" en échange de la satisfaction de leur désir, ce qui est la forme classique de l'échange intéressé, lequel est la marque de l'économie. Mais le marché libéral est "autorégulé" en ce qu'il met en masse les offres et les demandes, ce qui produit un équilibre et génère un prix admissible, les agents économiques à l'instant suivant prenant le prix de marché et choisissant les prestations disponibles. C'est donc la mécanique du marché qui fixe les prix, qui assure l'information et fait circuler les produits, etc. Ainsi, le marché est l'intermédiateur (certes "invisible") entre les parties, glissé dans toutes les opérations des marchés ordinaires de biens et services. Lorsque les marchés sont régulés, ils cessent d'être autorégulés, d'être régulés de cette manière invisible!footnote-473 et automatique : les régulateurs apparaissent et un appareillage, notamment sous la forme d'une réglementation ex ante , vient pour organiser les opérations.
L'espace d'Internet est "moins que le marché" parce que ce mécanisme d'autorégulation peut en être éjecté. Par une fusion entre les offreurs et les demandeurs et le mécanisme de ce qui est désigné comme "l'économie coopérative", les agents se dispensent du coût du marché, les deux acteurs intéressés échangeant directement deux services (une information contre une information, comme peut l'être l'échange d'une donnée personnelle contre une voie d'accès à des sites, par exemple) ou convergeant vers une utilité commune (covoiturage, par exemple). Le prix, qui n'est lui-même qu'une information, n'est plus alors nécessaire, puisque la neutralisation par le marché n'est plus requise, l'échange se faisant directement. Le fonctionnement est efficace par son archaïsme même, puisque la mise en masse des transactions est obtenue sans avoir recouru à la neutralisation des termes des échanges. Il s'agit donc d'une économie anté-marché, face à laquelle le droit de la concurrence, qui postule l'idée de marché, est pris au dépourvu, a pensée magique étant à l’œuvre, notamment la conception des machines comme nouveaux tiers de confiance (par exemple dans le mécanisme des blockchains).
Ainsi, comment interpréter la condamnation d'Uber pop ? En effet, une des victimes d'un tel système qui tient sa performance dans le fait qu'il est "moins que le marché" est l'État. Dans la mesure où il y a transfert d'argent, il y a prélèvement par l'État au profit du groupe social. Une régression par l'échange brut entre des lapins et des carpes permet de priver l'État de sa part et à travers sa fonction redistributive, le groupe social. Les tenants de la Corporate social responsability ne change rien à ce constat, un agent économique ordinaire contribuant au bien collectif en payant ses impôts et non pas en menant telle ou telle action sociétale qui lui agrée!footnote-309.
Par ailleurs, les comportements "coopératifs" consistent à s'éduquer entre soi, à s'héberger entre soi sans se soumettre aux normes de sécurité, etc., sont des comportements infra-marchés qui sont des comportements néanmoins économiques, intéressés et organisés à grande échelle par le biais des plateformes. En effet, les personnes qui échangent leurs appartements ou voyagent ensemble ne sont pas liés par des liens affectifs mais sont unis par une fonction d'utilité communs et maximalisent leur intérêt particulier respectif, ce qui fait un "intérêt commun" au sens de l'article 1832 du Code civil!footnote-310 . Désormais, les contrats-échanges font place aux actes conjonctifs!footnote-311 qui quittent la seule catégorie des contrats-organisation pour se développer sur les espaces d'échange.
Mais ces actes conjonctifs qui s'opèrent dans des espaces qui sont "moins que le marché" ne sont techniquement possibles que par l'existence technique des plateforme : il faut bien qu'existent des espaces de convergence pour que ces actes conjonctifs remplaçant par leur archaïsme ingénieux s'opèrent. La régulation des plateformes est un sujet à part entière. On peut l'aborder de plusieurs façon, soit en proposant de développer des exigences directement sur les algorithmes qui permettent au gestionnaire des plateformes de les faire fonctionner!footnote-312 ou bien proposer de réguler ces entreprises "cruciales"!footnote-313, ou bien les insérer dans un dispositif mondial de protection des effets potentiellement nocifs de la disponibilité des données, ce qu'a fait la CJUE par son arrêt du 6 octobre 2015!footnote-379.
III. LE RÔLE DE LA PERSONNE « CONCERNÉE »
Les activités numériques tendent à réifier les personnes, puisque celles-ci sont découpées en données consommées par d'autres, dans une nouvelle forme de la « personne-objet »!footnote-307, ainsi pulvérisée. Elle l’est encore en tant qu’Internet la promène en consommateur d’informations, « machine désirante »!footnote-297 adéquate à un pur comportement marchand à la fois individuel et répété à l’identique, à travers notamment les « clics » et les « like" . Elle l’est finalement en ce qu’elle produit elle-même des informations sur elle-même et sur autrui. L'économie numérique est avant tout cannibale, les recherches sur les moteurs de recherche portant avant tout sur soi-même.
Dans le même temps, Internet redonne à la personne la liberté qu’elle lui prend, prolongeant en cela l'économie de l'information dans laquelle la personne qui consomme de l'information participe à la production de celle-ci et à l'accroissement du bien public global que l'information constitue!footnote-314. L'attention que la personne peut porter à une information devient elle-même un objet marchand mais constitue aussi un bien public, à tel point que l'on a pu évoquer la constitution dans "l'ère numérique" d'une "cité attentionnelle"!footnote-345.
Pour que la personne maîtrise la donnée qui s'est détachée d'elle, la solution régulatoire du système consiste à l'instituer régulateur à travers la technique du consentement. Cette conception très libérale paraît pourtant illusoire, voire perverse (A). En revanche, ce qu'il est présenté par rhétorique comme un "droit à l'oubli" est un maniement du temps, marque de la régulation, qui justifie une prise en charge de cette fonction par un organe plus approprié que l'internaute (B).
A. LA RÉGULATION ILLUSOIRE, VOIRE PERVERSE, PAR LE CONSENTEMENT
On affirme souvent que la solution est trouvée : dans cette aire de liberté que constitue le numérique, c'est l'individu qui va créer par son seul consentement les équilibres (1). Mais cette régulation par la puissance du consentement de l'Internaute est illusoire, voire perverse (2). Ce n'est pas dire que l'Internaute n'ait aucun rôle à jouer car il peut venir en soutien des Régulateurs, des juges et des Législateurs (3).
1. La personne érigée en "Grand Interrégulateur" par la puissance de son consentement
Intervient ici l'articulation entre l'informatique et le numérique. S'il est vrai qu'Internet est un réseau informatique mondial constitué d'un ensemble de réseaux nationaux, régionaux et privés, dont la connexion générale (web) repose sur l'usage d'un même protocole de communication!footnote-332, il a engendré un espace numérique, lequel serait peut-être la base d'une nouvelle "ère"!footnote-346, d'une nouvelle "cité"!footnote-347, d'une nouvelle "civilisation"!footnote-348. L'évolution technique aurait ainsi réglé les problèmes qu'elle a engendrés. En effet, face à la puissance informatique, la personne est en dépendance et en défense!footnote-333, mais dans l'espace numérique, la personne transformée en "internaute" est devenue l'acteur, l'observateur et le créateur premier !footnote-344.
C'est pourquoi dans un espace numérique où les régulations ont du mal à s'ajuster, il est parfois affirmé qu'une solution libérale et néanmoins respectueuse des individus consiste à confier à celui-ci le soin de veiller à ses intérêts en l'armant de nouveaux droits, ce qui va créer les équilibres généraux du système sans entamer le dynamisme de l'ensemble. Il faudrait mais il suffirait que la personne soit informée des règles générales du jeu, qu'elle connaisse sa situation particulière et qu'elle exprime son accord. En effet, dès l'instant qu'il lui est loisible de sortir de l'espace numérique, que chacun est libre de ne pas entrer dans les différents espaces numériques, qu'il est techniquement possible de ne pas y laisser trace de ses données, c'est en consentant librement à donner en échange des informations accroissant un bien public que la personne, tirant profit d'un système qu'elle alimente à la mesure de ses propre intérêt, régule elle-même Internet.
Ainsi, il ne serait pas besoin de se poser la question d'une régulation exogène et encore moins celle de l'interrégulation, puisque c'est l'utilisateur lui-même qui devrait être le "Grand Interrégulateur", sachant ce qu'il fait et tient dans sa main un système dont il constitue la richesse et qui dépend donc de lui.
C'est pourquoi son consentement est sans cesse requis. Il lui suffit donc par un clic de tout refuser, sans qu'il ne lui en coûte rien. Il ne serait plus besoin de rechercher un ou des Régulateurs, c'est chaque internaute qui serait chacun en ce qui le concerne le "Grand Interrégulateur" d'Internet.
Messieurs les Censeurs, hors du monde de la liberté qu'est enfin Internet !
2. L'illusion et la perversité d'une régulation par le consentement
Internet fonctionne selon le modèle du "marché pur"!footnote-334, en ce qu'il renverrait à l'autosuffisance du consentement de l'Internaute, qu'il suffirait donc d'informer et dont il faudrait seulement par précaution conserver trace du consentement. Les marchés mondiaux s'appuient effectivement sur le consentement de ceux qui y figurent. De ces consentements des milliards de fois recueillis sur des millions de tête, l'on en conclut alors que la volonté libre des personnes a été respectée et qu'un monde d'adultes s'ouvre enfin. Internet est l'espace où le rêve rousseauiste des personnes, êtres solitaires et libres peuvent s'exprimer et échanger.
Mais le consentement n'est pas toujours la preuve de l'exercice d'une liberté pleine et entière qui en rencontre une autre, ces deux libertés s'aliénant efficacement par l'échange des consentements!footnote-335. S'il est vrai qu'il existe des échanges de consentements entre Internautes à travers le commerce électronique, lequel est par ailleurs l'objet de règles spécifiques, cette régulation par le consentement vise ici les rapports entre les Internautes d'une part et ce qu'il convient d'appeler les "Maîtres du Numérique", d'autre part, qui sont les entreprises tenant le système même du Net et de l'espace sur lesquels les rencontres se font (plateformes), les accès s'organisent (moteurs de recherche), les informations s'accumulent.
En effet, dans cet espace anté-marché sur lequel beaucoup d'opérations relèvent d'actes juridiques conjonctifs!footnote-336, les Internautes se retrouvent pour satisfaire leurs désirs réciproques en s'allégeant du coût d'intermédiations, y compris parfois celle de la monnaie!footnote-380, grâce à des entreprises de plateforme, les internautes ayant accès à ce qu'ils recherchent grâce à des moteurs, les mêmes entreprises qui tiennent les moteurs achetant des plateformes et réciproquement. Ainsi, le 9 octobre 2006 Youtube était acheté par Google pour 1,65 milliards $, l'acquisition se faisant par le biais d''une création d'actions, c'est-à-dire de titres immatériels de capital dont la valeur tient dans la confiance que le marché fait à Google. En l'espèce, elle est totale. Sur Youtube, tout est gratuit et ce sont les consommateurs eux-mêmes qui apportent en échange la richesse, à savoir l'information sur leur préférence et leur "attention", reconstruites par l'entreprise qui tient l'espace et guide leurs pas.
Dans ce système médiéval!footnote-338 de liens entre des maîtres vers lesquels convergent les utilisateurs, ce sont les maîtres qui posent les conditions d'usage, par des conditions générales, chartes et autres engagements ou Code de conduite. S'il y a "consentement", il se fait donc non pas par échanges mais par adhésion à ces actes unilatéraux. Le droit admet de plus en plus ce type de convergences de volonté, l'un émettant la norme commune, qui vaut cadre pour le groupe, tandis que les autres y adhèrent, le Droit laissant désormais faire tandis qu'il y a pas d'abus. L'on a pu parler d' "acte réglementaire privé"!footnote-451 et la notion juridique de "acte d'adhésion" est plus que jamais adéquate. Le consentement de l'Internaute, sous cette forme positive d'adhésion!footnote-339 suppose que le maître de l'Internet veille lui-même sur les intérêts de l'Internaute. On peut le croire, pourquoi pas ? Maintenant que l'on sourit lors qu’est évoqué le thème de la bénévolence de l'État, puisque l'on ne veut croire que cet organisme recherche notre bien, l'on semble accorder grand crédit à ce souci exprimé par des entreprises.
Pourquoi pas, chaque période a ses aveuglements. A tout le moins, cette situation de dépendance vis-à-vis d'un maître que l'on dira bienveillant interdit en tout état de cause de poser que la personne dépendante est le Régulateur du système. Les signataires de l'accord entre l'Europe et les États-Unis, dit Safe Harbor, permettant aux entreprises de transférer les données des personnes utilisant leurs services, ont estimé que l'internaute était le gardien suffisant de ses propres intérêts et que l'attention de toutes ses vigilances particulières suffisaient à garantir l'intérêt de tous, ce qui correspond à la définition de l'intérêt général pour un anglo-saxon, qui n'y voit que l'addition de la satisfaction de chaque intérêt particulier.
Mais, tandis que le droit de la concurrence réagit aux comportements de pouvoir sur les marchés, le droit de la régulation traite de la dominance. Or, l'Internaute est dépendante des grandes entreprises qui tiennent les accès dans un espace numérique où l'essentiel des prestations est l'accès!footnote-340. Il est inconcevable que la régulation de la dominance soit exercée par ceux qui sont dépendants de celle-ci. C'est pourquoi un Internaute a mis en doute ce raisonnement qui suppose soit la bénévolence des "maîtres du numérique", soit l'activisme de l'Internaute : la décision de la CJUE du 6 octobre 2015 a posé qu'un tel transfert de données européennes aux États-Unis sans garantie que celles-ci ne pourraient pas être utilisées sans porter éventuellement atteinte aux droits fondamentaux des personnes par des puissances américaines étaient contraires au droit européen. A travers cette sanction, l'on mesure que l'Internaute a un pouvoir essentiel, celui de saisir un juge, ici par le biais d'une question préjudicielle, et que celui-ci a le pouvoir de briser les accords dans lesquelles les entreprises et les États ont pesé de tous les poids.
L'alliance entre l'Internaute et le Régulateur peut se faire dans l'autre sens. Ainsi, en Belgique la Commission de la protection de la vie privée (CPVP) a obtenu du internet/facebook-ne-pourra-plus-espionner-les-belges-09-11-2015-1980400_47.php">Juge des Référés de Tribunal de Grande Instance de Bruxelles la condamnation sous astreinte de FaceBook par une ordonnance du 9 novembre 2015 d'avoir sous astreinte à obtenir le consentement des personnes qui visitent son système. Cela ne vaut pourtant pas pour les Internautes inscrites, dont le consentement est présumé donné et dont on pourrait dire qu'elles subissent de leur plein gré le mécanisme de cookies, mais des simples visiteurs, auxquels information et demande de consentement exprès devra désormais adressées par le maître des lieux.
On mesure ainsi que l'Internaute n'est pas le seul à jouer un rôle car affirmer cela c'est en réalité offrir l'espace numérique aux seules entreprises, mais qu'il trouve sa place en alliance avec le Régulateur et le Juge. Cela est d'autant plus vrai dans un système où chacun et tous s'observe. Dans la mesure où le numérique a brisé avec l’homogénéité des "mondes"!footnote-341, et avec elle avec le mécanisme de l'auto-observation, puisque sur le Net tout le monde regarde tout le monde sans filtre et recevabilité ni sanction, le numérique est plutôt l'espace de l'inter-observation : nul n'est pas l'abri des regards et il y a moins d'entre-soi. Dès lors, si l'interrégulation ne peut être assurée par l'Internaute lui-même, puisqu'il est dépendant du système et des maîtres de celui-ci, l'Internaute peut néanmoins jouer un rôle en venant en "soutien" des Régulateurs.
3. L'hypothèse de l'Internaute comme soutien des Régulateurs et des Juges
En effet, la distorsion de puissance entre les Internautes et les maîtres de l'espace numérique est si grande que l'on ne peut même parler de "co-régulation". Mais les Internautes peuvent être actifs auprès des Régulateurs.
Ainsi, les Internautes sont de plus en plus encouragés à apporter des informations aux différents Régulateurs. Puisque les Internautes regardent tout, visionnent tout, retrouvent tout, ils peuvent apporter ces informations aux Régulateurs. Ce que l'on désigne pudiquement comme le Whistleblow permettant à tout un chacun de dénoncer par e-mail l'auteur d'un possible manquement est un mécanisme utilisé pour alimenter les Régulateurs en information.
La jurisprudence a déjà eu à connaître du choc que peut prendre un tel pouvoir de délation lorsqu'il se traduit en obligation d'information, notamment en application de la loi Sarbanes-Oxley, mais trouve ses limites en butant sur le droit européen lorsque la transmission se traduit par une violation du droit à préserver la titularité des données à caractère personnelle.
L'arrêt précité de la CJUE du 6 octobre 2015 anéantissant l'autorisation par un accord général entre l'Europe et les États-Unis permettant aux entreprises américaines de stocker aux Etats-Unis les données personnelles collectées en Europe, redonne le pouvoir place aux accords particuliers entre les États d'une part (traités bilélatéraux) et les accords privés, les internautes, les internautes consentants à de tels transferts. dispositifs de concentrations des données à des fins de sécurité (safe harbor), mais aussi sans doute de puissance économique des entreprises américaines, redonnant aux États le soin de protéger les citoyens nationaux à travers la non-transmission de leurs données à caractère personnel montre que la tension est très forte entre les finalités. Cela est sous-tendu par des conflits de domination car l'Europe a intérêt à protéger sa puissance par une régulation de la vie privée qui conduit à ne pas transmettre aux États-Unis, tandis que ceux-ci ont intérêt à protéger la leur par une régulation de la sécurité publique.
Mais même en affirmant dans cette discussion la primauté de la protection des individus, cela ne cantonne pas pour autant le Régulateur à sa fonction traditionnelle. En effet, notamment par cet arrêt du 6 octobre 2015, le juge européen semble mettre en jeu la protection de l'individu à travers le droit des données mais cela ne réduit pas pour autant le Régulateur des données personnelles à sa fonction initiale de protection de l'individu contre la puissance des personnes à constituer des fichiers contre l'informatique. En effet, parce que l'espace numérique est le passage vers un espace où l'Internaute est actif et s'exprime, ce Régulateur entend suivre ce mouvement par ce que l'on pourrait appeler un effet de nature.
En effet, le Régulateur considère qu'en tant que protecteur de l'individu, il peut intervenir non seulement au titre de l'hypothèse initiale à savoir la mise en danger de l'individu dans ses libertés et dans sa dignité du fait de la puissance informatique, mais encore au titre de sa mise en danger dans ses libertés et dans sa dignité du fait de tout autre comportement, notamment du fait de l'exercice de la liberté d'expression. En effet, de la même façon que les droits de l'homme peuvent exprimer une prérogative face à des pouvoirs non-étatiques, la dignité de l'individu doit être protégée au regard de ce que l'on en dit dans l'espace numérique, l'informatique n'étant alors qu'un cas du principe plus général que le Régulateur doit servir : il devient alors le "Régulateur des libertés publiques dans l'espace numérique".
L'Internaute est ainsi la personne protégée par le Régulateur, qu'il s'agisse de son lien de titularité à l'égard des données qui le concernent ou de ce qui est dit par quiconque à son propos. Mais lui-même vient en soutien des Régulateurs. Non seulement par l'apport d'information mais encore en tant qu'il est celui qui accrédite ou discrédite les entreprises de l'économie digitale. Ainsi, s'il est vrai que le plafond posé par les textes de la sanction par la CNIL de Google de 150.000 euros a pu faire sourire, la mention de cette condamnation sur la page d'accueil du moteur de recherche a frappé davantage l'opérateur : ce sont les badauds qui rendent la technique du pilori efficace.
B. LA RÉGULATION EFFECTIVE, SOUS L'APPELLATION RHÉTORIQUE DU "DROIT A L'OUBLI" ET LA PERSPECTIVE D'UN CARQUOIS DE DROITS SUBJECTIFS UNILATÉRAUX
Le "droit à l'oubli" est une invention extraordinaire du Droit, qui se révèle très efficace (1). C'est une voie très prometteuse pour que, par la puissance du maniement des données les entreprises ne peuvent pas s'approprier le futur (2).
1. Originalité et efficacité du « droit à l’oubli »
Le "droit à l'oubli" est une invention juridique. Les "droit à ..." sont une catégorie juridique nouvelle des droits fondamentaux!footnote-382. Il a pris la suite du "droit de retrait", tel que la loi française Informatique et libertés de 1978 l'avait mis en place, permettant à celui sur lequel l'information porte de faire retirer l'information qui le concerne du fichier. Le droit à la portabilité est son petit frère, d’autres viendront. Ils constituent l’alternative à l’idée malheureuse de droit de propriété.
Ce changement de vocabulaire est en effet une manœuvre rhétorique pour armer les personnes d'un pouvoir juridique considérable : effacer ce qui a été, alors qu'Internet se caractérise par sa mémoire absolue. Le Droit développe sa puissance par rapport à la réalité en faisant que ce qui a existé est "comme si" cela n'avait pas existé puisque ce dont l'on se souvient de fait l'on ne peut s'en souvenir de droit.
Cela relève du mécanisme de la "fiction juridique", ce par quoi le Droit montre sa domination sur le monde puisqu'il le reconstruit en lui injectant sa réalité, alors même que celle-ci est contraire. Il est traditionnel d'affirmer que seul le Législateur est légitime à créer des fictions juridiques car le juge ou les personnes ordinaires que nous sommes ne peuvent que constater la réalité ou en créer qui ne soient à tout le moins pas contraires à celle-ci;
Pourtant le "droit à l'oubli" consiste pour une personne ordinaire à imposer à une autre le fait de ne plus savoir quelque chose qu'elle sait à propos d'elle : c'est une fiction. C'est une réalité nouvelle injectée dans le monde, par le seul imperium du droit, maniée par une personne ordinaire qui retire du présent un élément de fait qui était dans le monde passé, ce que personne de fait ne peut faire. C'est pourquoi ce que, par le biais d'un droit subjectif, désormais un individu peut faire et l'imposer à un autre.
Ainsi, rien n'est plus puissant que le "droit à l'oubli", puisqu'il imposer de "ne plus savoir ce que l'on sait", comme la prescription interdit de demander des comptes pour ce qui est pourtant répréhensible. C'est exprimer la force pure du Droit. Cette puissance a bien été repérée, puisque par exemple le Législateur vient de conférer un "droit à l'oubli" pour les personnes qui ont eu un cancer : il s'agit en réalité de leur permettre d'imposer aux compagnies d'assurer de "ne pas savoir ce qu'elles savent".
Il s'agit donc d'un "droit subjectif extraordinaire", puisqu'une personne peut obtenir ce qui est impossible et que seul le Législateur peut traditionnellement produire : une fiction qui réécrit le passé et fait que ce qui a existé n'existe plus, puisque la connaissance que nous avons du monde fait le monde. En cela, le Législateur a donc cédé son pouvoir, son imperium aux personnes ordinaires. En passant du "droit de retrait" au "droit à l'oubli", le système juridique a opéré un changement radical.
Pourquoi ?
Parce que le Législateur a sans doute considéré qu'en l'état la loi nationale, générale et abstraite est faible face aux maîtres des données numériques. "Réguler Google", écrire la "Google Lex", l'on peut y songer. Pour l'instant, il semble que les États quémandent un peu d'argent, soit à travers des impôts, soit à travers des aides directement versées à des secteurs mendiants. Le plus efficace est de transférer aux individus eux-mêmes le pouvoir de fiction consistant à ce que l'information dont les entreprises qui construisent les machines de données puissent leur être retirée. C'est l'effet du "droit à l'oubli".
Nous sommes alors dans le royaume des "comme si", c'est-à-dire des fictions. De la même façon que les entreprises du numériques sont "comme" des propriétaires de l'information, les internautes sont "comme" des maîtres de la mémoire", pouvant à volonté faire passer le marchand de sable et obliger les moteurs à dormir. Comme dans un mikado, il suffit qu'un nombre suffisant de petites épines se retirent du système pour que la machine marche moins bien. C'est pour cela que le Législateur a armé l'individu de ce "droit", qui n'est qu'une "nuisance" dirigée contre l'entreprise qui construit son empire sur le matériau de l'information.
L'Internaute, comme mouche du coche, pourquoi pas ? C'est bien le statut de l'administré dans le mécanisme du Recours pour excès de pouvoir. Il faut bien quelques internautes mal-lunés, voire névrotiques, pour que l’État de droit soit rétabli. Ainsi, pour reprendre le cas Safe Harbor, Monsieur Maximillian Schrems était un justiciable particulièrement hargneux!footnote-383.
Cela peut contribuer à préserver ce qui est le véritable enjeu d'un "monde repensé à travers la notion de donnée" : la préservation d'un futur ouvert".
2. La préservation d’un futur ouvert
La question brutale et pertinente est posée : Who Owns the Future ?!footnote-453L'alliance entre les avancées technologiques, par exemple l'informatique cognitive, et les business plans d'entreprises comme Google, font penser que la valeur des données tient avant tout dans le fait qu'elle donne l'image du "monde de demain", n'en déplaisent aux nostalgiques du "Monde d'hier".
Si l'on reprend une nouvelle fois l'exemple des données comptables, celles-ci sont désormais des données financières (IFRS) et ont pour objet (c'est-à-dire pour but) de fournir la réalité future de l'entreprise à propos de laquelle elles ont été construite, selon le modèle de la "comptabilité prédictive". Si l'on prend le domaine de la santé, et de citer le diction "il faut mieux prévenir que guérir", il s'agit de connaître l'état futur de la personne en collectant les données de sa famille pour identifiant ses problèmes futurs. Si l'on prend le domaine de la sécurité, dans le souvenir des théories de la défense sociale, il s'agit de repérer les foyers de dangerosité, de renforcer là où il y a risque - raisonnement qui a conduit les États-Unis à méconnaitre le droit européen. L'on peut encore prendre les domaines bancaire, financier, etc. : c'est le future qui a la plus grande valeur et l'entreprise qui peut vendre la connaissance du futur au-delà des simples probabilités, en resserrant le calcul à l'individu ou à l'entreprise ou au pays ("risque souverain") fait fortune.
L'on a beaucoup écrit sur la tension entre la liberté et la contrainte, sur le caractère autoréalisateur des prédictions, sur le caractère totalitaire des normes lorsqu'elles s'individualisent. On se contentera ici de rappeler que laisser les données entièrement disponibles à des puissances, quand même celles-ci ne recherchent que leur profit, voire que le bien commun, quand bien même ces informations sont gracieusement apportées par ceux qui cela concerne, peut fermer le futur. En effet, un futur déjà écrit n'est plus que le présent. Il n'y aurait plus de futur car si toutes les informations du futur deviennent par le calcul disponibles, le futur se ferme et il n'existe de véritable futur pour un être humain libre qu'ouvert.
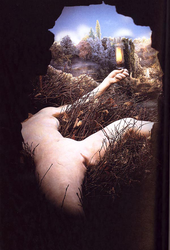

votre commentaire